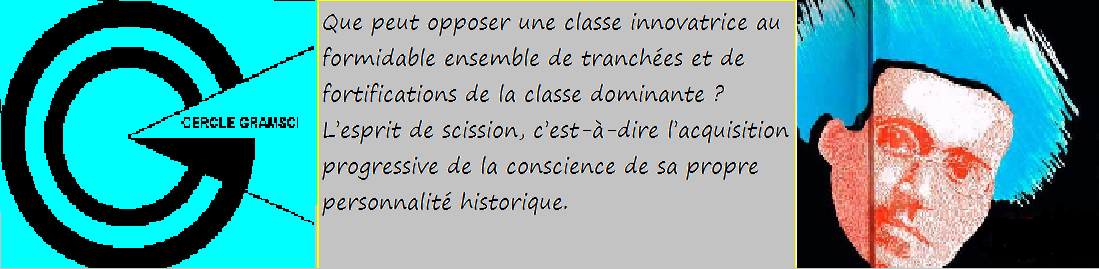Avec l ‘écrivaine Laurence Biberfeld
La prostitution est à la croisée de plusieurs oppressions liées aux inégalités de genre, de sexe, de classe, de race. C’est un sujet on ne peut plus intersectionnel et en traiter permet de traiter des champs beaucoup plus larges. Ce n’est pas qu’un régime sexuel qui traverse les siècles en société patriarcale en trouvant toujours le moyen de muer très souplement avec les formes de société. La prostitution pose aussi, à travers les âges, la question du rapport au corps. Le système prostitutionnel est un de ceux où il est le plus capital de séparer le corps de la personne, et c’est aussi le cas de la GPA. De la dissociation religieuse entre l’âme immortelle et le corps mortel au rationalisme qui fait du corps une simple machine au service de l’esprit, cette dissociation entre le corps et la personne permet, de fait, l’exploitation des corps pour lesquels on ne ressent pas d’empathie ni d’altérité. Des esclaves Aristote dit que ce sont des outils animés. Il en est de même des bêtes, des végétaux, mais aussi des femmes, versées dans la réserve générale des êtres dont on peut disposer. Elles sont réduites à leur corps, et leur corps est de ces outils animés dont on dispose. Le rapport que l’humanité patriarcale entretient avec le reste du vivant n’est pas différent. Le vivant, comme le corps qui représente le vivant en nous, est avant tout une ressource à disposition, qu’on jugera non sur la valeur absolue de son existence et donc de son expérience singulière, mais en fonction de l’usage qu’on peut en faire et des profits qu’on peut en tirer. A contrario, rendre une épaisseur existentielle tant au corps humain, au corps des femmes, qu’au reste du vivant serait peut-être un premier pas hors du patriarcat.
Laurence Biberfeld LE CORPS DES FEMMES, OBJET MARCHAND ?
(Exposé)
Alain Daubigny : introduction
Lorsque Solange, de l’excellente revue Casse-Rôles, a suggéré au cercle Gramsci de co-organiser un débat avec Laurence Biberfeld sur la marchandisation du corps des femmes, nous avons tout de suite dit oui. Au cercle Gramsci, nous nous efforçons depuis des années, à l’aide de multiples intervenants et intervenantes, de décortiquer les mécanismes de la domination économique et sociale. Le capitalisme, c’est évidemment la marchandisation des corps et des esprits de tous ceux et toutes celles qui n’ont que leur force physique et intellectuelle à échanger contre un revenu. C’est aussi le plus souvent un rapport de soumission à celui qui possède les outils de production et continue de s’enrichir sur le dos des travailleurs et travailleuses : le patron. Du patronat au patriarcat, il n’y a qu’un pas. La domination masculine dans la famille et dans les institutions est bien antérieure au capitalisme, mais elle est aussi un des piliers qui a servi à le construire. Le point crucial de la jonction entre le capitalisme et la domination masculine, c’est la marchandisation des corps sexués et évidemment en premier lieu du corps des femmes, que ce soit à travers la pornographie, la prostitution, ou maintenant la Gestation Pour Autrui (GPA). Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Laurence Biberfeld, ancienne enseignante, écrivaine de romans noirs et dessinatrice. Elle collabore depuis plusieurs années à Creuse Citron et à Casse-Rôles. En 2016, elle a publié Le plus vieux métier du monde, qu’ils disent, aux Éditions Libertaires. Cette année, elle a été la principale rédactrice du numéro hors-série de Casse-Rôles sur la prostitution.
Laurence Biberfeld
Plus je réfléchis sur le lien entre le capitalisme et le patriarcat , plus je tombe d’accord avec Françoise d’Eaubonne : le mercantilisme, puis le capitalisme sont vraiment des stades du patriarcat, des évolutions du patriarcat.
Je vais partir de la prostitution, qui est intimement liée au patriarcat. C’est un régime sexuel qui est en vigueur dans les patriarcats grecs et romains, très dur à l’origine. À ce moment-là, ce n’est pas du tout un invariant pour les autres sociétés. La prostitution n’existe pas en Égypte ancienne. Si elle va exister de manière massive à l’époque de Cléopâtre (vers 50 av. J.C.), c’est parce que la Haute Égypte, à cette époque, était sous colonisation grecque (ptolémaïque). La prostitution n’existe pas chez les Étrusques, ni chez les Celtes et les Vikings. Elle n’existe pas dans ces sociétés où les femmes sont dotées de droits. Dans toutes ces sociétés, il y a quand même un clivage très net entre les rôles, mais les femmes ont des droits, le mieux étudié étant le droit matrimonial. Là, on s’aperçoit que les femmes peuvent choisir leurs époux, s’en séparer, qu’elles ont des biens propres. Elles ont une autonomie très claire dans la société de ces cultures. Dans le monde grec, pendant l’époque archaïque et pendant l’époque classique, il y a une exception : Sparte, où il n’y pas de prostitution. Les femmes jouissent d’un statut qui n’a aucun équivalent dans le monde grec. Leurs droits, leur autonomie, sont très étendus. Par ailleurs, c’est une société très guerrière. On peut d’ailleurs y voir des femmes « à poil » s’entraîner à la lutte, à la course. Si on les entraîne militairement, elles n’ont cependant pas du tout le même rôle que les garçons. Les filles restent avec leur mère, alors que les petits garçons dès l’âge de sept ans vont dans le monde des hommes et sont entraînés à être des guerriers. Les femmes doivent être des mères, mais il n’y a pas d’inégalité aussi violente et de subordination aussi totale que dans le reste du monde grec et dans le monde latin.
En terre patriarcale, le régime sexuel va tout particulièrement exprimer la domination masculine et la perpétuer par le biais des relations sexuelles avec les femmes. Celles-ci n’ont aucun droit et sont totalement subordonnées, même lorsqu’elles sont « citoyennes » athéniennes ou romaines. Elles font à peine partie de l’espèce humaine, civilement. Cela se traduit par une prostitution massive. La plus ancienne mention de la prostitution est relative aux bordels institués par Solon à Athènes au VIe siècle av. J.C., les « dictérions », bordels très bon marché où l’on ne trouvait que des esclaves. Le prix y était très bas afin que tout homme puisse avoir accès au sexe. C’était un droit. Le premier droit des hommes était celui d’exprimer leur domination par la sexualité. Dans les sociétés patriarcales, la prostitution est massive, très bien tolérée, bienvenue.
En même temps, il existe un mariage confiscatoire extrêmement dur qui fait que chez les Grecs c’était compliqué de se marier avant trente ans. Il y avait ainsi des hordes de gens prêts à violer les esclaves des autres, à produire des bâtards partout, voire à provoquer l’adultère, etc. Dans les sociétés patriarcales, l’adultère est généralement puni avec un extrême férocité, particulièrement pour les femmes. Un homme qui trouve quelqu’un dans le lit de sa femme est à la limite autorisé à la tuer. Le régime sexuel en société patriarcale, c’est la domination réitérée, confirmée perpétuellement de façon physique, une domination qu’on ancre dans les corps par la pratique de la prostitution, du devoir conjugal, de la subordination de la femme. On l’ancre aussi par le harcèlement, par l’inceste, par le viol, par le contrôle extrêmement dur de la sexualité des femmes.
De façon un peu large, on peut définir le patriarcat comme une société de droit masculin. Ce n’est pas seulement le droit de la peur exercée sur les femmes, sur les enfants et sur les autres hommes ; c’est aussi le droit de tous les hommes sur les femmes, un droit qui s’exprime sexuellement et qui, dans les sociétés grecque et latine, va poser l’homme dominant comme homme pénétrant. L’homme qui pénètre est noble, quoi qu’il pénètre : enfant, femme, jeune homme, travesti. En revanche, la personne pénétrée est vile, méprisée. Cette domination va se traduire par un statut sexuel qui est celui de pouvoir disposer des corps et les pénétrer.
La prostitution comme institution, comme régime massif de sexualité va traverser des sociétés très différentes qui ont toutes en commun d’être patriarcales, viriarcales, d’être des sociétés masculinistes. On part de sociétés (grecque, romaine) qui, au départ, sont assez rationnelles, très ancrées sur l’observation scientifique, quand bien même on y rencontre le polythéisme. Mais très tôt on va avoir affaire en leur sein à un phénomène caractéristique du patriarcat : celui de dissociation entre le corps (la matière) considéré comme quelque chose d’assez grossier, d’assez menteur, d’assez impur, et l’esprit, qui est de l’ordre de la pureté, de l’essence, de la clarté, des chiffres, des lignes droites, de la perfection. Cette conception est illustrée par le mythe de la caverne de Platon, métaphore présentant la réalité qui nous parvient comme procédant de l’immersion de nos sens dans une caverne obscure d’où l’on ne reçoit que des messages brouillés. Cette dissociation entre le corps et l’esprit va perdurer.
Vient ensuite le christianisme, pendant lequel le patriarcat va se concrétiser par une idéologie qui présente, d’une part, le corps sale, mortel, promis à la pourriture et, d’autre part, l’âme pure, immortelle. On retrouve toujours cette dissociation à la Renaissance. Il y a cette idée que ce sont uniquement les hommes qui jouissent d’une âme, d’un esprit, de quelque chose de décroché du corps et qui doit le conduire, s’en rendre maître, le dominer. Pendant très longtemps, on va se demander si les femmes ont une âme, un esprit. La réponse de la société patriarcale, c’est : non, elles n’en ont pas. Les femmes sont finalement versées du côté du corps, uniquement. Cela entraîne beaucoup de choses. D’abord, le rapport au corps. En société patriarcale, le corps et l’esprit sont deux choses distinctes : le corps est sans esprit et l’esprit est désincarné. Cela veut dire qu’il ne faut pas écouter tout ce qui est de l’ordre de la sensation, des émotions, des sentiments : le corps ment.
Le sens des mots va changer au cours des siècles. Par exemple, le mot « sentiment », pendant très longtemps (jusqu’aux XVIIe-XVIIIe siècles), veut simplement dire « connaître par la perception », avoir une interface avec le reste du vivant et avec l’univers. On voit, on sent, tout ce qu’on perçoit donne une connaissance. Mais cette connaissance va être complètement niée car LA connaissance, elle, ne peut être qu’abstraite (la théorie, le concept). On trouve déjà cette conception chez les pères de l’Église. Avec saint Paul, avec saint Augustin, le corps est considéré comme quelque chose de vil : les femmes ne sont que des corps.
Pendant l’Antiquité et le Moyen-âge, la prostitution est massive. Cependant, au début du Moyen-âge, des luttes existent au sein de l’institution chrétienne pour l’obtention de droits par les femmes, droits qu’elles vont perdre au fil des conciles. Cela va finir notamment par l’interdiction du mariage des prêtres. Pour ce qui est de la prostitution, une doctrine du moindre mal va apparaître. La prostitution sera seulement tolérée, mais l’Église peut la prendre en charge. Il n’est pas rare qu’une abbaye ait, en plus d’une ferme et d’un moulin, un bordel et une maison de bains. Les bordels sont parfois municipaux, dépendent d’un archevêché ou d’une abbaye. Avec la Renaissance, on revient aux principes antiques et à la rationalité. Le même message est répété : il y a le corps bourbeux, la matière, et il y a l’esprit. La science va définir les lois de ce qu’on va appeler la nature pour bien la séparer de l’humain. On a l’esprit humain d’un côté, et la nature de l’autre.
La prostitution a traversé les siècles, elle a tenu dans nos sociétés une place massive depuis l’Antiquité. Il y a eu cependant une interruption pendant la Renaissance, en raison de l’irruption du « mal de Naples », la syphilis, arrivée vers le XVe siècle en Europe. Les gens, effrayés par ce fléau, mouraient comme les mouches. La prostitution connut alors (aux XVe et XVIe siècles) une grande répression. Par la suite, on est entré dans des formes de réglementarisme qui tentaient tant bien que mal de la réguler. Aujourd’hui, on en est toujours là, même si les choses sont présentées avec des arguments presque opposés, comme un droit, une liberté, une possibilité d’émancipation. C’est extraordinaire de voir comment cette institution coutumière, ce régime sexuel, va continuer à prospérer à travers les siècles, en disant tout et son contraire.
Pendant très longtemps, le patriarcat n’est pas universel. Il le deviendra à partir des « Grandes découvertes », celle des Amériques, qu’on pourrait appeler les « grands carnages » car tout un pan de l’espèce humaine y sera massacré. Ces peuples, d’ailleurs, ne fonctionnaient pas forcément sur les présupposés patriarcaux.
La colonisation du continent américain représente un pillage de richesses sans précédent de millions de tonnes d’or, d’argent…. Il servira historiquement à l’accumulation des capitaux nécessaires à l’instauration du capitalisme, ce que l’économie politique marxiste nomme « l’accumulation primitive ». Ce « transfert » de richesses d’un continent à l’autre va permettre en retour la colonisation de tout le continent africain. Les sociétés qui n’étaient pas sur ce principe d’accumulation vont être, une par une, massacrées, détruites.
Cette société marchande (patriarcale-mercantiliste) est soutenue pendant longtemps par les royautés. Les grandes compagnies marchandes, comme la Compagnie des Indes, vont faire des conquêtes pour le compte des rois. Mais, à un moment, la bourgeoisie va s’émanciper et ce sera l’entrée dans le capitalisme pur. Là, il ne s’agit pas de richesse des nations mais de celle des grands entrepreneurs. On assiste alors à une une mutation du patriarcat, qui reste cependant dans son modèle et ses principes. D’autres formes de sociétés subsistent, y compris à l’intérieur de l’Occident, mais le patriarcat capitaliste est devenu une forme hégémonique dans le monde entier.
À notre époque, pour la prostitution comme pour la gestation pour autrui (GPA), le corps n’est qu’une machine biologique – Descartes disait que l’animal est une machine. L’esprit, qui domine ce corps, peut en être totalement dissocié. Ainsi, quand on va voir une prostituée, on ne va pas acheter une personne, mais le corps de cette personne. Et son corps, ce n’est pas elle. Il en est de même quand on loue un utérus. Il s’agirait seulement d’un usage pour un temps donné.
Cette dissociation est arrivée à un tel point que nous avons affaire à un principe universel : dissociation de l’humain du reste du vivant, dissociation à l’intérieur de l’humanité, dissociation de l’humain entre hommes et femmes, ou par le tri racial, etc.
Mais, petit à petit, une autre appréhension du corps apparaît. Une expression, « mon corps est à moi » laisse tout de même rêveur, car on ne peut pas dire : mon corps est à moi, comme l’est ma voiture. Si celle-ci brûle, je ne pourrais plus me déplacer ou je devrai en prendre une autre, mais si mon corps brûle mon existence s’arrête. On ne peut pas considérer le corps simplement comme une propriété ou comme un ensemble de propriétés au sens d’un ensemble de capacités. Le corps, c’est vraiment le siège de notre existence. Alors, comment arriver à se le réapproprier ?
Les femmes, qui n’ont jamais été vraiment intégrées à cette fameuse « humanité », restent des ressources du côté de l‘animalité dans le vivant. Pour ne plus voir le corps, particulièrement le corps des femmes, comme un objet marchand, il va falloir poser sur lui un regard vraiment différent. Et surtout essayer, en tant qu’humain, de se réintégrer, d’une certaine façon, dans le tissu du vivant. On en est quand même arrivé à un stade d’évolution des sociétés humaines que le directeur de l’ONU a appelé le « risque d’existence » ! On s’est tellement dissocié de nous-mêmes, du tissu du vivant dans lequel on est inséré, qu’on ne cesse de l’empoisonner, de le détériorer, de le détruire, sans comprendre qu’en fait on en fait partie. Et, dans le façon dont on va se réinsérer dans le vivant, le rapport au corps est vraiment quelque chose de fondamental. On pourrait considérer la pensée, l’intelligence, l’analyse comme des fonctions du corps, comme le sont les émotions, comme le sont les sentiments, comme le sont tous les mécanismes automatiques qui font fonctionner notre corps. On pourrait se considérer comme des entités qui ont diverses fonctions, dont celles de penser, de réfléchir, d’analyser, etc. C’est très compliqué d’arriver à se « réinsérer » dans ce tissu. Mais c’est quelque chose qui, petit à petit, est en train de se faire.
Pour justement voir autrement ce corps, je vais faire une incursion dans ce qu’on appelle le « male gaze » et le « female gaze », c’est à dire la façon dont on peut s’approprier quelqu’un par le regard, notamment la façon dont on filme les femmes au cinéma. Celles-ci sont extrêmement érotisées, on les filme pour se les approprier par le regard, comme si on allait physiquement les prendre. C’est le « male gaze » , le regard masculin. Mais il y a le « female gaze », le regard féminin, qui n’est d’ailleurs pas forcément le fait de réalisatrices. Ce « regard » va essayer de filmer les personnes de telle façon qu’on arrive à entrer dans leur subjectivité. Qu’on cesse de les objectiver, qu’on arrive à ressentir ce qu’elles ressentent, à se mettre dans leur intériorité et qu’on les perçoivent comme des personnes vivantes, sensibles. C’est ce qu’on appelle le « female gaze ». Mais pour ça il faut non seulement s’intéresser aux sentiments, aux émotions, cesser de croire qu’elles sont mensongères, mais il faut aussi se pencher sur le corps.
Quand on cesse de regarder les femmes comme des objets érotiques animés, des jouets biologiques (les ouvriers sont des robots biologiques) – elles sont présentées comme des divertissements sexuels depuis la nuit des temps ‒, on essaie de regarder ce qui se passe à l’intérieur. Cela se fait dans tous les domaines, notamment celui des sciences naturelles (la biologie). Et c’est très récent, de s’intéresser de cette manière au corps des femmes. Ainsi, on a découvert un petit organe, le clitoris…. en 1998 (date de l’entrée du Viagra sur le marché !). On connaissait exactement comment un phallus fonctionne ou dysfonctionne (le corps caverneux, etc.), mais c’est seulement à ce moment-là que pour la première fois une dissection d’un clitoris est faite par une équipe australienne qui va présenter dans son entièreté ce petit organe. Ce travail va être pris en considération par d’autres équipes scientifiques qui vont le valider. Le clitoris va littéralement sortir du néant. D’ailleurs, on ne lui a pas attribué de fonction exacte, à part celle de donner du plaisir. Il doit bien servir à quelque chose, mais on ne sait toujours pas exactement à quoi. Puis, en 2005, c’est la première exploration par IRM (imagerie par résonance magnétique) d’un clitoris sur une personne vivante. Par la suite, en 2008, une coupe échographique en trois dimensions (relief) du clitoris est effectuée. En 2009, Odile Buisson, gynécologue, et Pierre Foldès, urologue, font l’échographie d’un clitoris pendant le coït (hétérosexuel avec pénétration). On observe que cet organe s’enroule autour du vagin et s’applique environ à l’endroit qu’on appelle le point G (le vagin n’est pas spécialement innervé). C’est un manière d’entrer, en l’occurrence, dans le corps féminin qui est extrêmement sensible comme tous les corps vivants.
Pierre Foldès a mis au point un protocole chirurgical pour réparer les clitoris après excision (l’excision ne coupe en général qu’une petite partie du clitoris). Il faut saluer ces travaux en faveur des femmes, d’autant que de nombreux chirurgiens de par le monde ont été formés à ces techniques. Citons Denis Mukwege, en République Démocratique du Congo, qui répare remarquablement des mutilations extrêmement graves faites au sexe des femmes. Il s’agit là d’une des façons de prendre le corps autrement, de le vivre de l’intérieur, d’essayer de le connaître et de connaître tout ce qui peut être dispensé par le corps comme sensations, comme émotions. Cela passe par les sciences naturelles. Aujourd’hui le clitoris n’est plus ignoré, il est présenté publiquement (images en 3 D…), y compris à travers des gadgets (porte-clés…).
Peut-être faut-il considérer le corps autrement qu’il a été considéré si longtemps, c’est à dire comme une espèce de machine constituée d’organes qui « fonctionnent » – chaque organe ayant une fonction précise, etc. Depuis quelques années, on se rend compte que c’est plus compliqué. En fait, nous sommes des « symbiotes ». Au passage, je rends hommage à un grand anarchiste qui était également un grand biologiste et géographe, Pierre Kropotkine. Il a été le premier à penser très fort que le mutualisme, la coopération, bref que l’échange pouvait être un moteur d’évolution beaucoup plus important que la compétition. Il a pensé cela au XIXe siècle, ce qui n’était pas évident. En étudiant les lichens, il subodorait que leur organisme était symbiotique, même s’il n’a pas pu le démontrer expérimentalement. Tous les lichens sont la symbiose d’une algue et d’un champignon. Alors pourquoi sommes-nous des symbiotes ? On s’est rendu compte qu’il existe un tout petit élément dans nos cellules, la mitochondrie, qui a une importance fondamentale. C’est grâce à elle que la respiration, l’oxydation, la décharge d’énergie vont s’effectuer. Ces mitochondries qui se situent dans nos cellules eucaryotes ne sont pas de petits organismes ; elles ne font pas partie de notre corps car elles ont leur ADN propre. Ce sont des bactéries. Elles montrent que les entités du vivant comme le corps humain ont réussi à se complexifier d’une manière incroyable. Au plus profond de nos cellules, nous sommes des symbiotes. Les végétaux pratiquent la photosynthèse grâce à de petits éléments situés dans leurs cellules, les chloroplastes. Les chloroplastes sont aussi des bactéries (cyanobactéries), ces fameuses petites algues bleues, qui ont produit absolument tout l’oxygène que nous respirons. À un moment, une cellule a incorporé ces petits chloroplastes qui ont conservé leur propre ADN, ce qui permet à tous les végétaux sur terre de pratiquer la photosynthèse. La symbiose des mitochondries comme celle des chloroplastes est très ancienne. De ce fait, ces bactéries ont perdu une partie de leur ADN et sont devenues dépendantes pour certaines fonctions (nourriture notamment). De la même manière, nous avons dans nos viscères deux à trois kilos de bactéries, d’archées, d’éponges, de virus : nos microbiotes qui nous permettent de digérer. Sans ce microbiote, nous serions incapables par exemple d’assimiler les sucres. Ces « organismes », internes à nos corps, pourraient tout à fait y être extérieurs. Et il n’y a pas que le microbiote intestinal, il y a le microbiote pulmonaire, sur la peau, dans la bouche, dans le nez, le vagin etc. On est constitué d’un ensemble de microbiotes. On n’est pas un sac étanche avec des organes qui fonctionnent comme des machines. C’est plus compliqué. On parle beaucoup du staphylocoque doré : ils fait partie de notre flore. Nous ne cessons, à chaque fois que nous nous serrons la main, que nous nous embrassons, à chaque fois que nous nous parlons, de renouveler nos microbiotes. Nous sommes en interactions perpétuelles avec le milieu dans lequel nous vivons.
Cela donne une autre vision d’un corps qui est un ensemble de dynamiques, vivant en perpétuel ajustement. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des écosystèmes. C’est tout à fait différent. Nous sommes des écosystèmes à l’intérieur d’autres écosystèmes. Et si on arrive à le ressentir, à le considérer comme ça, il ne s’agit évidemment plus d’un objet marchand : le corps n’est pas une marchandise. La question de transformer quelque chose en objet pour pouvoir l’échanger sur un marché ne se pose pas avec le corps, nous ne sommes pas des objets. Le vivant est beaucoup plus étendu que ça. C’est ce qui se pose comme question au niveau de l’espèce humaine, en l’occurrence au niveau des femmes pour la prostitution, pour la GPA, mais aussi pour les personnes qui testent les médicaments, pour toutes les personnes dont on utilise le corps. Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas beaucoup d’argent et à qui on va proposer 1000 ou 1500 euros pour rester trois jours à l’hôpital, bien nourris et bien surveillés, et pour prendre des doses en fait excessives de certains médicaments, pour voir les effets.
Si on peut avoir conscience de ce qu’est le corps, alors on va changer totalement le regard sur la sexualité. La sexualité peut être vue simplement comme un échange, pas comme une tractation, pas comme une négociation, pas comme l’affirmation d’une domination. Et cela peut conduire à se dire : « Si, nous, on fonctionne comme ça, si on est des écosystèmes à l’intérieur d’écosystèmes, que vaut ce rapport de séparation entre les hommes et les femmes ? Ou entre les hommes et toutes les personnes sexisées qui ne sont pas considérées comme des hommes ? ». Idem pour la classification des « races » qui est une séparation, une dissociation dans l’espèce humaine entre les supérieurs et tous les autres, inférieurs. C’est très ancien.
Mais c’est aussi le rapport de l’humain au reste du vivant, le rapport à ce que l’humain appelle « nature ». Un vocable qui n’est d’ailleurs apparu que récemment dans le sens de tout ce qui est extérieur aux humains. La nature au sens de « tout ce qui n’est pas humain » apparaît très tardivement car auparavant, depuis les Latins, la nature était l’ensemble des phénomènes physiques, ce qui incorporait aussi les humains.
C’est sous cet angle que je voulais aborder la question du corps par la prostitution. Qu’en pensez-vous ? (fin de l’exposé)
Discussion
Une intervention : Est-ce que tu considères « l’assistance sexuelle » comme de la prostitution et quelle problématique cela peut-il poser par rapport aux personnes en situation de handicap ?
L. B. : oui bien sûr que c’est de la prostitution. Le simple fait de parler d’assistance sexuelle signifie que la sexualité est un vrai droit, ce n’est même pas une question de handicap. Pour le coup, la sexualité dans ce cas n’est pas un échange, pas quelque chose de dynamique. C’est quand même de l’assistance généralement masculine qui est faite principalement par des femmes avec un problème d’argent. On est vraiment dans l’économie de la beauté cristalline, de tout ce qui est luxe calme et volupté, qui ne peut pas être considéré comme chaotique, comme physique. Aujourd’hui à notre époque cet ordre-là, c’est les valeurs marchandes. Transportons-nous dans le domaine économique : est-ce que l’argent est un bien commun ? Je ne crois pas. Ça pourrait être un bien commun si on considère que la monnaie, c’est quelque chose de bien pratique qui sert d’échanges parce que échanger une paire de bottes contre un cours de yoga, c’est un peu compliqué quand même. Mais aujourd’hui, à ce stade du capitalisme : qui fait l’argent ? qui bat l’argent ? qui dispose de l’argent ? Toute forme de prostitution ou de mise sur le marché de services qui impliquent le corps met du vivant sur un marché privatisé. On pourrait imaginer que l’argent soit mutualisé, soit juste une commodité. Dans l’absolu je trouve plus prometteur, plus révolutionnaire de sortir de ce système marchand, ce qui se fait dans certaines Zad, dans le mouvement des squats.
En ce qui concerne l’assistance sexuelle, c’est exactement la même chose que pour le divertissement sexuel. Le sexe est-il un droit ? Parce qu’il y a les droits : le droit à la nourriture, le droit de se cultiver, ce sont des droits que l’on exerce. Le droit à la sexualité ne peut s’exercer que sur autrui et de façon assez mécanique ; ça va s’exercer par des personnes qui ont du fric sur des personnes qui manquent de fric, qui négocient l’usage de leur corps sur le marché.
Une intervention : Merci, madame, pour votre historique sur l’usage du corps des femmes à travers les siècles. Cela dit, ce qui est posé quand même avec une évidence forte, c’est sortir du fétichisme de la marchandise et du fétichisme de l’aliénation. On voit bien qu’essayer de se déprendre de la valeur d’échange, c’est courir après un fantôme. Effectivement il existe des initiatives contingentes, mais ce sont des épiphénomènes, cela reste très anecdotique et cela valide le système de la démocratie libérale. Et deuxième question, il y a aussi le mimétisme identificatoire du matriarcat, qui fait un peu mentir la parole d’Aragon disant que la femme est l’avenir de l’homme. Dans l’entreprise, quand elles ont le pouvoir, elles sont souvent pareilles aux hommes.
Une intervention : Tu nous dis que la prostitution n’existait pas chez les Vikings, puis après tu remontes à la nuit des temps, tu remontes à des millénaires. Pour moi, c’est pas clair. Je manque vraiment d’informations et quid de la Chine ? Quid des sociétés encore plus anciennes et de la prostitution ?
L. B. : la période d’extension des Vikings est assez tardive. C’est aux VIIIe, XIIe siècles qu’ils vont vraiment essaimer. Ce sont plutôt des commerçants, mais oui c’est beaucoup plus tardif, effectivement. Là je parle des Grecs, des sociétés patriarcales. Oui il y a des sociétés patriarcales, et même à Sparte. Plutarque niait la présence de prostitution à Sparte parce que la monnaie spartiate n’avait aucune valeur : une monnaie en fer, non convertible dans le reste du monde grec. Cela décourageait les proxénètes de s’y installer et donc pas de prostitution. Dans les sociétés étrusques, dans l’Égypte ancienne on trouve des femmes médecins, scribes. Les femmes ont un statut, elles sont extrêmement respectées. Et puis dans les sociétés patriarcales, les femmes ne sont vraiment rien, on dirait qu’elles ne font plus partie de l’espèce. Dans les sociétés celtes, c’est pareil. Dans La guerre des Gaules par exemple, César est extrêmement choqué de voir des femmes qui lui paraissent totalement hirsutes, monstrueuses, parce que ce sont des grandes femmes athlétiques qui font tournoyer les gourdins au-dessus d’elles. Quand les hommes tombent au combat, les femmes les remplacent. Pour lui, c’est une horreur totale. La prostitution est vraiment liée aux sociétés patriarcales. Après, les Romains vont appeler prostituées les Étrusques parce que les femmes étrusques ont une liberté de mœurs, elles font ce qu’elles veulent en fait, et eux vont les appeler prostituées. Sauf que la différence, c’est qu’elles multiplient les aventures parce qu’elles ont envie. Pour eux, c’est quelque chose de monstrueux. Une femme ne peut pas chercher le plaisir. Je montre que le patriarcat n’est pas systématique, ce n’est pas dans toutes les sociétés. Sur la Chine, je n’en sais rien.
Quand les femmes se trouvent en position de pouvoir, elles sont des êtres humains comme les autres, extrêmement classiques.
Le rapport à la colonisation. Elle se fait par le militaire, en général. Les militaires ne se déplacent pas sans toute un infrastructure qui est censée garantir du sexe au soldat.
Il y a les bordels de campagne, mais il y a aussi des réseaux extrêmement organisés qui vont recruter des femmes parmi les colonisé.e.s pour les mettre à la disposition des soldats. C’est une situation qu’on observe systématiquement et dans des conditions qui sont la plupart du temps absolument atroces. La prostitution existe parfois dans les sociétés colonisées, mais jamais sous cet aspect-là qui a quand même très souvent un aspect d’abattage, que ça soit en Indochine, au Maghreb, ou en Amérique. Le bordel militaire, c’est vraiment quelque chose d’assez monstrueux. Et le pire, c’est que c’est une véritable institution et qu’une fois que c’est installé, et que le pays acquiert son indépendance, les structures, les systèmes de recrutement restent.
La prostitution est indissociable de la colonisation. Il n’y a pas de colonisation sans prostitution, c’est systématique. J’ai cherché partout, il n’y en a pas. Il y a d’excellentes études sur le sujet.
Une intervention : Est-ce que vous définissez la prostitution à partir du moment où il y a un aspect financier, ou lorsque des femmes sont assujetties à du travail sexuel ? Et vous parliez de l’Église, des différents conciles : est-ce qu’il y a une corrélation entre le développement des grandes religions avec les normes et les codes moraux qu’elles promeuvent, le patriarcat, et le développement de la prostitution ? J’ai cru comprendre que des religions moins étendues géographiquement n’avaient peut-être pas autant de valeurs imposées, de morale. Alors est-ce qu’il y a une relation entre le développement des grandes religions et tout ce que ça amène dans le mode de vie et la prostitution, la sexualité, etc. ?
L. B. : Oui, bien sûr. La première chose que vont faire toutes les religions du Livre, c’est s’efforcer de contrôler la sexualité. Le plus grand danger couru par la religion chrétienne, catholique, ça plus été ce qu’on a appelé la « finamor », tout ce mouvement des troubadours où l’adultère était valorisé, en général d’un homme « inférieur » face à une femme « supérieure ». Ça a vraiment ébranlé le pouvoir patriarcal de l’Église. C’est la raison pour laquelle ce qui était le plus fermement puni dans toutes ces religions, c’était l’adultère, la liberté sexuelle. Qu’on puisse baiser pour son plaisir, c’était hors de question !
La prostitution, elle, était tout à fait admise, et d’ailleurs, les prostituées au Moyen-âge, une fois qu’elles avaient fini leur « carrière », elles s’achetaient une conduite, elles n’avaient aucun problème d’intégration. Par contre, une femme adultère risquait la mort, taillée en pièces en place publique. Qu’elle puisse disposer de son corps et en plus, chercher le plaisir, non ! c’était insupportable !
Une intervention : On a parlé du rapport du patriarcat avec la soumission des femmes à travers certaines civilisations. C’est vrai que ça remonte à la nuit des temps, mais je voudrais savoir si vous vous êtes penchée sur la question du rapport entre le patriarcat et le tourisme sexuel qui vise en particulier les enfants, garçons et filles. Donc l’homme par rapport au petit garçon, est-ce que ça relève du même mécanisme, ou est-ce qu’il y a d’autres choses à voir derrière ?
L. B. : Oui, ça relève des mêmes mécanismes. Quand on regarde le patriarcat originel, les enfants font partie de la manne sexuelle dont on peut disposer. C’est très clair dans les mondes grec, latin. En fait, les hommes disposent du corps d’autrui. C’est leur droit, leur premier droit pour les divertissements sexuels : le corps d’autrui. Autrui, ce sont les femmes, les enfants, les jeunes garçons, les travestis, peu importe. Ce droit sexuel s’exerce par la prostitution, par le mariage, par le harcèlement, par le viol, par l’inceste. Bien évidement, tout n’est par réglementé ; mais pour le viol, c’est parce qu’on s’attaque à la propriété d’autrui. Si autrui n’appartient à personne, ce n’est plus un problème. Si vous violez un gosse des rues, personne ne va vous embêter ; mais si vous violez l’enfant de quelqu’un d’autre, ou la femme, ou l’esclave de quelqu’un d’autre, là ça ne va pas passer.
La pédophilie est massive dans l’Antiquité, c’est même impressionnant. Quand on regarde les bordels antiques, il y a plusieurs façons de se procurer des esclaves, et d’ailleurs on a un discours d’un Romain qui disait : mais vous vous rendez compte que vous pouvez très bien coucher avec votre fils, votre fille ? Parce qu’un père qui ne voulait pas de ses enfants les exposait, pour que les prenne qui voudra. Les proxénètes en récupéraient, les formaient pendant quelques années. L’espérance de vie des gosses prostitués était très courte, peu atteignaient l’âge adulte.
Toutes les sociétés qui méprisent les femmes ont exactement le même rapport aux enfants. C’est lié, ça s’observe. En revanche, dans celles où les femmes ont de l’importance, les enfants aussi. Ils sont respectés.
Une intervention : Je voudrais que tu abordes quelques points par rapport au corps marchand des femmes, et en particulier par rapport à certaines réflexions qu’on entend aujourd’hui et les démarches militantes défendant certaines libertés dans la gestion du corps. Par rapport à la prostitution, on sait que certaines personnes, y compris dans nos milieux, défendent le droit de se prostituer. Par ailleurs, une autre forme de disposition du corps des femmes a été longtemps une fonction d’élevage (les nourrices), et aujourd’hui on passe à une fonction encore plus interne dans leur corps avec la gestation pour autrui. Qu’en penses-tu ?
L. B. : Sur le droit de se prostituer, je dirais que c’est le faux nez du droit d’acheter des services sexuels. Parce que tant qu’il y aura nécessité, on va pas reprocher aux gens d’essayer de bouffer. L’argent étant chose privée, privative, qui n’est pas distribuée de façon équitable entre hommes et femmes, tant qu’il y aura des gens qui manqueront de tout, il y aura de la prostitution. L’argent n’est pas un droit et donc il y aura toujours des gens qui n’auront que leur personne à disposition pour en gagner, et d’autres qui auront suffisamment d’argent pour se payer du divertissement sexuel. Pour les uns, c’est du luxe, se payer une prostituée, c’est avoir le fric en plus pour le faire, et pour les autres qui auront des enfants à nourrir, on aura toujours de la prostitution.
Donc défendre le droit de se prostituer, c’est quoi ces conneries ? On ne peut pas le présenter comme ça. Je comprends très bien que des prostituées puissent défendre le droit qu’elles ont car on ne leur a pas proposé d’alternative. Un boulot à 500 balles par mois, ce n’est pas une alternative. Pareil, quand on regarde la loi de 2016 sur les parcours de sortie de la prostitution, on pleure. Dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs, on propose en gros un RSA à des femmes qui parfois ont des gamins, qui sont dans des situations infernales, de faire cette démarche héroïque de sortir de la prostitution. La seule façon de remédier aux situations affreuses qui la plupart du temps amènent à la prostitution, c’est de donner de l’argent aux gens, tout simplement, de dissocier le travail de la personne. C’est ce que propose Friot, de mettre en place les préconisations du DAL sur le droit au logement, de faire en sorte que cette nécessité n’ait pas lieu d’être, pour personne.
Mais il y a quelque chose de très gênant : une prostituée, c’est environ 20, 40, 100 clients.
Ça profite à qui, finalement ? C’est du divertissement sexuel sur la peau des gens. Admettons que quelqu’un ait envie de se prostituer. Dans l’absolu, est-ce qu’on a besoin de légiférer là dessus ? Une loi est édictée pour tout le monde, mais les femmes étant ce qu’elles sont, c’est-à-dire plutôt plus pauvres que les hommes, dans tous les pays où la prostitution est réglementée, l’institution fait mécaniquement disparaître énormément d’emplois que les femmes étaient allé chercher avec les dents pour pouvoir les exercer, parce que tout le monde n’a pas envie, tant s’en faut, d’être toujours au service de la personne de l’homme. Beaucoup de femmes ont envie de conduire des bus, d’enseigner l’histoire, de peindre, de faire des tas d’autres boulots qui leur ont été interdits pendant des siècles pendant lesquels les femmes étaient réduites à leur ventre et à leur sexe, littéralement incarcérées dans leur ventre et leur sexe.
Le droit de se prostituer : entre un droit et un devoir, ça glisse. On a mis des siècles a essayer de ne plus être considérées sous cet angle, donc le droit de se prostituer, c’est non. Ce n’est pas du droit de se prostituer qu’il faut parler, mais du droit qu’il y ait des prostituées dans la société pour que les hommes puissent y aller.
La GPA. Je trouve très intéressant de partir sur les nourrices. Il y a un bouquin de Leïla Slimani qui s’appelle Chanson douce. Il parle de ce qui est devenu un boulot mercenaire : celui de nourrice. Pendant des millénaires en terre patriarcale, la nourrice est très souvent une esclave ou quelqu’un de très basse extraction. Mais son rôle est suffisamment reconnu. Qui reconnaît Ulysse, quand il rentre à Ithaque ? Son chien et sa vieille nourrice aveugle qui va lui laver les pieds. Elle reconnaît une cicatrice qu’il a eu quand il était gamin, et cette nourrice est la seule à reconnaître Ulysse. Quand on a un personnage comme ça, c’est étonnant : elle est extrêmement valorisée, elle n’est rien et tout en même temps. Pendant des siècles, on reconnaît les frères et les sœurs de lait, c’est à dire que la femme qui allaite crée une fratrie. Elle reste dans les familles. Il y en a aussi dans les pièces de Molière où la petite amoureuse va voir sa nourrice en pleurant. La nourrice est la confidente de toute la famille, elle engueule le père, elle mène tout le monde par le bout du nez.
Ce rôle, qui est un rôle d’allaitement très dur parce que ces femmes abandonnaient leur gosse, qui mouraient très souvent, était central, reconnu. C’était un personnage très très fort. Chez Slimani, l’histoire commence par le meurtre de deux enfants, mais ensuite il y a toute la façon dont cette femme est entrée dans cette famille. Les deux parents ont trouvé tout naturel qu’elle n’ait pas de vie, qu’elle soit obsédée par son boulot, disponible nuit et jour. Comment pourrait-elle être normale, en vivant comme ça ?
La GPA, c’est quelque chose d’assez épouvantable. Il faut savoir que c’est pratiqué de tout un tas de façons différentes et qu’il y a des pays, l’Angleterre par exemple, où ce n’est pas interdit mais où la mère gestante est considérée comme la mère, et elle a six semaines après l’accouchement pour décider de donner ou non l’enfant. Elle n’a pas le droit d’être rémunérée, c’est ce qu’on appelle la GPA « altruiste ». Après évidemment, tous les arrangements sont possibles, mais elle a quand même un droit, elle existe.
Dans d’autre pays, l’Ukraine, l’Inde, on a des femmes qui sont collées dans des pouponnières, nourries, bien surveillées, et elles signent un engagement à renoncer à toute filiation.
Je voudrais revenir sur cette histoire de filiation. Pourquoi n’aurait-on que deux parents ?Dans le cas de la GPA, pourquoi ne reconnaît-on pas le rôle biologique, car ce n’est jamais un rôle seulement biologique ? Il va y avoir un être humain qui va former toute sa sensorialité, tout son bagage émotionnel dans un écosystème qui est celui de la mère gestante. Ce n’est pas dérisoire.
Au moment de l’accouchement, un gosse dans son placenta, il est stérile. Donc quand il sort il est ensemencé par la mère, par la flore vaginale, intestinale, par contact, par le souffle, l’allaitement. La mère n’est pas qu’un incubateur, elle lui donne des billes concrètement pour exister, car sans ces microbiotes il ne pourrait pas fonctionner. Une femme n’est pas seulement un incubateur.
Ce qui me dérange dans la GPA, c’est la même chose que ce qui me dérange dans la prostitution, c’est à dire le fait de nier qu’entrer en contact intime implique quelque chose comme une responsabilité. C’est-à-dire que pour moi, on n’a pas à se déresponsabiliser en sortant des billets.
Récemment, il y a une femme d’une cinquante d’années qui s’est fait tabasser à mort par un de ses clients. Quelles sont les circonstances aggravantes ? Il n’y en a pas, parce que baiser avec un putain, ça n’engage pas votre responsabilité, ce n’est pas la même chose que si vous tabassez à mort votre petite copine.
C’est donner de l’argent pour de désolidariser de la personne avec qui on entre en contact, et avec qui on est dans un rapport de pouvoir.
Donner de l’argent pour louer un utérus… On est quelques-unes ici à avoir accouché. On peut y rester, on peut avoir le corps durablement abîmé, on peut en mourir. Il y a quelque chose qui se passe chez les mammifères pendant la gestation. Il me semble qu’il devrait au moins y avoir un droit de continuité, de contact potentiel. On ne devrait pas pouvoir dire à une femme : « Tu renonces à tout contact avec l’enfant que tu as porté ». Et même pour le gosse. Pourquoi on ne pourrait pas déterminer un droit, une forme de droit qui fasse qu’on puisse rester en contact ?
Ça me paraît horrible. L’Ukraine est un des lieux où la GPA est pratiquée à l’échelle industrielle. Il faut savoir que même avant la guerre actuelle, c’était un pays dévasté, du fait notamment de la catastrophe nucléaire. Et la GPA n’y est pas chère !
Il y a déjà un moment, on a reçu un enfant de Tchernobyl. Zara est venu installer une usine dans la zone de Tchernobyl et la mère de cet enfant était payée 20 centimes par pantalon plié et ensaché. Ils ont construit cette usine où il n’y avait ni dispensaire, ni hôpital. L’usine est restée un mois et a fichu le camp avec toute la marchandise, et la mère de l’enfant n’a jamais vu son argent !
Avec Zara, la GPA, les proxénètes, on est dans un monde ultra libéral, ultra capitaliste. Il y a de l’argent à faire, c’est pas un problème. Dans un pays qui est dans une situation d’effondrement comme a pu l’être l’Union soviétique, les chicago boys ont littéralement bradé tout le pays. On voit les vautours rappliquer pour faire argent de tout. Il y a des gens à exploiter, on peut s’y ruer. Faire de l’argent avec la moindre cellule vivante.
Une intervention : Tu disais qu’un enfant n’appartient pas forcément à deux personnes. Dans les sociétés polynésiennes, avant qu’elles ne soient colonisées par les Anglais et les Français, les Tahitiens disaient que l’amour était libre, que l’enfant appartenait à la tribu. C’était une expérience qui pourrait nous servir de guide, parce que c’est peut-être ça le modèle auquel il faudrait se rapporter.
L. B. : il y a beaucoup de manières de vivre la parentalité. Il y a des sociétés où l’enfant n’est pas élevé par ses parents mais par ses grands-parents. Dans les sociétés matrilinéaires qu’on appelle aussi matriarcales (au sens premier), le père génétique a un rôle, mais le père social c’est le frère de la mère ou son oncle, un garçon apparenté à la mère et comme ça on ne se tracasse pas avec l’adultère. L’enfant de ma sœur est mon enfant, donc je ne vais pas la pister partout. La virginité n’a aucune valeur. La liberté sexuelle ne bouscule rien. C’est l’exemple typique d’une triangulation. Et pourquoi rester sur la triangulation ? La famille peut être encore plus étendue. Je ne pense pas qu’il y ait de modèle. Par contre, on gagnerait à laisser s’exprimer pleins de modèles différents, afin que l’enfant dispose de plusieurs référents adultes. La famille nucléaire, on ne devrait pas vivre comme ça. Je le dis, j’en suis issue et j’ai une famille nucléaire, mais en même temps c’est compliqué de faire autrement.
Une intervention : Par rapport à la GPA, la filiation, le patriarcat, qu’est-ce que c’est que de vouloir à tout prix un enfant, au prix de sacrifier quelqu’un d’autre, mettre en jeu d’autres personnes ?
L. B. : Le corps est dévalorisé, c’est un objet qui n’a aucune importance. On estime que la personne est ailleurs que dans le corps. Mais si la personne est le corps, ça pourrait tout changer. Aucune considération pour ce qui se passe dans un corps sensible.
Que des personnes puissent vouloir porter des enfants pour d’autres, on passe notre vie à échanger. Pourquoi on paie pour avoir des choses ? Pourquoi des gens paient pour avoir des relations sexuelles ? La quasi totalité des gens qui vont voir des prostituées ont une vie sexuelle à côté, mais ils veulent payer pour pouvoir imposer des choses que librement on ne ferait pas, qu’on n’a pas envie de faire. Ils veulent payer pour commander et ne pas avoir à se soucier d’autrui, ne pas avoir la moindre responsabilité avec la personne avec laquelle ils couchent. Je couche avec elle, mais je n’ai aucun engagement avec elle. Mais si, mon pote. Je me dis que si les prostituées pouvaient obtenir un droit de rétorsion sur tout client qui rentre en contact avec elles… Mais à partir du moment où elles reçoivent l’argent, elles renoncent à tout droit. Ce ne sont pas des prestations sexuelles qu’on paie, ni une gestation, c’est le fait d’acheter la déresponsabilisation par rapport à un alter ego. C’est pour dire : « Cette personne est coupée de moi, je m’en fous. » Ça, non.
Une intervention : Ce que tu disais au début, le fait de s’approprier le corps de l’autre par la pénétration. En ce moment, il y a une remise en question de ce code sexuel de passer par la pénétration ; on peut avoir des pratiques qui soient autres mais reconnues en tant que relations sexuelles. Il y a un lien entre pénétration, patriarcat, posséder l’autre et l’idée que les femmes jouissent spécifiquement par la pénétration et pas autrement. Je trouve que c’est drôlement important et intéressant ce mouvement.
L. B. : On est sur les questions qu’on peut se poser sur la sexualité, sur les modalités de plaisir que peuvent avoir les femmes. Mais on ne se pose pas ces questions : une femme, c’est fait pour donner du plaisir aux hommes. J’ai vu passer une enquête dans laquelle on demande aux femmes « Comment vous masturbez-vous, madame ? » Les femmes sont 2000 ou 3000 à répondre, et après on fait des statistiques. Combien utilisent la pénétration quand elles se masturbent ? C’est peut-être de l’ordre de 5 %. On peut jouir de la pénétration, mais ce n’est pas indispensable, alors que pendant très longtemps on a estimé que sans pénétration il n’y avait pas de relations sexuelles.
La pénétration est un mode de relations sexuelles, mais qu’il n’y ait pas d’autres moyens de jouir, ça pose un problème ! Et le problème est posé en plus parce qu’on commence à rentrer dans ce truc d’altérité et se dire comment les femmes fonctionnent, comment leur corps fonctionne. C’est une question qu’on ne peut pas poser dans la prostitution, ni la GPA : la façon dont les femmes désirent, dont elles ont du plaisir. Les femmes sont là comme ressource, pas pour avoir une subjectivité, un ressenti, des émotions, des sensations.
Et puis on n’est pas obligé de baiser, c’est aussi une sexualité. Ce qui est plaisant dans ce qui se passe en ce moment, c’est qu’on voit des tas de modalités différentes d’être, des tas d’identités différentes et c’est réjouissant, cette diversité incroyable !