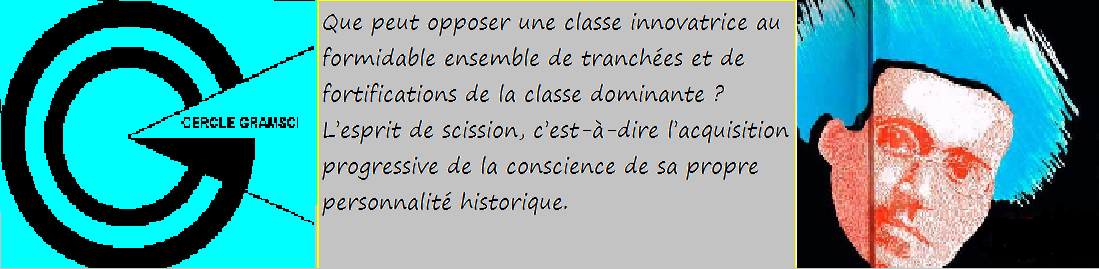Fichage et surveillance des « nomades »
Histoire(s) d’hier et d’aujourd’hui
Présentation de la soirée :
Jérôme Beaumarié est l’auteur d’un travail de recherche soutenu à l’Université de Limoges en 2003, sur la loi du 16 juillet 1912 et son application en Haute-Vienne de 1912 à 1939. Il poursuit aujourd’hui ses recherches à l’Ecole des hautes études en science sociales (EHESS).
La loi de 1912 visait 3 catégories de population « les gens de voyage », comme on les désigne aujourd’hui, les marchands ambulants et les forains.
Elle créée une nouvelle catégorie administrative « le nomade » et instaure leur fichage au moyen d’un « carnet anthropométrique d’identité pour nomades ». Obligatoire à partir de 13 ans, il comportait deux photos, les empreintes digitales des dix doigts, la couleur des yeux, la forme du nez, etc. Tous les déplacements devaient y être déclarés, ce qui rendait possible une étroite surveillance de ces populations…
En 1940, les autorités de la 3ème République décident de l’assignation à résidence des nomades, 1ère étape vers l’internement de plusieurs milliers d’entre eux par le régime de Vichy, et leur déportation vers les camps de la mort nazis.
Il a fallu attendre la loi du 3 janvier 1969 pour que ce système discriminatoire soit abrogé. Mais les nomades, devenus « gens du voyage », ont continué à être soumis à un statut particulier discriminatoire : le carnet anthropométrique a été remplacé non pas par une carte d’identité normale mais par « un titre (ou livret) de circulation ».
C’est seulement le 5 octobre 2012, que le Conseil Constitutionnel, saisi dans le cadre de la nouvelle procédure des « Questions prioritaires de constitutionnalité », annule le livret de circulation ainsi que l’obligation faite aux « personnes sans résidence ni domicile fixe », de justifier de 3 ans de « rattachement ininterrompu dans la même commune », pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales.
Jérôme Beaumarié nous invite à un grand voyage du début du 20ème siècle jusqu’au début du 21ème, sur la condition juridique et matérielle des tsiganes, manouches et autres nomades.
Les associations présentes témoigneront du quotidien des « gens du voyage » en Haute-Vienne et au-delà, des combats qui sont menés pour la reconnaissance du droit à choisir son mode d’habitat.
MA CAMPING 87, mène une action à la fois sociale et de défense des droits des « gens du voyage » en Haute-Vienne, elle vient de fêter ses 20 ans.
AM KETENES (tous ensemble) est une association qui promeut la culture tsigane.
HALEM (association pour les Habitants de Logements, Légers, Éphémères ou Mobiles et pour le droit à l’Habitat Choisi), a pour but notamment de favoriser la reconnaissance du mode de logement éphémère ou mobile et les droits fondamentaux tels les droits au logement, à l’accès au foncier et à la subsistance. www.halemfrance.org.
Notre intervenant
Jérôme Beaumarié est l’auteur d’un travail de recherche soutenu à l’Université de Limoges en 2003, sur la loi du 16 juillet 1912 et son application en Haute-Vienne de 1912 à 1939. Il poursuit aujourd’hui ses recherches à l’Ecole des hautes études en science sociales (EHESS).
HALEM
L’association HALEM, pour les Habitants de Logements Ephémères et/ou Mobiles promeut la défense et la réflexion sur les modes d’habiter atypiques, en particulier les habitats légers, mobiles, réversibles, à faible empreinte écologique (tels que yourte, roulotte, cabane, caravane), avec une réflexion sur les possibilités d’implantation en zone rurale et péri-urbaine.l’association encourage la production et la mise en réseau des producteurs artisanaux de ce type d’habitat, incluant le conseil et l’accompagnement à l’autoconstruction. Durant l’examen de la loi Loppsi 2, l’association a animé une campagne nationale de campements de résistance pour protester contre l’article 32 ter qui consacrait l’expulsion en 48 h sur ordre du préfet de toutes installations illicites. Le campement comme outil de résistance et d’information sur le contexte des lois sécuritaires s’est révèlé extrémement mobilisateur (l’article 32 ter a été censuré le 11 mars 2011 par le Conseil Constitutionnel). En 2012 l’association s’est également mobilisée contre l’article 5 de la Loi Léonard qui voulait graver dans le marbre l’interdiction de vivre à l’année dans les campings. Une campagne de guérilla-communication à motivé le retrait de cet article par son auteur lui-même. Egalement nous insistons sur l’aménagement des dispositions existantes, comme la loi organique de 2003 qui prévoit un droit d’expérimentation pour les collectivités territoriales, l’accès possible pour tout public au terrain d’habitat familial (initialement subventionné pour les gens du voyage quand réalisé par les collectivités pour être loué), en pleine propriété ou en locatif, familial ou coopératif,avec ainsi une évolution évoquée vers un statut de « terrain de vie ». HALEM considère comme indispensable la reconnaissance de la caravane comme logement avec les droits afférents, de même que pour tout habitat atypique constituant le domicile principal de ses occupants.en partenariat avec l’association RELIER, HALEM a mené à partir de septembre 2011 un cycle de rencontres sur l’Habitat Léger/Mobile qui a fait l’objet d’un recueil paru en juillet 2012.
Actuellement, le projet de loi Alur sur l’urbanisme rénové et le projet de loi Raimbourg sur le statut et l’acceuil des gens du voyage focalise notre attention sur le plan national, indépendamment des activités des groupes locaux qu’ il serait difficile d’évoquer ici dans la diversité des initiatives et la force des convictions.
Paul /HALEM
A propos de l’association Ma Camping 87
» En 1993, l’aumônerie catholique, devant le constat des conditions de stationnement inhumaines, insalubres et indécentes des gens du voyage, a interpellé la mairie de Limoges.
Une réflexion et un travail en partenariat avec la mairie allaient permettre à l’association Ma Camping 87 de se créer en juin 1993, avec son siège au 8, avenue des Coutures à Limoges.
Dès sa création, nous avons rencontré les responsables de l’État et du Département pour que l’association devienne un lien privilégié entre les institutions et les gens du voyage (Tsiganes, Manouches, Gitans, Roms, Sintis). Nous avons donc été associés au travail de réflexion sur le premier schéma départemental et à ce titre, depuis, siégé à la commission consultative.
Notre association a également monté le projet de camion-école et travaillé à sa mise en place avec la mairie de Limoges, la PEP et l’Éducation nationale. Dès l’origine, nous avons eu le souci d’accompagner ces communautés dans le maintien de leurs traditions culturelles en leur permettant d’être les acteurs de leur propre expression et de leur autonomie tout en développant l’éducation et la formation des jeunes. Depuis sa création, Ma Camping 87 a reçu et suivi à sa permanence plus de huit cents familles. Elle est un lieu repéré que les voyageurs connaissent bien, où ils peuvent être (entre autres) accueillis, aidés, orientés, sur un plan social, médical, scolaire et juridique. »
(d’après le dossier de presse constitué à l’occasion des vingt ans de l’association)
Références :
Henriette ASSEO, Les tziganes, une destinée européenne, Découverte Gallimard, 1994.
Jean Pierre LIEGEOIS, Roms et Tziganes, La découverte / Repères, 2009
Samuel DELEPINE et Alexandre NICOLAS, Atlas des tziganes, Autrement,
Bernard FORMOSO, Tsiganes et sédentaires, la reproduction culturelle d’une société, L’Harmattan, 2000.
Christophe ROBERT, Eternels étrangers de l’intérieur ? les groupes tsiganes en France, Desclée de brouwer, 2007.
Claire AUZIAS, Roms, Tziganes, Voyageurs : l’éternité et après ?, Indigène, 2010
Claire AUZIAS, Samudaripen, le génocide des Tsiganes, L’esprit frappeur, 2000.
Claire AUZIAS, Les funambules de l’Histoire, les Tsiganes entre préhistoire et modernité, Digitale 2002.
Arnaud LE MARCHAND, Enclaves nomades, habitat et travail mobiles, éditions du croquant / Terra, 2011.
conférence et débat, avec Jérôme Beaumarié
A l’origine de cette soirée il y a une rencontre avec Jean-Pierre Cavaillé, chercheur à l’EHESS, qui a été notre invité sur le thème de « Mémoires ponticaudes », auteur de La fête des ponts (on le trouve à la Librairie occitane). Il encadre, dans ses recherches, Jérôme Beaumarié, étudiant chercheur. Celui-ci a soutenu, en 2003, un mémoire de maîtrise à l’université de Limoges sur les carnets anthropométriques et sur la genèse de la loi de 1912 qui a instauré le carnet anthropométrique, plus particulièrement en Haute-Vienne. Ce sera le cœur de son propos. Il va tirer le fil jusqu’à aujourd’hui. Cette question a une résonance très forte avec l’actualité politique mais aussi institutionnelle, parce que le successeur du carnet anthropométrique a été abrogé par décision du Conseil constitutionnel, en octobre 2012. La deuxième rencontre, c’est avec Paul Lacoste qui fait partie de l’association Ma camping et qui est, en Limousin, un des fondateurs de l’association HALEM (Habitants de Logements Ephémères et Mobiles) et Daniel Lévy, président de Am Kéténes, association à visée culturelle pour faire connaître la culture tzigane, nomade, et qui a été à l’origine d’un évènement culturel, il y a trois semaines. Ma camping vient de fêter son vingtième anniversaire, il y a un mois, avec Jean Nicolas, un de ses animateurs.
Jérôme Beaumarié :
J’ai fait des recherches sur l’application de cette loi du 16 juillet 1912, et j’ai vu avec les sources historiques qui sont aux archives départementales de la Haute-Vienne et celles de la gendarmerie à Le Blanc, dans l’Indre, quelle a été, concrètement, son application en Haute-Vienne. C’est la loi fondatrice de tout le système d’encartement, de fichage mis en place jusqu’à aujourd’hui. Il y a d’autres historiens qui ont travaillé sur des périodes plus récentes, notamment la loi de 1969, puis de 2012.
Je voudrais commencer par les termes. Il faut être précis. Le premier terme est celui de Tzigane, que l’on retrouve dans les documents parlementaires de la fin du XIXème siècle mais aussi bien avant. A propos de cette dénomination de Tzigane, ou de nomade, on a tous une idée en tête et on va voir comment la législation percevait ces populations. Il y a des termes génériques utilisés mais ce n’est pas une population homogène. On parle aussi de Bohémiens, de Roms, de Hongrois, etc. Aujourd’hui on parle de gens du voyage, terme beaucoup plus valorisant. Dans l’historiographie on utilise plutôt le terme de Tzigane, à tort et à raison.
Un petit rappel historique
L’implantation des Tziganes en France est avérée depuis 1419, et elle va perdurer jusqu’au XVIIème siècle. On parle d’âge d’or des Bohémiens, des Tziganes : ils vont servir les nobles par un service armé, durable, pendant trois siècles. A cette époque on a une très bonne perception de ces personnes. Cela se termine avec Louis XIV qui, pour mettre fin à toutes ces petites guerres seigneuriales, demande à tous ses seigneurs de se séparer de leur service armé. C’est la première dispersion et fragmentation des populations tziganes en France en 1682, et tout bohémien peut être arrêté s’il y contrevient. Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, il y a une certaine bivalence qui se met en place. Quand ils arrivent dans des villes, vingt, trente personnes, ils attirent les foules et en même temps apparaissent les premières interdictions de stationnement. C’est la première vague de Romanichels, de Hongrois. On est là à la fin de la période féodale et du coup tous ces gens qui sortent du servage en Europe de l’Est se retrouvent à migrer en Europe de l’Ouest pour trouver un sort (notamment économique) meilleur et quand ils arrivent en France, ils donnent une perception exotique. C’est une nouvelle bivalence pour le public avec les montreurs d’ours, les diseuses de bonnes aventures, avec des campements de trente, quarante personnes. A Rouen on voit au même moment arriver ces populations qui attirent les foules et des trois mâts dans le port, manifestation organisée par la mairie et les gens vont se masser pour voir les Romanichels. Du coup le maire met en place une interdiction de stationnement : « Sera interdit le stationnement sur la voie publique et les terrains communaux aux bohémiens et autres nomades sans profession apparente ou avouée ». Là encore, dans la législation les termes sont très importants et jamais très positifs. Ils sont refoulés aux limites des frontières administratives (commune, canton). Mais il y a des maires qui favorisent le stationnement de ces populations parce que cela peut produire des bénéfices économiques. Bien qu’on n’ait rien à leur reprocher, on les éloigne parce qu’ils marquent les imaginations par leur mode de vie, parce qu’ils sont accompagnés de ces animaux exotiques. On les expulse, mais sans motifs délictueux ni criminels.
Au début des années 1900 c’est une nouvelle vague d’immigration avec les Sinti manouches qui viennent d’Italie et les Gitanos, d’Espagne. Au même moment on voit croître dans la population une certaine xénophobie à l’encontre de ces populations qu’ils soient Gitanos, Romanichels, Tziganes. Il y a une crise économique, donc il y a de la suspicion (ce sont des fauteurs de trouble, des voleurs) notamment de la part des notables, des responsables administratifs, des gendarmes et surtout des paysans sédentaires. Dans cette période de crise beaucoup de gens se retrouvent sur les routes pour trouver du travail et deviennent journaliers, saisonniers, donc pour les paysans c’est voler leur travail. Et on pense, souvent à tort, que ces gens ne sont pas français. Il y a une nouvelle crainte, fin XIXème, début XXème siècle, c’est celui de l’ennemi de l’intérieur : on les soupçonne d’espionnage car la plupart sont en mouvement notamment dans le Nord, et le Nord-Est de la France. On est après la défaite de 1870, et on les prend tous pour des espions à la solde des Allemands. On est aussi en pleine formation de l’Etat-nation et on ne peut pas exercer un vrai contrôle sur le nomade, sans carcan, et il n’entre pas dans ce modèle de l’Etat-nation. Cela soulève un certain nombre de problématiques : celle de l’identité, de la nationalité, de la surveillance des mouvements. Les journalistes (Le Petit Journal par exemple) interpellent les politiques. Ils traitent souvent les nomades de vagabonds, d’errants, de mendiants, mais dans les archives ils ne sont pas accusés de vagabondage parce qu’ils ont un domicile : mobile, la roulotte, mais c’est un domicile. On ne pouvait pas les accuser de mendicité par ce qu’ils avaient souvent un travail, la législation disait que c’était un travail non avoué, pas clair, mais ils avaient des revenus. C’est dans ce contexte assez suspicieux qu’en 1895 naît un recensement national des Bohémiens et autres « camps volants » qui recense 400.000 personnes en France métropolitaine, dont 25.000 voyageurs en roulottes. C’est sous la pression de l’opinion publique que les législateurs travaillent à une loi pour surveiller les déplacements des Tziganes. Au départ ils voulaient mettre en place une législation sur la base de critères raciaux, mais ils ont vite vu que c’était anticonstitutionnel, donc la législation de 1912 est basée sur les ambulants. Cette loi est promulguée sur « l’exercice des professions ambulantes et la circulation des nomades », et c’est la première fois qu’on crée en France trois catégories avec des statuts particuliers : le marchand ambulant, le forain et le nomade. On a le récépissé de déclaration attribué au marchand ambulant, ensuite on a un carnet d’identité pour les forains de nationalité française, et enfin le carnet anthropométrique d’identité des nomades (individuel et collectif). On va voir que la nationalité joue et comment on a voulu viser une population en particulier. Article 1er, définition du marchand ambulant : « tout individu français ou étranger qui exerce sur la voie publique une profession, une industrie ou un commerce soumis à la patente hors de la commune de laquelle ils ont soit une résidence fixe soit un domicile où ils reviennent périodiquement ». Il a un domicile fixe et donc un simple récépissé, comme dans les marchés aujourd’hui avec les patentes. Article 2, le forain : « tout individu de nationalité française n’ayant pas de domicile fixe et se déplaçant en France pour exercer sa profession, son industrie ou son commerce dans les villes ou les villages », c’est le carnet d’identité de forain de nationalité française. Les autres, étrangers, sont rangés dans la troisième catégorie, celle des nomades : « Sont réputés nomades quelle que soient leur nationalité, tous individus circulant en France sans domicile fixe et n’entrant pas dans les deux premières catégories ». Donc ils se retrouvent par défaut dans la troisième catégorie « même si ils ont des ressources et prétendent exercer une profession. Les nomades sont généralement des roulottiers n’ayant ni domicile, ni résidence, ni patrie, la plupart vagabonds présentant le caractère ethnique particulier aux Romanichels, Bohémiens, Tziganes, Gitanos et qui sous l’apparence d’une profession problématique traînent le long des routes sans souci des règles de l’hygiène, ils se donnent comme étant rétameurs, vanniers, rempailleurs, maquignons et ils vivent dans des maisons roulantes renfermant une famille nombreuse ». C’est le texte de loi. On est en 1912. C’est la délivrance du carnet anthropométrique d’identité. Au-delà de la perception négative des Tziganes, on voit que c’est toute une population qui va être encartée et fichée sur des suppositions, des amalgames car on ne parle pas d’une population homogène. Elle apparaît comme une population visible pour le pouvoir administratif. Cela va impliquer des non-Tziganes, des nationaux depuis trois ou quatre siècles, des gens considérés comme apatrides mais j’ai aussi retrouvé des gens qui avaient un carnet anthropométrique individuel qui étaient Algériens. Certes à l’époque l’Algérie était française, mais des gens se retrouvaient comme apatrides parce qu’ils avaient quittés leur sol, l’Algérie, pour exercer en France une profession de forain, donc se retrouvaient par défaut encartés comme nomades.
Ce carnet s’appelle anthropométrique parce que, à l’époque, c’est l’innovation de la police technique : tout ce qui avait été développé par Bertillon, notamment les empreintes digitales, mais poussé à l’extrême avec les mesures du corps. On va mesurer tout ce qui est mesurable chez un homme, une femme et chez un enfant. Sur la première page on a deux photos : une de profil, une de face, et ensuite il est noté le genre de commerce, d’industrie ou de métier, puis sont imposées simultanément les empreintes des quatre doigts et celle du pouce (main droite, main gauche). Sur la page 5 on a le signalement avec taille, tour de tête, des pieds, de l’oreille, du buste, l’envergure, la périphérie, etc. Pour les femmes on n’inscrit que certaines mesures. On a la couleur des cheveux, de la barbe, le teint, sa sanguinolence, le nez et l’âge apparent. Ensuite vont venir les marques particulière (tatouages, cicatrices, etc.). Après on a le lieu et la date de naissance. C’est certifié par le préfet ou le sous-préfet. Il y a l’identité, le nom du père, de la mère, la nationalité, les actes fournis pour prouver l’identité et il y a le rappel à la loi et les décrets. Il faut rappeler que toutes les personnes qui remplissaient les conditions d’obtention du carnet de nomades devaient être âgées d’au moins treize ans. A chaque déplacement on devait faire viser son carnet. Par exemple de Limoges à Bellac on traverse diverses communes. Il faut faire viser le carnet au départ et à l’arrivée par le maire, la police, la gendarmerie ou le garde champêtre. Il faut le faire dans les heures d’ « ouverture ». S’il n’est pas visé et que vous êtes contrôlé vous pouvez être soumis à une amende ou à des jours de prison pour défaut de visa. Hormis le carnet de nomades individuel il y a le carnet collectif, parce que parmi les suppositions il y a celle que ces gens-là ne voyageaient qu’en groupe ; donc on leur adjoint un carnet de groupe où il y a les photos des enfants, toutes les personnes qui composent le groupe avec leur lien (enfant, fils, cousin, gendre, ami…). Quand il y a un mariage, une naissance, un décès, il faut refaire le carnet. Dernière disposition : la plaque spéciale d’immatriculation pour les véhicules « plaque de contrôle spéciale pour les voitures de nomades » avec la hauteur, largeur et autres détails ainsi que le rappel à la loi. Tous ces moyens d’identification permettent de comprendre la logique clairement discriminatoire de la catégorisation. L’encartement anthropométrique habituellement réservé aux criminels assimile toute une population comme telle, alors que cela n’est pas avéré, et c’est la première fois qu’on fiche toute une population pour ce qu’elle est et non pour ce qu’elle a fait, pour son mode de vie. On est plus sur du supposé que sur du réel. Les enfants ne sont pas exempts de cette catégorisation et dès l’âge de deux ans sont, avec photos, empreintes digitales, portés sur les carnets.
Son application
Il y avait déjà un service spécial qui fichait les nomades : les Brigades du Tigre, brigades mobiles mises en place par Clémenceau. Déjà en 1908 elles avaient pour mission de recenser, photographier tous les Tziganes qu’elles pouvaient rencontrer. Ce sont ces brigades qui vont venir dans chaque canton prendre toutes ces mesures anthropométriques. La police ou la Gendarmerie de Bellac par exemple n’étaient pas formées pour prendre ces mesures, donc des tournées vont être organisées. En Haute-Vienne cette application a eu du mal à s’effectuer. L’article 10 de la loi prévoyait que 10 mois après sa promulgation (10 février1913) elle devait être appliquée. Il manquait les registres à souche. A chaque fois qu’une notification de notice, de carnet, était faite, un double devait être conservé dans les archives. Cette lourdeur administrative fait que la loi a du mal à se mettre en place ; les populations visées sont convoquées sur une journée dans une ville. Le préfet dit : « ces journées donnent lieu à de véritables rassemblements et concentration de nomades mais telle est la volonté du préfet car il m’a paru bon de les rassembler un jour déterminé ». On peut s’interroger sur ce que peut penser le préfet de cette population. Au niveau local la centralisation fait que cela a du mal à se mettre en place. Les services locaux demandent toujours aux services centraux comment faire ceci et cela. Par exemple avec le carnet collectif : dès qu’il y a une modification, il faut le faire refaire et retourner à la préfecture voir les brigades mobiles. Tout mariage en dehors du groupe rend les choses encore plus compliquées. Il y a eu un premier bilan en 1926 : quasiment 31000 carnets anthropométriques ont été délivrés, dont 17550 à des Français et 12520 à des étrangers, donc tous ces « nomades » ne peuvent plus être considérés comme des Tziganes parce que cela fait quatre siècles qu’ils sont là et il ne faut pas oublier qu’on est en pleine crise économique, donc la plupart sont des migrants économiques, qu’ils soient Français ou non. Il y a aussi des gens qui ont envie d’adopter un autre mode de vie. Qu’on l’appelle Gitan, Rom, Bohémien, ou voyageur, on parle d’un ensemble qui n’est pas homogène et surtout d’une population qui a été visée par des préjugés basés sur cette volonté de discriminer une population pour ce qu’elle représente. Il y a de nombreux Tziganes, au sens ethnique, nationaux ou pas, qui ont réussi à contourner la loi parce qu’ils avaient compris qu’il y avait deux catégories plus favorables. Du coup, ils ont soit loué un appartement pour être marchand ambulant soit acheté un commerce pour être encarté comme forain. Malgré tout c’est resté limité, du moins en Haute-Vienne. Au terme de ce bilan à la fin des années 1920, il y a un enracinement local, économique, social et parfois culturel. Ce sont des gens qui font les mêmes tournées pour des raisons économiques (commerce itinérant, forains), ou social (on va rejoindre une famille). Ce n’est pas un mode de vie en soi. On a assimilé des gens enracinés dans un territoire comme des criminels en puissance. Même l’administration locale, cela lui pèse de devoir être là pour viser ces carnets et on ne comprend pas trop ce système pour des gens enracinés depuis des générations.
En septembre 1939 c’est la déclaration de guerre de la France à l’Allemagne, c’est la drôle de guerre. Et le 6 avril 1940 il y a un décret qui assigne à résidence puis interne toute cette population fichée au préalable. La résidence, c’est là où ils étaient ou à un endroit précis (par exemple Limoges), puis ils seront envoyés dans des camps d’internement. Du coup il y a un essai de dénombrement. Tous les nomades porteurs du carnet anthropométrique (il y en a 6500) vont être internés dans les camps en France entre 1940 et 1946. Il y avait une trentaine de camps. Et quand la France est occupée le 4 octobre 1940, il y a un nouveau décret : comme ils sont considérés comme des espions, les nazis demandent l’internement systématique de tous les Tziganes – c’est une référence à ce qu’ils ont mis en place en Allemagne- et c’est la France qui se charge de l’internement jusqu’en 1946. Donc même après la guerre le gouvernement était bien content d’avoir cette population dans les camps le plus longtemps possible. Dans la plupart des circulaires du gouvernement français on relève les motifs militaires puisqu’ils sont toujours en mouvement : « outre les impératifs militaires pour justifier l’assignation à résidence des nomades ce ne serait certainement pas le moindre bénéfice si elle permettait de stabiliser des bandes d’errants qui constituent au point de vue social un danger certain et de donner à quelques-uns d’entre eux sinon le goût, du moins les habitudes du travail régulier ». C’est le modèle de l’Etat-nation et à l’époque sur les pièces de monnaie c’est travail, famille, patrie. Le gouvernement français comptait aussi réaliser ce que les législateurs de 1912 n’avaient pas pu faire sur les critères raciaux, c’est-à-dire l’intégration forcée des nomades par la sédentarisation et le travail. Il y a des « nomades » qui ont réussi à passer outre cette assignation. Les persécutions, qui ont eu lieu pendant l’Occupation sous demande allemande et exécution française, c’est l’expulsion d’Alsace-Lorraine ; dans la zone occupée les Nazis envisageaient le même avenir pour les Tziganes français que celui réservé aux Tziganes allemands : ils ont été internés dans les camps de concentration en Allemagne au titre d’asociaux. Ce qu’il faut avoir en tête, c’est que la question tzigane a été vue sous deux angles différents : la France combat un comportement, un nomadisme, qui selon elle provoque des tensions dans la société française. On ne voulait pas les exclure mais complètement les intégrer, alors qu’en Allemagne ils ne menaçaient en rien la cohésion sociale parce qu’ils étaient sédentaires. Et les Allemands basent leur nationalité sur le droit du sang et non sur le droit du sol. Ces deux approches mises en contact ont « favorisé » les Tziganes français qui ont, dans l’ensemble, échappé à l’extermination. En France seule une partie des « nomades » a été internée parce que l’administration ne disposait pas comme en Allemagne d’un recensement. La gendarmerie qui était chargé de l’internement n’a arrêté que les Tziganes de la catégorie « nomades » et ceux qu’elle a pu attraper car certains évitaient les communes pour échapper au système des visas, ou d’autres sont allés en zone libre. Les autorités françaises ont appliqué sans état d’âme la circulaire de 1940 pour essayer d’éradiquer le nomadisme et de « réussir », à terme, la sédentarisation des Tziganes.
En 1946, au sortir des camps d’internement, les Tziganes se retrouvent soumis à la contrainte des carnets anthropométriques, avec la même législation jusqu’en 1969. Pourtant en 1948 une commission interministérielle est chargée d’étudier les problèmes posés par la présence en France des nationaux d’origine nomade. L’objectif était de mettre en place une nouvelle législation pour insérer les nomades dans la société de l’après-guerre. Les travaux de cette commission n’aboutiront que vingt ans après, en 1969, avec la loi du 3 janvier qui porte sur la création de nouveaux titres de circulation et qui soumet à des contrôles moins rigoureux et des papiers moins exhaustifs que pour le carnet anthropométrique, et prône un « droit à la promotion sociale » pour ceux que l’on désigne désormais sous le terme de « gens du voyage ». Trois titres de circulation sont créés : le livret spécial de circulation, le livret de circulation et le carnet de circulation. Le livret spécial de circulation, article 2, est délivré « aux personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixe de plus de 6 mois exerçant une activité ambulante et inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers ». Ce livret n’est soumis à aucun visa. Le livret de circulation « est délivré aux personnes logeant de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile, qui justifient de ressources régulières leur assurant des conditions normales d’existence notamment par l’exercice d’une activité salariée. Le livret doit être visé tous les 6 mois dans un commissariat ou dans une gendarmerie » En 1985 il y aura une modification sur la durée du visa. Il deviendra annuel. Le carnet de circulation (abrogé en 2012), article 5 : « ce carnet est délivré aux personnes qui n’entrent pas dans la catégorie du livret et qui ne justifient pas de ressources régulières. Ce carnet doit être visé tous les mois dans un commissariat ou dans une gendarmerie » – il deviendra ensuite trimestriel. Le défaut de carnet est passible d’une peine d’emprisonnement et le défaut de visa, d’amendes.
Dès 1960 il y avait des circulaires pour planifier cette nouvelle législation. L’effet principal de cette loi n’est que la suppression du carnet anthropométrique et l’instauration des communes de rattachement. Ce qui permettra l’exercice du droit de vote. La mobilité s’est libéralisée mais le mode de vie est toujours suspect. Le droit à l’itinérance est reconnu. La législation met en place une scolarisation adaptée et des dispositions particulières par rapport à la santé, parce que si on est nomade on a une hygiène douteuse et il faut se faire régulièrement vacciner. C’est surtout une réorganisation des activités professionnelles de ceux qu’on appelle désormais les « gens du voyage », mais ces personnes sans domicile fixe (du nomade au sdf) devront détenir un titre de circulation particulier, et là on parle de gens nationaux, qui auraient pu réclamer une carte d’identité française, mais à qui on a souvent dit : « non vous ne pouvez pas la demander, vous n’avez pas de domicile ». Quand vous vous retrouvez face à une administration avec un document spécial et qu’on vous dit ce n’est pas possible, vous croyez que c’est marqué sur vous, au fer rouge et que vous ne pouvez pas vous sortir de ce carcan. Les personnes détentrices de ce carnet de circulation ont quand même, un statut d’une nature différente de tout un chacun, de tous les Français : les critères de différenciation sont sur la nationalité et sur la justification ou non de ressources. La commune de rattachement amènera progressivement les « gens du voyage » à se sédentariser pour « lever la malédiction qui pèse sur les nomades du seul fait qu’ils sont différents de nous » (travaux législatifs préparatoires) Elle doit leur procurer une partie des effets rattachés au domicile : mariage, droit de vote, droit au chômage, fiscalité, etc. Mais elle a contribué à complexifier le statut des « gens du voyage ». Bien que reconnu, le droit à l’itinérance est malmené car soumis à des contrôles de police beaucoup plus réguliers que pour n’importe qui. Si vous êtes en camion blanc, boxer Peugeot fin des années 1990, si vous êtes en marcel avec quelques tatouages et le crochet d’attelage et la caravane derrière, vous allez vous faire arrêter. Avant l’élection présidentielle on revendiquait un récépissé « j’ai déjà été contrôlé » pour ne plus l’être plusieurs fois par jour. J’ai des témoignages clairs sur l’aire d’accueil Django Reinhart. Il y a des terrains alloués par la mairie pour toute l’année, et la police ou la gendarmerie sait qu’à telle ou telle heure il faut se mettre là. Il n’y a pas de surprise. Dans les années 1980 il y a encore cette bivalence avec la caravane qui est devenue l’objet, le symbole des voyageurs. Il n’y a plus de roulottes. Si vous allez en vacances pour faire du camping (en caravane), ça montre un certain niveau de vie, mais si vous avez les traits ethniques « des gens du voyage »… On a d’autres préjugés qui arrivent.
A propos des communes de rattachement : les pouvoirs publics pensent que, à travers les aires de stationnement (aire de stationnement ou aire d’accueil pour les gens du voyage) qui sont collectives, cela allait régler les difficultés (accès à l’eau, à l’électricité) et débarrasser les municipalités des squats. Ce mode de stationnement n’était vu que du point de vue des nuisances potentielles. L’amendement du mois de mai 1990 fait obligation, dans les schémas départementaux, aux communes de plus de 5000 habitants de prévoir ces fameuses aires d’accueil convenant aux activités économiques, à la scolarisation, etc. pour les gens du voyage. En 1995 le Conseil Constitutionnel a intégré ces aires dans le quotas d’habitat social des communes et « outre cet accueil des personnes qui viennent d’ailleurs, qui ne sont pas de ce lieu, qui ne sont pas chez elles, qui sont alors de nulle part » Ces aires d’accueil ont des règlements intérieurs prévoyant en général des durées de séjour restreintes (15 jours à 3 mois) et relèvent du lieu assigné. C’est parfois aussi des lieux de relégation au droit à l’itinérance et encore une fois on essaie de vous restreindre dans votre mouvement perpétuel. Ces textes législatifs du début des années 1990 et 1995, qui auraient pu être mieux adaptés à la réalité des personnes vivant en caravane, ne révisent pas le statut discriminatoire : il y a toujours les carnets. Ce n’est qu’en 2012 que le carnet de circulation (à viser mensuellement puis trimestriellement) est abrogé par le Conseil Constitutionnel. Le livret de circulation nomade était, selon la loi du 3 juillet 1969, « obligatoire pour toute personne âgée de 16 ans, sans résidence fixe, vivant de manière permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile et n’étant ni salarié, ni commerçant, etc. » En plus de la taille, de la couleur des yeux, figure la couleur du teint et la corpulence du corps. Ces détails sont inexistants pour les autres nationaux et c’est pour ça que le Conseil Constitutionnel l’a abrogé. En juin 2011 environ 150.000 personnes étaient titulaires du carnet de circulation, ce qui en fait le justificatif d’identité le plus répandu dans la communauté des gens du voyage mais il est quand même très contraignant. Le Conseil Constitutionnel a jugé que la fréquence des contrôles de police et que les peines encourues (pour défaut de visa) étaient une atteinte disproportionnée à l’exercice de la liberté d’aller et venir ; le fait que juste les gens du voyage sans revenus fixes était concernés par ces mesures est également vu par les « sages » comme une différence de traitement et donc il y a donc une rupture de l’égalité.
La loi LOPSI 2 qui date de mars 2011, loi d’orientation et d’information pour la performance de la sécurité intérieure, est un véritable inventaire des obsessions sécuritaires du gouvernement. Là encore les gens du voyage sont mélangés aux pirates informatiques, à la multiplication des caméras de surveillance, à la criminalisation de la vente à la sauvette passible de 6 mois de prison et au couvre-feu imposé au mineurs de moins de 13 ans. Dans ce déluge de mesures répressives, un article vise plus particulièrement les gens du voyage et les mal-logés, qui simplifie les démarches des préfets pour faire évacuer tous les campements ou tous les squats, de force, s’ils présentent de graves risques pour la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique. Désormais on peut expulser sous 48 heures, partout, même sur des terrains dont les occupants sont propriétaires, sans respecter la trêve hivernale et sans proposer de solutions de relogement. Ca vise aussi les grands rassemblements religieux sur des anciens aéroports par exemple. En 2011 ça vise plutôt la « communauté Rom » qui ne correspond pas à celle des Tziganes en 1900 ni aux nationaux itinérants. Je citerai Stéphane Lévèque, responsable des Etudes tziganes : « L’histoire dira comment les préfets vont appliquer cette mesure et tout est à craindre ».
Le bilan, un siècle après la première législation française par rapport aux gens du voyage, c’est qu’ils sont toujours marqués aujourd’hui par un statut particulier, au moins aux yeux des législateurs. Ces populations, bien que françaises, je le répète parce que c’est vraiment important (je peux citer des noms de familles : des Lafleurs, Duvic, Pic, Chevalier) sont conditionnées administrativement. On est dans un pays où sont inscrites l’égalité, la fraternité, la solidarité pour tous les citoyens dès la naissance. Le sentiment d’exclusion, la volonté de différencier et de marquer de façon ostentatoire une population, ne peut que nous amener à nous interroger sur notre perception en tant que « Tzigane » ou non-Tzigane. Comment éviter ce sentiment d’exclusion lorsqu’on hérite de façon quasiment systématique d’une situation dès la naissance ? Il y a un documentaire sur les carnets anthropométriques de Raphaël Pillosio où il y a une interview où quelqu’un, par rapport à la demande de la carte nationale d’identité, répond « Non, non ce qui fait que je suis différent c’est mon carnet de circulation ». Donc comment avoir envie d’appartenir par un papier à une communauté, un ensemble, alors que depuis des générations (transmission orale, point commun à tous les Tziganes) elle est traitée « négativement » ? Comment se projeter dans cet ensemble-là ? Lorsqu’on est victime de contrôles divers et variés comment se sentir dans la normalité ? Cette population est française, a participé à la construction de la France et contribue au niveau local à la vie sociale, culturelle, économique, et quand bien même, pourquoi ils devraient se justifier alors que le reste de la population n’a pas à le faire ?
Le travail d’historien est aussi marqué par ce prisme : les seules sources qu’on a, (on parle de personne à majorité de tradition orale) ce sont les archives, de la police, gendarmerie, administratives, donc un prisme assez étroit. On n’a pas le ressenti des gens. Il manque une partie de la problématique. Et il reste un travail énorme à faire au niveau national pour avoir une vue globale.
Christophe Nouhaud : De quelle manière ce cadre discriminatoire pèse-t-il sur la vie quotidienne des gens du voyage, en Limousin, en Haute-Vienne en particulier ?
Jean Nicolas
On a créé Ma camping en juin 1993 un peu pour ce qui a été dit et aussi parce qu’il y a vingt ans, en parcourant le département, on a rencontré des situations inacceptables c’est-à-dire que l’humanité de ces gens-là était négligée. En 2013, dans certains endroits de la Haute-Vienne, elle continue de l’être et il faut faire quelque chose. Ma camping 87 c’est essentiellement de l’accompagnement social et juridique. L’article 2 des statuts le précise, faire en sorte que la population Rom, Tzigane, voyageuse, arrive à se prendre en charge par elle-même. Une fois de plus, ce soir, ce sont des Gadjés qui parlent à leur place. Le jour où à notre place il y aura un Rom, un Tzigane, un Voyageur nous auront accompli notre mission.
Daniel Lévy
Ce qu’a dit Jean est pertinent et notre association a 10 ans. Am Kéténès veut dire « Tous ensemble » en Romani, parlé par les Manouches. L’article 2 c’est : faire connaître les Tziganes et leur culture, donc de temps en temps on organise des spectacles. Et effectivement comme le disait Jérôme, l’attraction/répulsion est un peu une constante dans les relations entre les sédentaires et les « gens du voyage » : autant les gens viennent assister aux spectacles, surtout quand il s’agit de musique ou de cinéma, autant ce n’est pas exactement les mêmes réactions quand on voit des caravanes arriver près de chez soi. L’actualité est toujours présente et les travaux des historiens sont essentiels. Pour comprendre une situation il faut vraiment remonter dans l’histoire. On a un projet de cycle de documentaires pour l’année prochaine avec notamment les documentaires de Raphaël Pillosio sur les carnets anthropométriques. Il faut essayer de faire parler comme disait Jean, les gens du voyage eux-mêmes, de leurs problèmes et de leurs problèmes. Il y aura aussi un film sur la tentative de génocide avec Mémoire tzigane, l’autre génocide, un film récent, etc.
CN : Dans ce qu’a dit Jérôme on a vu que la Loi Lopsi 2 avait renforcé tout un arsenal répressif à l’encontre de différentes formes, non conventionnelles, de mode de vie et d’habitat. Comment, Paul Lacoste réagis-tu à tout cela ?
Paul Lacoste
HALEM réunit aussi bien des voyageurs, que des travelers, des habitants en yourtes, en cabanes, en tipis, de toute sortes d’habitats non ordinaires, atypiques mais effectivement lors du vote de la loi LOPSI 2 à l’Assemblée on a suivi tout le parcours de la loi. On a proposé très rapidement de faire des campements dans la ville car rien n’est plus insupportable pour ces beaux messieurs que de voir s’installer des campements très variés avec de l’information sur une loi en cours que la plupart des Français ignoraient : on votait dans leur dos tout un arsenal répressif et sécuritaire. Dans certaines villes ça a eu un certain succès, une répression féroce dans d’autres villes. Ce que peu de gens savent c’est que l’article 32 ter A a été censuré par le Conseil constitutionnel, celui qui prévoyait que le préfet pouvait expulser en 48 heures. Le Conseil considère que ce n’était pas conforme parce que ce délai ne permettait pas aux gens de présenter leur défense dans des conditions acceptables. Le lendemain c’était le séisme au Japon qui occupait tous les tabloïds mais un journaliste a relevé que c’était un véritable séisme parlementaire parce qu’il y a eu 13 articles censurés, ce qui assez rare. Mais Sarkozy, quand il était ministre de l’intérieur, a fait voter une loi très proche et qui permet d’expulser des terrains privés, sur plainte, en saisissant les véhicules. Là, il n’y a pas eu de bronca et si la loi est appliquée et notre ministre actuel a déclaré, lors de la présentation de la loi Raimbourg sur le statut des gens du voyage : « nous appliquerons la loi, si il y a une aire d’accueil dans les vingt kilomètres, on expulsera ». Nous, à HALEM, on pense qu’il faut être tous solidaires sur ces questions-là y compris les sédentaires, qui sont concernés. Toutes ces problématiques, de la gestion des populations, qui met toujours à l’index les plus nécessiteux ou ceux qui ont choisi des modes de vie différents, c’est très préjudiciable à l’évolution sociétale. Sur la question de la loi Raimbourg : ça semble très difficile de faire évoluer le statut des gens du voyage et actuellement il y a la loi ALUR qui est en débat et plusieurs articles concernent les gens du voyage. L’article 53 veut reconnaître les différentes formes d’habitat pour les inclure dans la partie constructible des plans locaux d’urbanisme, mais c’est très difficile d’avancer vers le droit commun. La véritable difficulté, c’est la question de la liberté d’aller et de venir et, au-delà de l’urbanisme, c’est une question de foncier et de spéculation. Pour finir, un extrait d’Edgar Pisani dans L’Utopie foncière : « J’ai longtemps cru que le problème foncier était de nature technique, juridique, économique et qu’une bonne dose d’ingéniosité suffirait à le résoudre. J’ai lentement découvert qu’il était le problème politique le plus significatif qui soit parce que notre définition et notre pratique foncière fondent tout à la fois notre civilisation et notre système de pouvoir, façonnent nos comportements ». C’est vrai que c’est étonnant d’imaginer qu’on puisse seulement être propriétaire d’une habitation qu’on pose sur un terrain dont on n’est pas propriétaire mais dont on a la jouissance. On respecte l’environnement, on respecte son voisinage, on noue du lien social mais on n’a pas cette problématique de spéculation et d’appropriation de la terre. C’est assez déprimant de voir la difficulté de faire avancer la question de l’habitat démontable, écologique, malgré la bonne volonté de certains élus locaux ou dans les administrations, et de voir l’état de réalisation de la loi Besson quand on voit qu’il n’y a que même pas 50% des aires d’accueil réalisées, qu’il manque un grand nombre d’aires de grands passage. En Haute-Vienne sur la question des terrains familiaux on en est encore à l’état de projet, alors que dans le dernier plan sur les logements des défavorisés il était prévu de développer des actions et rien n’a été réalisé. Et ces aires d’accueil sont bien souvent des aires de relégation, à côté de déchetteries, d’autoroutes, très éloignées des centres. Mais bon, il ne faut pas perdre espoir et se battre, montrer les réussites, qu’il y a des façons de développer l’harmonie.
Un intervenant :
Je voudrais savoir si le Conseil constitutionnel a aboli cette question des trois ans quand on a quitté sa commune de rattachement pour l’inscription sur les listes électorales.
JB :
Il fallait être rattaché à une commune, au moins pendant trois ans, après les 18 ans, pour s’inscrire sur les listes électorales. Fin 2011 cela passe à 6 mois au lieu de trois ans précédemment. Il y a quand même encore une discrimination, sachant que pour nous tous c’est avant la fin de l’année pour les élections de l’année prochaine.
Un intervenant :
Il y a le droit de vote, mais est-ce que les nomades ont été appelés sous les drapeaux ?
JN :
Certains oui, de la même façon que dans la Résistance il y a eu beaucoup de Tziganes (je n’aime pas le terme de voyageurs).
PL :
D’ailleurs François Hollande pour le 11 novembre 2012 a invité les associations de Tziganes. Et en 1914-1918 ils étaient recrutés pour conduire les attelages de chevaux. On les voit rarement sur les monuments aux morts.
JB :
Comme toutes les personnes françaises ils ont joués un rôle dans toutes les guerres. Il y en a sans doute qui ont collaboré.
Un intervenant :
Je trouve que tout à l’heure Jérôme a minoré l’extermination des Tziganes par les Nazis. Il y a un bouquin qui s’appelle L’holocauste oublié, de Christian Bernadac.
JN :
Il y a une remarque qu’il faut faire, c’est que notre pays n’a toujours pas reconnu officiellement le génocide tzigane.
PL :
C’est la question de la spoliation. On a avait Raymond Gurême à Saint-Junien, il n’a pas été dédommagé. Quand il a été interné avec sa famille, ils ont perdu le cirque, les animaux, leurs roulottes, le cinéma muet. Ils amenaient de la vie, de la culture, la fête dans les villages. Et l’Etat français n’a jamais rien fait. Sa famille est morte de faim, de maladie, de froid dans les camps. A part un discours d’un ministre des anciens combattants, il n’y a pas de reconnaissance.
JB :
Régulièrement on demande aux diverses associations qui représentent les communautés de venir poser la gerbe de fleur pour le 11 novembre ou le 8 mai.
En juillet aussi pour la commémoration de la déportation.
Une intervenante :
Je suis éducatrice à Ma camping, je reçois tous les jours des gens par rapport à leurs droits. Par rapport à la carte d’identité et au carnet de circulation, ceux que je vois ont laissé tombé le carnet et veulent une carte d’identité. D’autres, ceux qui avaient le carnet qu’il fallait viser tous les trois mois, il n’était pas tamponné. Quand ils se font contrôler par un gendarme ou un policier un peu trop zélé, ça ne passe pas. C’est facilité depuis la loi du 5 mars 2007 sur le logement opposable : il est donné aux mairies, aux CCAS de faire une élection de domicile pour les personnes rattachées. Avec ce document elles peuvent se faire éditer une carte d’identité. A un moment donné, derrière c’était marqué « commune de rattachement ». De plus en plus c’est juste l’adresse de la mairie qui est notée. Donc c’est moins stigmatisant.
JB :
La sédentarisation qui évolue porte ses fruits aujourd’hui. De plus en plus de familles se sédentarisent au moins avec l’achat d’un terrain et la possibilité de poser une boîte aux lettres. C’est depuis la fin des années 1980. Et pour autant ils ne sont pas obligés de changer de mode de vie. Pour la Haute-Vienne c’est souvent des tournées qu’on fait donc on repasse toujours au même endroit et on a souvent un lieu où on va passer plus de temps, pour les migrants. A une époque il y avait des contournements pour éviter le carnet anthropométrique et aujourd’hui c’est pour avoir une carte d’identité.
L’intervenant précédente :
J’ai aussi des personnes sédentaires qui conservent quand même le carnet de circulation parce que pour la scolarisation au niveau du collège ça se fait beaucoup par correspondance et au niveau de l’Education nationale, il faut faire une demande pour les cours par correspondance en justifiant le handicap, la maladie ou l’itinérance et pour ça l’inspecteur d’académie demande le livret de circulation. Quand vous refaites votre carte vitale avec la photo, on vous demande une copie de votre carte d’identité, le livret de circulation n’est pas valable, il doit être photocopié avant d’être validé.
JB :
Dans le documentaire de Raphaël Pillosio on voit des gens pour qui le carnet est le symbole de leur mode de vie à eux et c’est peut être ce qui leur reste pour montrer leur différence face aux autres, aux gadjés.
Daniel Lévy :
Je suis médecin, j’ai une approche de l’utilisation de la carte vitale. Une réflexion qui me vient souvent par rapport au mode de vie, à la sédentarisation, au nomadisme. On constate que depuis l’arrivée de ces populations au XVème siècle, malgré les tentatives discriminatoires, de sédentarisation, ils sont quand même attachés à une mode de vie, qu’ils ont partiellement conservé, un mode de vie remarquable par sa différence avec les sédentaires que nous sommes. Malgré tout ils ont quand même cette volonté de continuer à vivre comme ça. La sédentarisation j’ai l’impression, (je vois les gens dans les aires d’accueil, de confinement), que la situation a beaucoup changé en 15 ans. Avant j’allais dans les friches industrielles et commerciales abandonnées, et c’est comme ça que je me suis fait expulser une fois d’un terrain. Aujourd’hui il n’y a presque plus de friches industrielles, il y a encore des groupes familiaux attachés à leur mode de vie, à leurs activités de vannerie. Ce que je constate, c’est que les gens que je vais voir dans des appartements à Limoges, c’est dans les pires qu’on trouve à Limoges, des immeubles laissés à l’abandon. Ils disent qu’ils ne supportent pas bien de vivre trop longtemps en appartement. Ca les angoisse. Des familles démunies, qui vivent de l’aide sociale, quand elles sont en caravane dans un endroit un peu champêtre, ça va ; mais quand elles se retrouvent en appartement, on assiste à une quart-mondisation très rapide.
JN :
Je suis d’accord à 100% avec toi. C’est pour ça que je suis contre la sédentarisation. Il y a différents types de sédentarisation : obligée (celle dont Daniel vient de parler) et la sédentarisation volontaire. J’ai des exemples : sur Magnac-Laval, il y a une sédentarisation volontaire, une vieille ferme rénovée qu’ils arrangent. Ils sont de Marseille (Le Mirabeau) et eux ils ont réussi à faire que leur lieu de sédentarisation est devenu un lieu de vie passager. Il y a de la famille et eux –mêmes continuent de circuler entre Marseille et Magnac-Laval, ce qui fait que leur sédentarisation elle existe, c’est un point de chute, tout en continuant à vivre comme avant. Et cela ne les empêche pas de scolariser leurs enfants et de vivre normalement. Ils ont ce que j’appelle la sédentarisation active. Et je suis d’accord avec toi quand tu dis que la sédentarisation en appartement est passive, avec toutes les pathologies. Et ça c’est un problème. Les aires d’accueil, je les ai défendues et je continue mais à un certain nombre de conditions. Dans certains endroits de France c’est un lieu où on les met pour être tranquille. Ici on a essayé qu’elles soient aussi des lieux de vie, pas de rebut ; Suivant les gestionnaires et les populations accueillies, ça marche ou pas. Ce n’est pas la panacée. Mais en Haute-Vienne on a réussi quelque chose qui ne marche pas si mal.
Un intervenant :
Loin de la pression médiatique derrière le discours de Jérôme, pour moi, se dessine un modèle de lecture de l’histoire : celui d’Ibn Khaldun, grand historien arabe qui explique la mort des civilisations par l’envahissement des nomades. Et quand on voit la liste des restrictions à travers lesquelles tu as lu leur histoire, est-ce que ces populations nomades représentent une menace pour la civilisation occidentale ?
JB :
Ce que je peux dire c’est qu’il n’y a pas de menace dans les faits, que ce sont des spéculations, un travail purement imaginaire. C’est la législation qui crée le délit (vagabondages, défaut de vaccination, de visa…). Par rapport à l’ensemble de la population, les trois catégories représentent à peine 3% des crimes et délits, dans les archives en 1913-1915.
Un intervenant :
Ce serait bien d’avoir une précision sur les raisons pour lesquelles ces peuples sont devenus itinérants. Alain Régnier dit une chose intéressante : dans la population globale européenne les Tziganes sont sédentaires, et s’ils ont utilisé ce mode de vie c’est plus un mode de fuite, et dans bien des endroits où ils se trouvaient ils étaient chassés. Sur ce constat il ne faut pas trop fantasmer sur ce mode de vie et la liberté qu’on peut éprouver comme ça.
JB :
Oui c’est la vision romantique, avec la diseuse de bonne aventure, le foulard dans les cheveux, le montreur d’ours, avec la roulotte… Je vous invite à lire le livre de Henriette Asséo.
L’intervenant précédent :
Je ne demande pas qu’on me réponde. Il ne faut pas perdre de vue qu’en Haute-Vienne il y a une pauvreté caractéristique de ces gens-là, qui sont relégués sur des terres agricoles ou des terres dont ils sont propriétaires et dont ils sont expulsés. Donc il y a des conditions de précarité qui font qu’ils ont une réelle difficulté à s’insérer. « S’insérer », voilà un mot dur à utiliser. Je ne sais pas moi-même si je le suis très bien, « inséré ». Mais à un moment il y a un certain nombre d’accès à la société qu’il est nécessaire d’avoir. Ces gens-là souffrent et ce n’est pas parce qu’ils sont d’origine manouche ou autre, mais parce qu’ils sont dans la précarité. Je crois que pour ces gens-là, peut-être plus que pour d’autres, on a beaucoup de mal à intervenir pour aménager des situations qui soient décentes. Il y a simplement des positions politiques à prendre au niveau du département.
JB :
J’ai beaucoup de mal à généraliser. J’en connais qui vivent dans l’aisance comme dans la précarité. Et la précarité n’est pas forcément synonyme de manque d’hygiène. Certes il y a des terrains, partout en France, avec des scandales comme le saturnisme.
JN :
Je rejoins là l’expérience du toubib. Ce n’est pas la génération d’aujourd’hui, ces familles en question, qui sont touchées par la précarité. Si on regarde les parents ou les grands-parents on retrouve la même précarité. Comment se fait-il que de génération en génération ces familles se retrouvent toujours au-delà de la précarité, je dirais dans la marginalisation ?
Un intervenant :
On a fait une soirée sur les Tziganes, les Manouches, etc., en leur absence. On parle de leurs droits en leur absence. Les travailleurs, les ouvriers, eux ils se sont organisés pour se défendre. Là il y a une difficulté. En plus, on a créé une catégorie alors qu’il y a plus qu’une diversité de ces populations. C’est une catégorie qui est aussi cloisonnée, où il y a un fort déterminisme politico-administratif dans son histoire. Et on voit aussi, même si on veut trouver comme trait commun le mode de vie, que ce n’est pas forcément un critère généralisable. Est-ce la langue ? La nationalité ? C’est quand même assez gênant que pour se garantir on doive s’affirmer comme « Tzigane français de souche », ça peut aussi amener à réfléchir. J’ai été très content de participer à ce débat mais je vois derrière ça une certaine complexité et une difficulté de saisir la vie et d’agir par rapport à tout ça.
PL :
C’est vrai que ce texte de la loi ALUR sur la reconnaissance de la diversité de l’habitat et l’obligation de l’inclure dans les plans d’urbanisme, c’est un peu dommage, mais les sénateurs disent : « Non, on est contre la pratique du pied-à-terre. » Mais combien ils en ont, ces messieurs ? On parle de familles qui échouent sur un petit lopin de terre agricole ; parfois ils ont les permis de construire ; mais ils n’ont finalement rien fait. Est-ce que leur désir profond c’est de se poser, d’accéder à la reconnaissance sociale, à la stabilité ?
Ce n’est pas une utopie, le voyage ; mais peut-être est-ce une envie de vivre plus léger, avec un certain détachement, plus près de sa culture, des autres, d’une vie de communauté.
Compte rendu de la soirée du 6 juin 2013, rédigé par Christophe Nouhaud.