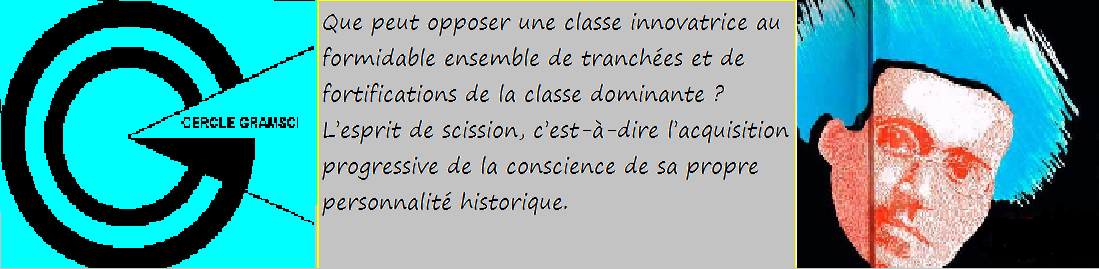Compte rendu de la soirée du 21 janvier 2014
Introduction de jean-Louis Vauzelle.
Nous venons d’entendre «We shall overcome», l’hymne officieux du combat pour les droits civiques dans les années 1960 : « Nous vaincrons, nous vaincrons, un jour nous vaincrons ». Bruce Springsteen la remet au goût du jour à la fin des années 1990 et durant la campagne d’Obama. Cette chanson est le prototype du protest-song et son effet sur la mobilisation fut indéniablement positif. Ce soir nous allons nous pencher, non sur la chanson mais sur le polar et essayer de comprendre quel effet émancipateur il peut nous offrir. Soirée dont le titre aurait pu être «les livres peuvent-ils changer le monde ?»
En 2000, nous avions déjà organisé une soirée « Polar : quels regards sur le monde ? » avec Jacques Migozzi et Jean-Bernard Pouy. Le thème du polar, porteur d’un questionnement sur le monde avait été assez largement décortiqué (cf le compte-rendu sur le site du Cercle). Il y avait à la tribune ce soir-là Serge Vacher, et nous lui dédions cette soirée.
[passage d’une plage du CD « Les quais », une histoire avec accompagnement musical enregistré en 2000. Laurent Cagnon, Serge Vacher et Alain Niarfeix].
Serge, un amateur de polars, un auteur de polars, fondateur, cheville ouvrière, pilier du fanzine La Vache Qui Lit avec son édito toujours inimitable.
Pour revenir à la soirée, souhaitons qu’il n’y ait pas trop de “baston” entre puristes quant aux définitions de l’objet : polar, roman policier, roman noir, roman à énigme, etc. Pour ma part, j’aime bien roman noir.
Dans le monde de l’édition, le roman noir représente 1 livre sur 5 publiés, 52 millions en 2011. Grosso modo, 8000 nouveautés sortent chaque année en polar.
Pourquoi lit-on un polar ? et même « qui n’a jamais passé une nuit blanche pour une série noire » ? Evidemment, le suspense, l’énigme, l’enquête tiennent le lecteur mais aussi d’autres dimensions : classiquement, des raisons prosaïques comme l’anti-intellectualisme, le plaisir, l’identification, le voyage, l’évasion, la facilité, on pose/on reprend, un antistress, anti-fatigue. A propos de l’intellectualisme, Serge disait en rigolant qu’à Limoges, vu le nombre d’auteurs, ils allaient constituer “ l’école de Limoges ” : un peu comme l’école de Brive mais en moins “ parisien ”.
Autre raison de lire du polar, un sentiment de justice possible. Dans le polar, les comptes se règlent généralement de manière directe, d’homme à homme. La justice du héros passe même si elle s’oppose à la loi et cela produit un certain plaisir. Le traître souvent paye. La toute-puissance du héros, sa dimension idéale proche du cow-boy solitaire nous fascinent et permettent une identification très séduisante. Il faut dire que le polar a beaucoup évolué au long du XX° siècle. Schématiquement on est passé de “ qui a tué ? ” à “ pourquoi y a-t-il eu crime ? ” : “ le roman noir est une vision du monde ajoutée au récit d’un crime ” L. Devillairs. Le polar passe dans le rayon de la “ parasociologie ”, il était déjà dans celui de la parapsychologie.
Je n’ai pas pu me priver de vous lire ces deux courts extraits comme illustration.
Premier extrait : Tom Franklin, La culasse de l’enfer : « les propriétaires terriens les plus en vue de la région ne se souciaient que des gens des classes moyennes et supérieures et se foutaient complètement de celui qu’on tient pour un moins que rien, le cultivateur de coton qui trime dans ses champs de l’aube au coucher du soleil et dont la production est le pilier de toute l’économie. » Autre bien belle manière de dire « Ceux qui produisent tout n’ont rien et ceux qui ne produisent rien ont tout » (Alexandre Jacob,1905).
2° extrait : « A Bethlehem,la plupart des gens suivent des chemins tout tracés par cette complicité naturelle qu’orchestrent le rang social et les inclinaisons personnelles, de telle sorte que la fille d’un médecin épouse un médecin ou suit elle-même cette carrière, de même que l’ambitieux fils d’un ouvrier de scierie a davantage de chances de s’élever au métier de charpentier plutôt qu’à la profession d’architecte. » (Christopher Cook, Bethlehem, Texas). Là, ça me fait vraiment penser à la notion sociologique d’habitus.
Autrefois décrié, méprisé associé aux littératures populaires, “ de gare” le polar, nouvelle peinture du monde moderne, a pris l’ascenseur de la légitimité culturelle. Dans la Pléïade, après Shakespeare qu’est-ce qu’on trouve ?… Simenon.
Du coup, le polar entre à l’école, au collège, au lycée sans doute.
Deuxième point dont il est question ce soir : la gauche. Ca va quand même pas fort, du côté de la pensée, surtout de la pensée de la gauche au pouvoir. Pour illustrer l’écart qui s’est creusé entre la gauche au pouvoir et la gauche, je vais vous parler de Sylviane Agacinski. Elle a été prof à l’EHESS de 1991 à 2010. La femme du candidat socialiste tint un journal durant la campagne électorale pour la présidentielle de 2002, journal publié quelques mois plus tard : Sylviane Agacinski, journal interrompu, 24 janvier-25 mai 2002. Interrompu, vous savez pourquoi. Cette chronique d’une défaite non-programmée s’ouvre à la date du 24 janvier 2002. C’est le jour où fut annoncée la mort de Pierre Bourdieu. Elle n’en fait même pas état ! Bourdieu ne représente rien pour elle, si ce n’est un ennemi sans doute. Pas un mot sur ses livres, son influence considérable dans les sciences humaines et sociales, sa place dans la pensée de gauche. Rien. Par contre, elle s’en prend violemment à Jacques Derrida qui avait refusé de soutenir Jospin, en ayant même le mauvais goût d’invoquer quelques principes moraux sur la manière dont on traitait les immigrés en France. A l’époque Bourdieu était très présent dans l’actualité, parlant de “ la fausse gauche ” opposée à “ la gauche de gauche ” (et non à “ la gauche de la gauche ”, distinction fondamentale). Faut dire que les matières à critique ne manquent pas. François Mitterand écrivait, dans l’autre siècle : “ Celui qui n’accepte pas la rupture avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, ne peut pas être adhérent au parti socialiste.” Effectivement, Jospin s’est prévalu du fait que son programme n’était pas socialiste. Depuis nous avons un président social-démocrate. Si seulement !
Cette évolution, du refus du capitalisme au libéralisme, consista à faire passer désormais pour “progressiste” et “moderne” tout ce qui avait appartenu jusque-là au répertoire de la pensée de droite, et pour “totalitaire” et “archaïque” tout ce qui définissait la pensée de gauche et notamment – et principalement – la pensée critique (Didier Eribon). Les références intellectuelles de la gauche devinrent donc les mêmes que celles de la droite, c’est-à-dire qu’elles devinrent des références de droite. Concrètement, cela s’est traduit par une destruction des droits qui avaient constitué autant de conquêtes des luttes sociales en France, destruction d’un “type de civilisation”, dixit Bourdieu. La conférence de presse du Président avec pour sujet essentiel l’économie, est l’illustration de l’absence de pensée de gauche. La technocratie, l’économie omniprésente sont une vraie entreprise de dépolitisation, en sous-tendant l’impossibilité de faire autre chose que rassurer les marchés. Paul Krugman, prix Nobel d’économie 2008, a fait le commentaire suivant à propos de cette conférence : François Hollande a proposé “des politiques économiques de droite discréditées, des principes conservateurs erronés et butés, un effrondement intellectuel…et c’est ainsi que la seconde grande dépression de l’Europe va continuer…”
Je tiens à rajouter deux points :
– la pensée politique, la pensée de gauche ne saurait se cantonner à l’économie, la croissance, la consommation ou à quelques sujets de société instrumentalisés (IVG, Dieudonné) afin de détourner de chantiers autrement plus essentiels tels que l’écologie, la fiscalité, la solidarité, l’internationalisme… Cette pensée de gauche pourrait prendre en compte «le paradoxe du bonheur» désignant l’existence d’une corrélation nulle ou négative entre le bonheur et l’accès aux biens de consommation.
– bien que très admiratif devant certains intellectuels de gauche, et leur étant très reconnaissant, ils ne sont pas les seuls dépositaires de la pensée et je crois beaucoup à l’intellectuel collectif.
Nous sommes très heureux d’avoir parmi nous Phillippe Corcuff. Un déplacement long, du temps, du travail, on le remercie vivement. Philippe Corcuff, “ un intellectuel total”. Il produit et écrit de la pensée et c’est un militant. Il a changé souvent de parti, – par désenchantement ? – mais de la « gauche molle » vers la gauche plutôt que l’inverse (du col mao au rotary) comme ce fut le cas pour beaucoup d’intellectuels. Il va tenter, à l’aide du polar, de nous insuffler une énergie critique, peut-être de nous expliquer ce que pourrait, devrait être une pensée de gauche.
PS : Serge Vacher lisait et écrivait des polars, il animait et réalisait aussi un fanzine, La vache qui lit, qui représentait beaucoup pour lui et pour d’autres.
Un petit groupe se propose de relancer un fanzine, tout reste à préciser, je ne rentre pas dans les détails. Il ne s’agit pas d’imiter le travail de Serge qui était justement inimitable mais plutôt de faire vivre un support où les amateurs de polars se retrouveraient. Si certains sont intéressés, ils peuvent me contacter : jean-louis.vauzelle@wanadoo.fr
Je voudrais introduire ce soir notre discussion à partir de quelques-unes des analyses présentées dans mes deux derniers livres :
Le premier livre est paru en octobre 2012, sous le titre La gauche est-elle en état de mort cérébrale ?, et se présente comme un court pamphlet. Le titre apparaît avoir encore plus d’actualité un an après !
Le second livre, paru il y a quelques semaines, en octobre 2013, propose des réflexions philosophiques et sociologiques à partir d’un matériau inhabituel pour les sociologues et les philosophes : la littérature policière, et plus particulièrement le roman noir de tradition américaine ; son titre est Polars, philosophie et critique sociale.
Ces deux livres s’inscrivent, sous des formes différentes, dans un sillon commun qui est la réinterrogation des « logiciels » de la critique sociale et de l’émancipation. Si j’emprunte une métaphore au vocabulaire informatique – avec l’expression « logiciels » -, c’est pour pointer un niveau peu souvent perçu aujourd’hui. Car on a souvent tendance aujourd’hui à se jeter prématurément sur des « réponses ». Dès lors, on n’a plus le temps d’interroger les « logiciels » de la pensée, c’est-à-dire les modalités mêmes de formulation des problèmes et des questions pertinentes. Et en n’interrogeant pas les « logiciels », on génère souvent des réponses analogues, assez convenues et décevantes.
C’est pourtant ce niveau, fréquemment oublié aujourd’hui, qui a fait la fierté du travail intellectuel dans le sillage des Lumières du 18e siècle : la formulation des problèmes, le questionnement des préjugés et des stéréotypes, la mise à distance des automatismes et des évidences, la prise en compte des complications des questions contre les manichéismes et les simplismes. Et, second niveau superposé au premier : le meilleur libertaire de l’esprit des Lumières suppose que pour tenter de maladroitement « penser par soi-même », il faut s’efforcer de « penser contre soi-même », c’est-à-dire par exemple d’interroger les évidences de sa propre « famille » politique. C’est ce que je vais aussi tenter ce soir, dans une démarche qui sera aussi autocritique.
Quelques éléments de constat d’abord. Je fais ainsi le constat polémique que des tendances désintellectualisatrices importantes sont à l’œuvre dans les gauches aujourd’hui. Ce qui introduirait une rupture fondamentale dans l’histoire moderne de la notion de « gauche » qui, tout particulièrement en France, a depuis ses origines souvent été associée à une activité intellectuelle. Et cela depuis la Révolution française, où le mot « gauche » apparaît, puis le grand moment de « l’affaire Dreyfus » où l’expression « les intellectuels » intervient pour qualifier les dreyfusards, jusqu’aux grandes figures de l’engagement intellectuel, de Sartre et de Beauvoir à Foucault et Bourdieu. Cette pente désintellectualisatrice ne signifie pas qu’il n’y a plus d’idées à gauche. On y trouve même nombre d’idées, mais trop fréquemment dans un fatras non réfléchi, empilées sous la forme de routines, d’habitudes, d’automatismes, d’évidences… Les articulations intellectuelles de la gauche apparaissent gonflées d’arthrite.
Ce qui tendrait à s’effilocher à gauche, ce n’est pas tant le lien avec les idées en général qu’avec le travail intellectuel, qui justement met au travail les idées assoupies ; et les pensées critiques qui, depuis au moins les Lumières, débusquent les préjugés, mettent à distance les stéréotypes, interrogent les évidences, questionnent les automatismes.
Toutefois, m’objectera-t-on, il y a encore des chercheurs et des collectifs intellectuels se réclamant de la gauche qui travaillent et qui pensent aujourd’hui. Oui, mais ce qui m’intéresse plus précisément ce sont les zones d’intersection et d’interactions entre organisations politiques, mouvements sociaux, associations, intellectuels professionnels, milieux artistiques et citoyens ordinaires dans l’élaboration d’idées de gauche.
Ce sont de telles zones de dialogues et de confrontations entre ces différents groupes qui tendent à être tout particulièrement anémiées actuellement. Ces zones sont moins anémiées du côté des gauches radicales que du côté de la gauche sociale-libérale de gouvernement, mais les gauches radicales sont aussi affectées.
A partir de ce constat, mon topo aura deux temps principaux : 1) l’identification de trois automatismes transversaux au sein des gauches, des rails, des « logiciels » sur lesquels la pensée des gauches patine aujourd’hui, et 2) quelques pistes quant à un renouvellement intellectuel à gauche puisant dans le polar américain. La première partie puisera donc dans La gauche est-elle en état de mort cérébrale ? et le seconde dans Polars, philosophie et critique sociale.
Secouer les automatismes
intellectuels de la gauche
Je me contenterai ici, à titre d’illustration, de trois grands types d’automatisme de la pensée de gauche aujourd’hui, qui constituent des obstacles à un renouveau intellectuel à gauche, au carrefour des mouvements sociaux et des milieux intellectuels. Et il est important de noter que ces automatismes touchent la gauche sociale-libérale au gouvernement (et ses alliés écologistes) mais aussi une large part des gauches critiques et radicales, notamment à travers ce que j’appelle de manière provocatrice « la pensée Monde Diplo’ ».
L’automatisme présentiste
et son vis-à-vis nostalgiste
Le premier « logiciel », ou plutôt couple de deux « logiciels » travaille l’ensemble des gauches, mais aussi la droite et l’extrême droite. C’est le présentisme et le nostalgisme.
On ne peut pas, dans l’action, éviter d’être pris dans des urgences, mais le danger est d’être pris constamment et uniquement dans des urgences. Sans pendre le temps de réfléchir à ce qu’on fait, en dehors de l’action immédiate. Sans avoir le temps de mettre en rapport ce qu’on fait avec le passé et l’avenir dans une temporalité plus large. La gauche sociale-libérale de gouvernement est ainsi souvent asservie à la tyrannie de l’immédiateté, via notamment les médias.
Mais les milieux militants critiques sont aussi tentés de se laisser aller à un zapping continu.
Par exemple, c’est : un jour les retraites, un autre jour le gaz de schiste, un autre le nucléaire, un autre les Indignés, un autre les révolutions arabes ou la Grèce, un autre le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, un jour les Roms, etc. un jour Bové, un jour Besancenot, un jour Montebourg, un jour Mélenchon, etc. Et cela sans guère d’évaluation critique des difficultés du passé, ni projection claire dans un avenir différent.
Cette tendance apparaît en rapport avec un type de rapport au temps dont l’historien François Hartog (dans Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, 2003) a décrypté la pénétration dans les sociétés actuelles : ce qu’il appelle « le présentisme ». Les sociétés les plus traditionnelles auraient fait du passé le point de référence principale, et les sociétés modernes, avec les Lumières et la notion de « progrès », on fait du futur la référence principale. Aujourd’hui, avec une certaine crise du « progrès » et de l’avenir, ce serait le présent qui deviendrait une référence montante. Le « présentisme », ce serait un enfermement dans le présent, de plus en plus déconnecté du passé comme du futur. C’est une sorte de culte implicite d’un présent perpétuel, de l’immédiateté, sans arrêt recommencée et constamment décevante.
Le futur serait mangé par le présent et le passé serait aussi mangé par le présent. Bref nous dit Hartog : on a affaire à « un présent monstre », « Il est à la fois tout (il n’y a que du présent) et presque rien (la tyrannie de l’immédiat) ». Ce rapport au temps est ajusté au capitalisme contemporain et à sa logique néolibérale : le mouvement d’expansion de la marchandise, accompagné par le mouvement de la publicité.
Face au présentisme, un autre travers est souvent activé : la nostalgie d’un passé fantasmé ou le « c’était mieux avant ! » à la Alain Finkielkraut, mais qui a une prégnance beaucoup plus large. C’est une autre façon de paralyser l’action : non pas par le mouvement de surplace du présentisme, mais dans la contemplation d’un passé mythifié ne permettant pas de se coltiner les défis du présent. Car plutôt que de tenter de répondre aux enjeux actuels, on regarde surtout la vie dans le rétroviseur.
Face à cette double tendance (présentiste et nostalgiste), il faudrait essayer de retrouver tout à la fois des racines dans une mémoire critique du passé et des repères quant à un avenir différent.
Il faudrait trouver les voies d’une nouvelle alliance de l’action présente avec le passé et le futur.
La diabolisation des médias
et l’oubli du “ s’émanciper ”
Le deuxième « logiciel » travaille aussi une bonne part des gauches, mais aussi la droite et l’extrême droite. C’est la diabolisation des médias. Mais elle a des conséquences spécifiques à gauche : l’oubli de l’horizon de l’auto-émancipation. Ce « logiciel » est en rapport avec le présentisme, mais le présentisme est plus large que la question des médias. Et souvent quand on critique les médias, on attribue à eux seuls les méfais du présentisme, alors qu’ils n’en sont qu’une des manifestations.
Ainsi quand il y a un problème, une explication simple et rassurante intervient souvent dans les milieux militants de gauche : « C’est la faute aux médias ! » ; formule dans laquelle se mêlent des accents conspirationnistes (dans la vision des médias-émetteurs) et une vision misérabiliste (quant aux dominés-récepteurs supposés complètement « aliénés »). C’est une des tendances manichéennes dans la critique sociale actuelle, particulièrement à l’œuvre dans les automatismes de la fameuse « pensée Monde Diplo’ ». Ce type de posture critique habituelle, avec ses impensés, pourrait nous empêcher de relancer le projet d’émancipation individuelle et collective à gauche. Pourquoi ?
La relance d’une perspective émancipatrice doit pouvoir clarifier un problème lexical qui se présente aussi comme un problème éminemment politique. Le cœur radical des traditions émancipatrices renvoie au verbe pronominal “ s’émanciper ”. C’est la fameuse formule écrite par Marx pour les statuts de la Ière Internationale ouvrière : « L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Il s’agit donc d’une auto-émancipation. Ce qui suppose que les individus et les groupes qui s’émancipent donnent un caractère actif, et non pas passif, au mouvement d’émancipation. Or il y a un risque à rabattre l’émancipation sur le verbe transitif émanciper (en oubliant le s’émanciper), par exemple dans le geste qui émancipe les esclaves. Or émanciper les esclaves, c’est distinct du combat d’un Spartacus qui s’émancipe lui-même.
Or, historiquement, tant l’instituteur républicain et socialiste que l’avant-garde révolutionnaire dite « léniniste » ont eu tendance à déplacer le s’émanciper vers l’émanciper, faisant apparaître de nouvelles « tutelles » vis-à-vis des opprimés. Et on peut observer dans la politique moderne la plus ordinaire que la professionnalisation politique continue à fournir à l’extrême-droite, à droite, à gauche et dans la gauche radicale quantité d’« hommes (ou de femmes) providentiels » prétendant émanciper le peuple. Ou dans les milieux militants, la « féministe historique » qui veut émanciper la prostituée ou la femme voilée sans elle ou même contre elle. C’est encore l’enseignant d’Attac qui veut émanciper les citoyens face aux effets de la mondialisation néolibérale, en sortant de leurs têtes les mauvaises idées pour mettre les bonnes (je suis moi-même membre du Conseil scientifique d’Attac et enseignant !). Ou le prophète de la décroissance qui veut désaliéner les autres des effets de la société de consommation… Il faut donc aussi pendre, encore une fois, ces critiques comme une autocritique.
Mais en quoi le fameux « c’est la faute des médias » est-il en rapport avec cette question de l’émancipation ? Les médias occupent une place accrue dans la politique contemporaine, mais une place encore restreinte, souvent exagérée par les journalistes comme par leurs critiques les plus manichéens. Par conséquent, critiquer radicalement les médias et diaboliser les médias renvoient à deux postures fort distinctes.
Une critique radicale des médias s’efforce de saisir des logiques dominantes, spécifiques (quête des scoops et du « nouveau », circulation circulaire de l’information, privilège accordé aux formats courts, etc.) et générales (types de propriété, logique marchande, rapports de classes, de sexes, discriminations racistes ou homophobes, etc.) qui travaillent la production des informations. Toutefois « le champ journalistique », selon l’expression de Pierre Bourdieu, est doté d’une autonomie relative et se trouve traversé de conflits et de contradictions. Bref du côté de l’émetteur, critiquer radicalement les médias, c’est donc penser aussi leurs contradictions, comme pour Marx critiquer radicalement le capitalisme, c’est aussi penser les contradictions du capitalisme, qui justement laissent ouvertes des possibilités d’émancipation.
Par ailleurs, les sciences sociales contemporaines ont affiné aussi leur regard pas seulement sur les émetteurs dans les médias, mais aussi les récepteurs.
Ainsi se sont développées à partir des années 1980 ce que l’on appelle « les études de réception » des médias (s’intéressant à la manière dont lecteurs, auditeurs et téléspectateurs reçoivent les messages médiatiques : comment sont reçues les informations, les séries télévisées, les émissions de divertissement, etc.). Ces études nous ont alors fait découvrir des récepteurs tendant à filtrer les messages qu’ils reçoivent (en fonction de leur groupe social, de leur sexe, de leur génération, etc.) et manifestant des capacités critiques différenciées (mais rarement nulles).
Une telle vision nous éloigne des représentations misérabilistes, si courantes dans les milieux critiques, d’une masse de téléspectateurs « aliénés », voire « abrutis », par « la propagande médiatique ». Les tenants de ce type de discours se demandent rarement pourquoi ce sont « les autres » qui sont ainsi « abrutis » par les médias, et comment ils échappent eux, comme par miracle, à ce supposé abrutissement généralisé. Dans cette perspective, où « les autres » sont appréhendés de manière élitiste et méprisante comme une masse informe et passive, il n’y a plus beaucoup de place pour une émancipation des opprimés par eux-mêmes. D’où le glissement subreptice et fréquent, dans la diabolisation des médias, du s’émanciper à l’émanciper. Partant, cette critique misérabiliste des médias tend à désarmer la critique sociale de certaines de ses potentialités libératrices, rejoignant l’instituteur républicain-socialiste et l’avant-garde révolutionnaire d’hier, comme les professionnels de la politique d’aujourd’hui. Cela se présente donc comme radical, mais cela révèle un noyau élitiste et conservateur.
Le « logiciel collectiviste »
Les mouvements sociaux et la gauche sont fortement marqués, tout particulièrement en Europe, par des routines quant au rapport entre l’individuel et le collectif, tant sur le plan de la critique du monde existant que des perspectives d’émancipation par rapport à lui. C’est ce que j’appelle « le logiciel collectiviste » ; le troisième « logiciel » transversal aux gauches, examiné aujourd’hui.
Qu’est-ce à dire ? La figure de l’individu est aujourd’hui souvent malmenée à gauche. « C’est la faute à l’individualisme », « Le néolibéralisme, c’est la promotion de l’individu », « La gauche, c’est avant tout le sens du collectif », « L’individualisme aujourd’hui fait perdre le sens du collectif », « Il faut opposer la solidarité à l’individualisme »… : ce sont des phrases courantes dans les échanges publics ou informels entre dirigeants, militants et sympathisants de la gauche et des mouvements sociaux de différentes couleurs politiques et intellectuelles en France. Cette vision des choses, fort unilatérale, laisse entendre que la droite et le capitalisme auraient une sorte de monopole de l’individu et que la gauche devrait prendre le parti du collectif contre l’individuel. C’est donc ce que je nomme l’hégémonie d’un « logiciel collectiviste » à gauche.
Et pourtant, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, des anarchistes (comme Proudhon, Bakounine ou Kropotkine), des syndicalistes révolutionnaires (comme Pelloutier et Pouget), un socialiste républicain comme Jaurès ou encore Marx, vont s’efforcer d’associer développement de l’autonomie individuelle et relations de solidarité, promotion de la créativité personnelle et cadres collectifs. Par exemple, le socialisme républicain de Jean Jaurès, en association avec le thème de « la propriété sociale » des moyens de production et d’échange, fera de « l’individu » une des valeurs cardinales de la gauche. Il va ainsi jusqu’à écrire : « Le socialisme est l’individualisme logique et complet. Il continue, en l’agrandissant, l’individualisme révolutionnaire » (Socialisme et liberté, 1898).
En France, c’est seulement après la guerre de 1914-1918 que le « logiciel collectiviste » va s’imposer à gauche, en dehors des courants libertaires et anarchistes, mais davantage marginalisés. Or, dans les sociétés individualistes qui sont les nôtres, ce logiciel « collectiviste » freine les possibilités des gauches, en n’arrivant pas à les faire parler aux « individus réels », pour parler comme Marx. Les « individus réels » dans nos sociétés sont davantage individualisés ; or, souvent les gauches ne parlent pas à ces « individus réels » mais à des individus imaginaires, tels qu’elles aimeraient qu’ils soient. Ce qui renforce le caractère inaudible des gauches.
Pistes pour renouveler
les idées à gauche à partir
du polar
Après l’identification d’obstacles, il nous faut formuler des pistes alternatives. Je vais puiser pour ce faire dans le polar. Dans Polars, philosophie et critique sociale, je m’arrête sur le roman noir américain né dans les années 1920, des écrivains classiques (comme Dashiell Hammett, Howard Fast, David Goodis, etc.) à des auteurs actuels (comme James Lee Burke, Dennis Lehane, George Pelecanos ou James Sallis).
Ma visée principale ? Fournir quelques repères quant au problème philosophique classique du sens de nos existences, dans le cadre d’une vision critique de nos sociétés inégalitaires et déréglées.
Une remarque de Raymond Chandler (une des deux figures fondatrices avec Dashiell Hammett) nous introduit à la double tonalité philosophique et de critique sociale du roman noir américain. Dans son essai de 1950, The simple art of murder (L’art simple du meurtre), Chandler écrit : « Ce monde ne sent pas très bon mais c’est celui où l’on vit ». Cette remarque de Chandler nous mène au centre des intersections entre la portée philosophique et la portée sociologique-critique du roman noir américain. Portée philosophique, car si cela « ne sent pas très bon », cela pose à la fois des questions afférentes au sens de l’existence humaine et aux réactions morales vis-à-vis des aléas et des déboires de la quête du sens. Portée sociologique-critique, car ces interrogations existentielles et ces sentiments moraux se situent dans les sociétés « où l’on vit », vues à travers des lunettes critiques dans leurs inégalités, leurs corruptions et leurs désordres divers, voire leur pourriture. D’emblée le polar américain formule, dans son registre littéraire propre, le problème philosophique classique du sens et de la valeur de la vie, mais il le fait à la manière des sociologues critiques. Non pas comme une interrogation intemporelle, mais dans des contextes sociaux et historiques précis, avec le scalpel de la critique sociale.
Cette critique sociale est particulièrement acérée par rapport au roman policier européen classique, par exemple avec Sherlock Holmes et Maigret. Ces derniers, comme l’a bien mis en évidence le sociologue Luc Boltanski dans son livre Enigmes et complots (2012), se situent par rapport à une énigme, manifestation d’un trouble de l’ordre social, qui peut être résolu à la fin. L’ordre social peut être rétabli sous l’égide de l’Etat-nation. Dans le roman noir américain, l’ordre ne peut pas être rétabli, le désordre d’une société basé sur l’argent roi et la violence est structurel. Et l’Etat lui-même est rongé par la corruption. Ce qui donne une portée politique plus radicale à ce genre littéraire, avec des tonalités anticapitalistes et anti-étatistes plus libertaires. Jean-Patrick Manchette, le créateur du « néopolar » français des années 1970 et grand amateur de romans noirs américains, a insisté sur la dimension morale de cette critique sociale radicale : « le polar est la grande littérature morale de notre époque ». Le fort sens moral des personnages du noir ne se cale pas alors principalement sur la légalité. Le juste déborde sans arrêt le légal. Et ce sens moral n’a rien d’une vision moralisatrice se prétendant « pure », au-dessus de l’action. Il est nécessairement « impur », au cœur de l’action, éclaboussé par les pourritures du monde.
A partir de ces quelques traits généraux, je fais le pari qu’en s’épaulant mutuellement polar, philosophie et sociologie critique peuvent nous aider à désembrouiller nos questionnements quant au sens et à la valeur de notre vie dans un rapport critique à la société existante. Il n’y a pas le plus souvent (sauf quelques exceptions) directement une politique exprimée dans le polar américain, mais une politique renouvelée de gauche pourrait s’inspirer utilement de ressources puisées dans le polar. Le polar pourrait donner un meilleur soubassement à une politique de gauche à réinventer, notamment à travers ses dimensions existentielles et éthiques. Bref, plutôt que de lire les cours de la Bourse et les sondages, comme la gauche « hollandaise », ou que lire Le Monde diplomatique, comme les gauches radicales, j’invite à lire des polars américains, classiques et contemporains. Dans cette seconde partie aussi, mon propos se déploiera en trois points, mais plus condensés et les pistes ne seront alors qu’esquissées.
Associer critique sociale
et sens de l’existence
Dans ce premier point, il s’agit de mieux lier la question philosophique du sens et la question sociologique de la critique de nos sociétés. Il s’agit, dans une politique de gauche, de donner de la chair existentielle, moins désincarnée, à la critique sociale et de donner une teneur critique à l’interrogation existentielle.
Prenons l’exemple de La lune dans le caniveau publié par David Goodis en 1953 (adapté au cinéma en France par Jean-Jacques Beineix en 1983), avec le personnage de William Kerrigan, docker habitant Vernon Street, rue de misère sociale où sa sœur a été violée, puis s’est suicidée. L’interrogation existentielle est constamment agitée en lui. Mais hanté par ce suicide et par le poids des contraintes sociales, William ne mènera pas jusqu’au bout une histoire d’amour avec une jeune femme issue d’un milieu aisé, Loretta. Goodis écrit par exemple :
« Cela le frappa de plein fouet, cette prise de conscience inévitable qu’il traversait la vie avec un billet de quatrième classe. »
Et puis à la fin du livre, son histoire et celle de sa sœur se rejoignent dans un fatalisme social et un tragique existentiel encastrés :
« Et quel que soit l’endroit où les plus faibles se cachaient, ils ne parvenaient jamais à échapper à la lune de Vernon. Elle les tenait pris au piège. Elle les tenait pris dans leur destin. Tôt ou tard, ils seraient mutilés, démolis, écrasés. Ils apprendraient à la dure que Vernon Street n’était pas un lieu pour les corps délicats et les âmes timides. »
D’où la séparation finale avec Loretta.
Il ne s’agit surtout pas ici de retenir le fatalisme social de Goodis. Mais simplement de prendre en compte le poids des contraintes sociales, sans en faire une fatalité. Et il s’agit alors surtout de se saisir de la façon dont le poids des contraintes sociales et la réflexion existentielle sur le sens de la vie se nouent l’un à l’autre. On trouve une figure originale ici chez Goodis. Le plan existentiel n’y est pas le simple produit des inégalités sociales, sans pouvoir être détaché d’elles. Il déborde le sociologique tout en étant tramé par lui. C’est comme si Goodis avait trouvé une articulation originale entre une philosophie existentielle et une critique sociologique, mais dans un registre proprement littéraire. Ce que l’on trouve rarement en philosophie, en sociologie et encore moins en politique. La gauche « hollandaise » aurait à la fois besoin de se revivifier par de la critique sociale et par de la densité existentielle. Les gauches radicales auraient besoin, quant à elles, de donner davantage de chair existentielle à leur critique.
Pistes mélancoliques
Ce second point me permettra de répondre au couple présentisme/nostalgisme. Selon ce nouvel angle, l’éthique du roman noir pourrait contribuer à la reconstitution d’une politique, une politique inspirée du polar. Plus précisément, le polar pourrait aider la politique émancipatrice à se doter de tonalités mélancoliques.
La notion de mélancolie renvoie ordinairement dans nos dictionnaires à un état de tristesse, de dépression, de spleen, de vague à l’âme. Dans son livre Le pari mélancolique (1997), le philosophe et militant Daniel Bensaïd a toutefois distingué deux formes historiques de mélancolie à partir du 18e siècle, un peu décalées par rapport à ces racines étymologiques. La première est la « mélancolie romantique » (celle des écrivains et poètes romantiques comme Charles Baudelaire), une mélancolie fortement nostalgique surtout tournée vers le passé.
Mais émergerait également ce qu’il appelle une « mélancolie classique » (celle des révolutionnaires Saint-Just et Louis-Auguste Blanqui), que l’on pourrait aussi appeler mélancolie radicale, une mélancolie ouverte sur l’avenir, sur la construction d’un avenir différent. Une mélancolie puisant dans le passé des ressources pour ouvrir un autre futur.
Une troisième mélancolie pourrait être dégagée : une mélancolie tragique, dont le cinéma de Jean-Pierre Melville, constitue une des expressions la plus limpidement sobre. Dans ses polars (Le doulos, Le samouraï, Le cercle rouge…) comme dans d’autres films (comme ce récit de la Résistance au scalpel cinématographique et éthique que constitue L’armée des ombres), Melville confronte la mélancolie au tragique, c’est-à-dire aux circonstances qui nous échappent et qui nous écrasent de douleur, comme dans les tragédies grecques ou de Shakespeare. La mélancolie tragique est associée chez Melville à une éthique tragique : une façon de se tenir face au tragique, une manière de maintenir une certaine intégrité malgré le tragique et devant le tragique. Cette mélancolie-éthique tragique est plutôt, à la différence de la mélancolie radicale, submergée par le pessimisme.
Le roman noir hésite alors, en fonction des auteurs ou parfois chez un même auteur, entre deux directions mélancoliques : la mélancolie tragique, qui le leste vraisemblablement le plus, et la mélancolie radicale, qui laisse ouvertes des trouées utopiques sous la forme de « peut-être ».
Un exemple de mélancolie tragique, adossée à une éthique du maintien de soi ? Je prendrais un des polardeux récents les plus intéressants, Craig Johnson, avec son shérif Walt Longmire dans le Wyoming. Son roman Little Bird (2005) pousse de manière incandescente la tension entre l’humour et l’inquiétude quant au sens de l’existence, et même entre l’auto-ironie et le tragique. A la fin du roman, la femme dont il tombe amoureux se révèle être la criminelle. Elle cherchait à venger le viol d’une jeune indienne, Little Bird, resté impuni, alors qu’elle avait elle-même été victime de la pédophilie de son père. Elle se suicidera à quelques pas de lui :
« – Walter, je veux que tu détournes les yeux.
– Vonnie, ne fait pas ça.
Il y eut un long silence. (…)
Elle le dit comme s’il s’agissait d’un commentaire sur le temps.
– Je t’aime.
Ce fut mon tour de détourner les yeux. Elle savait que je le ferai. »
Dans l’épilogue, la mélancolie apaise la douleur, ne la supprime pas, mais permet de tenter de se tenir face au tragique.
Un exemple de mélancolie radicale, ouverte sur l’utopie ? Je m’arrêterai encore une fois sur David Goodis. Goodis, on l’a vu, apparaît comme un auteur particulièrement noir et pessimiste, mais reste disponible à des trouées utopiques, notamment sous la forme de la rencontre amoureuse, quelque chose de fragile qui peut alors briser la pente fataliste. Dans “peut-être”, le verbe être est caractérisé par le possible (peut). Mais un tel possible est marqué par le doute et l’incertitude souvent induits par l’emploi de l’adverbe. Justement l’adverbe “peut-être” exprime une hésitation entre le pessimisme et l’optimisme, appréhendés comme deux éventualités incluses dans un processus non strictement déterminé à l’avance. C’est la figure du pari, avec son lot de risques, qui émerge d’une telle philosophie du “peut-être” qui se dessine chez Goodis, comme chez d’autres auteurs de polars. Cette figure du “peut-être” apparaît directement dans son roman La blonde au coin de la rue (1954) :
« Tout ce temps passé, c’était un pari sur l’avenir. Leur numéro sortirait peut-être un jour, ou il ne sortirait jamais. Mais, tant que les dés n’avaient pas cessé de rouler, il y avait toujours un certain éclat dans ce qu’ils faisaient. Le simple fait de se dire que leur numéro sortirait peut-être, ou qu’il pouvait ne jamais sortir…Peut-être et encore peut-être ou peut-être pas. Mais tant qu’il y avait un « peut-être », il leur restait l’éclat. ».
Le peut-être est l’aiguillon du rêve, malgré la conscience de la noirceur du réel, en affrontant la noirceur du réel, sans se la masquer dans la mièvrerie. « L’éclat », c’est l’éthique du maintien de soi susceptible de déboucher (ou pas) sur un ailleurs utopique.
Pistes perfectionnistes : s’améliorer soi-même en améliorant la collectivité
Dans son récent Les Anges de New York (2010) le Britannique Roger Jon Ellory retrouve un peu de l’esprit du polar américain. Son anti-héros, le policier de la police de New York Frank Parrish, est un alcoolique qui connaît des déboires professionnels et familiaux. C’est également un fan des chansons de Tom Waits, plutôt désenchanté.
Cependant, une éthique de la confiance en soi – que l’on pourrait référer à la philosophie du grand penseur de l’individualisme démocratique américain Ralph Waldo Emerson (1803-1882), ce que l’on appelle le perfectionnisme – va se stabiliser en lui au cours de l’enquête.
La reprise de la confiance en soi prendra appui chez Parrish sur des séances avec une psychologue qui lui sont imposées par sa hiérarchie, constituant alors un dispositif de dé-fragilisation. Cela va lui permettre de reprendre le dessus dans une quête pour s’améliorer lui-même à travers des relations sociales, dans la logique du perfectionnisme emersonien, qui associe le mouvement pour le perfectionnement de soi et celui pour le perfectionnement de la collectivité démocratique. Malgré les doutes, dans la confrontation avec les turbulences du doute. Pendant longtemps, la perspective du changement de soi n’avait chez lui tenu qu’à un fil fragile de la volonté, rechutant constamment dans l’alcoolisme :
« Je me disais que chaque jour, quoi que je fasse, je ne m’améliore pas. C’était ma manière de me rappeler que je devais changer. Mais vous savez quoi ? Je n’ai jamais changé. », avoue-t-il à la psy.
Mais par la suite, progressivement, s’efforçant de retrouver la face aux yeux de sa fille comme de ses collègues, il va relever la tête dans le mouvement même de l’enquête :
« Il était ici à cause de son intuition, de la confiance qu’il avait en lui-même – aussi bien au niveau personnel que professionnel. »
Il fera son job jusqu’au bout, tout en ayant passablement contourné les cadres légaux.
L’éclairage emersonien sur le personnage de Parrish met l’accent sur l’importance de l’individualité dans le polar américain, mais une individualité qui, bien que souvent solitaire, se constitue à partir des valeurs collectives de la cité. Sur ce point, les formulations d’Emerson dans son livre de 1870 Société et solitude apparaissent précieuses et tout particulièrement adaptées au roman noir (ou au western) :
« La solitude est impraticable, et la société fatale. Nous devons garder la tête dans l’une et nos mains dans l’autre. Nous y parviendrons si nous conservons notre indépendance sans perdre notre sympathie. »
Pour Parrish, relever la tête, ce n’est pas oublier les désordres existentiels et sociaux. C’est, avec humilité, en prendre la mesure, sans baisser les bras, mais sans non plus les nier ou croire qu’on peut facilement les supprimer. L’éthique de la reprise de la confiance en soi continue à être lestée de pessimisme, dans la tradition du polar américain.
A travers cette radiographie partielle des impensés de la gauche et des pistes alternatives, on peut identifier un axe transversal d’un renouvellement de la critique sociale et de l’émancipation à gauche : l’incorporation d’une bonne dose de pessimisme, contre le poids des contes de Noël optimistes à gauche. Il s’agirait de faire son miel de l’expression du penseur marxiste italien Antonio Gramsci, inspirée de l’écrivain français Romain Rolland : « Pessimisme de l’intelligence, optimisme de la volonté ». Il faut bien tenir compte de deux siècles d’échecs et d’impasses du combat pour bâtir une société non-capitaliste émancipée et pluraliste de manière durable, sans pour autant abandonner le combat et l’exploration de sociétés radicalement différentes !
Le polar a servi de fil directeur dans la phase propositionnelle de mon propos. A partir du roman noir de tradition américaine, son inspiration a été prolongée dans d’autres formes de la culture de masse : le film noir, puis les séries télévisées noires. Le film noir, c’est bien sûr la figure devenue mythologique incarnée par Humphrey Bogart dans les années 1940-1950. Mais il y a encore des choses intéressantes aujourd’hui. Vient ainsi de sortir sur nos écrans un film qui associe le noir et la dureté du social, en s’arrêtant sur la condition ouvrière américaine aujourd’hui dans une petite ville en voie d’appauvrissement, et cela dans la forme d’un thriller. C’est Les brasiers de la colère, avec l’acteur Christian Bale (celui qui a joué les derniers Batman). On est très proche d’un certain fatalisme sociologique des romans de David Goodis. Ce film explore le côté populaire du monde social. Le dernier roman noir paru en France de l’auteur louisianais James Lee Burke, sous le titre L’arc-en-ciel de verre, explore la gangrène morale qui affecte les riches, cette fois. Il participe de la série des polars autour du flic Dave Robicheaux, ancien alcoolique (dont Bertrand Tavernier a adapté au cinéma un des romans).
Mais il y a surtout aujourd’hui l’importance prise dans la culture populaire par les séries télévisées. Il y a bien sûr la grande série critique américaine, à la tonalité ethnographique et sociologique : en français Sur écoute, en anglais The Wire (2002-2008), 5 saisons dans les difficultés sociales et raciales de Baltimore. The Wire est considérée comme une des plus grandes séries de l’histoire des séries. Son créateur, David Simon, a multiplié les déclarations critiques sur le capitalisme.
Cependant il y a aussi des séries plus classiquement policières, sorties en 2013 et intéressantes quant à leur double portée existentielle et critique, comme Top of the Lake (la série néo-zélandaise créée par Jane Campion, passée en France sur Arte), The Bridge (adaptation américaine d’une série suédo-danoise, se déroulant sur la frontière americano-mexicaine, avec l’actrice allemande Diane Kruger, inédite en France) ou Low Winter Sun (se déroulant dans la ville de Détroit, hier phare de l’industrie automobile et aujourd’hui socialement déglinguée, série aussi inédite en France).
Ces divers exemples nous indiquent que plutôt que de ne voir la culture de masse que comme un dispositif d’aliénation généralisée, il faut se saisir de ses contradictions, voire de ses potentialités critiques et émancipatrices.
Romans noirs, films noirs, séries télé noires… : ils invitent aussi la pensée critique à moins d’arrogance, à plus d’humilité, quand elle croit tout pouvoir ranger dans ses concepts à prétention totalisante, en passant à côté des complications des sociétés humaines. Je terminerai alors sur une phrase tirée d’un roman de James Sallis (l’auteur de Drive, adapté aussi récemment au cinéma). C’est issu de Salt River (2007), qui se situe dans la série des John Turner (ancien flic, ancien taulard et ancien psychologue). Sallis écrit ainsi : « Le genre humain s’est toujours acharné à trouver un concept unique capable de tout expliquer : religion, visites d’extraterrestres, marxisme, théorie des cordes, psychologie… »
Le débat
Un intervenant :
Ce que je viens d’entendre, vous savez à quoi ça m’a fait penser ? A l’heure que je passe dans mon bistrot privilégié place Carnot, aux discours que j’entends autour de moi : “où en sommes-nous ?” Il y a quelque chose que je voudrais vous demander : est–ce que vos analyses peuvent nous aider à défricher par exemple la novlangue dans laquelle nous nous trouvons ? c’est-à-dire, comment le vocabulaire que nous sommes contraints d’utiliser, qui nous a été imposé, est-il totalement corrompu ?. La deuxième chose est de quelle manière, à travers ce dont vous avez parlé, je pourrais m’en sortir dans les différents registres de discours que j’entends autour de moi pour partager au plus près du possible, sans démagogie, la pensée des autres ? La pensée de ceux qui m’entourent, c’est-à-dire de gens qui, encore une fois, sont des piliers de bar mais viennent d’un peu partout, des croquemorts, etc. Je passe une heure, une heure ½ à fréquenter ces gens-là. Vous, vous fréquentez les policiers. J’aimerais bien s’il vous plaît que vous puissiez dire si c’est encore intéressant malgré tout, sans être particulièrement nostalgique, d’étudier cet aspect des choses. Vous avez parlé de l’encéphalogramme plat de la gauche. Ce que vous venez de nous dire m’a passionné. Mais de quelle manière malgré tout pourrait-on réussir à l’utiliser dans le métissage qui est en train de se faire même dans une ville comme Limoges ? J’habite une rue qui est relativement mondialisée, avenue du général Leclerc en remontant, c’est un coin qui est un peu particulier. Comment faire pour qu’il y ait des maisons à palabres ? On pourrait essaimer comme ça et on pourrait réussir à ce que vous dites là, on pourrait réussir à partager le mieux possible.
PC :
D’abord peut être, il faut rappeler, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, que ce que j’ai dit là a une dimension, notamment dans la première partie, autocritique. Parce que ma particularité, ce qui est rare dans le milieu universitaire, c’est que depuis l’âge de 16 ans je suis militant. Ça fait presque 40 ans que je suis militant et j’ai fait un parcours dans la gauche française. J’ai adhéré au lycée au parti socialiste, dans un courant qui s’appelait le CERES, animé par Jean-Pierre Chevènement à l’époque ; j’y suis resté 17 ans. J’ai suivi Chevènement au Mouvement des citoyens, puis j’ai quitté le Mouvement des citoyens pour les Verts, puis j’ai quitté les Verts pour la Ligue communiste révolutionnaire et le NPA –je suis resté 15 ans dans la galaxie LCR-NPA- et depuis 1 an je suis membre de la Fédération anarchiste. Donc mon parcours est particulier mais il me donne une certaine connaissance disons, des milieux militants. J’ai toujours milité dans ces différents milieux : syndical, je suis membre du syndicat Sud-éducation, Attac, au conseil scientifique d’Attac. C’est pour ça que ce que j’ai dit là est lié à la fois à mon travail universitaire et à une analyse critique de mon expérience militante depuis 40 ans, presque.
Un des éléments importants que j’ai rencontrés dès le départ où j’étais militant et qui sans doute me posait problème au début, c’est que je me suis rendu compte que les langues de bois militantes supposaient l’affichage d’un optimisme. Et même quand les militants individuellement avaient une expérience qui portait à une forme de pessimisme, dès qu’ils parlaient au nom de l’organisation, il fallait que ce soit optimiste. Et donc, moi qui suis lecteur du roman noir depuis longtemps et qui étais assez éloigné des personnages du roman noir, des antihéros du roman noir, mon expérience politique m’a rapproché peu à peu de cette situation étrange, de cette vision du pessimisme. Un élément je pense central pour débloquer une série de choses, c’est que, plutôt que de raconter des nouveaux contes de Noël par rapport auxquels les gens sont vite déçus, le pessimisme doit être un carburant de l’optimisme. Plutôt que d’entretenir d’une certaine façon la déception, la haine de la politique, la haine du militantisme, des organisations, etc. Deuxièmement, il faut réévaluer la place de l’individu dans la gauche. Et notamment cette éthique du maintien de soi dans les situations difficiles de l’anti-héros du polar est importante. Comment se tenir. Il y a beaucoup de gens qui ne se tiennent pas aujourd’hui. C’est un élément important.
Troisièmement, mon ami Lilian Mathieu qui est aussi sociologue et qui codirige avec moi cette collection «Petite encyclopédie critique» chez Textuel (il a sorti en même temps que moi un livre qui s’appelle Colombo, la lutte des classes ce soir à la télé), fait l’analyse systématique de la série Colombo à partir d’un paradigme marxo-bourdieusien. Et il montre bien comment, au cœur de Colombo, une série des plus populaires, on a la lutte des classes : on a un plouc qui n’enquête que sur les riches ; c’est toujours les riches les corrompus, les assassins, qui prennent d’ailleurs le plouc de haut au départ et c’est lui qui finit par gagner. Lilian Mathieu interprète ça comme la revanche des dominés à chaque enquête qui se répète dans les romans noirs, films noirs, séries télévisées, chansons ou autres. Toutes ces formes culturelles populaires ou ordinaires sont plus un lieu avec un public plus large que simplement un discours savant ou politique classique. Parce que l’intérêt de ces formes culturelles ordinaires c’est que ça circule dans les sociabilités ordinaires. Les gens discutent dans les bistrots, devant la machine à café de tel film, de telle série. Il y a une dimension d’alimentation de la sociabilité ordinaire dans ces formes de culture populaire. C’est-à-dire que c’est aussi une façon de se réinsérer dans l’ordinaire. Un des problèmes des gauches, que ce soient les gauches de gouvernement ou bien les gauches critiques, c’est la difficulté à recomposer de la politique à partir de la vie ordinaire. C’est ce que vous avez dit de votre bistrot, voilà c’est la vie ordinaire. Comment recomposer de la politique à partir de ça.
En général on recompose de la politique à partir de notions, de concepts, de programmes, etc. qui ont été conçus antérieurement et qu’on va faire redescendre du haut vers le bas. Et donc là, il y a, à mon avis un enjeu très important. La gauche classique, elle a le gouvernement, elle a l’appareil technocratique, les conseils en communication qui font la médiation par rapport à la vie ordinaire et malheureusement – ce n’est pas que je suis hostile à la critique des médias, je pense, comme l’a fait Bourdieu, qu’une critique des médias est nécessaire – mais ce qu’on trouve aujourd’hui sur Internet ou ailleurs de diabolisation des médias est en fait quelque chose qui empêche de réfléchir, qui empêche d’agir. Parce que comme je l’ai dit tout à l’heure : on finit par prendre la masse des gens comme des abrutis qu’il faut sortir de leur merde, on va les émanciper nous-mêmes, on va leur mettre les bonnes idées dans la tête. On ne va plus vers la vie ordinaire, on préfère lire Le Monde ou regarder la télé pour critiquer ce que dit Le Monde ou ce que dit la télé plutôt que d’aller vers les gens parce qu’on est persuadé que tous ces gens sont aliénés. C’est aussi un prétexte ou une barrière qui empêche de retourner vers la vie ordinaire pour reconstruire une politique à partir de l’ordinaire.
Ici l’intellectuel n’a pas de solution à apporter pour être fidèle à l’idéal d’auto-émancipation, à l’idéal d’une certaine autonomie. Que peut faire l’intellectuel professionnel qui est payé par l’Etat pour faire du travail intellectuel comme moi à l’université ? Si je dis que je vais apporter les solutions, comme François Hollande ou Jean-Luc Mélenchon, je sors de l’auto-émancipation et je me mets dans la logique de la tutelle. C’est moi qui vais apporter la solution avec mon savoir et ce serait contraire à ce que je voudrais faire. Tout ce que je peux faire, c’est essayer de décrypter – c’est ce que j’ai appelé le logiciel – la formulation des problèmes. Parce que c’est mon métier, j’y passe beaucoup de temps, beaucoup d’heures. Je peux essayer de faire un travail de formulation des problèmes et des questions. Mais c’est aux individus et aux groupes de s’approprier ça et de fabriquer leurs solutions. Autrement on n’est plus dans la logique de l’auto-émancipation mais dans la logique de l’intellectuel ou de l’organisation ou de l’expert qui va apporter la solution dans un rapport toujours tutélaire à la politique.
Ce que je peux faire aussi, c’est parfois d’expérimenter des choses moi-même. Je participe au réseau des universités populaires. Je travaille à Lyon, il y en a une à Lyon, et puis il se trouve que j’habite Nîmes donc on a créé quelque chose qui est une sorte d’université populaire : c’est une université critique et citoyenne. Dans ce système, il y a des formes comme ce soir de débat et de conférence, et puis il y a aussi ce qu’on appelle les ateliers. C’est 20 personnes maximum et l’intervenant occupe 10 % du temps simplement. C’est les gens de l’atelier, eux-mêmes, qui s’organisent avec un président de séance, qui font leur compte-rendu, qui organisent l’ensemble. Moi j’amène des matériaux et des questions. C’est une solution plus interactive. Il se trouve qu’il y a deux ans j’ai fait un atelier à Nîmes sur le polar ; on a lu des extraits de polars et on a posé des questions, comme ça. Et d’une certaine façon ça a marché, puisque j’ai arrêté l’année suivante et le groupe a continué sans moi. Sans plus d’animateur. Cette année je vais commencer un atelier sur la chanson francophone en partant de chansons de Brassens jusqu’au rap aujourd’hui. Voilà, on peut faire des choses en pratique. Mais il ne faut pas attendre de l’intellectuel professionnel qu’il apporte des solutions. Il peut pointer des problèmes.
Il y a eu des périodes où il y a eu plus de difficultés. Les gens qui ont connu la Résistance ont eu des difficultés bien plus importantes que les nôtres. Quand on prend les débuts du mouvement ouvrier, vers 1830 jusqu’à la fin du XIXe, on a des gens qui travaillent 15 h par jour. Souvent, ce sont des journaliers, c’est-à-dire qu’ils sont payés au jour le jour, ils ne savent pas s’ils vont manger le lendemain. Qu’est ce qu’ils font ? Ils inventent la pensée socialiste, le mouvement social ouvrier dans des conditions beaucoup plus difficiles que les nôtres. Donc, on n’a pas de raison de se plaindre autant, de dire que c’est trop difficile de faire quelque chose aujourd’hui. Il y a eu des moments beaucoup plus difficiles où les mouvements sociaux ont été plus inventifs d’une certaine façon. Mais on a à gérer un problème particulier : c’est une interférence de temporalité, c’est-à-dire qu’on a à gérer deux urgences et un problème à moyen terme. Le problème à moyen terme, c’est que les gauches sont presque mortes intellectuellement donc il faudrait reconstituer une pensée de gauche critique et ça, ça ne peut pas être fait par une seule personne, ni se faire tout de suite. Il faudra du temps, il faudra que ce soit interactif : un temps moyen, disons.
Et puis il y a des urgences. Il y a urgence sociale avec les effets des politiques qui sont menées aujourd’hui en Europe et en France avec beaucoup de difficultés sociales. Et puis il y a une autre urgence qui est imbriquée, mais qui est en partie autonome et en partie associée, c’est ce que j’appelle en France la montée d’un néo-conservatisme à tonalité xénophobe qui parcourt tout l’espace social : extrême droite, droite, gauche, extrême gauche et il y a 2 pôles dans l’espace médiatico-intellectuel qui disent à peu près la même chose sur 2 points : le mal c’est le communautarisme, il faut revenir à la nation. Le mal c’est le monde, l’Europe. L’ennemi principal, le mal absolu, c’est les bobos anti-racistes.
Il y a un pôle islamophobe et négrophobe qui est représenté par Eric Zemmour, Elisabeth Lévy, ou Alain Finkielkraut, et puis il y a un pôle antisémite avec Dieudonné et Soral. Il y a le pôle plus médiatique, plus visible avec Zemmour, etc. et le pôle qui a un grand succès underground sur Internet. Et puis même l’extrême droite va chercher Jaurès ou des gens qui se définissent comme des socialistes libertaires, même s’il y a des pentes conservatrices et que j’ai beaucoup de désaccords avec eux, comme Jean-Claude Michéa. Il est maintenant utilisé par Marine le Pen, par Soral, etc. A l’extrême droite on utilise des choses de l’extrême gauche, de plus en plus. Il y a un courant du parti socialiste qui s’appelle la Gauche populaire, qui dit que les petits blancs hétérosexuels sont en état d’insécurité intellectuelle. Ils sont menacés par les pédés et les musulmans. Ça c’est au cœur du parti socialiste, des courants avec les secrétaires nationaux du PS. La Gauche populaire c’est un courant ; vous pouvez voir, il y a des déclarations de François Kalfon qui est délégué national du PS aux élections qui dit des choses comme ça. J’ai cité ses déclarations, il n’y a pas de problème, c’est assez public. Donc on a une humeur néo-conservatrice et puis on a un ministre de l’Intérieur qui a tenu des propos xénophobes sur les Roms, un incendiaire qui s’est présenté après comme un pompier face à Dieudonné pour se rétablir un peu plus à gauche.
On a donc quelque chose de très particulier qui ressemble beaucoup aux années 1930, ce que Bourdieu a bien analysé dans son livre sur Heidegger L’ontologie politique de Martin Heidegger, où il montre dans la première partie comment se met en place dans la république de Weimar une idéologie néo-conservatrice avec des gens qui sont très différents, qui sont souvent opposés, mais qui vont créer des évidences ou des significations qui vont s’imposer, comme l’idée que la ville c’est le mal et que la campagne c’est le bien. Et là on a un certain nombre de choses qui sont en train de travailler l’ensemble de l’espace politique et intellectuel. C’est comme ça qu’ils se présentent : c’est du « politiquement incorrect », les « vrais critiques antisystème », comme ils disent, qui pourrait devenir la nouvelle idéologie dominante dans un climat où les choses sont très confuses contrairement aux «tuyaux» antérieurs de la gauche. C’est-à-dire que quand on était pour la lutte pour l’avortement on était aussi pour les luttes syndicales ; que si on était pour les droits des homosexuels, on était aussi dans la lutte contre le chômage, quand on luttait pour les « Sans-papiers » on était pour la lutte contre la précarisation. Ces tuyaux sont en train de se défaire. Et alors, maintenant, il y a d’autres tuyaux qui s’embouchent : Bonnets rouges, etc. On associe des choses qui étaient antagoniques. On est dans une phase d’expérimentation, rien n’est établi, c’est flou, c’est confus. Dans Libération j’ai fait une tribune il y a quelques jours contre un critique des médias assez honorable habituellement, Schneidermann, qui avait son émission de télé sur la 5 et qui maintenant a un site. Il a fait dans Libération une chronique sur Dieudonné assez trouble où il essaye de comprendre de l’intérieur le dieudonniste, le fait que peut-être, lire Anne Franck et Primo Levi c’est du conditionnement, etc. Chose extrêmement trouble et ambiguë. Donc on est dans une période de confusion mentale, n’importe quoi peut arriver et donc voilà, c’est là la grande difficulté, on a à gérer deux temporalités : recréer une pensée de gauche à moyen terme et répondre à ces deux urgences qui sont : l’urgence sociale et la montée d’une pensée de droite radicale qui a des effets bien au-delà. Une pensée néo-conservatrice xénophobe qui se constitue sur la base de l’échec de la gauche et de l’échec des autres formes antérieures. Et il est très difficile de savoir comment gérer le rapport entre l’urgence et le moyen terme : en général, souvent, on sacrifie le moyen terme. C’est pour ça que ça fait à peu près 20 ans qu’on parle de la reconstitution d’une pensée de gauche et que ça fait 20 ans que ça patine. Et on fait des erreurs à mon avis. Par exemple, quand il y a eu ce triste assassinat de Méric il y a eu une réactivation de la galaxie antifasciste mais qui nous conduit à une erreur, car ce n’est pas la même chose de lutter comme on l’a fait à Lyon contre les groupuscules violents d’extrême-droite et de lutter contre ce qui est devenu une organisation à effet de masse et qui pourrait un jour entrer au gouvernement comm le Front National. Croire que c’est la même chose, c’est une bêtise. On hérite d’un logiciel avec le mot “anti-fasciste”. Moi je vis dans un département qui a mis Marine Le Pen en tête, dans le Gard, au premier tour des présidentielles. Ça ne sert à rien de dire aux gens qu’ils sont nazis maintenant, au point où ça en est arrivé, ça n’a aucun sens. Comment répondre à ça ? Le folklore anti-fasciste est plutôt un obstacle. Ce n’est pas parce qu’on va faire du karaté et qu’on va s’opposer aux bandes rivales qu’on va résoudre le problème qui est de répondre aux urgences. Il ne faudrait pas y répondre avec les vieux logiciels qui nous conduisent à des impasses. C’est une des très grandes difficultés de la période : ajuster l’urgence à court terme et le moyen terme en essayant de faire les deux. Je n’ai pas de réponse, je vois le problème, mais je pense que c’est un des enjeux les plus importants pour nous.
Une intervenante :
Pourquoi avez-vous choisi le roman noir américain alors qu’il existe aussi des auteurs de romans noirs français.
PC :
Premièrement parce que ça part un peu d’un travail qui a été fait : j’ai cité le livre de Luc Boltanski Enigmes et complots. C’est une interrogation sur l’Etat, la critique de l’Etat dans le capitalisme à travers la naissance de quatre formes qui sont concomitantes. L’émergence du roman policier, avec Sherlock Holmes et Maigret, la naissance du roman d’espionnage qui va stabiliser les formes du conspirationnisme, l’émergence du traitement psychiatrique de la paranoïa, et l’émergence du traitement par la sociologie de la causalité. Et comment ces quatre espaces qui n’ont rien de commun entre eux arrivent de manière concomitante, ça permet à Boltanski d’avoir une réflexion sur l’Etat et sur la place de l’Etat dans le capitalisme, et de bien baliser le roman policier dès le départ. Et ce dont je me suis aperçu, moi qui étais un lecteur de romans noirs, c’est que le roman noir américain, à partir des années 1920, donc juste après, apporte quelque chose de nouveau : cette idée que, en fait, on ne peut pas rétablir l’ordre à la fin. Et que l’Etat ne peut pas rétablir l’ordre lui-même parce que l’Etat lui-même est corrompu. Donc il n’y a plus la confiance en l’Etat-Nation qu’il y a dans le roman policier originel. Ca m’intéressait de partir de cette troisième figure. D’autant plus que ce qui a en partie renouvelé le roman noir (le roman noir français aujourd’hui à partir de Manchette, le roman noir espagnol, d’Amérique latine, des pays nordiques), le point d’inspiration, c’est le roman noir américain. C’est le point de départ, la référence, après il y a des transformations propres, par exemple avec Manchette qui va créer le néo-polar français, à partir du roman noir américain. Après le néo-polar, il y a eu des déclinaisons particulières, plus politisées, du roman noir américain. Ensuite, il y a eu une série de gens comme Daenincks qui ont prolongé le néo-polar. A partir de l’invention de la série qu’on appelle «Le Poulpe», série créée par Pouy qui est venu ici ; Pouy est un des auteurs intéressants à l’époque.
Du point de vue des questions existentielles et de la critique, il n’y a pas photo entre le roman noir américain contemporain et le néo-polar français dégradé aujourd’hui. En effet, à partir des Poulpes, il y a une sorte de dégradation, de surpolitisation. L’analyse critique des rapports sociaux disparaît plus ou moins et on a une surpolitisation avec des catégories politiques sans le substrat social. Et on va avoir, pour caricaturer, énormément de romans avec un membre du Medef qui est pédophile, qui est en cheville avec la mafia et qui soutient le Front national. Alors ça plaît beaucoup à l’électorat gauchiste et post-gauchiste mais à un moment donné ça s’épuise parce qu’il y a une sorte d’appauvrissement. Il vaut mieux lire les auteurs comme James Lieber, Georges Pelecanos, Denis Lehane ou James Sallis. Après, il y a des gens qui se situent un peu en dehors, qui sont intéressants et qui ne sont pas dans cette logique de dégradation. Dominique Manotti, par exemple, en France, qui fait un polar social.
Voilà. C’est pour des raisons historiques, parce que c’est une matrice de quelque chose de nouveau, et aussi parce qu’il reste dans le roman noir américain quelque chose d’intéressant qui a ré-émergé en France dans les années 1970 mais qui s’est ensuite un peu reperdu avec une sorte de routinisation.
Un intervenant :
Contrairement à mon petit camarade du quartier de la place Caserio* – car Caserio a vaincu sur Carnot, il faut le dire, j’ai connu le roman noir très tôt, en 1968, par Chester Himes. Et là c’était du noir, lui au moins avait la bonne couleur (NDLR : Himes était afro-américain). Et je préfère parler de hard-boiled (roman des durs-à-cuire) sous réserve bien sûr et sous le contrôle de mes amis du Club Polar de Limoges, il y a quand même matière à une petite différence sans évoquer bien sûr la lepénisation du polar. On n’en est pas là. Et puis au-delà du polar effectivement, il y a souvent cette analyse à la fois sociale, philosophique et vitale qui nous amène à une conception qui est celle que nos amis anglo-saxons appellent l’empowerment. L’empowerment ce n’est pas tout à fait s’émanciper mais il y a un petit peu de ça. Ça va un peu plus loin, c’est la prise de pouvoir de chacun sur soi d’abord et l’exemplarité de cette démarche qui fait une certaine contagion, autour de soi. Et là on est effectivement dans une démarche profondément libertaire et de respect pour les autres qui peut peut-être changer un peu la donne, y compris dans les arbres à palabres.
Un intervenant :
Il me semble que la diffusion de masse du polar, du roman policier quel qu’il soit, a beaucoup baissé ces dernières années : voir le changement de format de la «Série noire». Il y a un problème économique réel ici alors que, effectivement, le cinéma, notamment le cinéma populaire, a réussi à continuer, à partir des romans américains, à proposer des choses comme Drive, pour ne citer que celui-là, mais c’est surtout la télévision avec toutes les séries qui sont tellement passionnantes et qui touchent beaucoup plus de monde. Ce qui est intéressant c’est de réfléchir justement par rapport à la télévision, enfin des séries de fiction françaises ou même allemandes, qui ont beaucoup de mal et n’arrivent pas à avoir l’audience qu’ont les séries américaines.
PC : J’ai mis de côté des gens comme Chester Himes dans le livre parce que j’aimerais faire quelque chose de systématique sur le traitement de la condition noire dans le polar et c’est énorme. Il y a soit des auteurs noirs qui traitent de la condition noire, soit des auteurs blancs. J’aimerais faire ça un jour. Sur l’empowerment, je suis tout à fait d’accord, mais il faut faire attention parce qu’il y a un livre qui vient de sortir sur l’empowerment, un bon bilan critique aux éditions de La Découverte. Il montre bien qu’il y a deux usages du terme. Un usage par les institutions technocratiques internationales type Banque mondiale qui utilisent le terme et qui est une sorte de traquenard néolibéral. Et puis il y a le fait que des communautés, des collectivités reprennent individuellement et collectivement des capacités sur leur vie. Et là c’est très important.
Sur la lecture : il y a le problème particulier de la lecture, qui a baissé. Mais le roman policier reste massif. C’est toujours la majorité des ventes. J’ai fait plusieurs débats dans des bibliothèques et c’est la majorité des prêts. Sur un fond de baisse de la lecture c’est un des éléments qui résistent. Après, l’audience est plus grande au niveau du cinéma, d’abord, et aujourd’hui au niveau des séries télévisées encore plus. C’est pour ça qu’il ne doit pas y avoir ce mépris général par rapport à la télévision. On peut mépriser des choses à la télévision, mais il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Il y a une difficulté, c’est vrai, pour les séries télévisées noires françaises. Il y a de petites tentatives, Engrenage, par exemple, des choses intéressantes produites par Canal plus. Il y a des essais qui vont dans ce sens-là mais timides, c’est vrai, avec moins d’écho. Il y a beaucoup de choses plus classiques qui se font en France. Donc là il y a sans doute une difficulté. Pas un problème France – Amérique, mais une capacité de l’industrie culturelle américaine à innover constamment. C’est assez étonnant. Et même au cœur du capitalisme, ça produit des produits critiques du capitalisme. Ca veut bien dire qu’il y a des contradictions, des marges de jeu. Il faut savoir par exemple (j’avais eu un long entretien quand il est venu en France avec Denis Lehane), que les auteurs américains de romans ou les scénaristes font souvent les deux. Par exemple Denis Lehane et Georges Pelecanos ont été scénaristes de certains épisodes de la série The Wire dont j’ai parlé. On ne fait pas ça en France parce qu’en France on croit au talent inné. Aux Etats-unis, il y a des cours pour apprendre à écrire et les grands romanciers américains deviennent aussi romanciers en passant par l’université. Et à l’université ils sont imbibés parce qu’il y a une particularité à l’université américaine qui est qu’elle est un peu détachée de l’humeur américaine générale et que donc les pensées critiques y sont dominantes, sous différentes formes. Le penseur qui y est le plus discuté aujourd’hui c’est Foucault. Dans les universités américaines il y a plus de marxistes qu’en France, il faut le savoir. La pensée critique est très vivace. Tous ces gens passent par l’université et inventent des éléments qu’ils puisent dans leur culture universitaire et critique.
Un intervenant :
Dans les révisions de logiciel, quand vous parlez de l’individu, j’aurais tendance à applaudir des deux mains parce que j’ai toujours trouvé que dans la pensée de gauche l’individu était toujours agi par des forces qui lui étaient extérieures, mais que quelque part il n’existait pas beaucoup lui-même. Ca c’est quand même un sacré problème. Et l’autre problème aussi où je trouve qu’on a vraiment du chemin à faire, c’est de considérer que le capitalisme n’est pas un système extérieur à nous mais un système que nous fabriquons et qui par certains côtés est une coproduction entre les salariés, les entrepreneurs, l’Etat, etc. Et si on veut comprendre le capitalisme aujourd’hui, il est évident que la place des mouvements sociaux est quand même assez centrale pour expliquer un certain nombre de changements.
Sur les séries américaines, sur le polar américain, je suis entièrement d’accord avec vous, par exemple, au niveau des séries télévisées françaises même si Engrenage est en effet quelque chose d’assez remarquable par rapport à la production moyenne française, c’est quand même très loin derrière des trucs comme The Shield, The Wire, etc. ne parlons même pas de trucs comme Treme qui sont des séries complètement stupéfiantes parce que c’est presque de l’ethnologie appliquée. Je me demande toujours si ça ne tient pas à la fois à un effet de masse : les Etats-Unis sont un pays beaucoup plus peuplé, 320 millions d’habitants. C’est quand même la garantie d’une espèce de diversité sociale, culturelle, ethnique etc. qui est probablement beaucoup plus forte qu’en France et en même temps qui est mieux acceptée parce que c’est un pays d’immigration et avec des différences, et on pourrait dire aussi le bordel social d’un certain côté, parce que c’est quand même ingérable, c’est beaucoup plus visible que chez nous. Ca finit par produire une littérature plus ouverte, plus percutante, par rapport à ce qu’est la réalité sociale moderne, les séries télévisées que ça donne sont effectivement aussi mieux jouées parce qu’il y a à la fois probablement au départ beaucoup plus d’acteurs et donc une qualité générale plus forte mais tout simplement aussi parce que la réalité sociale est beaucoup plus variée. Je donne juste un exemple d’une série dont vous avez parlé : quand dans un épisode de The Wire on voit un flic noir décider de quasiment neutraliser un quartier noir pour permettre librement le commerce de la drogue parce qu’il se dit que comme ça au moins les prix vont peut-être se stabiliser un peu et la violence régresser, c’est quand même assez stupéfiant. Dans The shield la brigade anti-gangs qui a été montée dans la police de Los Angeles a fini par devenir elle-même une sorte de gang qui rackettait les gangs, mais quand cette police a été dissoute à la suite des scandales qui ont été révélés, la guerre des gangs a repris de plus belle et l’insécurité globale a augmenté. On est en plein dans des problèmes des très grandes villes à l’heure actuelle et avec une liberté de ton qui est un peu stupéfiante pour les Français.
PC :
Sur les logiciels je suis d’accord, l’idée que le capitalisme est complètement extérieur, qu’il serait une sorte de système homogène complètement extérieur à nous. Ce discours, y compris dans les milieux critiques, fatalise d’une certaine façon le capitalisme. C’est comme s’il était trop puissant pour nous, comme si c’était une sorte de machine complètement extérieure à nous qui s’impose nécessairement. Et si on envisage le fait que c’est nous qui le fabriquons, il devient plus fragile, il a plus de contradictions, il a aussi nos contradictions. Quelque chose qui paralyse la pensée de gauche et probablement de la gauche critique, c’est une surévaluation de la force du capitalisme comme une sorte d’élément homogène sans contradictions qui s’imposerait nécessairement et contre lequel on ne pourrait pas faire grand-chose. Ça limite par avance les possibilités, alors qu’il faudrait avoir une pensée de la fragilité du capitalisme. Parce que le capitalisme a plusieurs contradictions que j’essaye d’analyser dans mon petit livre de choix de textes de Marx (Marx XXIe siècle). Il y a la contradiction capital-travail qui pose la question sociale, et aujourd’hui avec le chômage et la précarité il y a beaucoup d’insatisfaction. On rencontre peu de gens qui sont des apologistes du capitalisme, ou alors il ne faut rencontrer personne dans la rue, avoir une vision un peu extérieure du monde. Il y a ces insatisfactions, il y a disons une prise de conscience progressive de la contradiction entre le capitalisme et la nature, les dangers que cela fait courir : une deuxième zone de fragilité. Et il y a ce que j’appelle la contradiction capital-individualité, c’est-à-dire que le capitalisme promet de réaliser chaque individu et en même temps il ne le peut pas parce qu’il ne le peut que dans son cadre marchand, ce qui crée de la frustration : frustration de la reconnaissance, de la créativité, etc. Le capitalisme a donc plusieurs zones de fragilité, crée beaucoup d’insatisfaction, et un des problèmes pour les gauches critiques c’est qu’il faudrait qu’elles inventent un discours qui se reconnecte à ces insatisfactions ordinaires alors que leur discours apparaît plus plaqué, abstrait, en dehors de ça. On ne sait pas parler. Par exemple si on pose la question de l’individualité, la gauche ne sait pas en parler. Dans ses tracts il n’y a jamais d’individu, il y a toujours le service public, la réforme fiscale, des choses comme ça. Il y a des entités politiques, il n’y a jamais d’individu. Si on prend aujourd’hui des textes de rap par exemple, il y a de la violence sociale, de la contrainte sociale et des intimités des individus. Des subjectivités. Il n’y a pas d’intimité dans le langage politique de gauche. Elles sont éliminées. Donc comment accrocher à ça, si ce n’est pas dans le discours ? En fait il faudrait réinventer un discours politique. Il faudrait aussi inventer des formes d’organisations qui soient plus adaptées à la forme de société existante.
La raison pour laquelle on n’arrive pas aujourd’hui à avancer davantage pour faire reculer la logique capitaliste me semble résider moins dans la force du capitalisme, que dans les faiblesses des anticapitalistes qui n’ont pas à mon avis le langage politique adéquat, les formes d’organisation etc., qui ne savent pas se saisir de ces fragilités du capitalisme, et qui en général, au contraire, surévaluent sa puissance avec l’idée qu’on ne peut pas en sortir.
Après sur les Etats-Unis, oui, il y a l’espace américain, il y a l’univers social et culturel, il y a sans doute le fait aussi qu’il y a eu un mouvement ouvrier américain, notamment anarchosyndicaliste à un moment donné, mais qui a subi une défaite et donc est devenu marginal, un mouvement ouvrier radical, et que la pensée critique continue à être là, moins dans des formes organisées nationales que dans des formes locales : il y a plein d’expériences locales alternatives, de groupes locaux alternatifs radicaux aux USA et très peu de réseaux au niveau fédéral, au niveau national. Et donc la pensée critique au niveau national s’exprime d’une certaine façon à la fois dans les universités, dans la littérature, dans les séries télévisées, dans le cinéma à défaut de porte-paroles critiques nationaux. Donc le roman noir, les séries télévisées, c’est aussi cette présence de la pensée critique, mais pas comme chez nous où ça passe immédiatement dans les formes politiques ; on a des représentants politiques : il y a Mélenchon, Besancenot, Nathalie Arthaud, etc. Au niveau national il y a des représentations, des représentants politiques de la critique radicale. Aux Etats-unis ça n’existe plus vraiment aujourd’hui. Et la pensée critique est disséminée dans ses formes culturelles qui sont extrêmement inventives. Et qui arrivent à se frayer un chemin parce qu’en même temps, l’industrie culturelle américaine, son problème principal, contrairement à ce qu’on croit, ce n’est pas d’imposer une idéologie homogène, c’est aussi que si ça marche ça fait de l’argent. Donc si une série a du succès ou si un roman a du succès, on le promeut. Même s’il est critique. Puisque le problème n’est pas d’imposer une idéologie, comme on le croit souvent, mais immédiatement, sur un produit, de faire de l’argent. Si ça marche, on donne de l’argent. C’est comme ça que des choses innovantes ont pu être produites. Si ça ne marche pas, on retire l’argent. D’où la grande difficulté aujourd’hui pour David Simon pour trouver de l’argent et réaliser la dernière saison de Treme. D’après ce qu’il raconte il a un peu de difficultés à boucler le budget. Parce que ça a eu moins de succès que The Wire et donc voilà, si ça a moins d’audience, il faut le sortir. C’est cette dimension de l’argent qui est importante.
Un intervenant :
Je souscris à la plupart des choses que tu as dites mais il y a quelque chose qui m’interpelle un peu, c’est que tu as l’air de vouloir croire qu’il y a une misère philosophique et intellectuelle au niveau de la gauche, comme si la gauche pouvait ne pas l’avoir cette misère philosophique et intellectuelle. La gauche institutionnelle, qu’elle soit officielle ou non-officielle, s’accroche au système et à partir de là on ne peut pas espérer qu’il y ait quelque chose. Par contre, au niveau des intellectuels de gauche il y a quand même des trucs frappants, c’est que justement quand ils s’opposent (mais là c’est plutôt dans leur disciplines) surgissent des tas d’intellectuels de valeur qui sont capables d’analyser ce qui se passe et faire des propositions : je pense à Albert Jacquard, Jean-Marie Pelt, etc. C’est-à-dire que la société est tellement complexe, que chacun dans sa spécificité est capable d’intervenir correctement.
PC :
Pourquoi misère politique et philosophique ? Si je prends la fin des années 1970, ce n’était pas le cas. On était trotskiste, on était mao, on était PC ou on était au PS : le cadre était marxiste. Il y avait une vie théorique et intellectuelle très forte. Au PS par exemple, c’est étonnant mais il y avait au moins 6 revues théoriques à l’intérieur. Dans la revue socialiste et les revues de courant qui paraissaient régulièrement, il y avait énormément de débats intellectuels théoriques, culturels etc. Ça n’existe plus du tout. Donc il y a eu une dégradation par rapport à cette œuvre. Je ne regrette pas le fait qu’il y ait eu l’hégémonie du marxisme parce que je pense que la pensée critique est beaucoup plus large que le cadre du marxisme et que je crois que le marxisme a interprété d’une manière réduite Marx, mais en tout cas il y avait cette vivacité qui s’est peu à peu perdue avec l’arrivée de la gauche au pouvoir. Mais ce que j’ai voulu indiquer c’est que dans les gauches critiques, il y a eu aussi des effets de routinisation qui ont fait perdre ce lien avec l’activité intellectuelle. Je suis d’accord, il y a une désintellectualisation de la gauche mais il y a encore beaucoup d’intellectuels de gauche. La particularité c’est que souvent ces intellectuels de gauche le sont en tant que personnes, c’est-à-dire qu’il n’y a plus de dialogue avec des mouvements sociaux ou avec des organisations syndicales, politiques ou associatives. C’est ça qui s’est perdu et donc souvent ils vont intervenir dans leur spécialité, dans la spécialisation universitaire. Et de temps en temps ils émergent un peu au-delà dans les sphères médiatiques sur certains domaines. C’est-à-dire que ce qui est en train de se perdre, c’est une dimension globalisante de la pensée critique. A l’université aujourd’hui, un sociologue peut faire toute sa vie sur la sociologie de la famille. J’ai connu quelqu’un en science politique qui a fait toute sa carrière sur le crédit agricole. Comme quelqu’un peut faire uniquement sa carrière philosophique sur Kant ou sur Platon ou sur Aristote. Donc il y a ce mouvement de spécialisation qui à la fois apporte plus de rigueur dans le travail sur ces auteurs, et en même temps perd la globalisation. Donc il y a aujourd’hui un problème dans la globalisation de la pensée critique. Il y a l’isolement des différents penseurs qui ne sont plus connectés à des mouvements sociaux et il y a une hyperspécialisation qui rend difficile la globalisation. C’est les deux. Mais il y a encore beaucoup d’intellectuels de gauche. Le paradoxe c’est qu’il y a pourtant une désintellectualisation de la gauche.
Compte-rendu réalisé par
Francis Juchereau et
Jean-Louis Vauzelle.
Le Polar…
Faire en quelques lignes une rétrospective du roman noir est bien sûr du domaine de l’impossible. Situons donc simplement les auteurs dont il a été question lors de la soirée du Cercle avec Philippe CORCUFF sur « l’éthique du polar comme réponse à la mort cérébrale de la gauche ? »
Les précurseurs : Dashiell HAMMETT puis Raymond CHANDLER qui, dit-on, ont succédé à Edgar A. POE, ci-devant présumé créateur du roman policier. Ce sont les fondateurs du « hard boiled », roman dont le héros est un détective « dur à cuir », une sorte de chevalier moderne sans peur et sans reproche. On peut lire au hasard l’une de leurs enquêtes, elles se ressemblent beaucoup, ou alors voir les films avec BOGGART. A noter qu’HAMMET a eu des démélés avec la commission McCARTHY. Communiste, il a présidé l’une des premières associations pour les droits civiques. Arrêté, il n’a jamais dénoncé ses camarades, ce qui lui a valu un an de prison.
Howard FAST, considéré par Jean-Bernard POUY comme l’un des fondateurs du roman noir, était, comme HAMMETT et selon les propres termes de McCARTHY, « un porteur de la carte du Parti communiste », ce qui n’était pas rien dans ces années-là. Pour en savoir plus, se reporter à Mémoires d’un rouge paru chez Rivages/Noir.
Comme le dit MANCHETTE dans ses chroniques : « un type qui n’a pas le vin gai, à première vue, c’est Goodis ». Effectivement, chez David GOODIS, tout est sombre et désespéré. Le cinéma a bien aimé La lune dans le caniveau par exemple. Philippe CORCUFF parle à son propos de fatalisme social et en effet, pour s’en convaincre, on peut lire (ou relire) sous cet angle Tirez sur le pianiste !
Les auteurs de roman noir contemporains, Dennis LEHANE, George PELECANOS, James SALLIS notamment, ont souvent, sinon exclusivement, des thèmes de prédilection : la drogue, le racisme, la guerre du Vietnam. SALLIS a notamment créé le personnage de Lew GRIFFIN, détective-écrivain-philosophe noir qui arpente les rues de la Nouvelle Orléans, et ce faisant, nous donne un aperçu discret mais saisissant de la ségrégation au quotidien. Soulignons au passage qu’il a également écrit une biographie de Chester HIMES, écrivain noir américain longtemps méconnu en France. Auteur prolixe et révolté, HIMES a notamment créé les personnages de Ed CERCUEIL et FOSSOYEUR, flics noirs de Harlem pas piqués des hannetons si vous voulez mon avis.
Concernant LEHANE, il est bien connu via le cinéma : Shutter Island, Mystic River. Mais je conseillerais Un dernier verre avant la guerre, et surtout Un pays à l’aube sur la police, les luttes ouvrières et, là encore, le racisme dans le Chicago du début du siècle.
Les romans de PELECANOS se passent en général à Philadelphie, dans le quartier noir où le taux de criminalité est l’un des plus élevés des USA et où les gamins, quand ils ne se font pas descendre, n’ont d’autre avenir que les gangs ou le deal. Je recommande pour la prise de contact Un jour en mai, une histoire tragique, mais avec un happy end.
James Lee BURKE est le créateur du personnage de Dave ROBICHEAUX, dans le décor magique de la Louisiane. Mais, comme chez CRUMLEY, l’envers du décor, c’est l’omniprésence de la guerre du Vietnam avec les angoisses récurrentes et l’alcoolisme qui brise la vie des vétérans. ROBICHEAUX et son pote CLETE luttent contre leurs démons, mais aussi contre l’injustice et la corruption. Le premier de la série des ROBICHEAUX est La pluie de néon. Si l’on en croit MESPLEDE dans ses Chroniques, il y en aura 16 entre 1987 et 2007.
Enfin, pour en finir avec les Américains (du nord), un mot sur Craig JOHNSON, comparé à Jim HARRISON sur la 4ème de couverture de son roman Little Bird paru dans la collection Gallmeister, qui publie des auteurs de roman noir amoureux de la nature (sauvage de préférence). HAMMETT avec son Poisonville se retournerait dans sa tombe…
Quelques mots enfin sur les Européens, Sherlock HOLMES et Roger Jon ELLORY, Georges SIMENON et Jean-Pierre MANCHETTE.
HOLMES, Sherlock HOLMES, tout le monde connaît, je ne m’étends pas, d’autant que ce n’est pas ma tasse de tea (même avec un nuage de lait). Rien à voir avec ELLORY dont il faut savoir qu’il est anglais, sinon on jurerait que c’est un Amerlock. Il a commencé à être connu avec Seul le silence, mais si vous aimez les histoires de mafia, je vous recommande Vendetta.
Les enquêtes du commissaire MAIGRET, c’est comme HOLMES et Agatha CHRISTIE, pratiquement sûr que tout le monde ou presque en a lu un, donc passons.
Reste MANCHETTE, le néo-polar à la française qui mêle roman noir et politique (L’affaire N’Gusto, Le petit bleu de la côte ouest, Nada). Moi, j’aime ses Chroniques parues dans Rivages/Ecrits noirs.
Bonne lecture…
Michèle Gay.