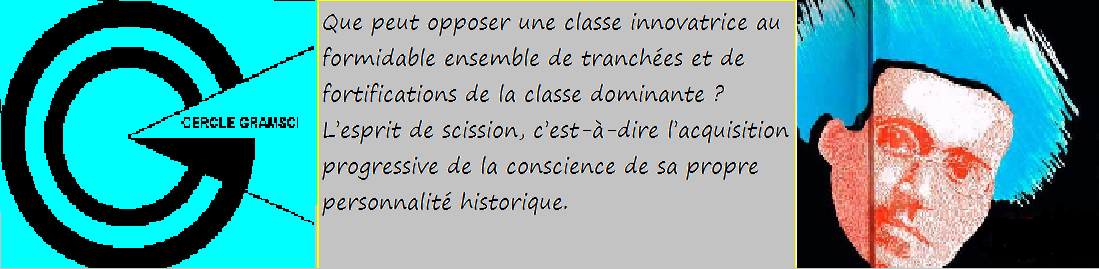Vendredi 20 janvier 20h30 salle du Temps libre Limoges (derrière la mairie)
La résilience, une technologie du consentement ? avec Thierry Ribault, chercheur en sciences sociales au CNRS
La prochaine soirée-débat du cercle Gramsci sera animée par Thierry Ribault, chercheur en sciences sociales au CNRS, auteur du livre : Contre la résilience, à Fukushima et ailleurs (éditions L’échappée, 2021).
Funeste chimère promue au rang de technique thérapeutique face aux désastres en cours et à venir, la résilience érige leurs victimes en cogestionnaires de la dévastation. Ses prescripteurs en appellent même à une catastrophe dont les dégâts nourrissent notre aptitude à les dépasser. C’est pourquoi, désormais, dernier obstacle à l’accommodation intégrale, l’« élément humain » encombre. Tout concourt à le transformer en une matière malléable, capable de « rebondir » à chaque embûche, de faire de sa destruction une source de reconstruction et de son malheur l’origine de son bonheur, l’assujettissant ainsi à sa condition de survivant. À la fois idéologie de l’adaptation et technologie du consentement à la réalité existante, aussi désastreuse soit-elle, la résilience constitue l’une des nombreuses impostures solutionnistes de notre époque. Cet essai, fruit d’un travail théorique et d’une enquête approfondie menés durant les dix années qui ont suivi l’accident nucléaire de Fukushima, entend prendre part à sa critique. La résilience est despotique car elle contribue à la falsification du monde en se nourrissant d’une ignorance organisée. Elle prétend faire de la perte une voie vers de nouvelles formes de vie insufflées par la raison catastrophique. Elle relève d’un mode de gouvernement par la peur de la peur, exhortant à faire du malheur un mérite. Autant d’impasses et de dangers appelant à être, partout et toujours, intraitablement contre elle. Thierry Ribault est chercheur en sciences sociales au CNRS. Il est coauteur, avec Nadine Ribault, des Sanctuaires de l’abîme. Chronique du désastre de Fukushima (Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2012).
On peut l’entendre ici : https://actualitedesluttes.info/emission/contre-la-resilience-par-thierry-ribault-mobilisation-pour-vincenzo-viecchi Invité par la coordination Stop Golfech, T. Ribault viendra à la mi-janvier, du 12 au 14, à Agen, à Montauban, à Toulouse. Il est beaucoup intervenu sur le refus de la résilience face aux catastrophes, notamment nucléaires. Il propose la résistance. Il a également co-réalisé un documentaire sur les réfugiés à Fukushima. Ce film de 52mn réalisé en 2014 lorsqu’il menait des recherches au Japon (où il a vécu 14 ans) sur la catastrophe nucléaire et sa gestion politique, s’intitule « Gambaro – Courage ! » Le lien vers le film est : https://www.dailymotion.com/video/x7yxy9p
Hervé Faure présente notre invité et le thème de la soirée-débat :
Thierry Ribault est chercheur au Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques. Il est également responsable scientifique du Laboratoire international associé « Protection humaine et réponses aux désastres » de l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Très intéressés par son dernier livre intitulé Contre la Résilience, à Fukushima et ailleurs, nous l’avons invité pour plusieurs raisons.
Les analyses critiques de la résilience ne sont pas si nombreuses, et elles sont peu diffusées. Il faut dire que le terme « résilience » a le vent en poupe. Il est dans l’air du temps. Deux exemples parmi d’autres : la « résilience alimentaire » ; la loi « climat et résilience ».
Thierry Ribault s’est intéressé à la résilience à partir de la catastrophe nucléaire de Fukushima, au Japon, en 2011. Il questionne la résilience comme processus d’adhésion de la population et de cogestion du malheur. Ce qui caractérise l’intention de Thierry Ribault est une critique radicale de la résilience, au sens propre du mot « radical » : c’est-à-dire qu’il va au plus près des racines de la question. Il nous propose le résultat de ses recherches sur ce que signifie la résilience en termes de conditionnement et d’encadrement des populations, et ce qu’elle implique socialement et politiquement.
La réflexion et l’analyse de Thierry Ribault devraient nous interroger sur plusieurs points :
– La résilience sous-convoque les causes des catastrophes, des désastres et des traumatismes, pour rapidement entrer dans un processus d’acceptation de l’inacceptable. L’exemple japonais confirme ce processus. La résilience maintient, voire accentue la pression de conformité. Ses prescripteurs le disent : « Incitons les différents acteurs à participer et à cogérer l’implacable désastre ».
– Avec la résilience, ne veut-on pas faire croire que chacun serait résistant à toute épreuve ? Mais à quelles conditions ? Celle de s’adapter ; mais de s’adapter à quoi ? A la radioactivité, dans l’exemple de Fukushima ? S’adapter à quel système de pouvoir ? D’accepter ; mais d’accepter quoi ? Le désastre ? L’accepter, voire le transcender ? Ne plus dénoncer les causes et accepter sournoisement le renforcement de la domination, des rapports sociaux de classes ? Car faut-il donc répondre aux précaires, aux personnes marquées par des échecs et des peines profondes : « Ca va aller si vous acceptez, si vous rebondissez, si vous vous dépassez » ?
– Ce processus est accompagné d’injonctions sur la responsabilité de chacun dans ce qui arrive, sur la culpabilité de ne pas s’en sortir. Il faut mériter son malheur. Le désastre devient donc un remède.
– La résilience n’est-elle pas (c’est le thème de notre soirée) une technologie du consentement ? Une technique comportementale normative, une thérapie par la soumission… dont le but essentiel serait l’effacement des causes pour étouffer l’alternative, la rébellion, la rage et la fureur, et en fin de compte bâillonner les possibilités de liberté et d’émancipation ?
Je laisse la parole à Thierry Ribault qui va nous en parler plus précisément.
Thierry Ribault :
Merci pour cette présentation, qui pourrait presque nous dispenser de mon intervention, parce que beaucoup de choses ont été expliquées de manière assez précise. Je vais simplement donner quelques illustrations.
Mais d’abord, quelques précisions. La biographie que vous avez faite est un peu fausse, puisque malheureusement je ne suis plus responsable du laboratoire franco-japonais que j’avais créé en 2012 au Japon, et qui travaillait sur les questions de gestion publique de la catastrophe de Fukushima. Ce laboratoire a vécu entre 2012 et 2017, pendant cinq ans. Il n’avait pas beaucoup de budget, mais suffisamment pour pouvoir faire des choses ; et on a organisé beaucoup de choses au Japon notamment, et quelques événements en France, des colloques… Normalement ces laboratoires, dans le cadre du CNRS, font l’objet de plusieurs mandats, en général au moins trois mandats de cinq ans. Celui-ci n’en a eu qu’un seul. Il a été fermé en 2017 ; pourtant j’avais demandé bien sûr la prolongation de son existence. Il a été remplacé trois mois après sa fermeture par un autre laboratoire, qui en fait est dirigé maintenant par un jeune chercheur très brillant du Commissariat à l’Énergie Atomique !
Pour entrer dans le sujet directement : ce dont je vais vous parler, ce n’est pas de la fiction. Ce n’est pas de la projection philosophique (je n’ai rien contre la philosophie, mais je ne suis pas philosophe). Ce n’est pas « Qu’est-ce qu’on ferait en cas de catastrophe, qu’est-ce qu’il arriverait ? » Je voudrais essayer de vous parler de choses concrètes, réelles, qui ont existé, qui existent encore, même si bien sûr j’ai essayé dans mon travail de partir de la gestion publique de la catastrophe. Le mot « gestion » n’est pas de moi ; j’utilise plutôt la notion d’administration du désastre.
J’ai essayé de regarder, depuis la survenue de cet accident nucléaire en 2011, comment les pouvoirs publics avaient pris en main cet accident. Comment ils avaient contribué à transformer complètement le statut de la catastrophe (un moment objectif de l’histoire d’une société technologique, techno-industrielle, qui a ses défaillances) en un moment subjectif et psychologique. C’est-à-dire : comment on a fait sortir la catastrophe de Fukushima de l’Histoire pour en faire une petite histoire. Je dirais même de multiples petites histoires qui sont les histoires que chaque victime est censée construire en relation avec cette catastrophe. C’est ce que j’appelle la subjectivisation du désastre.
Ma parole n’est pas plus légitime que celle de quiconque, même si j’ai travaillé au Japon pendant quatorze ans et notamment dans les sept dernières années, entre 2007 et 2016, ponctuées par cet accident du 11 mars 2011. Je ne vais pas focaliser sur cet accident. Je veux dire trois mots dessus, mais après je vais parler de la France, parce que ce que je veux montrer, c’est qu’en fait la manière dont les pouvoirs publics se sont emparés de l’accident de Fukushima est une heuristique, c’est-à-dire une lunette qui nous permet de comprendre comment toutes les catastrophes désormais sont et seront gérées (c’est ma thèse : elle est contestable, mais c’est ce que j’essaie de démontrer) en mobilisant cette notion de « résilience », même si bien sûr je ne prétends pas que la notion de résilience est née avec la catastrophe de Fukushima.
Il y a eu un accident nucléaire en 2011. Sa caractéristique (comme souvent avec les accidents nucléaires) c’est qu’il a eu lieu à un moment ; mais en réalité il dure, il dure toujours, il dure encore. Ce n’est pas du tout pour faire des jolies phrases : c’est vrai. En fait il y a sur ce site six réacteurs nucléaires, un peu comme les six réacteurs de Gravelines, à 80 km de là où j’habite. Trois ont explosé et sont entrés en fusion. Ces réacteurs introduits par les Américains avaient une architecture particulière : les piscines des combustibles se trouvaient sur les toits des réacteurs. Donc vous imaginez que si vous enlevez ce qui est en-dessous du toit, le toit peut tomber. Ce n’est pas arrivé, mais c’est ce qui pourrait encore arriver. On a réussi à vider une des piscines des combustibles usés et non-usés qu’il y avait dedans, car des humains ont réussi à l’approcher. Malheureusement les deux autres piscines ne sont pas approchables et le chantier pour pouvoir extirper les 1500 barres de combustible usé est sans cesse repoussé depuis l’accident. On parle de la date de 2030 pour éventuellement commencer, mais rien n’est certain. Il est pratiquement sûr qu’on ne pourra pas commencer. Des piscines qui s’effondreraient si un tremblement de terre de magnitude 9, égal à celui qui est survenu en 2011, survenait à nouveau. Ces piscines s’effondreraient et l’explosion des trois réacteurs serait presque comme une blague par rapport à ce qui surviendrait alors. Ce sont les physiciens qui le disent. Trois cœurs en fusion dont on a essayé d’extirper le magma qui s’est créé, ce qu’on appelle le corium : un mélange de matière fissible, de béton et de ferraille. Tout ça forme 900 tonnes de corium pour les trois réacteurs, qu’on ne sait pas comment approcher. On essaie avec des robots. Les Japonais sont devenus d’ailleurs à cette occasion les plus grands experts en matière de robotique, ce qui leur permet (ça fait partie de la « résiliomanie » ambiante) de vendre leur expertise robotique à d’autres pays nucléarisés, en cas d’accident. La capitalisation sur le malheur est à l’œuvre dans le contexte de Fukushima, sans aucun doute. On a trois cœurs de réacteurs en fusion, avec des déchets qu’on ne peut approcher. On pense qu’on pourra commencer peut-être à les approcher dans une cinquantaine d’années. Les Japonais ont pris l’option de ne pas faire de sarcophage, contrairement à Tchernobyl, en prétendant qu’ils pourront développer les technologies qui permettront d’extraire les cœurs en fusion. C’est aussi une manière de montrer qu’en fait, l’accident n’avait pas vraiment eu lieu, parce que quand on met un sarcophage, on reconnaît qu’il y a un « mort » qu’on a mis sous le sarcophage.
La catastrophe dure toujours sur le plan de l’eau accumulée sur le site, et dont on ne sait plus quoi faire. Vous connaissez les images des mille cuves, eau qui vient de l’arrosage que l’on est obligé de faire. Les eaux souterraines sont également contaminées. On a essayé de mettre en place un congélateur géant de 4 km de long pour arrêter l’écoulement des eaux, mais ça ne fonctionne pas, alors on accumule l’eau qui coule. Puis on a filtré cette eau avec une technologie française fournie par Veolia. Ça fonctionne un peu, mais le problème est que les matières les plus nocives qui sont bien sûr en très petites quantités comme le strontium, on ne peut pas les filtrer ; et donc on rejette maintenant tout ça dans l’océan, tout simplement.
Du côté humain, il y a ces 60 000 liquidateurs qui sont intervenus depuis le début sur le site de la centrale. Soixante pour cent d’entre eux probablement n’avaient aucun dosimètre au moment où ils ont été envoyés sur le chantier de décontamination de la centrale puisque cette main d’œuvre est issue du marché du travail au noir des grandes villes que sont Osaka et Tokyo. On y trouve beaucoup d’étrangers bien sûr, beaucoup de laissés-pour-compte, les castes les plus défavorisées de la société japonaise qui ont toujours été maltraitées, et qu’on mobilise beaucoup dans la construction, dans le secteur du bâtiment. Là, ils ont été embarqués dans la décontamination sur le site de la centrale alors qu’eux-mêmes ne savaient pas ce qu’ils allaient faire. Ces gens-là n’ont jamais eu de dosimètre. Mais à partir de ça, on ne peut donc pas donner tort à ceux qui disent que le bilan de Fukushima en terme de victime (vous le connaissez), c’est zéro. Il suffit de ne pas mesurer. Parce que tous ces gens sont dans la nature, ils vont avoir des maladies, cancéreuses ou pas d’ailleurs, pas forcément ; et mourir. Ils auront des maladies comme vous et moi on aura des maladies ; peut-être un peu plus ; et puis on ne saura jamais d’où viennent leurs maladies puisqu’on n’a aucun historique.
On est face à un impossible lorsqu’un événement comme celui-là survient. Toute la frauduleuse ambition de la résilience, ça va être de prétendre qu’en fait il est possible de clore l’impossible. Et au Japon la prétention à clore l’impossible, cette prétention à apporter une réponse à l’impossible va prendre une forme très concrète à partir de 2012 lorsque les autorités japonaises vont créer ce qu’elles ont appelé un « Ministère de la résilience nationale ». Quand il y a un Ministère de la résilience nationale, ça veut dire qu’en fait il y a un ministre de la résilience nationale : ça vous paraît bête, mais je préfère le dire quand même, pour qu’on prenne bien la mesure de ce que tout cela signifie, mais aussi pour dire qu’en rien, il ne faut considérer la mobilisation de la notion de résilience dans tous les champs de la vie sociale, économique, psychologique etc., comme ce qu’on dit souvent : comme une mode. La mobilisation de cette notion à un sens réel, un sens politique, d’où la mobilisation de cette notion dans la « Loi climat et résilience » en France. Dans ce projet de loi, le mot qui revient le plus, ce n’est pas le mot résilience, c’est le mot préparation. Quarante occurrences de ce mot montrent bien qu’en fait, il s’agit d’après les législateurs de préparer les corps et les esprits, les mentalités, d’éduquer. Mais je parlerai de la France plus tard.
Deux grandes branches dans cette politique japonaise de résilience nationale. D’abord le programme de décontamination, la décontamination étant un mot impropre puisque concernant la radioactivité : on délocalise. On prend et on met ailleurs, mais jamais on ne décontamine. Bref, on parle quand même de programme de « décontamination » : 30 000 décontaminateurs envoyés dans le département de Fukushima pour gratter le sol, mettre ça dans des sacs… Mais en fait ce n’est pas ça, le cœur du programme de décontamination. Le cœur, c’est ce qui est inscrit dans les directives du Ministère de la résilience, à savoir que ce sont les gens eux-mêmes qui doivent apprendre à décontaminer. C’est fondamental, parce que si l’on reprend les propos des psychiatres mobilisés (ce sont les professionnels, les experts les plus mobilisés dans le contexte de la catastrophe) « les gens doivent prendre part à la décontamination pour pouvoir évacuer leurs peurs » ; « il est important pour calmer sa peur d’être exposé à la radioactivité ». On est vraiment dans la logique que la catastrophe ce n’est pas ce qui survient, mais c’est l’impréparation notamment psychologique à ce qui survient. Le président de l’enquête sanitaire sur la catastrophe de Fukushima, un grand ponte, un grand expert également président de l’AERF, organisme nippo-américain qui depuis l’après-guerre gère le gros laboratoire qui prend en compte et fait de l’expérimentation sur les victimes d’Hiroshima (je ne vais pas vous décrire toute la toile d’araignée japonaise des relations science-industrie), ce monsieur
Yamashita dit des choses qui sont très intéressantes et importantes. Il dit d’abord qu’à Fukushima il y a eu une épidémie de peurs et non une épidémie de cancers. A Fukushima, c’est la peur qui tue. Il dit encore que les effets des radiations n’atteignent pas les gens heureux et rieurs. Elles touchent les gens à l’esprit mesquin, qui ruminent et se font du mauvais sang. Tant pis pour vous ! Le stress, dit-il encore, n’est pas bon du tout pour ceux qui sont soumis aux radiations. Le stress met à bas le système immunitaire et peut donc provoquer des cancers et des pathologies non cancéreuses, c’est pourquoi il recommande aux gens de se relaxer. C’est une sommité scientifique japonaise qui s’exprime. Donc un programme de décontamination qui consiste à faire passer la catastrophe du côté subjectif et psychologique.
La politique de résilience nationale dans le contexte japonais a une autre composante : la politique du « retour ». Mais il faut que je dise d’abord deux mots de la politique de l’aller. Il y a eu 80 000 personnes qui ont été déplacées de force par les pouvoirs publics. Entre 100 000 et 120 000 ont bougé de leur propre gré : on les appelle des « évacués volontaires », ce qui est un terme impropre encore une fois, puisque l’évacuation volontaire lorsque l’on est poursuivi par un tigre, ce n’est pas vraiment volontaire. Mais bon, passons sur la terminologie. Ce qui est certain c’est qu’il y a à peu près 80 000 + 120 000, soient 200 000 personnes qui ont été déplacées, sachant que dans le département de Fukushima concerné, il y a 2 millions d’habitants. Un million sur ces 2 millions sont répartis dans trois grandes villes, de 300 000 habitants chacune : Fukushima, Kuryama et Iwaki, toutes à peu près à 80 ou 70 kilomètres de la centrale. Aucune évacuation obligatoire dans ces trois grandes villes. 200 000 évacués, 2 millions de personnes et en fait les physiciens nucléaires ont mesuré des retombées dans dix départements adjacents à celui de Fukushima, y compris jusqu’au nord-ouest de Tokyo. Ce qui veut dire que 10 millions de personnes seraient en réalité concernées. Pas de manière hystérique, apocalyptique, mais au sens où en fait 10 millions de personnes sont soumises à l’exposition à du rayonnement à plus ou moins faible intensité. Je donnerai la définition de ce qu’on appelle faible un peu plus tard, sachant que la science officielle produite par les nucléaristes (y compris par les nucléaristes français) explicite bien que dès que vous quittez le seuil de zéro millisievert et que vous montez en exposition, vous augmentez les risques de pathologies cancéreuses. Il n’y a pas de seuil en deçà duquel il n’y aurait pas de risque : c’est ce qu’on appelle une courbe linéaire sans seuil. Ce qui me fait dire qu’à Fukushima le gros problème n’est pas qu’il y ait eu des déplacés, mais plutôt qu’il n’y en ait pas eu assez. Ceux qui sont restés pour des raisons diverses dans des zones contaminées sont aussi « déplacés » parce qu’ils se retrouvent dans un monde faux, un monde dont ils ne peuvent plus maîtriser les tenants et les aboutissants car ils sont journellement exposés, en lutte, en train de mesurer leur alimentation, leur environnement. Donc des gens qui sont placés involontairement sous une menace face à laquelle ils n’ont pas d’armes.
Bien qu’il y ait eu finalement très peu de déplacés, à peine étaient-ils déplacés qu’il fallait les faire revenir. Les pouvoirs publics ont mis en place une politique d’encouragement au retour à travers la suppression des logements provisoires et des subventions (les subventions versées dans le contexte de la catastrophe, 800 € par personne et par mois pour celles qui les ont reçues, n’ont jamais été des subventions liées à la radioactivité mais des subventions dites « psychologiques »), la reconstruction d’écoles dans les villages. Le problème des pouvoirs publics (que les petits vieux restent sur place n’intéressait pas les pouvoirs publics) était d’avoir des femmes et des enfants pour pouvoir faire fonctionner ce qu’ils appellent (c’est comme ça que sont qualifiées les femmes par certains ministres japonais à l’époque) des machines à reproduire. Il faut des machines à reproduire pour que les zones soient repeuplées. Il ne faut pas de rupture dans le fonctionnement économique et il faut absolument montrer qu’en cas d’accident, il n’y a pas besoin de déplacer les gens, ou seulement de manière minimale. Ça, c’est fondamental, parce que sinon le nucléaire n’est plus crédible (comme s’il l’était, même sans ça !).
Le seuil de sécurité a été fixé par les pouvoirs publics japonais à 20 millisieverts par personne et par an d’exposition tolérable. Au-delà donc, on a décidé d’évacuer. Eh bien, ce seuil correspond déjà à quatre fois le seuil de 5 millisieverts mis en œuvre à Tchernobyl en 1986, seuil qui lui-même était déjà cinq fois supérieur à celui d’un millisievert par personne et par an édicté par les autorités nucléaristes internationales avant tout cela. On est donc passé de 1 à 5, puis à 20. Pourquoi 20 ? En fait, il y a eu inversion du logiciel. Les pouvoirs publics japonais ont d’abord décidé du nombre de personnes qu’elles voulaient évacuer, et en fonction de ce nombre de personnes, elles ont remonté l’algorithme et ont défini le seuil au-delà duquel elles allaient évacuer. Elles ont décidé qu’il était socialement acceptable d’évacuer à peu près 80 000 ou 90 000 personnes, et donc en fonction de ça, ont défini le seuil à 20 millisieverts par personne et par an. C’est très important, parce que évidemment ce sera la même méthode qui sera appliquée en France en cas d’accident. La politique de résilience nationale au Japon a fonctionné à merveille car elle a permis de culpabiliser les victimes, de déresponsabiliser les responsables, de fabriquer de l’ignorance avec une science sans cesse contestée, alors qu’en fait on a une science sur les méfaits des nuisances radioactives. Mais c’est un peu comme l’industrie du tabac. A un moment donné, quand elle est confrontée à la mise en accusation, l’industrie produit une fausse science. De plus, des enquêtes auraient dû être menées et n’ont pas été menées. Mais je dirais que le cœur du réacteur de la résilience à Fukushima (« réacteur » au sens de producteur de réaction, c’est-à-dire d’anti-révolution), c’est la cogestion des désastres : c’est amener chacun à prendre part à la cogestion, à la décontamination, à devenir géomètre de sa vie quotidienne, à devenir un acteur alors qu’en fait, on a affaire à des victimes. Tout ça en prétendant que finalement à travers cette expérience, les gens allaient se renforcer dans l’épreuve.
J’ai essayé de démontrer que la catastrophe de Fukushima était une heuristique, un moment-clé, un changement, un nouvel esprit des catastrophes, parce qu’il y a une mise en doctrine de la résilience comme outil de gestion des populations, contrairement à Tchernobyl. Il y avait l’idée d’accommoder les gens à la vie radioactive après Tchernobyl ; mais à Fukushima il y a véritablement la mobilisation de la notion de résilience et une mise en politique de ce monde. Les choses deviennent claires : il y a vraiment un tournant. La manière de gérer la catastrophe, grâce à l’outil de cette technologie du consentement qu’est la résilience, va imprégner toutes les gestions des catastrophes dans le monde à partir de ce moment-là.
Je ne vous parlerai pas en détail de l’opération résilience COVID-19 en 2020, lancée par le président Macron. Elle s’appelle comme ça : « Opération résilience ». Le Parlement français a créé une Commission nationale de la résilience en juin 2021, qui a travaillé quelques mois. Elle a rendu son rapport en février 2022, trois jours avant l’entrée de la Russie en Ukraine. Ce rapport de 256 pages produit par les parlementaires a trois points de convergence majeurs avec ce dont je viens de parler concernant la politique de gestion de la catastrophe à Fukushima. Il montre combien les pouvoirs publics français s’alignent sur la politique japonaise.
Premier de ces points, ce que j’appelle la « fatalisation des désastres », c’est-à-dire surtout ne pas s’attaquer aux causes, rendre les désastres inéluctables comme une nécessité avec laquelle il faut vivre. Pourquoi fatalisation des désastres ? Dans ce rapport, les parlementaires nous disent qu’on entre dans un monde qui est « en guerre totale » : la guerre des satellites, la menace cyber, la crise climatique, les épidémies, les pannes de service internet, la désinformation, les agressions directes, etc., bref ce monde est devenu un monde en feu. Pour eux, il y a nécessité de devenir tous solidaires pour pouvoir contrer ce monde agressif dans lequel on vit. Quant il s’agit, lors de la crise sanitaire, de parler de solidarité, les parlementaires nous parlent de la « nécessité d’être solidaires pour renforcer significativement notre autonomie en matière de production industrielle et d’approvisionnement ». Le problème n’est donc pas les hôpitaux et le manque de lits, mais l’avenir de l’industrie pharmaceutique. Effectivement on se demande à quoi pourraient servir des lits supplémentaires, dans un contexte ou finalement « la crise sanitaire a montré l’aptitude de notre pays à résister aux conséquences de la catastrophe notamment grâce au dynamisme de la société civile et à des services publics développés et performants ». Voilà la représentation que se font les gouvernants concernant la réalité de cette catastrophe sanitaire et comment elle a été gérée. Le plus délicieux reste à venir. On voit en effet dans ce rapport que les parlementaires soulignent avec force (et on en est presque heureux) le rôle des activités humaines dans « l’accélération de la fréquence des épidémies ». Pour eux, il y a bien un problème avec les fermes industrielles, avec l’élevage intensif, l’urbanisation échevelée … Enfin ils pointent les causes ; mais toute l’entourloupe est de pointer les causes pour ne s’attaquer qu’aux effets, notamment en utilisant cette fameuse résilience comme solution, comme arme d’adaptation massive.
Deux exemples : concernant les virus, le modèle de la ferme industrielle, considéré comme le coupable, n’est pas questionné au sens où l’on n’envisage pas de le démanteler mais de mener des actions biosécuritaires (confinement, vaccination des hommes et des bêtes, destruction de cheptel). Or on sait très bien que ces actions sont parfaites pour conforter le modèle de la ferme industrielle, qui n’existerait pas sans ces outils technologiques ; il s’effondrerait. Et justement ce sont ces outils que les pouvoirs publics veulent développer. Ils identifient la ferme industrielle comme cause et ils y répondent en accroissant la capacité de cette même ferme grâce à la protection biosécuritaire… C’est une folie !
Deuxième exemple : le dérèglement climatique. Nos parlementaires ne sont pas trumpistes, ils admettent que le dérèglement climatique existe. Nos résilients en marche nous proposent la résilience, concrètement l’énergie nucléaire « qui comporte inéluctablement des risques industriels, sanitaires et environnementaux. Elle s’accompagne d’exigences supplémentaires de prévention des accidents et de résilience en cas de survenue de ces derniers ». Je résume : on a une crise climatique, on y répond par la résilience avec le nucléaire et en cas d’accident, il faudra être résilient. C’est la résilience dans la résilience, ce qu’on appelle « l’effet Vache qui rit ». Il y a une substitution de la fatalité des risques liés au réchauffement par la fatalité des risques liés à l’atome. On n’est pas dans un processus de remise en cause, d’abolition des causes. Résilier signifie toujours gouverner dans la fatalité sans se demander si tout bêtement, nous sommes véritablement adaptés. C’est une question bête que je voudrais poser : Est-ce que l’adaptation est adaptée ?
Deuxième point de convergence avec Fukushima, de ce rapport français : rendre le désastre subjectif. On explique aux gens qu’on peut vivre avec la radioactivité, le problème n’étant pas la radioactivité mais la peur. Cette subjectivisation du désastre va, dans le rapport parlementaire en question, jusqu’à faire un éloge du sacrifice. Voici ce que disent les auteurs du rapport : « Des centaines d’exemples d’héroïsme civil et militaire montrent la résistance collective des peuples face aux épreuves, famines, invasions, exils, épreuves qu’ils traversent illustrant que les membres d’une société humaine peuvent être habités par un sentiment ou des idéaux qui leurs paraissent plus élevés que leur propre vie ».
Donc, on est rassuré. D’autant plus qu’un peu plus loin, on nous dit : « La crise du Covid a prouvé que des milliers de citoyens étaient prêts à s’engager, y compris en prenant des risques ». Les rapporteurs nous disent également, et on ne s’en étonne pas :« Il va falloir mener une évaluation des effectifs directement mobilisables pour contribuer à la résilience nationale, c’est-à-dire les hommes et les femmes susceptibles d’intervenir en première ligne en cas de crise grave ». Et pour cela, ils préconisent parmi 51 mesures, une généralisation du Service National Universel et une généralisation du port de l’uniforme dans les écoles.
Je ne peux manquer de vous citer encore ce que nous disent ces gens concernant la jeunesse : « Chez de nombreux jeunes et moins jeunes, l’abondance inhérente à la société de consommation a fait oublier la possibilité du manque matériel. L’habitude du confort a fait perdre l’aptitude à la rusticité, aboutissant à une société qui assimile moins le risque et le danger et perd en résilience face à l’adversité ». On voit bien qu’on est un peu comme des sous-hommes, des sous-femmes à qui on enjoint de se tenir prêts à se faire crucifier dans l’espace canonique de la résilience, qui lui-même est sans cesse être en expansion. On voit bien aussi que décidément, dans ce monde en guerre dont on nous parle, dans lequel nous sommes projetés et duquel il faut nous accommoder à tout prix, on voit bien que cette quête effrénée de résilience nationale a de très forts accents de national-résilience !
Troisième et dernier élément de convergence de la gestion des catastrophes : c’est ce que j’appelle gouverner par la peur de la peur. Ou encore ce que j’appelle le racisme des émotions. Voilà ce que disent les rapporteurs : « Nous avons tous le devoir de faire prendre conscience à nos concitoyens que le monde qui nous entoure est un monde violent et qu’ils vont être rattrapés par cette violence très rapidement quoiqu’il arrive ». Donc là, c’est le contraire de ce que j’ai dit, c’est gouverner par la peur. Il y a donc bien un axe de gouvernement par la peur, mais un peu plus loin, les rapporteurs prescrivent « d’éviter que s’immiscent au sein de la population des jeunes une peur du futur, car si ce futur est perçu comme hostile, comme menaçant, cela devient très problématique. La propension à l’anxiété et à la frustration des générations actuelles tend à réduire notre capacité de résilience collective dans des situations de crise grave ». Donc, on a gouvernement par la peur d’un côté, gouvernement par la peur de la peur de l’autre, ce qui n’est absolument pas incompatible et fait partie effectivement de ce dispositif de double pensée auquel nous soumettent les dirigeants (ils tentent de nous y soumettre en tout cas), où il faut à la fois avoir peur et cesser d’avoir peur. Il s’agit donc d’évacuer notre anxiété, anxiété que les dirigeants semblent craindre, pour mieux se préparer au pire sans jamais se révolter contre les raisons du pire. C’est bien ça, l’objet de cette double pensée. L’objectif est effectivement de nous faire intérioriser la menace et de transformer la réalité physique et sociale du désastre (quelque chose qui arrive à un moment T) en quelque chose à quoi on ne pourrait pas se soustraire. Ce qui nous amènerait chacun à faire l’impasse sur ce à quoi on est contraint de se soumettre pour tenter de répondre à ce désastre. On a vu qu’à Fukushima, on a demandé aux gens de participer à la gestion du désastre afin de ne plus avoir peur de la radioactivité. On se souvient de la déclaration, en mars 2021, du Numéro Deux de l’OMS, disant : « On n’en finira pas avec le Covid-19, mais il faut éradiquer la peur du Covid-19 ». Il avait raison sur la première partie de la phrase, mais la deuxième partie est prescriptive. Tout ça pour demander aux Français de cogérer les catastrophes avec des bouts de ficelle, afin qu’ils se calment. « Nous estimons qu’il est indispensable qu’en France les populations soient mises dans la position d’acteurs plutôt que de consommateurs » comme lorsque nous avons été incités à fabriquer des masques sanitaires. « Cette implication pourra en retour réduire le sentiment d’anxiété, voire d’angoisse éprouvée ». Il s’agit de prétendre mettre les populations à l’abri de leur anxiété, et c’est bien l’objectif de cette résilience dont les apôtres visent à une réduction au silence, à l’abolition de la liberté d’avoir peur. Si on reprend l’analyse de Gunther Anders, philosophe allemand qui a travaillé beaucoup après Hiroshima, la liberté d’avoir peur est cette liberté qui renvoie à la capacité d’une population donnée d’éprouver un sentiment, une peur à la mesure du danger qui pèse sur elle, de ressentir la quantité d’angoisse qu’il faut que nous ressentions si nous voulons vraiment nous libérer du droit d’être libérés de la peur et avoir peur afin d’être libres.
La peur contribue à la prise de conscience que nous menons une existence dans un monde faux. Et c’est bien pourquoi il a fallu expliquer aux gens à Fukushima qu’il faut qu’ils cessent d’avoir peur, parce qu’ils sont dans un monde faux. S’il leur prenait envie d’avoir peur, il est évident qu’ils se mettraient en colère et qu’ils se révolteraient et fuiraient. La principale raison pour laquelle ils ne fuient pas, c’est qu’ils ont appris à ne plus avoir peur et à être l’objet d’un ajustement indéfini dans le nouvel environnement dans lequel ils sont plongés.
Je vais conclure avec une citation infâme de Sébastien Lecornu, le ministre des armées, invité du forum Normandie pour la paix : « La leçon de l’Ukraine, c’est que c’est un peuple résilient, c’est autre chose qu’une facture de chauffage, le don qu’ils font c’est celui de leurs fils ».
Voici la partie débat de la soirée avec Thierry Ribault, auteur de Contre la résilience. A Fukushima et ailleurs.
Le débat
Une intervention :
La peur, chez tout être humain « normal », fait partie de la base du cerveau reptilien : c’est ce qui le fait fuir, par exemple quand il y a un incendie. Le feu se voit, la radioactivité ne se voit pas. Ici on le sait bien, avec l’exploitation d’uranium pas très loin de Limoges. Ici ce n’est pas un sujet inconnu, mais c’est quelque chose de difficile à doser, même en milieu hospitalier. Ce qui est très choquant dans ce que vous avez dit depuis le départ, c’est l’absence de connaissance. À savoir : Qu’est-ce que c’est que la radioactivité, pour les Japonais ? Comment ils acceptent cela ? Moi, je pensais qu’ils avaient un niveau intellectuel assez élevé sur l’ensemble de la population, et c’est un peu comme s’ils n’avaient pas appris leur leçon sur la géologie, sur le nucléaire, dans quoi ils vivent. J’ai plein de questions sur ces savoirs de base qu’on apprend normalement au collège ou au lycée. Depuis 2020, on a un président qui utilise le mot « guerre » trois fois à la téloche, et on sait bien que faire la guerre contre un virus c’est complètement absurde. Je suis toujours étonné quand il n’y a pas de questionnement de la population. Depuis 2011, est-ce que les Japonais se sont interrogés sur ce qui se passe ? Sur la réalité du nucléaire ? Ont-ils accès à la connaissance ? Heureusement, en France, les médias ont dit beaucoup de choses, notamment depuis 2020. Ça a fait évoluer les connaissances des gens.
Thierry Ribault (T.R) :
Ça m’inquiète, votre manière de présenter les choses – j’ai peut-être mal compris – car il est évident que dans toute catastrophe nucléaire, où qu’elle arrive, il n’y a pas de manière française, japonaise ou autre de la gérer. Les peuples sont à peu près partout les mêmes. Bien sûr que les Japonais sont comme tout le monde, ils ont même plus de moyens, ils sont au courant des effets.
En fait, il y a un truc qui s’appelle « la politique de résilience nationale » qui fait que dans ce contexte de catastrophe japonaise, toute opposition et toute capitalisation sur la connaissance existante a été remise en question et bafouée. C’est à ça que sert la politique de résilience, partout. Il est évident qu’en France, au Japon ou ailleurs, on sait tout, on a accès à la connaissance. La connaissance sur le nucléaire est produite par les nucléaristes. Ils produisent des études où ils prouvent, sur la base de grandes études internationales, que la radioactivité devient nocive à partir de zéro millisievert. La connaissance, elle est là. Mais le problème, c’est que ce n’est pas parce qu’il y a de la connaissance qu’il y a une mise en action à partir de cette connaissance. A Fukushima, le problème c’est que la ligne entre connaissance et action est rompue : elle sert aussi à ça, la politique de résilience. Cette politique nous dit : le danger de la radioactivité par rapport aux populations, ce n’est pas la radioactivité, c’est la peur qu’en ont ces populations.
Le grand tournant de la politique de Fukushima, c’est le suivant : la gestion administrative publique du désastre n’est plus un problème technique (où on va parler de doses, d’exposition, etc.), non : c’est essentiellement sur les dimensions psychiques que va se faire la gestion du désastre. C’est-à-dire gérer les émotions que les gens ressentent à l’égard de ces désastres.
Évidemment que la peur est un réflexe humain vital, mais on est là dans une tautologisation de la peur. Peur de la peur. Elle est devenue en soi une maladie. A Fukushima, les pouvoirs publics ont injecté dans les réseaux sociaux des espèces de slogans, et il y en a un de particulièrement choquant : les pouvoirs publics ont stigmatisé les mères et les enfants qui sont partis, en les accusant d’être « des mamans irradiées de la cervelle ». On est vraiment dans quelque chose de lourd, où il s’agit de marteler que la peur est une maladie. D’ailleurs, c’est tellement une maladie qu’il y a des gens très sérieux qui, en neurosciences, avec l’observation des circuits neuronaux, travaillent à l’extinction de la peur : ils parlent d’éteindre la peur. Ils séduisent beaucoup de gens avec cette idée d’éteindre la peur : « switch off », comme un commutateur. Il faut trouver le commutateur dans le cerveau, pour qu’en cas de catastrophe les humains arrêtent de nous embêter avec leurs peurs. Tout converge, en termes scientifiques et politiques. Les scientifiques japonais qui travaillent sur l’extinction de la peur le disent clairement : nous travaillons là-dessus parce qu’il y aura de plus en plus de catastrophes et il faut apprendre à canaliser la peur, à la supprimer. Éteindre la peur pour mieux éteindre son malheur : c’est le fond de commerce de la résilience.
Sur la connaissance qu’ont les Japonais, il est évident que leur niveau de connaissance est au moins aussi élevé que celui que nous avons tous. Le problème, c’est qu’il y a cette fameuse politique de résilience qui vise à adapter et non pas à travailler sur les causes ni à préparer aux effets. Donc, à partir de là, tout le savoir possible ne sert à rien. Il y a eu des résistances au Japon, bien sûr, avec des millions de gens dans la rue. Mais la politique de résilience a permis de rendre non crédibles toutes ces paroles sur la radioactivité, parce que les pouvoirs publics avec leur politique de résilience ont introduit des fractures, ils ont semé le doute, en disant « on peut vivre avec ». Au point qu’il y a eu beaucoup de fractures dans les familles.
Une intervention :
Pour moi, il y a résilience et résilience. Ce terme a été utilisé par le mouvement écologiste, notamment par les gens de la décroissance et la revue Silence, à une période antérieure à Fukushima. Il y a des gens taxés de collapsologues qui ont employé ce terme. J’aurais tendance à ne pas mettre ces gens-là dans le camp de l’ennemi. Quant aux peuples indigènes qui ont subi des politiques de colonisation génocidaire, est-ce qu’on ne peut pas utiliser de manière phénoménologique ce terme de « résilience », pour dire qu’ils ne se sont pas fait exterminer ? Quand on voit ce qui se passe au Chiapas par exemple, où avec leur rapport à la terre ils n’ont pas été transformés par 500 ans d’histoire coloniale qui voulait les anéantir.
T.R :
Votre question est importante parce qu’elle me permet de parler de ce dont je n’ai pas parlé. J’ai oublié de dire que la résilience, c’est une anti-résistance. Et vous, ce dont vous parlez, c’est de résistance.
On voit bien là qu’il y a de la confusion, pas de votre part mais dans la manière dont la notion de « résilience » est mobilisée. Elle l’est pour laminer tout ce qu’on pouvait utiliser pour donner une belle définition de la résistance. C’est le président Macron, encore une fois, qui a dit lors des commémorations de la guerre, il y a deux ans : « La Résistance en France nous prouve qu’en fait la France est un pays résilient. » Vous voyez le problème. Il faut savoir. On ne peut pas être résistant et résilient. Si ça veut dire la même chose, moi je n’y comprends plus rien et franchement je vais me coucher ! Pour moi, durant la guerre, les résilients ce sont les collaborateurs. En face d’eux, il y avait les résistants. Excusez-moi : j’ai une vision très simpliste.
Il faut au minimum définir les choses. Il est possible qu’un certain nombre d’écologistes, de gens qui se prétendent résistants, mobilisent la notion de « résilience » mais ils font une grave erreur. Je vous rappelle que la notion de « résilience » est née dans la science des matériaux au XIXème siècle, quand dans les chemins de fer on cherchait à rendre les traverses en bois plus solides. Puis on a travaillé sur la résilience des métaux pour faire des rails de chemins de fer. Là on est dans la physique des matériaux : la résilience renvoie à la capacité de résistance des métaux ou du bois à un choc, à la capacité de ces matériaux à retrouver une forme après avoir subi un choc. Là je dis : parfait ! pas de problème.
Le problème, c’est quand la résilience, notion née dans la science des matériaux, de l’inerte passe aux choses vivantes. Appliquer cette notion qui vient des matériaux au vivant, c’est pour moi le début de la fin. Et c’est dès les années 1950 qu’on voit émerger la mobilisation de la notion de « résilience » dans le discours des psychosociologues, qui vont l’utiliser pour qualifier l’incapacité de certaines populations à ne pas tomber dans la délinquance. Bien sûr, ça va viser les populations noires : les personnes résilientes ne vont pas tomber dans la délinquance, et les autres tant pis pour elles. Ce qui est intéressant, c’est que la délinquance est vue comme un phénomène individuel. On est dans la culpabilisation des victimes. Les psychosociologues dans les années 1950 dans les pays anglo-saxons veulent mettre en place une liste de critères-types de ce qu’est la résilience, et parmi ces critères on trouve la foi, facteur de résilience qui évite aux gens de devenir délinquants. Cette vision réactionnaire de la représentation des phénomènes sociaux, on la retrouve dans les paroles du pape ou du gourou français de la résilience, ce fameux Boris Cyrulnik qui dit la chose suivante – il met ça au goût du jour : « La neuro-imagerie confirme l’effet thérapeutique de Jésus ». Je n’invente rien. Soixante-dix ans après, on a les mêmes conneries qui sont ressorties comme le nec plus ultra des avancées scientifiques de la connaissance de la psyché humaine. C’est grave. Au fond, la résilience, c’est un peu comme les bordels : ça se construit avec les briques de la religion. C’est à peu près les mêmes racines.
Une intervention :
Je n’ai pas préparé et je ne suis pas allé voir les textes de Silence ou de Servigne, ni réfléchi sur cette différence entre résistance et résilience. On peut remarquer aussi que les sciences se servent, comme d’autres domaines, de mots : on a la « puissance », la « résistance », en électricité. Après il y a des dérivés et des usages dans le temps et des sens qui se modifient.
T.R :
Tout à fait. Mais ce que je vous explique, c’est qu’il n’y a pas d’usage hasardeux d’une notion. Elle est bien utilisée dans notre époque pour des objectifs précis. Et je coupe court à une objection : « Oui mais la résilience, c’est une notion qui a été détournée, instrumentalisée ! » Non. En fait c’est un instrument de détournement ! J’ai essayé de l’expliquer en montrant qu’elle servait à déplacer notre attention des causes des catastrophes vers les effets. Ça défocalise de l’objectivité du désastre vers la subjectivité de sa gestion, et ça cherche aussi à nous détourner de la peur, donc de la révolte. C’est-à-dire à nous détourner de notre capacité de transformer la connaissance en action pour aller vers la joie agissante de l’action dans le désastre et la survie. J’appelle ça une technologie du consentement : l’idéologie utilise une technique qui nous amène à consentir à la survie, et non pas à nous dire : Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour vivre (et non survivre) ?
La résilience est une technologie du consentement, c’est-à-dire que c’est une technique et une idéologie. Consentir à quoi ? Consentir à la technologie, par la technologie. Dans le contexte de Fukushima, il s’agit de consentir au nucléaire. Il a bien fallu tenir compte de ces millions de gens qui sont sortis dans la rue après l’accident pour dire « Il faut arrêter le nucléaire ! » et même le premier ministre a dit : « On arrête ». Eh bien non. Six mois plus tard, un nouveau gouvernement a dit : « Non, on reprend, on continue et on développe ». Je n’entre pas dans les déterminants géostratégiques avec la place des Américains et leur pression sur les décisions, pour les faire avaler, à savoir que les Américains avaient besoin de bases de fabrication de l’arme nucléaire pour pouvoir faire face aux ennemis de toujours que sont les Russes et les Chinois, parce que le nucléaire civil sert toujours à faire du nucléaire militaire, et les Américains sont les gendarmes de cette zone et les Japonais leurs complices. Même s’ils sont frères ennemis, ils sont alliés avec les Américains du fait de leur deux ennemis communs.
Donc il s’agit bien de faire consentir à la technologie. Il s’agit aussi de nous faire consentir à la technologie vaccinale dans le cadre du Covid 19, et surtout de nous faire consentir aux technologies de surveillance. On n’a jamais plus consenti que dans cette époque et je pense que ce n’est qu’un début. La résilience est une technologie du consentement qui nous amène à consentir aux nuisances, qui vise à rendre incontournables – voire nécessaires – le désastre et ses suites. Consentir à la participation, aussi : amener chacun à devenir acteur par la cogestion des dégâts qui, bien sûr, permettent de déresponsabiliser les responsables et de culpabiliser les victimes. Consentir aussi à l’ignorance, en désapprenant à être touché au plus profond de soi (la santé) par la privation de nos libertés ; consentir à aller à l’entraînement, l’apprentissage et l’expérimentation des nouvelles conditions de vie induites par le désastre.
Parmi les 51 mesures du rapport parlementaire que j’ai cité, il y en a une qui définit le 13 octobre comme la « Journée nationale de la résilience ». Personne n’en a parlé. Ça veut dire que ça ne préoccupe personne. On est censé, lors de cette journée, apprendre à faire face à toutes les menaces qui nous assaillent et ce qui est intéressant, c’est que l’inauguration de cette première journée s’est faite à Rouen pour célébrer la catastrophe Lubrizol : catastrophe où, le jour où ça s’est passé, devant un nuage noir le ministre a dit à la foule : « Il va falloir que les populations cessent d’être anxieuses ». Donc on est bien dans une peur de la peur, à Fukushima et ailleurs.
Une intervention :
Quand j’étais en licence de géographie à Créteil, j’ai entendu parler pour la première fois du terme « résilience », mais plus d’un point de vue collectif, sociétal, pour dire que les sociétés non industrialisées étaient beaucoup plus résilientes en cas de catastrophes naturelles, par rapport à nous qui avons des centrales nucléaires qui peuvent exploser, ou construites dans des endroits inondables ou menacés d’avalanches, ou autres… J’avais beaucoup aimé cette approche, et pour moi c’est le terme « résilience » qui résumait cette découverte. Pour l’instant, j’adhère encore à cette version positive du terme. Qu’est-ce que vous en pensez ?
T.R :
Je vais essayer d’être délicat. Il est évident que la résilience, quel que soit le contexte, société traditionnelle ou pas, individuel ou collectif c’est toujours la même chose : c’est la capacité à faire face à un choc, voire à grandir dans l’épreuve. Alors, je ne sais pas si c’est de la résilience ou pas. C’est peut-être tout simplement de l’intelligence. Est-ce que ces gens-là, vous les avez interviewés ? Je vous dis ça, parce qu’aux victimes du Bataclan on n’arrête pas de dire : « Vous êtes résilients, vous avez une forte capacité à traverser les épreuves… » Et elles, quand on les interviewe, elles disent : « Mais moi j’en ai ras le bol qu’on me dise que je suis résilient ! Je vais porter ça sur mes épaules toute ma vie ! » Est-ce que les paysans, suite à un tremblement de terre, gardent leur malheur sur leurs épaules toute leur vie, ou pas ? Ce que je veux dire, c’est que la résilience est un outil d’interprétation utilisé a posteriori.
Le même intervenant :
S’il y a un tremblement de terre et qu’il y a des constructions en béton, il y a des morts. S’il n’y a pas de construction en béton, il n’y a pas forcément des morts, et les champs continuent à produire. C’était comme ça qu’on nous la présentait, en cours, la résilience.
T.R :
Les gens qui vous ont présenté cette histoire, ils ont vécu des tremblements de terre ? J’ai vécu à la campagne au Japon, et lors d’un tremblement de terre vous avez intérêt à vous planquer, même s’il n’y a pas de béton. Le danger c’est le danger, et après on s’organise face au danger. Je n’ai pas dit qu’il n’y avait pas de réaction, de façon de s’organiser, mais pourquoi appeler ça de la résilience ?
Une autre intervention :
Les paysans dont tu parles, qui vont chercher une alternative à des moments de catastrophe qu’ils ont connus, ils ne sont pas dans un processus d’acceptation, au contraire. Je le vois plus comme ça.
T.R :
Je rappelle que les Japonais sont le peuple le plus préparé aux catastrophes, au niveau mondial. Ils ont des sessions de préparation aux tremblements de terre, aux raz-de-marée. Il y a des systèmes d’alarme. C’est très sophistiqué, c’est inscrit dans les pratiques sociales. Mais ils ont quand même eu 21000 disparus du fait du raz-de-marée. Et pourtant, vous disiez que les Japonais sont les plus résilients du monde… Donc la notion de « résilience », celle qu’on vous a inculquée, elle vient a posteriori lire une réalité qui en fait n’a rien à voir avec la résilience.
Cette notion est aussi utilisée pour parler des gens rescapés des camps de concentration. On entend souvent les cyrulnikiens dire : « Les gens qui en ont réchappé étaient résilients ». J’ai même trouvé des cyrulnikiens pour dire que la résilience inscrite dans « l’expérience du camp de la mort est un chemin initiatique qui procure une force de vie » ! Mais demandez plutôt aux gens qui en ont réchappé, ou lisez ce qu’ils ont écrit, comme Primo Levi : « Moi j’ai réchappé des camps par hasard. » Donc il y a un problème à utiliser une notion qu’on mobilise pour lire une réalité, alors que cette réalité n’a rien à voir avec la notion qu’on mobilise pour l’expliquer. En fait, ça s’appelle une fraude.
Bien sûr qu’il y a des situations où les humains arrivent à faire face à ce qui leur arrive. Heureusement. Mais ce n’est pas de la résilience.
Une intervention :
Est-ce que nous sommes prévenus de ce qui nous attend ? On parle de « loi climat et résilience ».
T.R :
Oui, mais bien sûr il s’agit de ne pas remettre en cause les raisons du dérèglement climatique. Il s’agit de continuer comme avant avec des mesurettes et de culpabiliser les gens, comme s’ils ne baissaient pas le chauffage, comme s’ils adoraient payer des grosses factures ! On est dans une individualisation du désastre, donc dans tout sauf s’attaquer aux causes.
Une intervention :
Je vous conseille de lire cet ouvrage qui me sert un peu d’antidote. En bac pro, il y a cet ouvrage : Vers le Bac. Le Japon, une gestion difficile des risques dans lequel on nous dit que de nombreuses maisons japonaises sont en bois, ce qui facilite la résilience ; et là il y a une petite note pour nous dire ce qu’est la résilience : c’est la « capacité d’un individu ou d’une société de s’adapter à une catastrophe » ; et un peu plus loin on nous dit : « Au cours des derniers jours les autorités japonaises ont remis des instructions d’évacuation à 5 millions de personnes, mais elles ne sont pas obligatoires et beaucoup ne les ont pas suivies par ignorance ou parce que c’était dangereux de partir ». Est-ce que la résilience, ce n’est pas une nouvelle forme de la servitude volontaire dont parlait La Boétie ? Il y a une version de droite autoritaire, manipulatrice, et une version de gauche beaucoup plus naïve. Comment faire participer les gens à leur propre aliénation ? Je suis bien d’accord qu’en ce qui concerne le vocabulaire, la différence c’est que la « résistance » a un ancrage historique et la « résilience » est une manipulation rhétorique. C’est quand même une différence fondamentale, c’est une condition de la pensée.
Une autre intervention :
J’ajouterais quelque chose : avec les neurosciences, on peut démontrer que le cerveau est résilient. Les techniques de MDR veulent évacuer toute notion de trauma.
L’intervenant précédent rajoute :
Tu cites Etienne Klein à la fin de ton intervention : l’observation du cerveau montre qu’il y a de l’électricité qui passe dans une partie du cerveau, oui, mais rien n’en dit la signification. C’est vraiment une manipulation rhétorique.
T.R :
Concernant la manière dont les nouvelles psychothérapies intègrent la résilience comme outil thérapeutique, je ne connais pas trop ; mais les témoignages que j’en ai eu en faisant des conférences dans toute la France me montrent que pour les professionnels de la psychiatrie, de la psychologie aussi, la résilience n’est absolument pas une notion pertinente pour travailler. C’est un faux outil pour eux et qui cherche à rendre responsable la personne qui est victime.
On est dans une métaphysique étatique du malheur, une espèce de religion du malheur gérée par l’État, et la résilience est au cœur de cette religion. Les gens dont j’ai lu le rapport tout à l’heure sont persuadés que le monde va s’effondrer et qu’il faut se préparer individuellement à ce qui va arriver. Comme si on était responsable individuellement de l’effondrement à venir, alors que c’est à cause d’eux ! Mais eux, ils admettent l’effondrement comme fatal, c’est pourquoi ils nous donnent comme réponse et antidote la résilience. Ils sont effondristes, comme ceux que l’on retrouve du côté des libertariens avec leur fusils, vivant en micro-communautés et se préparant pour faire face à l’ennemi potentiel. Voilà les deux écueils de notre époque, que nous révèle la mobilisation de la notion de « résilience » : d’un côté on nous entraîne à un survivalisme d’État, c’est-à-dire une situation où l’État va nous donner les voies de la survie collective ; de l’autre le survivalisme libertarien pur jus, en treillis, qui réinvente le feu et surtout réinvente l’arme à feu comme outil de protection face aux ennemis qui vont venir, en cas d’effondrement, nous voler le peu qui nous reste. Les deux écueils sont là.
C’est pourquoi il faut qu’on se ressaisisse. Il faut démanteler la résilience pour éviter ces deux impasses. Dans un cas comme dans l’autre, il ne s’agit pas de mettre en place une résistance, il s’agit d’amener chacun à s’adapter. On n’est que dans l’adaptation, et non pas dans la remise en cause de ce qui nous amène à cette crise profonde. Et si j’ai un message à donner, c’est qu’il faut travailler à ne tomber dans aucun de ces survivalismes, d’État ou libertarien (néofasciste en fait). Il y a plein d’éléments en France qui convergent vers ça.
Une intervention :
Est-ce que vous avez suivi les échanges entre Houellebecq et Michel Onfray, dont on a parlé dernièrement ?
T.R :
Non, non je ne connais pas ces personnes ! [rires].
Le même intervenant :
Quand on est au CNRS, on devrait écouter un peu ce qui se dit ailleurs !
T.R :
Excusez-moi de répartir mon temps de la manière la plus utile. Moi je n’ai rien à dire à ce sujet, mais allez-y.
Une intervention :
On parle de l’actualité, ce débat à son intérêt. Le Français moyen, y compris le jeune bachelier, est-ce qu’il connaît et comprend le mot « résilience » ? C’est important, de lui donner une définition à peu près correcte.
T.R :
Je ne comprends pas bien votre question… Mais c’est un mot qui est partout, donc les jeunes doivent en avoir une vague idée. C’est l’art de s’adapter, en fait.
Une intervention :
Je voulais juste revenir sur un mot employé qui m’a choqué : c’est le mot « larve », employé à propos d’une sommité qui est Ministre des Armées. C’est le premier qu’on ait : d’habitude ce sont des Ministres de la Défense. Pour qu’on ait un Ministre des Armées, c’est qu’on est vraiment très menacé ! Les larves c’est très précieux, ce sont des êtres très résistants, peut-être plus que l’humain. Un peu de respect !
T.R :
J’en profite pour donner une autre citation de la larve en question, en septembre : « Il faut qu’on réfléchisse à une dimension mondiale du Service National Universel. Comment prendre une classe d’âge et la préparer à tous ces risques ? Les risques c’est la pandémie, l’attentat terroriste, la guerre aux portes de l’Europe. Je pense qu’il y a un chemin autour de la vérité et du partage des contraintes. C’est ça, la résilience. » Voilà encore une autre manière d’en parler.
Une intervention :
Qu’est-ce que vous préconisez, comme action ?
T.R :
Il faut arrêter de dire que le malheur a quelque chose de bon à nous apporter. Ça paraît bête, mais c’est important. Ça ne veut pas dire le mettre sous le tapis : ça, c’est en quelque sorte ce que nous apprend à faire la résilience. Je n’ai pas d’actions à vous proposer, je ne suis pas votre gourou ! Demandez à Cyrulnik ! Par contre, il faut sortir de l’exaltation de la souffrance et du sacrifice : elle est inversement proportionnelle aux effets déployés pour en être épargné. Il faut trouver toutes les manières de vivifier le désir de prendre distance vis-à-vis de la condition de survivant dans laquelle on veut nous enfermer.
Il faut arrêter de penser que le désastre est une source de progrès. C’est cette machinerie qui fait que nous allons avoir des désastres. Si on prétend empêcher, freiner les catastrophes, il faut arrêter d’en faire des sources de progrès. Le malheur n’est pas vertueux. Voilà. Je ne me présente pas aux élections, donc je n’ai pas de programme.
Ce que j’attaque, c’est la résilience en tant que fausse solution. Je ne vais pas dire qu’il faut s’unir, lutter tous ensemble – peut-être que c’est bien, mais il faut d’abord lutter dans sa propre tête, faire une révolution intérieure avant de la faire à l’extérieur. Je crois qu’il faut qu’on soit conscient que le bonheur palliatif qu’on nous propose n’est pas admissible. C’est quoi ? C’est un bonheur où on nous demande sans arrêt de faire appel à du « trop peu » : trop peu de santé (je l’ai déjà évoqué), trop peu de vie, de liberté, de fureur, trop peu de refus comme si cette situation de trop peu était éternelle. À l’échelle individuelle, il faut remettre en question cette idée que nous sommes une machine à encaisser les coups. Il faut cesser de nous dévaloriser et cesser de faire de la résilience une réponse à tout, une forme de solutionnisme. Je suis sincèrement affligé de voir que c’est un rouleau compresseur qui avance vite. Et c’est à chacun de refuser de se rouler dans le malheur comme si c’était un mérite.
Une intervention :
Ça concerne la gestion des émotions par l’administration de la résilience, et c’est un mot que moi j’ai utilisé il y a six ou sept ans quand il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo. Je fais de la chanson. Dans une chanson je parlais d’« émotionalisme » et je l’ai vu dans ton livre. Je te donne ma version : c’est les bas-fonds de l’émotion – dans la chanson je dis : « T’embrasses un flic, t’es fier d’être Français »… L’émotionalisme est réactionnaire et donne le fascisme.
T.R :
Ce n’est pas incompatible avec ce que je dis. Ma définition de l’émotionalisme, c’est : le racisme des émotions. Il y aurait des émotions positives et négatives. Peur, colère, anxiété : on devrait les mettre sous le tapis. On devrait n’avoir que des émotions dites positives : le sens de la solidarité, être tourné vers l’avenir, avoir de l’espoir, positiver, etc. L’administration des sentiments dont je parle, qui est devenu la sœur jumelle de l’administration du désastre, c’est d’amener chacun à mettre sous le tapis les émotions négatives pour ne se concentrer que sur les émotions positives et pour éviter toute forme de révolte. Ta question est importante parce que c’est vraiment ça, la chose la plus menaçante qu’on est en train de vivre : la prétention des neurosciences à vouloir gérer ces émotions qui nous sont propres. C’est dramatique, de vouloir faire le tri entre les bonnes et les mauvaises émotions. D’ailleurs, il n’est pas certain que les neurosciences soient capables de le faire, mais elles essaient.
Je voudrais faire une citation pour montrer que ces gens sont dangereux. Encore une fois, de Boris Cyrulnik, dans son interview du 25 octobre 2022 dans We Demain, une revue épaisse, luxueuse, genre bobo-fasciste. C’est un numéro spécial paru à l’occasion de l’organisation du troisième « Forum sécurité et résilience » coorganisé notamment par la revue et par la Direction générale de la gendarmerie nationale. Cyrulnik est la vedette de ce colloque. Depuis 2007 il a fait beaucoup de formations pour l’armée. Il dit : « On assiste a une démocratisation de la violence. [Au sujet des Gilets jaunes :] Chacun estime que cette violence est légitime et délégitime ainsi la violence de l’État. » Ça veut dire que l’État ne peut même plus taper sur les gens sans se faire accuser, parce qu’il y a des Gilets jaunes qui attaquent les gendarmes ! Plus loin : « Les neurosciences actuelles permettent d’identifier de nouvelles sources de violence avec des familles instables, des fins de mois difficiles, une absence de contrôle des émotions, une mauvaise maîtrise du langage, un accès distant à la culture et à l’école, des catégories entières de gens défavorisés sont privés de lieux de parole. C’est ça qu’on a vu avec les Gilets jaunes, Gilets jaunes qui légitiment la violence parce qu’ils ne peuvent pas prendre part à la société. » Voilà la lecture que fait Cyrulnik de ce mouvement social ! Il dit plus loin : « Cela s’objective en neurosciences, neurosciences qui photographient comment un cerveau non éduqué acquiert une dysfonctionnement cérébral et ne peut plus gouverner et maîtriser cette violence. » Voilà ce qu’il nous dit ! Sa lecture du mouvement social est la suivante : en gros ce sont des tarés à qui il manque une case, qui sont incapables de contrôler leurs émotions, et il va falloir faire quelque chose pour qu’ils arrêtent de taper les CRS qui, si on les tape trop, vont être délégitimés dans leur violence d’État… Et ça passe comme une lettre à la poste ! Dans toutes les discussions sur la résilience il faut la démanteler, parce qu’elle mène à ça, à cette vision machinique des humains.
—————————————-