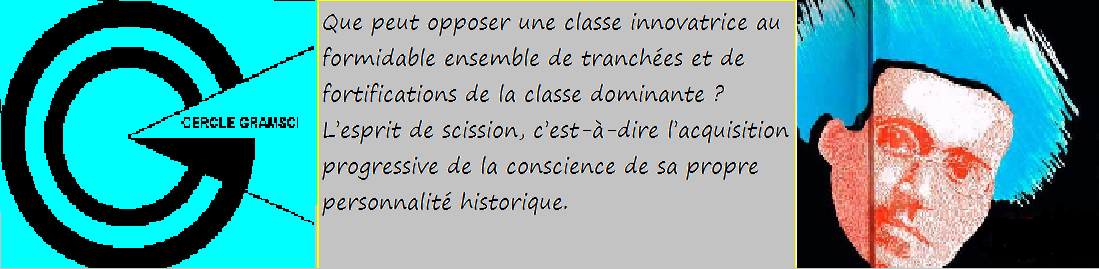L’Histoire, ça sert à quoi ? Deux historiens, deux regards
L’Histoire, ça sert à quoi ?
À faire la guerre bien sûr, et à mobiliser les peuples autour du Pouvoir. À faire d’une population une nation. Chaque empire, chaque état a eu ou s’invente sous nos yeux un « roman national » dont le Pouvoir joue à sa guise. Sans lui pas de Brexit et pas d’Écosse, pas de Milosevic, pas d’Erdogan, pas d’Israël. Soit. Mais l’Histoire libre de dire détient les clés de la liberté, de l’autonomie et de l’esprit critique. L’Histoire en liberté est le socle des Lumières. Elle menace les « croyances », elle met à bas les certitudes et les dogmes en tous genres. C’est pourquoi elle fut/elle est si souvent science interdite ou muselée : dans l’Espagne de Franco, l’URSS de Staline, l’Inde de Modi, l’Algérie d’aujourd’hui. Under control. Passée sous silence. Ou héroïque. Ce qu’on tentera de démontrer. Michel C. Kiener, agrégé d’histoire, diplômé INALCO (langues slaves).
Et si le passé éclairait le présent ?
Il est courant de recourir à l’histoire afin d’expliquer des phénomènes contemporains. Cela peut sembler paradoxal pour une discipline tournée vers l’étude des mondes disparus. Est-il ainsi raisonnable de remettre au passé les clés du présent ? L’histoire permet une mise en contexte de nature à faciliter la compréhension d’une situation présente mais une intrication systématique du passé et du présent peut conduire à conférer un sens à l’histoire. Cette histoire qui a conscience de ses propres fins remplit une dimension consolatrice car elle montre la voie d’un salut que le sens de l’histoire est censé dévoiler. Des Lumières aux néoconservateurs américains, grande est la tentation de déchiffrer l’histoire et assigner ainsi un but à l’humanité. Mais, loin de ces grands systèmes idéologiques, si l’histoire nous aidait simplement à vivre ensemble en société ? Décrédibilisé par les crispations identitaires, le « roman national » tisse aussi les liens d’une communauté. Cependant, à l’ère néolibérale où il n’est pas de société mais des individus quel rôle peut bien encore remplir la connaissance du passé ? Dominique Danthieux, docteur en histoire, chercheur associé au CRIHAM, université de Limoges.
L’HISTOIRE, ÇA SERT À QUOI ?
Première partie de cet après-midi débat. La suite dans le prochain numéro.
Présentation de Christophe Nouhaud
Nos deux invités sont « tombés » dans l’Histoire depuis longtemps : Dominique Danthieux est enseignant d’Histoire-géographie en collège, Michel Kiener a été longtemps professeur d’Histoire-géographie au Lycée Gay-Lussac à Limoges et chargé de cours à l’université de Limoges. Ce sont des chercheurs en histoire contemporaine et aussi en histoire moderne (pour Michel Kiener) de notre région dans les champs politique et social. Dominique Danthieux est l’auteur d’une thèse sur le mouvement social en Haute-Vienne – République, socialisme et communisme sous la 3ème république ; il a aussi publié des articles sur le communisme rural, il a coordonné différents ouvrages, en particulier Utopies en Limousin (Les Ardents, 2014) – un débat a été organisé dans le cadre du Cercle au moment de la sortie du livre, ainsi qu’un ouvrage sur Le Front Populaire en Limousin (Les Ardents 2016). Il préside depuis 2010 l’association Mémoire Ouvrière en Limousin. Il est chercheur associé au laboratoire CRIHAM des universités de Limoges et de Poitiers.
Nous devons à Michel Kiener de nombreux ouvrages et travaux sur l’histoire du Limousin depuis le livre marquant Quand Turgot régnait en Limousin (Fayard 1979), il y a quarante ans. Dans les dernières années, il a beaucoup travaillé sur la Première et Seconde guerres mondiales en Limousin : les enfants juifs réfugiés, la bataille du Mont Gargan…
Le thème de notre débat est » l’histoire ça sert à quoi ? « , notamment pour les pouvoirs,² qu’ils soient autoritaires ou de régimes de démocratie libérale. Ceux-ci se sont emparés de l’histoire et en ont fait une construction pour légitimer une nation, c’est-à-dire une population sur un territoire donné, ou pour légitimer leur pouvoir propre. C’est vrai pour la République, avec l’élaboration des programmes scolaires et leurs images d’Epinal (le sacre de Clovis, etc.) sous la Troisième et Quatrième républiques. L’histoire a été beaucoup utilisée, y compris dans la construction des démocraties libérales. Mais l’histoire, c’est aussi un moyen d’interroger le passé, de mieux comprendre le présent à travers l’analyse des événements qui se sont produits par la passé.
Exposés des deux intervenants :
– Intervention de Dominique Danthieux
Ce que nous a demandé le cercle Gramsci est un exercice qui n’est pas simple pour des historiens, parce que l’historien » fait » de l’histoire ; il en fait avant de la penser. Penser sur l’histoire est un exercice un peu plus complexe avec lequel les historiens sont plus ou moins à l’aise. Parler histoire, c’est aussi éviter de verser dans des discours trop complexes, hermétiques au grande public.
Avant de se questionner sur l’utilité de l’histoire, on peut parler du travail de l’historien. L’histoire, c’est bien sûr un mode de connaissance du passé. Il y a des historiens de métier mais aussi des historiens » non académiques « , hors sphère universitaire. Les historiens sont d’abord animés par une éthique professionnelle, une » éthique de vérité « . On peut reconnaître alors comme historiens tous ceux qui s’en réclament et se retrouvent dans cette éthique de vérité. Je me suis inspiré pour cela d’un texte d’Henry Rousso1 sur cette éthique de vérité applicable à la compréhension des mondes passés. L’idée est d’atteindre le plus haut degré de vérité possible. Cela passe par l’application d’une méthode rigoureuse de problématisation, de contextualisation, d’inventaire critique et de croisement des sources, etc. A travers la démarche de l’historien, on peut déjà formuler un premier » à quoi ça sert » : le service de la vérité.
L’histoire aide les hommes à se sentir mieux : le sens de l’histoire
Cet impératif éthique m’a amené à m’attarder sur une phrase de Marc Bloch2 : » L’histoire, c’est ce qui aide les hommes à se sentir mieux « . Cette citation qui parait très simple soulève des choses beaucoup plus complexes. Est-ce qu’approcher de la vérité permet de se sentir mieux ? L’histoire remplit-elle une fonction » consolatrice » ?
Est-ce que l’histoire comme étude du passé (dans la mesure où nous pouvons le connaître) nous permet de déchiffrer des éléments qui nous permettent de comprendre le présent et nous guideraient dans le futur ? C’est l’idée qu’il y a un sens de l’histoire et qu’en déchiffrant ce sens, on se sent un peu moins seul au monde, sachant vers quoi nous allons. Le déchiffrement de ce sens de l’histoire plus ou moins caché permettrait d’en finir avec ce que le philosophe allemand Hegel appelait » la conscience malheureuse « . Hegel, auteur d’une philosophie de l’histoire, cherchait le sens de l’histoire dans la quête de « l’Idée » qui animait l’histoire. Hegel est un contemporain de la Révolution française et il a vu cette révolution triompher des monarchies absolues. L’idée de liberté devenait ici un moteur important de l’histoire. Cette idée de moteur de l’histoire a été portée avant Hegel par la christianisme, et après Hegel par les grandes idéologies du XXe siècle : le fascisme et le communisme.
» Fin de l’histoire « , fin des historiens
Depuis une trentaine d’années, on a parlé de la mort des idéologies parce que toutes ces grandes vagues idéologiques sont venues mourir sur le rivage et ont fini par disparaître. En 1989, un intellectuel américain, Francis Fukuyama, avait théorisé la « fin de l’histoire » dans un ouvrage : La fin de l’histoire et le dernier homme. Il prédisait la fin du communisme et l’avénement du marché et de la démocratie. Il entendait par là moins la fin du fil des événements qu’une clôture de cette histoire qui serait guidée vers sa propre fin – dans un mouvement dialectique thèse, antithèse, synthèse… Ce qu’il voulait dire par « fin de l’histoire », c’était au fond un point final à l’évolution idéologique de l’humanité.
Un philosophe britannique, James (John) Gray, dans son ouvrage Black Mass ( 2007) dit que notre vision de l’histoire héritée des Lumières et par-delà du Christianisme se retrouve dans le néo-conservatisme (Gray a participé à cette doctrine puis s’en est éloigné). Ainsi, ce qui donne ici le sens de l’histoire, c’est d’inscrire la démocratie et le marché dans l’horizon du salut avec, si besoin est, l’instrument de la violence comme mode d’instauration (c’est ce qui s’est passé par exemple en Irak avec la guerre du Golfe de 2003).
L’histoire comme fonction critique
Cette supposée fin de l’histoire nous interpelle : si l’histoire finit, à quoi servent alors les historiens ? Elle porte aussi l’idée d’une histoire vidée de sa substance critique (l’histoire a une fonction critique) parce que le marché et le capitalisme deviennent l’horizon unique de l’humanité et vont apporter la libération et le bonheur. Ces idées-là se sont élaborées à la fin des années 1980, la cible désignée était le marxisme et la faillite de l’Europe de l’Est rendait en définitive la critique inutile. Telle était la démarche de François Furet3 illustrée par la phrase : » Nous devons accepter le monde dans lequel nous vivons » qui conclut son livre Le passé d’une illusion.
On voit que les néoconservateurs américains cherchent à achever leur adversaire idéologique avec ses propres armes, puisque les marxistes aussi prédisaient la fin de l’histoire – mais avec la fin du capitalisme. Ces intellectuels ont aussi retourné à leur profit tous les concepts moteurs de l’histoire telle qu’elle était avant, c’est-à-dire une histoire marchant vers le progrès et l’émancipation. Une belle illustration de cette récupération est le sens pris par le mot » réforme » quasiment vidé aujourd’hui de sa substance.
L’histoire, un éternel retour ?
Ces réflexions répondent à des préoccupation ancrées dans notre époque, car il ne faut pas oublier que l’historien qui étudie le passé parle depuis le présent. Les liens entre passé et présent sont donc importants à considérer. Ainsi, on oscille entre deux préjugés contradictoires : le premier est celui de » l’histoire qui ne repasse pas les plats » et le second, à l’inverse, est celui du » sentiment de retour perpétuel des événements « . Henry Rousso disait que cette dernière vision est héritée du XXe siècle car il y a eu deux guerres mondiales en l’espace de vingt ans, deux crises économiques, la chute de deux tyranies (nazie et communiste). Ainsi cette idée de revivre l’histoire, d’une certaine manière, s’incarnerait dans une opinion, commune aujourd’hui, qui veut que nous revivions les années 1930. Le philosophe Michaël Foessel, dans un ouvrage récent, Récidive (2019), s’intéresse particulièrement à l’année 1938 pour faire un parallèle avec le temps présent. Il reconnaît que l’histoire des années 1930 est une histoire singulière, ce qui était » possible » dans les années 1930 ne l’est plus aujourd’hui. Mais Foessel utilise le terme » possible » dans une acception philosophique, c’est à dire » l’essence « . En d’autres termes, à quoi peut-on résumer ces dernières années ? Si on cherche à résumer dans leur essence ces dernières années, on peut esquisser une comparaison entre 1938 (année sur laquelle porte l’ouvrage) et 2019 (date de parution de l’ouvrage) qui s’incarnerait dans ces questions : » De quoi les années 1930 sont-elles la manifestation ? et en avons-nous définitivement fini avec cela ? « . On se déplace des conditions historiques aux causes essentielles, (pour cela Foessel est parti du dépouillement de la presse de l’époque).
Je suis cependant un peu perplexe sur le résultat parce qu’il faut être prudent dans l’utilisation de l’histoire. Il faut voir d’une part l’usage que peut en faire un philosophe et d’autre part la façon dont l’historien considère les choses. Le risque est de tomber dans un essentialisme (naturalisme) et une lecture déterministe (les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets), même si les auteurs s’en défendent. Michaël Foessel peut user d’un parallèle avec 1938 parce qu’il connaît la suite. Et là, son » éthique » n’est pas exactement celle de l’historien : lui, il écrit pour alerter sur le mal. L’historien va se demander comment le mal a été possible, quelles conditions l’ont rendu possible, tout en considérant que ces conditions ne sont pas des déterminations.
Autre exemple : la lecture de la » Belle Epoque « . Celle-ci est surdéterminée par ce qu’on sait de son issue, la Première Guerre mondiale, notamment en ce qui concerne les relations internationales. L’historien australien Christopher Clark a écrit en 2014 Les funambules, ouvrage montrant que la Première Guerre mondiale, non inscrite à l’agenda des chancelleries, n’était pas inéluctable. Même quand l’enchaînement des causes n’est pas explicitement souligné, on a tendance à sélectionner les faits parce qu’on connaît la fin. La réflexion de Michèle Riot-Sarcey, historienne de ce XIXe siècle français si riche en réflexions politiques, se pose en critique de cette histoire-là. A travers son étude des révoltes et grèves sous la Monarchie de Juillet, Le réel de l’utopie, paru en 1998, elle observait que » le mouvement réel de l’histoire se dessine radicalement différent de ce qui est reconnu à travers les faits vainqueurs « . Il y a donc des » faits vainqueurs » que nous sélectionnons. Elle préconise de » s’intéresser aux phénomènes sans suite, restés incompréhensibles parce qu’incompatibles avec une continuité historique toujours arrangée « . C’est-à-dire qu’il faut s’intéresser à ce qui semble ne pas faire sens. Elle poursuit : » La connaissance de ce qui vient par la suite est un handicap, un fantôme usé et résistant « .
Les rapports passé / présent / futur sont assez complexes. On pourrait même effectuer un renversement quand on considère la période de l’affaire Dreyfus (1894 – 1906). A cette époque, on est en plein dans l’élaboration d’une histoire dite » méthodique « , basée sur des méthodes très rationnelles (critique des documents, etc.), c’est aussi le temps d’élaboration d’une histoire universitaire française. Et l’affaire Dreyfus a fait réfléchir les historiens. Ils se sont dit : étant donné que l’histoire est au service de la vérité, celle-ci n’est pas servie par la nation avec cette affaire. Cette affaire a aussi enclenché la création d’une histoire contemporaine, alors que jusqu’alors l’histoire ne s’effectuait que sur des périodes éloignées et était utilisée pour comprendre le passé. Gabriel Monod (1844 – 1912), le père de l’histoire méthodique française, fondateur de La revue historique, disait que » l’affaire Dreyfus et son déchaînement de passions et de fanatisme permettent de comprendre les guerres de religions, la Ligue et la Révolution » c’est-à-dire » comment des foules pacifiques, aveuglées par le préjugé peuvent devenir haineuses et meurtrières « .
Entre toutes ces visions, en apparence contradictoires, qui établissent des liens entre l’histoire, le passé …, ne pouvons-nous pas établir un point de convergence qu’on pourrait trouver avec cette proposition : et si l’histoire nous aidait à faire société ? Ce serait un des moyens du vivre ensemble (on a en tête la fameuse citation d’Ernest Renan sur la nation4).
On sait le rôle de l’histoire dans la construction des Etats-nations au XIXe siècle. L’histoire a évidemment aidé à constituer une communauté nationale. Aujourd’hui, la question semble beaucoup plus compliquée parce que nous sommes à l’heure de la mondialisation, du néolibéralisme qui, comme le libéralisme, ne reconnaît pas vraiment de société (dixit Margareth Thatcher5), mais des individus dont les relations s’établissent sur la base du contrat, qui se substitue au lien social traditionnel à la base de la solidarité, de l’organisation, du lieu de vie et de métier, de la société civile, des partis, des syndicats, etc. La question qui se pose alors, telle un serpent de mer, est celle du » roman national » : peut-il avoir une » face lumineuse » ? Partager une histoire commune est pratique parce que cela permet d’avoir des références communes : tout le monde sait ce que signifie 1789. Il faut aussi considérer que la conception du roman national brandie aujourd’hui par les tenants d’une histoire très conservatrice imposant par le haut ce roman national présente la risque de déboucher sur une histoire stérile, sans risque, immobile. C’est-à-dire qu’en arrêtant le temps de l’histoire, on constitue une espèce de sphère immobile rassurante ( » c’était mieux avant « ) qui se présente comme un phénomène de compensation par rapport à l’accélération du temps imposé par le tempo (l' » agenda « ) du monde économique et technologique. Un philosophe allemand, Hartmut Rosa, a décrit ces questions dans son ouvrage Accélération – une critique sociale du temps (2013).
Si on abandonne ainsi l’histoire à un passé immobile, on laisse la capitalisme, le libéralisme maître des horloges tout en purgeant l’histoire de sa fonction critique. » On construit alors un passé sans histoire « , comme dit Guillaume Mazeau dans son petit ouvrage, Histoire (2020).
Faut-il se méfier de l’histoire officielle ?
La production historique s’est effectivement faite au départ (au XIXe siècle) sous l’égide de l’Etat, avec les chaires universitaires d’histoire parce qu’il a été considéré que faire de l’histoire demandait une pratique à temps plein. Ce n’était plus un travail d’amateur éclairé comme auparavant. C’est aussi une époque où on recherche l’universalité et l’objectivité de la recherche. On cherche aussi à soustraire l’histoire à des groupes particuliers comme l’Eglise. Au XVIIIe siècle et même encore après, beaucoup d’hommes d’Eglise faisaient de l’histoire. Ces érudits locaux comme on disait, parfois pour s’en moquer un peu, étaient souvent des prêtres.
En Europe, on considère que c’est l’Etat qui peut assurer la subsistance des savants (aux Etats-Unis ce n’est pas la même conception). Si la communauté accepte de les rémunérer, c’est parce que leur travail présente une utilité pour elle, et plus largement une universalité pour l’humanité. Ainsi les historiens enrichissent la mémoire collective d’une communauté nationale et plus largement celle de la communauté humaine.
Mais, pour produire des connaissances, l’historien doit parfois se tenir à distance du monde social. Les questions qui se posent alors sont notamment : à quoi sert l’histoire ? l’historien doit-il se tenir éloigné du cours de l’histoire ? Comme l’histoire repose sur un travail critique, le résultat de ce travail peut heurter la mémoire nationale. Par exemple, l’attitude de l’Etat et de la nation dans l’affaire Dreyfus, ébranla fortement les valeurs des historiens de l’école de l’histoire universitaire » scientifique « . Cela les amènera à prendre leurs distances avec l’Etat et à s’engager en faveur de Dreyfus. Pour Gabriel Monod, l’histoire est une leçon de patriotisme mais avec certaines valeurs : conscience, humanité et bienfaisance. Le patriotisme des historiens de cette époque s’est trouvé quelque peu ébranlé, et ceux-ci se sont un peu dissociés de la vie publique pour approfondir la dimension scientifique de leur discipline. Après la Première Guerre mondiale, ils ont élaboré une critique pour se protéger d’une trop grande soumission à la nation. Les fondateurs des Annales, Lucien Febvre et Marc Bloch, ont recentré leur méthode sur des critères beaucoup plus stricts et scientifiques, au risque de bannir leur engagement dans la vie civique comme au risque d’une » désintellectualisation » (dixit Bloch). Quand Marc Bloch écrit en 1943 L’étrange défaite et se sert de son bagage d’historien pour analyser la défaite de la France en 1940, il dit : » Nous n’avons pas osé être sur la place publique la voix qui crie « . Bloch osera justement dans cette période difficile ne pas se replier complètement sur sa sphère universitaire, il s’engagera dans ses travaux mais aussi comme résistant, ce qui l’amènera à être assassiné par les nazis.
Pour terminer, je vais opérer un retour à la démocratie, car sans les historiens il manque quelque chose sur la place publique. Il ne faut pas penser l’histoire dans le cadre trop étroit du monde académique. Bloch estimait nécessaire la communication entre l’histoire et le grand public. Il disait : » Ayant les hommes pour objet d’étude, comment, si les hommes manquent à nous comprendre, n’aurions-nous pas le sentiment de n’accomplir qu’à-demi notre mission ? «
Quand on travaille en histoire contemporaine, il y a aussi une demande du public qui oriente les travaux vers certains questionnements, demande sociale à laquelle l’historien doit répondre. On a vu des historiens témoigner au tribunal, notamment dans des affaires jugeant des responsables de la Shoah. La fonction sociale de l’histoire exige des historiens qu’ils apportent des réponses au public. Il y a deux positions sur cette question : Gérard Noiriel dans La crise de l’Histoire dit : » Si on s’enferme un peu trop dans ce type de questionnement, la discipline perd de vue ce qui fonde sa spécificité, c’est-à-dire la compréhension des mondes passés « . Guillaume Mazeau, lui, considère que » l’histoire remet en jeu le passé dans le monde social et le met en tension avec le présent « .
Le développement d’une histoire à vocation scientifique est lié à un régime démocratique, sa connaissance s’impose comme un fondement des consciences publiques et, pour citer Max Weber6, » seules, les nations qui reposent sur l’histoire peuvent contribuer au bien commun « . Dans Le savant et le politique (1919), Weber poursuit : » En face de la politique, le développement de la science (l’histoire), permet un éclaircissement des faits et aux citoyens de devenir pensants et critiques « . Il faut ajouter que, vivant dans une société normalement éduquée avec beaucoup de moyens de communication à notre disposition, l’histoire est devenue une pratique sociale ordinaire. Mais après tout, n’est-ce pas ce que nous sommes en train de pratiquer ici ensemble ?
– Intervention de Michel Kiener
L’Histoire ça sert à quoi ? Je répondrai en deux temps. Elle sert avant tout à faire la guerre bien sûr, aucun doute là-dessus, et à mobiliser en continu les peuples autour du Pouvoir. Mais de quelle « histoire » parle-t-on alors ? Je parle ici de la mémoire collective, souvent divergente voire éclatée, de la mémoire d’actes et de moments fondateurs dont l’effet se prolonge. Ainsi en a-t-il été longtemps de la prise de la Bastille, de Valmy, des guerres de Vendée et de la courte séquence de la Terreur, pour m’en tenir à la Révolution. L’Histoire-mémoire est une arme fatale, oui, pour qui sait la maîtriser voire la manipuler, l’arranger à sa façon ou même la fabriquer de toutes pièces. Et cela reste d’actualité : les jeunes nations d’Afrique, Israël et les trois pays baltes, comme avant eux les nations émancipées de l’Amérique espagnole, ne peuvent s’en passer s’ils veulent subsister comme nations. Quant à l’Histoire des historiens, l’Histoire libre de fouiller et de dire, elle pourrait détenir de son côté les clés de la liberté de penser, pour peu qu’on la laisse fissurer la carapace des certitudes et des convictions, politiques, morales ou religieuses, qui sont le fouet des peuples. Encore faut-il qu’on l’écoute ou qu’on l’entende. C’est pour cela qu’on la traque ou qu’on la confine dans son monde d’érudits – c’est selon – quand on ne la remplace pas par une anti-histoire faite de fake news révisionnistes ou conformes à la doxa. Imaginez, à titre d’exemple, que le peuple catholique soit autorisé à fouiller sa propre histoire, à en savoir davantage sur ce que fut le mariage dans le passé ou le célibat des prêtres, cette tunique de Nessus dont l’Église catholique ne parvient pas à se dégager…
L’Histoire officielle, ce que Pierre Nora appelle « les identités groupales », disons cette vulgate en forme de roman national – expression désormais consacrée, sans qu’il soit utile ici d’énoncer les travaux qui l’ont rendue publique – cette histoire qui court les rues, les romans et les manuels dans chaque Etat ou société du monde, cette histoire fondatrice n’a pas seulement pour fonction de conforter la légitimité du pouvoir en place, comme ce fut le cas pour la République, comme c’est le cas pour les jeunes Américains qui prêtent chaque matin le serment au drapeau, comme c’est le cas pour l’Algérie contemporaine ; l’appel à l’Histoire a vocation à agréger et à mobiliser quand il le faut la population autour du Pouvoir « au cas où », en muselant les opposants et les pinailleurs. Malaxés par le Pouvoir du moment, les hauts faits du passé et les héros choisis, conquérants ou martyrs, s’articulent en une doxa mythique, fantasmée / façonnée peu importe – dont Rome, la Grèce (moderne autant qu’antique), la France, l‘Argentine et la Chine aussi bien, se sont nourris ou nourrissent leur présent. La France des rois, de même que l’Angleterre des landlords du passé et des Public schools actuelles, n’ont jamais cessé d’activer le roman de leurs origines et de leur devenir, comme le faisait n’importe laquelle des 360 tribus peau-rouge qui peuplaient la Californie d’avant les colons, un roman que chaque état, chaque nation développe et réinvente de siècle en siècle à son service. Que serait l’Ecosse sans son histoire à part et Marie Stuart ? La noblesse française d’avant 1789 pouvait opposer au vulgum pecus du Tiers-état son sang bleu, celui des Francs victorieux de la lie sang-mêlé héritée d’un empire romain à l’agonie.
De fait, à partir de la charnière XVIIIe – XIXe siècles, un roman national à forte charge émotionnelle, structuré autour de quelques valeurs fortes et de héros emblématiques, se met en place partout en Europe et dans les Amériques au sein des peuples, un récit national diffusé par l’école et magnifié par la production culturelle : opéras, romans, statuaire, sagas. Les « Éveilleurs » tchèques de la fin du XVIIIe siècle ont leur pendant chez les Magyars, les Serbes orthodoxes et les Scandinaves, et une histoire en forme de roman populaire sert alors de béquille à leurs revendications nationales et d’assise à un patriotisme revanchard. Et cela n’a fait que s’amplifier jusqu’à nos jours. Milosevic et sa croisade serbe des années 1970 doivent beaucoup voire tout à l’histoire, au souvenir exacerbé de la défaite tragique des Kosovo Polje, du Champ des Merles ; Trump et la NRA au mythe pionnier, aux Pères fondateurs sans cesse invoqués, aux cow-boys et à Fort Alamo ; Erdogan aux sultans conquérants vainqueurs de l’Occident. Staline a beaucoup exploité le souvenir d’Alexandre Nievski et de 1812, contrebalançant la révolte honnie des marins de Kronstadt par celle, glorieuse, du cuirassé Potemkin. L’Israël de Netanyahu se pose en réplique du récit biblique,ancrée dans une Palestine attribuée par Dieu à son peuple mais conquise de vive force dans le passé – et dans le présent ? – au profit d’un peuple seul maître de son destin. L’Israël d’aujourd’hui a pour socle son histoire, enracinée dans une archéologie mise au service de la cause ; Israël rejoue tous les jours dans ses écoles et la conscience collective la prise de Jéricho et l’épisode de Massada ; le mur des Lamentations, « invention » récente semblable à celle de la Sainte Croix pour les Chrétiens, permet de mobiliser les cœurs en donnant raison aux durs et aux purs. La IIIe République rejouait, de même, Bouvines, Valmy et le bûcher de Rouen tous les jours dans les salles de classe.
Cette mise en gloire des héros cultes ne date pas d’hier, qu’ils soient un conquérant (un Clovis, un Charlemagne, un Ivan le Terrible, un Charles Quint, un Louis XIV), un prince modèle (Henri IV, Saint Venceslas, Pierre le Grand), un résistant (de sainte Geneviève à De Gaulle en passant par Alexandre Nievski), un vaincu malheureux (Vercingétorix, Jeanne d’Arc, Toussaint Louverture, Abd-el-Kader), un martyr sans reproche (notre Jeanne encore, Michel de l’Hôpital, le petit tambour Bara), un moment culte (la Commune, la Bataille d’Angleterre de 1940, la révolte des Taipings), au nom duquel on va mobiliser les énergies et justifier les combats du moment.
Deux remarques pour en finir avec ce premier point.
Tout d’abord, concernant la géographie historique elle-même, flottante par définition. Elle justifie toutes les revendications territoriales les plus actuelles, celles du Hongrois Orban comme celles, il y a peu, du Serbe Milosević, tous les rêves de grandeur comme en Roumanie, en Pologne ou au Danemark. Il ne s’agit pas seulement du cas Taïwan qui exaspère la Chine, mais qu’on pense à la Bavière du CSU, orpheline des Wittelsbach, qu’on pense à Israël encore, à la Turquie en guerre contre ses Kurdes au nom de la Grande Turquie, et à la Russie orthodoxe proclamée par son tsar troisième Rome à la chute de Constantinople, à cette Sainte Russie chère à Poutine qui, pas plus que les Bolchéviques de naguère, ne peut accepter une Ukraine séparée de la mère patrie, cette Ukraïn de la Kiev des Varègues, matrice de la Russie actuelle.
Deuxième remarque, l’histoire admise d’une population / peuple se révèle à géométrie variable au fil du temps. J’en donne trois exemples. Tout d’abord, chez nous, l’inversion du regard concernant l’aventure coloniale naguère vantée de Jules Ferry, raciste tranquille, qui culmina dans l’exposition coloniale de 1931. Voici encore ce qui touche l’Algérie plus précisément. L’histoire « officielle » de l’Algérie française d’avant 1962 s’ancrait dans la Romanité de saint Augustin, puis sautait l’épisode d’une conquête arabe conçue comme une longue décadence, avant de vanter la mise en valeur régénératrice issue de la conquête d’Alger en 1830. L’histoire des manuels algériens d’après l’indépendance fait l’impasse sur une romanité jugée superficielle ou meurtrière au profit des racines indigènes berbères puis d’une société musulmane riche en histoires, riche d’une histoire brisée par la conquête quasi génocidaire française puis retrouvée avec l’indépendance. Une inversion de la loupe qui mobilise les chercheurs algériens, sommés de poser les bases d’une histoire vraiment algérienne. Mais c’est dans les éditions successives des manuels d’histoire de l’Union soviétique communiste stalinienne, puis post-stalinienne et désormais russe, qu’on peut suivre le mieux les variations orwelliennes d’une doxa officielle qui sait gommer jusqu’au nom et à l’image des héros d’avant devenus des parias, et choisir au fil des décennies dans les jardins du passé les fleurs à se passer à la boutonnière et les ronces à élaguer et oublier. On imagine ce qu’un enseignant aura dû avaler au cours de sa carrière.
Pourtant, c’est elle, cette Histoire, qui fascine tant de gens parmi les plus modestes de nos jours et alimente une production éditoriale généreuse où se mêlent les biographies, le roman historique et la reprise « mise à jour » des thèmes les plus porteurs.
Mais l’Histoire ne sert pas qu’à accompagner les tragédies. À condition qu’on commence à se mettre d’accord sur le sens d’un mot polysémique de nature. L’Histoire des manuels scolaires états-uniens ou français, j’en atteste, résulte d’un équilibre subtil entre le livre d’histoires (au pluriel) et l’injection savamment dosée des résultats de la recherche proprement historique. Car, heureusement, en marge de la doxa politico-religieuse en vigueur, travaillent des chercheurs qui vont aux sources, et cela depuis les bénédictins mauristes du XVIIe siècle chez nous. Des chercheurs qui, partout dans le monde, peuvent certes servir bien malgré eux à réactiver ce qui est jugé opératoire sur le moment dans le vécu passé, mais chercheurs qui peuvent aussi obliger à réviser les idées les mieux reçues et à ébranler les dogmes sur lesquels s’assoient les Pouvoirs. À commencer par Karl Marx et Engels, ou les travaux des femmes historiennes, professionnelles ou d’occasion.
Mais qu’il est difficile de faire passer dans la conscience collective ce que la recherche oblige à voir en face ! Autant que la « vérité », c’est la complexité que l’historien doit dévoiler. Deux freins s’opposent à son travail : d’une part sa propre résistance et celle de la société (ainsi dans l’Espagne post-franquiste) à revenir sur le trouble et les troubles du passé, d’autre part la cristallisation durable des idées reçues au sein de la population.
Qu’il est difficile pour un historien en herbe d’affronter les zones d’ombre, les terres inconnues et dangereuses que charrie sa propre société ! Comment s’attaquer au mythe napoléonien ? À la guerre d’Algérie, à la colonisation, aux débats de l’année 1919 en France face à l’Allemagne ? On doit constater qu’il revient souvent à « l’étranger » – Robert Paxton sur Vichy, des historiens américains, italiens et autres pour ce qui concerne l’épopée napoléonienne, et, une fois encore, des femmes pour ce qui les concerne – ou bien à des journalistes ou des écrivains – Soljenitsyne par exemple – de casser la baraque et d’ouvrir les vannes de la recherche. L’historien, qui devrait être« révisionniste » critique par nature, se trouve souvent pris à la gorge entre ceux qui, trop contents, entendent se servir de ses travaux ou en fausser le sens à leur profit, et ceux que son savoir menace. Ainsi en alla-t-il des travaux d’un François Furet sur la Révolution, ou de la production d’un Charles-Robert Ageron sur l’Algérie coloniale, dont les Guy Pervillé et les Benjamin Stora d’aujourd’hui ont pris le relais. Mais comment les Pieds Noirs et leurs descendants, qui diffusent et moulinent à l’envi en famille et au grand jour l’histoire très sélective d’une Algérie fantasmée soi-disant fraternelle, pourraient-ils assumer aujourd’hui les vérités qu’ils récusaient farouchement hier ? Comment dire le vrai sur l’année 1944 sans passer pour un révisionniste néo-nazi ? Comment dire le vrai sur les débuts meurtriers de Haïti sans passer pour raciste ou je ne sais quoi ? Comment plonger dans l’univers des pensionnats catholiques du passé, sujet tabou devenu explosif de nos jours ? Comment travailler sur une présence juive acceptée sans problème dans nos régions sous l’Occupation, sans risquer d’être accusé d’oublier Auschwitz ? C’est à l’honneur d’un Serge Klarsfeld de refonder ou au moins compléter sa vision de ce moment tragique de notre histoire nationale à la lumière des recherches les plus actuelles.
Affronter le déjà dit, le plus assuré, affronter le tu et le maudit, relire par exemple cette année 1919 si décisive pour la suite et pourtant laissée pour compte, étaler ses délires partisans et ses dérives, ce n’est pas si évident. Travailler sur la genèse et la construction du Coran peut se révéler à hauts risques, on peut l’imaginer, pour celui qui s’y colle, comme cela le fut au XIXe siècle pour ceux qui voulurent s’atteler à la genèse des évangiles canoniques, pour un Alfred Loisy ou un Teilhard de Chardin. Je songe aussi au bénédictin qui s’attaqua au dossier Jean Hus, recteur de l’université de Prague brûlé vif en 1415. Il avait travaillé sur les archives vaticanes, il termina dans les années 1960 aumônier d’un collège privé de jeunes filles en banlieue parisienne.
Mais l’histoire « scientifique » – on le maintient – est libératrice, autant que la science des climatologues et des géologues face aux délires des évangélistes de toute religion et aux diktats des dictateurs, et si elle est source de débats acharnés entre historiens au moment de lire l’archive et d’en tirer la leçon, elle est de toutes façons une source inépuisable de réflexion sur la condition humaine, sur l’organisation des sociétés, sur les ruses du Pouvoir et les mensonges qui nous gouvernent ou nous encadrent. Elle est ethnologue, sociologue, géographe, anthropologue, linguiste ou elle n’est pas. Briseuse de dogmes et de certitudes de toutes façons, et gestionnaire attentive et libre des itinéraires, personnels ou collectifs auxquels elle s’attache. Marraine des Lumières, indispensable de toutes façons. Elle est laïque, frondeuse, rétive, elle veut savoir et mettre au jour, rappelant sans se lasser la valeur du sens critique et du doute, et celle de la liberté d’apprécier et de penser.
Bref, elle est une Antigone irrépressible et sans cesse renaissante, dont aucune société moderne ne saurait se passer.
1 Henry Rousso, historien français, spécialiste du XXe siècle et notamment de la Seconde Guerre mondiale. Ce chercheur est notamment reconnu pour avoir défini les notions de négationnisme et de résistancialisme.
2 Marc Bloch (1886 – 1944), historien français, fondateur avec Lucien Febvre des Annales d’histoire économique et sociale en 1929. Marc Bloch a donné à l’école historique française une renommée internationale.
3 François Furet (1927 – 1997) historien français, spécialiste de la Révolution française et de son héritage idéologique. Au sein de l’École des Annales, il appartient à une génération d’intellectuels cherchant dans les faits les raisons de la faillite du projet marxiste.
4 “ Ce qui constitue une nation, ce n’est pas de parler la même langue, ou d’appartenir à un groupe ethnographique commun, c’est d’avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l’avenir. ”
5 En 1987, dans une interview au magazine Woman’s Own, la chef de gouvernement conservatrice indique : » Nous sommes arrivés à une époque où trop d’enfants et de gens (…) rejettent leurs problèmes sur la société. Et qui est la société ? Cela n’existe pas ! Il n’y a que des individus, hommes et femmes, et des familles. «
6 Max Weber (1864 – 1920), économiste et sociologue allemand considéré comme l’un des fondateurs de la sociologie. Ses interrogations portent sur les changements opérés sur la société avec l’entrée dans la modernité. On lui doit notamment des analyses du capitalisme industriel, de la bureaucratie et du processus de rationalisation en Occident.
LE DÉBAT
C. Nouhaud :
On voit que l’activité d’historien est une activité à risque car elle bouscule les idées reçues. D’où aussi l’intérêt de l’Histoire. L’Histoire se heurte à la mémoire, qui par nature est vive et peut même être « à vif ». C’est vrai pour l’histoire récente mais aussi pour une histoire beaucoup plus ancienne, comme par exemple l’histoire biblique.
Un intervenant :
Merci à vous. Je voudrais aller plus loin encore dans ce que vous avez dit à propos du passage de la mémoire à l’Histoire. La mémoire est indispensable, c’est celle des témoins. Mais elle divise, elle oppose et fait souvent ressurgir la douleur des blessures. Tu as évoqué les horreurs en Algérie. Comme le dit Benjamin Stora, c’est la mémoire éclatée des Pieds noirs, celle d’un paradis perdu. Une mémoire qui continue à se transmettre aux petits-enfants : celle des Harkis, des militaires de carrière, des militaires du contingent… Bref, ce sont des mémoires toujours douloureuses. Ce qui est nécessaire, c’est ce passage à l’Histoire. La mémoire divise et l’Histoire réconcilie. Cette réconciliation a été possible avec l’Allemagne au sujet de la Deuxième Guerre mondiale, elle reste à faire avec l’Algérie parce pour l’histoire de ce pays une « version officielle », en dehors de laquelle on ne doit pas sortir, entrave les choses. Il est réconfortant cependant de voir le peuple algérien, qui dans son ensemble n’a rien oublié, ne garder aucun ressentiment vis-à-vis des Français en général et les accueillir avec beaucoup d’affection. Cette réconciliation viendra par l’enseignement de l’Histoire.
D.D. :
Sur la question de la mémoire ou des mémoires. Je ne suis pas sûr que la mémoire divise. Ce sont les mémoires qui divisent. Au départ la mémoire est conçue comme quelque chose qui doit rassembler une communauté, voire une communauté nationale. Elle est conçue forcément dans une optique de division. D’ailleurs la notion de mémoire émerge dans le champ de la science, en tout cas de la sociologie, après la Première Guerre mondiale : Maurice Halbwachs1 écrit Les cadres sociaux de la mémoire en 1923, et ce n’est pas un hasard car on avait alors besoin de se souvenir. D’ailleurs au départ, on ne parle pas de mémoire. La mémoire c’est quelque chose de savant : on parlait jusqu’à une période récente de « souvenir ». Le mot « mémoire » a fait son apparition en force à partir des années 1980 avec la publication de Les lieux de mémoire de Pierre Nora. C’était la mémoire de la Shoa, donc un « devoir de mémoire », et ensuite on a parlé de « la concurrence des mémoires ». Au départ la mémoire est sensée rassembler autour de quelque chose de commun. Mais en fait, une mémoire en cache une autre, c’est un emboîtement. D’autres mémoires apparaissent et se révèlent au fil du temps, avec les questionnements de la société et aussi parfois avec le travail des historiens. En ce sens, on peut avoir effectivement l’impression que la mémoire divise. Pour nous historiens, nos relations avec la mémoire ne sont pas toujours faciles. Il y a cette injonction du devoir de mémoire et en tant qu’enseignants nous sommes soumis à celle-ci dans nos classes (la mémoire est entrée au programme des Terminales il n’y a pas si longtemps). Cela s’enseigne donc aujourd’hui. C’est un objet d’étude, un matériau aussi pour les historiens. Il y a peu de temps encore, le mot « mémoire » avait complètement effacé le mot « Histoire ». Je ne sais pas si cela aidait à la compréhension des faits.
Un intervenant :
Paul Ricœur a écrit sur la mémoire dans Temps et récit. Quelque chose me tracasse à propos du problème : « à quoi sert la mémoire ? » En dépit de la complexité de la question, j’ai l’impression qu’il y a urgence. J’ai peur qu’une rupture dans la transmission des savoirs soit en train de se faire, et douloureusement pour beaucoup. La mémoire est peut-être la discipline ou le « champ de recherche » qui est le plus touché. Michel Kiener laissait entendre qu’un gosse de 14-15 ans ne savait rien du tout sur la Shoah. Le « roman national » avait l’avantage, même avec ses déformations, ses excès, ses approximations et même ses mensonges, de créer pour les générations primaires et secondaires une sorte de tissu, de culture commune : Saint Louis sous son chêne, Vercingétorix, etc. Il y avait beaucoup de mensonges dans ce roman national, mais maintenant on est quelque part paumé. J’ai l’impression qu’il faudrait que vous, les historiens, vous nous fournissiez, en tant que citoyens, des armes qui seraient utilisables pour les citoyens au quotidien.
M.K. J’ai dit que notre pays, par rapport à d’autres comme les Etats-Unis, l’Angleterre, la Chine ou même l’Allemagne, a perdu le « roman national ». Ce roman est devenu aujourd’hui « gênant », ça fait ridicule. Mais j’ai ajouté : …avant qu’on en retrouve un autre. Je suis absolument persuadé que la France d’aujourd’hui, dans le cadre européen, a besoin de retrouver un roman national. Est-ce que vous vous rendez compte qu’en 1914 la France était le seul pays au monde à avoir dissocié le pouvoir religieux (ou la référence religieuse) et le pouvoir politique ? La laïcité est chez nous une valeur cardinale. Retrouver le moment et le pourquoi de cette chose bizarre qui a surgi dans l’espace français au moment de la Révolution française, avec le refus de voir Rome gouverner ici ou là, c’est intéressant. De plus, la France a voulu incarner ce que j’ose appeler « les valeurs européennes », inscrites dans la Déclaration des droits de l’homme, qui est quelque chose d’extraordinaire. Ce n’est pas tout à fait celle des Etats-Unis, qui se rapporte au droit pour chacun de posséder une arme. Nous, au contraire, considérons que c’est à l’Etat et au droit de régler les conflits entre particuliers. Le discours des dictateurs chinois actuels est de dire publiquement : « Nous, Chinois et autres, avons des valeurs qui ne sont pas du tout celles de l’Occident ». On a cru que la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, fabriquée par des Français en 1948-1949, serait acceptée comme telle, en tant que vérité. Elle ne l’est pas, elle ne l’est plus. « Nos » histoires de femmes égales aux hommes, ce n’est pas leur truc. Malgré les saloperies (« nos » saloperies) comme la colonisation, redonner à nos enfants et aux citoyens français l’idée que nous portons le bonheur de cette histoire créative, redonner la connaissance de ce fil rouge qui traverse l’Histoire, c’est extraordinaire. Ce peut être quelque chose qui permette à nous, Français, de retrouver le sens de notre propre histoire et celle de la construction de ses valeurs dans le monde actuel. C’est persister dans notre façon de voir et refuser par exemple la dictature des idéologies religieuses. Dans le monde, il n’y a pas que ce qui se passe dans des pays musulmans. Aux Etats-Unis, dans certains Etats, des institutions réclament que soit enseignée à côté de la théorie de l’évolution de Darwin, l’histoire de l’homme selon la Bible ; ou encore, dans une Australie en feu, un premier ministre évangéliste nie tout ce que les scientifiques peuvent dire, etc.
Un intervenant :
Pour moi, l’histoire n’est pas tant la connaissance des grandes dates que celle des événements, des faits avec leurs causes et leurs effets. On se polarise beaucoup sur la mémoire du passé en oubliant le présent. Pour moi, le présent ce sont les gaz à effet de serre, qui tuent le vivant. On peut en voir l’histoire de son déclenchement dans les guerres mondiales (destructions massives par gazage). L’histoire doit permettre d’éveiller et de réveiller les esprits par rapport aux questions du présent.
D.D. :
Je vais vous répondre sur ces questions environnementales. Elles ne sont pas du tout en dehors du champ de l’Histoire. C’est un des nouveaux fronts pionniers ouverts ces dernières années. Il y a toute une génération d’historiens qui renouvellent cette matière. Emmanuel Le Roy-Ladurie, par exemple, est un des premiers à s’être intéressé à l’histoire du climat. Cela a paru bizarre à l’époque. Cela dit, les socialistes utopistes du XIXème siècle s’intéressaient à ces questions. Ils avaient bien compris le rapport de l’homme avec son environnement, on l’a un peu oublié entre temps. Le Roy-Ladurie utilise la méthode des Annales, c’est-à-dire qu’il construit des séries longues, statistiques, etc. Il s’intéresse aux récoltes dans les régions de montagne, aux avancées et reculs de glaciers, etc. Il reconstitue comme cela des mouvements séculaires. Il faisait cela alors qu’on n’était pas encore entré dans l’urgence environnementale. Aujourd’hui c’est devenu un sujet en soi. Un ouvrage publié récemment à Limoges traite par exemple des conflits environnementaux2. Aujourd’hui on a forgé le concept d’Anthropocène qui considère l’homme comme étant devenu une force géologique, l’égal des forces naturelles. L’Anthropocène a une histoire qui est une histoire des sciences, des techniques. Les historiens s’intéressent aussi à l’histoire environnementale au travers de la pollution. Avec ces questions de pollutions industrielles notamment, on se rend compte comment l’Etat a donné la priorité aux intérêts privés par rapport à l’intérêt collectif : depuis Napoléon et le Code civil, la loi interdit aux maires d’exercer la police en matière d’établissements industriels, lesquels relèvent du préfet et de l’Etat. Souvent les avancées de l’Histoire sont liées à des questionnements de la société. Michèle Perrot a été longtemps pionnière au sujet des f emmes en ce qui concerne l’histoire. Aujourd’hui l’histoire des femmes est assez féconde. Même chose avec les histoires post-coloniales. Le monde anglo-saxon produit beaucoup de champs nouveaux comme cela (les studies). La circulation de telles idées lance des initiatives de recherches, notamment historiques.
A la question de cette planète qui souffre actuellement et s’interroge sur son devenir, l’historien donne des éléments pour le débat public. Il faut que les gens s’en saisissent ; en ce qui concerne les politiques, on aimerait bien.
Un intervenant :
Est-ce que l’étude du vocabulaire entrerait dans le champ de la réflexion des historiens ? Par exemple, il y a mille manière de dire « juif » : israélien, israélite, etc. On brasse ces termes et personne ne s’y retrouve car cela crée une confusion. Le problème est de nettoyer les mots afin qu’ils soient employés au mieux. Camus disait, « Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde ».
M.K. :
J’ai employé le mot « révisionniste » comme un clin d’œil. Un « révisionniste » est quelqu’un qui nie les chambres à gaz, mais la révision ne s’applique pas qu’à cela. Jusqu’aux années 1980 en France l’histoire du déclenchement de la guerre de 1914 était sérieusement biaisée. Ainsi, une commission européenne de « révision des mémoires » est intervenue à juste titre sur ce sujet et a permis de s’accorder sur l’essentiel au plan historique entre ex-belligérants.
D.D. :
Nous regrettons parfois d’avoir accepté et transmis certaines conceptions en Histoire, mais les révisions qui interviennent par la suite correspondent aussi aux avancées scientifiques. L’Histoire est dynamique. Michel Kiener a employé le mot « révisionnisme » à bon escient parce que nous, les historiens, devons nous saisir de ce mot. Il ne faut pas le laisser aux autres. Je m’appuierai sur une citation de Paul Ricœur dans Le temps, la mémoire, l’oubli où il dit que « l’Histoire est soumise à un incessant processus de révision ». Donc, réviser, au sens de modifier les connaissances, mais modifier sans les nier, c’est là où est la subtilité. Jean-Jacques Fouché dans une conférence au cercle Gramsci3 à propos des historiens négationnistes du drame d’Oradour expliquait que ceux-ci avaient gagné la bataille des mots en s’intitulant « révisionnistes ». Ils entretiennent ainsi une confusion sur leur travail et leur rôle en prétendant avoir simplement révisé l’histoire, alors que leur projet est un projet de mensonge. C’est du négationnisme, pas seulement du révisionnisme. Il faut effectivement faire très attention au vocabulaire et à sa précision. Les historiens peuvent être révisionnistes en considérant aujourd’hui que l’empereur Guillaume II a bien mené l’Allemagne dans la guerre de 1914, même s’il ne l’avait pas souhaitée (exemple évoqué précédemment).
M.K. :
Il se passe aujourd’hui en Russie des choses loufoques. On est parti d’une histoire faisant l’apologie de Staline, puis en 1956 le rapport Khrouchtchev révèle au peuple russe le mensonge de cette histoire. Puis dans les années 1990 sous Boris Eltsine le jugement porté sur la période stalinienne depuis Khrouchtchev est révisé à la hausse. Enfin, arrive Poutine, qui réhabilite les Romanov, les derniers tsars. Dans l’univers de la Russie, l’histoire contemporaine est une grande cacophonie : l’église orthodoxe est en train de canoniser le dernier tsar, Nicolas II ! L’historien est soumis à un pilonnage politique et idéologique qui rend difficile l’enseignement de cette histoire. Avec la Russie on a le bel exemple d’un roman national à éclipses qui bascule d’un camp à l’autre et qui chahute la société au point qu’il faut être prudent quand on traite de cette histoire. Poutine joue avec ces mémoires : celle des anciens combattants patriotiques, celle de la religion. Il réhabilite la mémoire de l’orthodoxie. Nous qui avons vécu au XXème siècle, sommes aujourd’hui des anciens combattants qui portons des mémoires différentes, que nos enfants ne comprennent pas forcément. Je n’arrive pas à convaincre mes enfants que, quand j’étais au lycée, j’avais des crevasses aux mains et n’arrivais pas à écrire à cause du froid. Et quand je vois ces dernières années la valse des programmes scolaires, notamment en Histoire, je me dis qu’on a besoin de retrouver un roman national qui soit le nôtre, qui conserve sa valeur universelle, qui soit capable d’intégrer le fait que les Français d’aujourd’hui sont de différentes origines (on ne peut plus parler de « nos ancêtres les Gaulois »), dire que nous avons toujours été à la recherche de l’universel (il n’y a pas que Marco Polo). Les Européens ont ceci d’extraordinaire dans le monde qu’ils ont été peut être des conquérants voulant convertir, mais ils ont été surtout des observateurs passionnés, fascinés par les autres, et ceci depuis le Moyen-âge. Au XVIIème siècle nous avons un nombre incalculable de récits de voyages en Egypte. Les Français en allant au Vietnam ont créé une écriture, un alphabet pour la langue vietnamienne : ces Vietnamiens, qui étaient obligés d’apprendre la langue chinoise comme nous, en Europe, avions été obligés d’apprendre le latin, retrouvaient une littérature dans leur langue et une conscience nationale. Quand Edouard Glissant, écrivain antillais, revendique l’universel et dit : « Je suis un écrivain tout court », il exprime là une espèce de fierté française antérieure à notre génération, dont nous sommes porteurs qui est peut être un des volets de notre récit national.
Un intervenant :
Quand vous parlez de la façon dont on refait l’histoire en Russie, je constate que quelques années avant, en Croatie, on a réhabilité les oustachis4 et dans les pays baltes, particulièrement en Lituanie, on réhabilite les nazis qui ont combattu les Russes (de l’Union soviétique), lesquels ont perdu environ 20 millions de personnes lors de la dernière Guerre mondiale. A propos du nazisme : il y a eu le 5 février 2020 une expérience politique curieuse en Thuringe, dans le centre de l’Allemagne, où le parti d’extrême droite a aidé à éliminer un candidat sortant qui appartenait à Die Linke (gauche radicale)5.
Je reviens au début de notre débat à propos de l’histoire qui se renouvelle. On nous bassine actuellement en rapprochant notre actualité avec celle des années 1930 mais on oublie, en ce qui concerne les années 1930, ce qui a permis à Mussolini et à Hitler d’arriver au pouvoir : l’appui du mur de l’argent dont on parlait déjà en 1936. Actuellement on veut nous faire peur avec le Rassemblement National (RN), alors que le pouvoir de l’argent est avec Macron et n’a pas besoin de s’appuyer sur le RN ni de lui donner de l’argent. Le RN est en phase de faillite.
D.D. :
Je voulais intervenir sur la question de l’histoire européenne. Il y a, certes, les histoires dans un cadre national, mondial. Mais l’Europe, c’est aussi une construction originale, parce qu’elle est économique mais aussi politique et culturelle. On n’a peut-être pas assez pensé à ce qui peut faire des « Européens », c’est-à-dire des personnes vivant sur un même continent faisant partie d’une même organisation politique et institutionnelle (l’Europe). Au début du XXIème siècle, avec l’intégration des anciens pays de l’Europe de l’Est, on assiste à quelque chose d’assez compliqué, parce que notre Europe, d’abord construite par l’Europe occidentale, pouvait se rassembler sur l’antifascisme et contre les valeurs des dictatures d’extrême droite. L’Europe de l’Est, elle, a aussi subi l’occupation nazie, mais pour certains cette occupation n’a pas forcément été si mal vécue et, eux, ce qu’ils appellent « Occupation », c’est celle de l’Armée rouge jusqu’au début des années 1990. Nous n’avons pas tout à fait la même façon de regarder l’Histoire. Cela pose un problème en Histoire parce que cela facilite le rapprochement et l’identification entre les deux totalitarismes (« C’est au fond la même chose »). Il y a assurément des traits communs mais en même temps il y a des divergences idéologiques qui sont importantes. On voit bien que l’Europe actuellement a du mal à trouver un point d’accord, de cristallisation entre ces deux histoires de l’Est et de l’Ouest du continent.
Un intervenant :
Je veux dire un mot sur la préhistoire. La préhistoire est à l’origine, à la fin du XIXème siècle, une science principalement française, belge et anglaise. Aujourd’hui elle est surtout étatsunienne. « A quoi sert la préhistoire ? » : voilà une question que les préhistoriens ne se posent pas. Sophie de Beaune est une des rares universitaires qui la pose aujourd’hui dans son livre, Qu’est-ce que la préhistoire ? 6. Il y a très peu de réflexion dans ce domaine, qui semble relever de la supposée évidence qu’affichent les sciences dites dures. En revanche, on trouve dans cette discipline une multitude de petits livres qui dénoncent les erreurs du passé, les idées reçues, les « mythes » (c’est le mot qui est employé sans cesse) qui seraient d’origine littéraire, artistique, ou dus à des erreurs d’analyse, à l’insuffisance des données. C’est me semble-t-il, à peu près la seule réflexion épistémologique. L’histoire de la préhistoire en reste le plus souvent aux « grandes découvertes » et aux « grands savants », il y a très peu par exemple de réflexion sur l’histoire des institutions : les revues, les congrès, le vocabulaire de la préhistoire. Les préhistoriens ne semblent pas, à de rares exceptions près, s’apercevoir que leur science apparemment gratuite a une fonction sociale majeure : construire le roman de l’espèce. Et là, c’est très clair, on est vraiment proche de ces romans nationaux qui ont servi à la guerre, à l’oppression raciste, à la colonisation, à l’oppression des femmes, etc. La préhistoire et l’anthropologie ont servi a cela, elles ont collaboré à cela avec empressement. Ce n’est pas une erreur due à des données insuffisantes ou mal interprétées. En conséquence de cette incompréhension du passé, ou de ce refus de voir le passé de la préhistoire, il n’y a donc aucune réflexion sur la question subsidiaire qui porte sur le présent : N’y aurait-il pas aujourd’hui des idéologies répandues grâce à cette science ou s’autorisant de ces sciences ? La préhistoire écrit, ou plutôt réécrit sans cesse, un roman à l’échelle de l’humanité. Ce roman prétend par nature à l’universel, il explique tous les actes de l’homme d’aujourd’hui par ce qu’il a été dans le passé, il est à la recherche d’invariants anthropologiques. Je vais vous raconter une petite histoire drôle sur cette préhistoire qui cherche à justifier le présent – c’était comme cela au XIXème siècle et c’est toujours comme cela aujourd’hui, mais sur d’autres bases. Ma petite histoire est la suivante, je l’ai entendue à la radio dans la bouche d’un « scientifique » très sûr de lui : « Pourquoi est-ce que les hommes ne retrouvent pas leurs chaussettes dans les tiroirs ? Parce que leur système neuro-optique est construit pour repérer les gros objets mobiles à cause de la chasse, alors que pour les femmes ce sont les petits objets immobiles à cause de la cueillette ». Notre « scientifique » ne se pose pas la question : Pourquoi les hommes ne faisaient-ils pas de cueillette ? Qu’est-ce qui le prouve ? Eh bien… le fait qu’ils ne retrouvent pas leurs chaussettes ! Raisonnement circulaire.
D.D. :
Un historien américain (James C Scott – Homo Domesticus ?) qui fait de l’histoire critique explique qu’on a perdu beaucoup en passant des sociétés de chasseurs-cueilleurs aux sociétés d’agriculteurs parce que c’est à ce moment que commencent à pousser les racines du productivisme, les sociétés autoritaires, etc. C’est un exemple d’utilisation de la préhistoire pour démontrer que le malheur des hommes provient du productivisme.
M.K. :
Cela renvoie à un autre mythe qui est le « mythe d’avant », c’est-à-dire avant qu’il y ait des rois, des princes, des gens qui prennent la société en main, il y avait des sociétés de chasseurs libres qui évitaient de se rencontrer, chacun ayant son territoire de chasse. C’est une thèse ridicule. Toutes les sociétés amazoniennes, de Nouvelle Guinée, etc. sont construites sur la guerre. Une guerre permanente entre chasseurs. Il y a une concurrence des territoires. Cela me rappelle que sous Staline, dans les années 1940-1950, les archéologues russes recherchaient les vestiges des premiers villages slaves pour prouver que les Russes étaient les premiers communistes de la terre et vivaient dans des communautés fraternelles, sans chef. La gentillesse de l’homme préhistorique est une fable. Jusqu’à nos jours, sur tous les continents, les sociétés de chasseurs-cueilleurs connaissaient la violence, les hiérarchies, et n’ont pas attendu pour cela la rencontre avec l’homme blanc colonisateur. Il y a d’autres points aveugles comme la démographie, dans les analyses. Par exemple, dans les causes du ravage de la biosphère, l’explosion démographique actuelle n’est pas prise en compte au plan de sa responsabilité historique, au même titre que les grandes compagnies d’exploitation forestière ou autres. M. K relate également les pressions morales (« patriotiques ») des politiciens croates sur leurs propres historiens pour entraver leurs études sur les guerres qui ont accompagné la dislocation de la Yougoslavie à la fin du XXème siècle. Il est très difficile aujourd’hui, notamment à cause des réseaux sociaux, de faire accéder les personnes à la vérité des faits. Par exemple : en 2018 au lycée du Bourget, les professeurs d’histoire en Secondaire s’aperçoivent que 70% de leurs élèves ne croient pas au débarquement de l’homme sur la lune. Ce serait pour eux une « fake news« . En réponse, ces professeurs organisent un projet éducatif de recherche sur cet événement. Trois mois après, l’absence de résultat les laisse perplexes.
Une intervenante :
Vous avez parlé des progrès qu’une pensée scientifique a apporté par rapport aux croyances. En préparant cette soirée, nous avons parlé aussi des dégâts commis par le rationalisme, notamment celui de Descartes, cette pensée trop abstraite qui nous a amené à une arrogance universelle. Il semble alors qu’il vaudrait mieux intégrer les croyances, au lieu de dire de manière humiliante que ce sont des béquilles. Il s’agit au contraire des savoirs anciens. Sur beaucoup de sujets, les savoirs anciens pouvaient guider le quotidien des populations à l’époque de la préhistoire et après. On les retrouve dans nos textes occitans, ici en Limousin. L’histoire, et vous avez cité à juste titre Paul Ricœur, est en permanence en transformation, il ne faut donc pas être arrogant et il faut savoir intégrer, me semble-t-il. Le double problème est qu’on ne respecte pas les différentes façons de voir et que nous refusons de changer notre regard. Cependant, pour changer notre regard, on peut avoir recours à celui des étrangers : par exemple, la vision intéressante des Italiens sur l’épopée napoléonienne ou celle des femmes historiennes qui apportent des points de vue nouveaux. Il faut respecter ces différents points de vue et se rendre compte que chacun réfléchit en fonction de son territoire. Et nous sommes tous sur des terres différentes : nous avons parlé récemment avec Maurice Robert de nos façons différentes de réfléchir au Sud et au Nord, même en France. Il faut respecter cela et en faire une richesse. En tout cas ne pas être hors sol. L’universalité est un peu issue d’une pensée rationaliste à outrance, qui est trop abstraite. En somme, il est très important de respecter ce mouvement, toute cette marche humaine avant l’arrivée de la science. La science rationnelle n’est pas forcément un progrès.
Un intervenant :
Je voulais juste faire un pas de côté. A quoi sert l’histoire ? Vous avez très bien répondu, à savoir, d’une façon ou d’une autre, à quoi sert-elle à la société ? Mais il y a quand même des sujets d’histoire qui ne servent à rien et qu’il faut étudier. C’est la simple recherche de la connaissance. L’astronomie, ça sert à quoi ? Compter les galaxies, ça sert à quoi ? À rien. Faut-il arrêter ? Bien sûr que non : inutile mais indispensable.
D.D. : Cela peut être un beau mot de la fin.
1Maurice Halbwachs (Reims 1877-Buchenwald 1945), sociologue français, a créé le concept de mémoire collective.
2Une histoire des conflits environnementaux. Luttes locales, enjeu global (XIXe – XXIe siècles), Anne-Claude Ambroise-Rendu, Anna Trespeuch-Berthelot, Alexis Vrignon (dir.), PULIM, 2019.
3Jean jacques Fouché, Violence nazie et négationnisme, un savoir de la violence, à partir de l’exemple du drame d’Oradour – mars 2002.
4Mouvement séparatiste croate, antisémite, fasciste et anti-yougoslave qui prit le pouvoir en Croatie en 1941 avec le soutien de l’Allemagne et de l’Italie, après l’invasion et le démembrement de la Yougoslavie. Ils instaurèrent l’État indépendant de Croatie, dictature particulièrement arbitraire et meurtrière (Wikipédia 2020)
5l’élection à la présidence de cette région du candidat conservateur avec les voix du parti néonazi a immédiatement provoqué une crise au sein de la CDU aboutissant à de nouvelles élections et à la réélection du candidat de gauche en mars 2020.
6Sophie Archambault de Beaune, Qu’est-ce que la préhistoire , Gallimard, Folio histoire, 2016