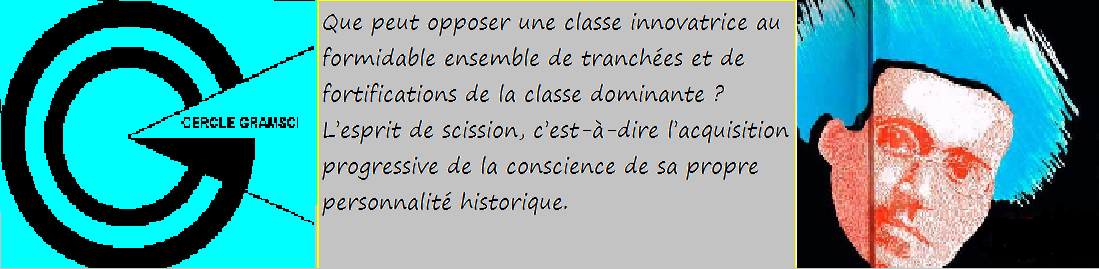Une histoire populaire de la France de la guerre de Cent Ans à nos jours
Gérard Noiriel, historien, auteur du livre Une histoire populaire de la France. De la guerre de Cent Ans à nos jours, aux éditions Agone, viendra animer la prochaine soirée du Cercle. Le texte publié ici est tiré de l’avant- propos.
Il existe deux grandes manières d’écrire l’histoire de la France. La première est collective. Elle consiste à rassembler un grand nombre de spécialistes sous l’égide d’un historien, bien placé au carrefour des institutions académiques, de l’édition et du journalisme, pour présenter au public cultivé un état du savoir historique à partir d’un fil conducteur assez lâche, de façon à réunir les petits producteurs indépendants que nous sommes autour d’une œuvre commune. Ernest Lavisse, Pierre Nora et aujourd’hui Patrick Boucheron s’inscrivent dans cette longue tradition. La seconde manière est individuelle. Elle caractérise les historiennes et les historiens qui sont arrivés dans la dernière ligne droite de leur carrière et qui exposent leur vision de l’histoire de la France en s’appuyant, notamment, sur leurs propres travaux. Jules Michelet, Fernand Braudel ou, plus récemment, Michelle Zancarini-Fournel ont incarné cette démarche. C’est celle que j’ai adoptée moi aussi dans ce livre, qui est l’aboutissement des quarante années que j’ai consacrées à la recherche historique. Lorsque les éditions Agone m’ont proposé cet ambitieux projet, il y a une dizaine d’années, la grande référence qui s’est imposée à moi fut, évidemment, l’Histoire populaire des Etats-Unis d’Howard Zinn, que cet éditeur avait fait connaître au public français. Cependant, dès que je me suis attelé à la tâche, j’ai été pris d’un doute sur ma capacité à mener à bien une entreprise du même genre. C’est l’une des raisons qui expliquent qu’il m’ait fallu une décennie pour en venir à bout. La première édition du livre d’Howard Zinn a été publiée en 1980, date qui constitue pour moi, un tournant majeur dans l’histoire de la France et même du monde. Le but de ce grand historien américain était de proposer une «histoire par en bas» faisant une vraie place à ceux dont les manuels ne parlaient pas ou peu : les Amérindiens, les esclaves, les femmes, les syndicalistes ouvriers, les objecteurs de conscience hostiles à la guerre du Viêt Nam, etc. Le projet d’une telle histoire alternative était inédit il y a trente-cinq ou quarante ans. Il l’est beaucoup moins aujourd’hui car il ne serait pas honnête de faire croire au grand public que l’histoire universitaire occulterait encore tous les exclus du passé. Grâce aux travaux et aux efforts des historiens et des historiennes engagés comme Howard Zinn, ces lacunes de la recherche ont été largement comblées. Zinn a écrit son Histoire populaire à la fin de la décennie qui a suivi les événements de mai-juin 1968. Ce fut une période heureuse, peut-être la plus heureuse que le monde ait connue. Les forces progressistes avaient alors le vent en poupe et elles étaient suffisamment unies pour favoriser la convergence des luttes et des bonnes causes. Cette perspective s’est effondrée au cours des décennies suivantes. La crise du mouvement ouvrier a considérablement affaibli les luttes sociales au profit des conflits identitaires. Le projet d’écrire une histoire populaire du point de vue des vaincus a été accaparé par les porte-parole des minorités (religieuses, raciales, sexuelles) pour alimenter des histoires féministes, multiculturalistes ou postcoloniales, qui ont contribué à marginaliser l’histoire des classes populaires. Mon travail s’inscrit dans le sillage d’Howard Zinn au sens où celui-ci s’est toujours efforcé, dans son œuvre, d’articuler les différentes formes de domination qu’ont subies les exclus de l’histoire en préservant le primat de la lutte des classes. Toutefois, à la différence de Zinn, je ne pense pas qu’on puisse écrire une historie globale (en l’occurrence nationale) en ne reprenant à son compte que le point de vue des vaincus, car l’historien qui s’engage dans cette voie risque toujours de laisser dans l’ombre des formes oubliées du malheur social. Voilà pourquoi, plutôt que d’adopter le point de vue des dominés, j’ai privilégié l’analyse de la domination, entendue comme l’ensemble des relations de pouvoir qui lient les hommes entre eux. Cette démarche socio-historique doit beaucoup à Norbert Elias, qui a envisagé l’histoire comme un processus multi-millénaire au cours duquel les individus ont noué des liens d’interdépendance de plus en plus étendus, liens qui sont aussi des relations de pouvoir. Le mot «pouvoir» n’est pas utilisé ici comme un jugement de valeur. C’est un constat qui peut s’appliquer aussi bien aux relations entre parents et enfants qu’à celles qui lient un patron à ses ouvriers, même si les effets sociaux ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Toute relation de pouvoir peut engendrer des formes de domination ou de solidarité entre les hommes. Cette perspective relationnelle explique que, pour moi, le «populaire» ne se confond pas avec les «classes populaires». La définition du «populaire» a été un enjeu de lutte constant. L’identité collective des classes populaires a été en partie fabriquée par les dominants et, inversement, les formes de résistance développées au cours du temps par «ceux d’en bas» ont joué un rôle majeur dans le bouleversement de notre histoire commune. Cette perspective m’a conduit à débuter cette histoire de France à la fin du Moyen Age, c’est-à-dire au moment où l’Etat monarchique s’est imposé, dans le cadre de relations internationales qui ont constamment affecté son développement. Appréhendé sous cet angle, le «peuple français» désigne l’ensemble des individus qui ont été liés entre eux parce qu’ils ont été placés sous la dépendance de ce pouvoir souverain, d’abord comme sujets puis comme citoyens. Une autre dimension essentielle de la socio-histoire tient dans l’articulation qu’elle propose entre le passé et le présent. La démarche historique permet de retracer la genèse des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle, dans cette histoire populaire de la France, j’ai privilégié les questions qui sont au centre de notre actualité, comme les transformations du travail, les migrations, la protection sociale, la crise des partis politiques, le déclin du mouvement ouvrier, la montée des revendications identitaires. Ces dernières ayant poussé au paroxysme les polémiques mémorielles, il est important d’aborder ces enjeux en montrant ce qui différencie l’histoire et la mémoire. Parmi les multiples références mobilisées pour rendre intelligible cette histoire, j’ai tenté d’articuler celles qui ont le plus compté dans ma formation intellectuelle, à savoir Karl Marx et Pierre Bourdieu. Néanmoins, comme je l’ai expliqué dans mon livre Penser avec, penser contre, je ne les ai pas sollicités comme des maîtres à penser. Je me suis contenté de puiser dans leurs œuvres les outils dont j’avais besoin pour mes propres recherches. Expliciter le point de vue à partir duquel on examine le passé exige aussi de dire un mot sur son histoire personnelle car il est certain que celle-ci oriente le regard que l’on porte sur le monde. Mon intérêt pour les classes populaires vient en grande partie de ma propre trajectoire, typique de ces «miraculés sociaux» dont a parlé Pierre Bourdieu. Issu d’un «milieu modeste», comme on dit, j’ai gravi un à un les échelons depuis l’école normale d’instituteurs des Vosges jusqu’aux plus prestigieuses institutions académiques françaises et américaines, animé par une quête intense de vérité et convaincu que celle-ci se trouvait dans la science. Autant que je puisse être lucide sur le sujet, je dirais que cette expérience vécue a orienté mon regard sur l’histoire à trois niveaux. Tout d’abord, comme j’ai été très tôt confronté à la violence et la stigmatisation interne aux classes populaires, je n’ai jamais pu croire que la domination se réduisait à l’exploitation des pauvres par les riches, même s’il s’agit là d’une dimension essentielle. Je n’ai donc jamais partagé la vision romantique du peuple qui domine chez les intellectuels. C’est l’une des raisons qui expliquent l’importance que j’accorde au problème de la nationalité car, depuis le XIXe siècle, le clivage entre les nationaux et les étrangers a été l’une des plus puissantes relations de pouvoir ayant permis aux dominants de creuser le fossé séparant les différentes composantes des classes populaires. Comme beaucoup de transfuges sociaux, j’ai aussi fréquemment ressenti une certaine culpabilité à vivre dans le monde pour lequel je n’étais pas programmé. Charles Péguy a souligné que ce genre de scrupules moraux poussaient souvent les transfuges à se tenir à l’écart des lieux où se fabrique le pouvoir et la gloire. Cela n’a rien d’héroïque car c’est un privilège exceptionnel de pouvoir passer sa vie à l’abri, sous la protection des «saintes écritures». L’inconvénient, quand on défend néanmoins la fonction sociale de l’histoire, tient au fait qu’en acceptant de rester en marge, on a peu de chance d’atteindre les lecteurs qu’on aimerait toucher. C’est pourquoi il faut savoir, quelquefois, se faire violence pour être entendu dans l’espace public. Ma trajectoire sociale a aussi joué un grand rôle dans l’importance que j’attribue à la science sur le plan civique. Etant donné que la recherche m’a permis de me libérer des principaux déterminismes qui pesaient sur moi au départ, je voudrais que le plus grand nombre de mes concitoyens puissent aussi en bénéficier. L’émancipation par la connaissance est un idéal qui a été défendu par les Lumières et qui a fait partie, autrefois, de ce qu’on appelle les «valeurs républicaines». L’ambition ultime de cette Histoire populaire de la France est d’aider les lecteurs, non seulement à penser par eux-mêmes, mais à se rendre étrangers à eux-mêmes, car c’est le meilleur moyen de ne pas se laisser enfermer dans les logiques identitaires.
Gérard Noiriel.
Compte-rendu conférence :
Gérard Noiriel, invité par le cercle Gramsci et la librairie Pages et Plume.
Auteur de « l’histoire populaire de la France, de la guerre de cent ans à nos jours ».
Un des points dont je voudrais parler est ma posture particulière dans le champ historique à partir de mon parcours. Pierre Bourdieu appelait, transfuges sociaux les gens qui n’étaient pas destinés au départ à être dans le monde intellectuel. Cela crée un certain nombre de particularités, un regard particulier sur l’histoire et également dans la pratique de l’histoire. J’ai toujours eu le souci de ne pas me laisser enfermer dans le monde académique. J’ai toujours eu une activité dans l’éducation populaire via le monde associatif. Quand j’étais enseignant de collège, j’ai participé à la grande grève des ouvriers de Longwy que j’ai appelé par la suite le champ du cygne d’une certaine classe ouvrière dans des régions aujourd’hui désertées, la grande industrie qui foutait le camp. Je faisais des émissions d’histoire à la radio « Lorraine Coeur d’acier », la radio de la CGT, avant les radios libres. Ce moment a été fondateur dans mon itinéraire, dans mes choix de recherches. J’ai gardé par la suite cette activité associative, je suis président d’une association d’éducation populaire.
Depuis 20 ou 30 ans je travaille sur l’immigration, le racisme, la xénophobie. La dimension civique, c’était de tourner dans des conférences. Quand j’ai commencé ma carrière apparaissait un nouveau mouvement d’extrême droite, le FN, alors à 5%. Quand on voit aujourd’hui la situation on ne peut pas se sentir satisfait, ce qui m’a donné envie de travailler d’une nouvelle façon avec des artistes qui sont capables de toucher les émotions. Avec une association on a d’abord travaillé sur le film Chocolat . On l’a redécouvert, on a fait un spectacle qui tourne encore, à l’époque il n’existait rien sur lui. J’ai écrit deux livres sur ce clown. Ça prouve que quand on réfléchit aux nouvelles formes d’éducation populaire, on peut quand même desserrer un peu l’étau, garder des motifs d’espoir, face au découragement, aux gens désabusés, fatigués.
Parallèlement au livre, on continue à faire une histoire populaire de la France à travers les conférences gesticulées : on tourne dans les centre sociaux, dans les écoles en région parisienne.
Quand on écrit un livre qui s’appelle une histoire populaire de la France, chaque mot est un piège au-delà de l’évidence des trois mots. « Histoire ». Déjà, presque tous mes chapitres commencent par une interrogation sur un enjeu de mémoire. Je différencie l’histoire et la mémoire car l’historien doit garder une distance par rapport aux polémiques, aux multiples enjeux mémoriels. Il doit avant tout expliquer et comprendre le passé alors que les acteurs de mémoire sont là plutôt pour juger. On a besoin de la mémoire mais il faut établir une distinction, l’historien doit expliquer le passé et non distribuer des médailles ou des anathèmes. L’ Histoire pour moi est une discipline à vocation scientifique qui exige de se tenir à distance des enjeux de mémoire.
Maintenant « Populaire ». Là aussi un enjeu important. Souvent les éditeurs aiment ce titre pour toucher un vaste public, gagner des sous. Quand on discute avec des journalistes, des gens qui font des essais, comme Stéphane Bern ou autres, ils disent : « On est populaire, parce que des centaines de milliers de personnes achètent nos bouquins ». Là, c’est le populaire au mauvais sens du terme, au sens commercial. L’enjeu du populaire est de faire passer des connaissances, des réflexions critiques dans des publics plus larges que les spécialistes. Ce qui explique que dans ce livre, j’ai pris le parti de ne pas mettre des notes de bas de page. C’est un choix, car la note fait partie de la déontologie de l’historien. Elle permet de vérifier ce qu’on affirme et rend hommage à ceux dont on utilise les travaux. La sacrifier n’est pas évident, mais si j’avais mis des notes de bas de page, le livre aurait fait 2000 pages dont 1000 pages de notes. Là radicalement, cela aurait été rébarbatif pour les 3/4 des gens que je voulais toucher. C’est le choix qu’avait fait Howard Zinn, contrairement à Michèle Zancarini-Fournel.
J’ai aussi fait le choix du récit : il n’est pas honteux pour un historien de raconter une histoire et même une histoire nationale. C’est un créneau qu’il faut occuper, ne pas le laisser à des gens comme Zemmour. Notre discipline est de plus en plus mondialisée. Aujourd’hui il y a plus d’Américains que de Français.qui travaillent sur l’histoire de France. Et on oublie de parler aux classes populaires alors que les réactionnaires, eux, ne l’oublient pas. J‘ai considéré que c’était un enjeu de prendre l’objet, histoire de France, pour raconter autre chose. Mes récits ne sont pas à la gloire de la nation ou de la République. Je ne juge pas, j’essaie de montrer comment ça s’est passé, les formes de domination, de résistance.
Enfin, le mot « France ». Qu’est-ce que c’est, la France ? Différents choix sont possibles. J’ai écarté d’emblée nos ancêtres les Gaulois : aucun chercheur sérieux ne peut le retenir, mais il y a quand même l’idée d’un point de départ. J’ai choisi le début du XVe siècle, l’époque de Jeanne d’Arc pas pour elle-même (héroïne de l’extrême droite mais aussi de l’extrême gauche, des communistes avec Aragon, des féministes) mais pour montrer plutôt qu’à cette époque se passent des événements tout à fait fondamentaux pour notre histoire, dont la création de l’Etat royal. J’ai beaucoup travaillé sur l’Etat. En démarrant ce travail, je me suis posé la question : qu’est-ce qui fait la différence entre une population et un peuple ? Une population, en gros, ce sont des individus sur un territoire. Un peuple, ce sont des individus liés les uns aux autres sur un territoire ce qui soulève la question du lien social. Je me définis comme un socio-historien. La sociologie est très présente dans mon livre. Donc ce lien social, on peut le définir de manière directe par une interaction mais l’évolution des sociétés a fait que les liens directs sont de plus en plus dépassés (ils n’ont pas disparu) et pris dans une logique plus vaste des liens indirects. C’est-à-dire que l’on peut être lié à des gens qu’on ne connaît pas, qu’on ne voit pas, et pour moi c’est tout à fait fondamental. Et les deux éléments essentiels qui ont structuré les liens indirects sont la monnaie et l’écriture. Une de mes grandes références, c’est Norbert Elias. Il a montré que le pouvoir d’Etat repose sur la maîtrise des liens à distance à travers une bureaucratie et des moyens financiers suffisants. Cette dimension-là se met vraiment en place en France au début du XVe siècle, à la fin de la Guerre de cent ans. L’Etat français s’installe avec Charles VII et on voit apparaître l’impôt, royal, qui concerne tout le monde, et la force physique. Les impôts servent à payer les soldats chargés de récupérer l’impôt. Cette logique se met en place. C’est structurant et en même temps, on a le début de cette centralisation parisienne. La monarchie parisienne va dominer de plus en plus l’ensemble des autres régions. Et là, on va avoir une spécificité française c’est-à-dire un Etat très centralisé, qui va franciser la population et qui va durer des siècles, puisque que nous vivons encore dans les conséquences lointaines de cet Etat qui apparaît au XVe siècle.
Et les premières révoltes populaires sont des révoltes anti-fiscales. C’est aussi une des raisons pour lesquelles j’ai beaucoup insisté sur cette notion de l’Etat pour débuter mon histoire populaire de la France.
Dans la définition du populaire, j’insiste aussi dans l’introduction pour dire que ce n’est pas une histoire des classes populaires. C’est là une différence avec la problématique d’Howard Zinn et de Michelle Zancarini-Fournel. Pourquoi ? Il y a une dizaine d’années, les éditions Agone, pour lesquelles j’avais déjà publié un livre sur les questions d’identité nationale, au moment où Sarkozy avait créé le ministère de l’Identité nationale m’avaient proposé de faire ce livre, un équivalent de Zinn pour la France. Mais, quand j’ai commencé à travailler là-dessus, je me suis rendu compte que c’était beaucoup plus compliqué que ce je pensais au départ. Parce qu’Howard Zinn a écrit son livre dans les années 1970. Or les années 1970, je les ai vécues comme étudiant, étaient à la fois optimistes et offensives du point de vue militant. C’était l’époque où on n’avait pas besoin de crier sur les toits «Convergence des luttes !», elles se faisaient dans la pratique. J’étais militant du côté du mouvement ouvrier, anti-raciste, féministe, etc. Il y avait spontanément une vision de l’avenir de nos sociétés comme une convergence des « bonnes causes ».
Or, à partir des années 1980, la classe dominante, pour résumer, s’est ingéniée et a réussi à faire en sorte de mettre en concurrence les « bonnes causes ». Progressivement on a vu des divergences et des contradictions apparaître, par exemple dans le camp anti-raciste où vous avez ceux qui luttent contre l’antisémitisme et qui sont contre les anti-racistes. Des logiques identitaires ont pris une place très importante au détriment souvent des questions sociales. Donc, si on voulait faire une œuvre utile civiquement, ce qui était mon cas, il fallait s’adapter à ce contexte.
La deuxième différence avec Zinn, d’ordre historiographique, c’est que Zinn était fondé à dire qu’il allait raconter une histoire que personne n’avait jamais racontée, parce que dans les années 1970, l’histoire des esclaves, des Amérindiens, des femmes n’avait été faite par personne ou seulement dans des revues marginales. Il a rassemblé un savoir complètement marginalisé mais aujourd’hui nous n’en sommes plus là. Grâce à Zinn et aux historiens de la nouvelle génération, on a toute une génération qui a étudié ces questions (mouvement ouvrier, antiracisme, féminisme). Moi-même j’y ai contribué avec mes travaux sur l’histoire de l’immigration, complètement ignorée jusque dans les années 1980. Donc, Il fallait une perspective différente.
Plutôt qu’une histoire des classes populaires, j’ai fait une histoire populaire dans le sens où je mets davantage l’accent sur la domination que sur les dominés. J’analyse un processus dont je retrace les étapes depuis le XVe siècle jusqu’à aujourd’hui, qui impose de tenir compte à la fois des dominants et des dominés, c’est-à-dire des classes populaires mais aussi de ceux qui les dominent, les exploitent. Et ça c’est pour moi un enjeu important et une divergence qu’on peut avoir au sein de l’historiographie, notamment entre l’histoire sociale et la socio-histoire.
J’ai été marqué dans ma formation par des gens qui n’étaient pas historiens mais plutôt philosophes ou sociologues, principalement Pierre Bourdieu et Michel Foucault qui ont beaucoup apporté sur la réflexion sur le pouvoir.
Voici donc mon point de départ : les relations de pouvoir. Mais pour moi ce terme de relations de pouvoir n’est pas une dénonciation, ni une condamnation.
Toute société est structurée par des relations de pouvoir. On ne connaît pas de société où il n’y aurait pas de relation de pouvoir, mais les relations de pouvoir peuvent aboutir à de la solidarité ou à de la domination. On peut avoir les deux logiques. Max Weber dit que dans une famille, quand les parents disent aux enfants, « mange ta soupe », c’est un ordre, une relation de pouvoir ; mais il faut en passer par là pour que les enfants soient éduqués, deviennent adultes, autonomes, etc. Donc il n’y a pas forcément de contradiction entre une relation de pouvoir et le développement d’une solidarité. Voilà ma grille de lecture et j’ai essayé de la mettre en oeuvre concrètement. Ce que je dis là de manière abstraite, je le montre concrètement dans le livre à travers des exemples.
Et là où je rejoins la sociologie (on pourrait d’ailleurs peut-être faire le lien avec Gramsci même si mes références sont plutôt liées à la sociologie et à Bourdieu) c’est ce que Bourdieu appelle domination symbolique ou la violence douce. Dans les relations de domination très souvent, l’identité des dominés est elle-même construite à travers le regard des dominants. Dans le livre, je le montre à différentes époques : il n’y a jamais de définition véritablement autonome de leur propre expérience et de leur propre image collective chez les dominés dans les classes populaires. Très souvent il y a une dialectique qui s’opère avec un regard très péjoratif, mais ça change au cours du temps. Par exemple dans le premier chapitre, je cite une phrase d’une noble du XVème siècle parlant des pauvres, où elle les traite de « merdaille ». On part de loin. Ensuite c’est « populace ». Je retrace, toute cette généalogie des représentations négatives des classes populaires jusqu’à Macron.
Dans les milieux populaires il y a bien sûr une résistance parce que les gens défendent toujours leur dignité, mais très souvent ils vont être obligés de s’approprier le discours, le langage que les dominants fabriquent pour le retourner, pour le modifier, pour l’adapter et c’est ça qui est intéressant. Voyez mon chapitre 2 sur les guerres de religion que j’ai intitulé “Dire sa souffrance au nom de Dieu», parce que la religion est aussi un instrument de domination des classes populaires. On dit : «Vous souffrez, vous donnez tout ce que vous avez aux nobles et aux curés mais ne vous en faites pas, le royaume des cieux vous appartient ». On voit que lorsque le protestantisme émerge, il y a une appropriation de ce discours un peu critique par rapport à la religion catholique pour désigner des luttes, des formes de résistance. Il y a une dialectique qui a pour conséquence que les dominants eux-mêmes sont obligés de changer leur regard. Là, je suis aussi tributaire de Marx sur la notion de lutte des classes, même si on peut l’envisager de façon différente de ce qu’il faisait en son temps, il y a ce processus qui est une dialectique de l’histoire et qui permet de montrer le rôle essentiel qu’ont joué les classes populaires dans les transformations de la société, y compris quand les luttes ont été perdantes, parce que c’est le cas le plus souvent.
Pour donner un exemple concret, je vais reprendre ce que les éditions Agone ont retenu en 4ème de couverture. Ça fait partie d’un chapitre du livre. Au début du XIXe siècle, Victor Hugo, issu de l’élite, de la noblesse de l’époque, est reçu à l’Académie française. Il fait un discours et utilise le mot « populace » pour parler des classes populaires. Il se trouve qu’à cette époque il y a déjà des écrivains ouvriers. C’est le début de cette génération d’écrivains socialistes qui a marqué la Monarchie de juillet, qui savent lire, écrire, sont artisans très souvent. L’un d’entre eux, Jacques Vinçard, a créé une revue, La Ruche populaire, et quand il découvre ce terme, il va prendre sa plus belle plume et écrire à Victor Hugo pour lui dire : «Nous nous sommes sentis humiliés par ce terme de populace ». On voit bien la dialectique. Ce qui est intéressant et qui prouve que Victor Hugo était un humaniste, c’est qu’il va prendre ça au sérieux et ça va le tracasser. Progressivement Victor Hugo va intégrer cette dimension dans son œuvre et dans Les Misérables, qu’il avait commencé d’écrire, le terme et l’image même des misérables va changer. Au début, c’est un peu synonyme de criminel ou de bas-fonds. Progressivement le mot « misérable » va avoir des connotations positives. Et progressivement, Hugo va être considéré comme le porte-parole du peuple. On a ça aussi avec Eugène Sue, Les Mystères de Paris. On voit l’évolution de ce gars au début très à droite, conservateur, et qui progressivement va presque apparaître comme le porte-parole des classes populaires.
On voit comment se forme cette liaison entre ceux d’en haut et ceux d’en bas et c’est pour moi un moteur essentiel de l’histoire. C’est dans ce sens-là que j’ai pris l’expression « populaire»
Alors évidemment quand on envisage un projet de cette manière-là, il y a des choix drastiques à faire : la masse des travaux et écrits à prendre en considération est absolument immense. Il m’a fallu 10 ans pour arriver au bout, bien plus si je compte les 40 ans de travaux de mes propres recherches. J’ai ressenti une énorme frustration parce que, pour chaque chapitre, j’aurais voulu en dire bien plus. Mais je m’étais mis d’accord avec Agone pour ne pas dépasser 800 pages. C’est une énorme frustration personnelle et en même temps une culpabilité, une injustice à l’égard des travaux que je n’ai pas cités. Pour le clown Chocolat c’était l’inverse. Le clown Chocolat était un esclave cubain, arrivé en France en 1886, 40 ans après l’abolition de l’esclavage. On ne lui a jamais donné d’état civil. Il est mort à Bordeaux avec l’étiquette Clown Chocolat. On lui a inventé un nom le jour de sa mort. Cette histoire-là m’a fasciné. Il n’y a rien dans les archives publiques. Comment écrire l’histoire d’un homme qui n’a pas laissé de traces ? Je suis allé à la Havane, j’ai retrouvé ses descendants, à Bilbao où il avait vécu… C’est un travail complètement différent, un travail plus satisfaisant psychologiquement parce que je me disais « j’ai tout dit », j’avais le sentiment d’une exhaustivité. On n’a jamais tout dit mais sur « Chocolat », je suis imbattable. Alors que là, sur Une histoire populaire de la France, à chaque fois, lors des débats, les gens me disent pourquoi pas ceci, pourquoi cela… Mais j’avais ma grille de lecture, ma discipline, la volonté de raconter une histoire comme je l’ai dit plus haut, et je ne pouvais pas trop y déroger sinon je ratais mon projet.
A partir de là, en partant non des classes populaires mais du processus de domination liant les différentes composantes de la société française, il fallait que je dégage des structures de domination, c’est-à-dire des grandes phases historiques qui correspondaient à des moments différents dans notre histoire des relations de domination. Il fallait que je donne des repères aux gens : c’est très important dans une histoire populaire, de ne pas faire comme si le monde entier état une salle de classe. Non, si on veut toucher un public plus vaste, il faut aussi donner des éléments de base de la chronologie, de la succession des rois, des grands événements, des repères où je case des éléments sur les structures de domination.
La première de ces formes s’étend de l’époque de Jeanne d’Arc au milieu du XVIIIème siècle : une relation de pouvoir dominée par un régime de logique féodale. Le roi dit tenir son pouvoir de Dieu et justifie par là les privilèges accordés à la noblesse. Dans cette époque-là, le peuple n’est pas considéré comme faisant partie de la nation. D’ailleurs le mot «race» a une histoire coloniale mais aussi hexagonale : au début les nobles utilisaient ce mot pour se désigner en tant que race supérieure. « Nous, nous descendants des Francs, de la race des vainqueurs et vous de la race des vaincus, des Gaulois ». Evidemment, après la Révolution ça va se retourner : nous les Gaulois nous avons fait la Révolution, d’où le « nos ancêtres les Gaulois ». Là, il y a une logique où le peuple est complètement exclu et ça légitime des formes de violence extraordinaires et de répression inouïes. Des centaines de milliers de victimes, sous l’Ancien Régime, et ça n’émeut pas le moins du monde ceux qui participent à tout cela. Une logique extrêmement répressive justifiée par l’idée d’une extériorité du peuple par rapport à la noblesse et à ceux qui comptent dans la société. D’ailleurs, ça suscite un nombre incroyable de révoltes, de la fin du Moyen-Age à la Révolution. Mais elles ne débouchent jamais sur des révolutions.
C’est seulement en 1789 que l’on bascule.
Pour moi la deuxième période commence en 1750 avant la Révolution. En m’appuyant sur des travaux d’historiens récents qui insistent sur la naissance d’espace public à partir de 1750, le développement de l’écriture, d’un embryon d’opinion publique avec les écrivains qu’on appelle philosophes comme Voltaire, Rousseau, Diderot qui deviennent une force capable de s’opposer au pouvoir royal parce qu’ils ont un public. Des choses tout à fait décisives se mettent en place et annoncent la Révolution de 1789. Là, on entre dans une nouvelle période qui va durer jusqu’à la Commune de Paris, en 1870. L’époque des révolutions où les relations de pouvoir tournent beaucoup autour de la question de la citoyenneté, avec deux conceptions antagonistes de la citoyenneté.
La conception bourgeoise, celle qui s’est imposée et nous gouverne aujourd’hui, fondée sur la délégation de pouvoir : les élites estiment qu’elles sont légitimes pour gouverner le peuple parce qu’elles ont une compétence, ce qui est une conception de la démocratie qui a été longtemps critiquée. Du temps des Grecs on considérait que la meilleure solution démocratique c’était le tirage au sort, la véritable égalité. Le principe de la compétence va progressivement s’imposer et, du coup, les classes populaires vont être exclues de la participation concrète à la vie politique nationale. Si vous prenez l’exemple d’aujourd’hui, les ouvriers représentent encore 20% de la population active, vous en avez zéro à l’Assemblée nationale. C’est une forme de discrimination extrême et on n’entend pas beaucoup de gens la contester. Il y a même un recul par rapport à l’époque du Front Populaire ou des années 1950-1960. Comment s’étonner ensuite que les gens ne croient plus à la politique, n’aillent plus voter ? C’est une mascarade dont ils sont exclus. J’essaie de refaire la genèse de tout cela.
Cette évolution-là, on la voit arriver dès la Révolution, il suffit de relire Kant ou Malesherbes. Et puis elle est contestée. Sous la Révolution, en 1792, les sans-culottes ont une autre conception de la citoyenneté : la démocratie directe. La citoyenneté, c’est participer à la vie de la nation et à l’époque c’est participer militairement sur le thème de la patrie en danger, de la prise du pouvoir d’Etat, du contrôle des élus, de la révocation de ceux qui ont été désignés… Et cette conception populaire de la citoyenneté, on la voit ressurgir. A chaque fois elle est réprimée. La chute de Robespierre et la terreur thermidorienne, ce sont des élites qui répriment la citoyenneté populaire. Elle ressurgit en 1830 et surtout en 1848 avec la notion de citoyen-combattant, puis sous la Commune de Paris, c’est presque l’apogée. Après cela, il y a un déclin puisque la IIIème République impose la démocratie parlementaire, mais elle ressurgit à chaque révolte populaire, cette conception de la citoyenneté comme action directe, notamment au sein du mouvement ouvrier marqué par le syndicalisme d’action directe, l’anarcho-syndicalisme, quand des militants ne voulaient pas se faire déposséder de leurs actions militantes au profit de bureaucrates. Et puis ça ressurgit en 1936, en 1968 et dans les luttes actuelles, on a encore ces aspirations à la démocratie directe.
On a un schéma qui me paraît extrêmement important entre la Révolution française et la Commune de Paris qui fait partie des traces de notre histoire dans notre présent.
La troisième période des relations de domination que je dégage, c’est celle qui débute avec la III ème République titrée «la nationalisation de la société française». La question nationale devient déterminante. Jusqu’au début de la IIIème République, si on prend la question des migrants par exemple, le clivage fondamental était celui qui opposait les villes et les campagnes. Les élites ne connaissaient pas la nationalité, le mot était très peu employé, on parlait de qualité de Français. On ne se préoccupait pas dans les classes populaires de savoir qui était français, qui ne l’était pas. On disait : « classe laborieuse, classe dangereuse ». On mettait tout dans le même sac. Avec la IIIème République, les choses changent parce que le projet républicain est de pacifier la société. Il veut mettre fin aux révolutions et intégrer paysans et ouvriers au sein d’une nation, d’une communauté nationale. C’est le projet de Gambetta, Ferry, etc., projet qui va globalement réussir mais qui va aboutir à de nouveaux clivages : eux et nous.
Le clivage de classe demeure mais un clivage majeur s’impose entre nous Français et Eux les étrangers, déclinés sous deux figures : l’étranger comme ennemi, le boche, le juif allemand ; et l’étranger comme inférieur, l’indigène des colonies. Les deux apparaissent en même temps, à la fin du XIXème siècle quand la république bascule dans l’aventure coloniale.
Cette nouvelle structure de pouvoir se met en place, mais en même temps c’est la grande industrie, la révolution industrielle qui s’impose avec de nouvelles figures de militants ouvriers. Auparavant c’étaient surtout des artisans, désormais c’est le mineur, le métallo comme figure du mouvement ouvrier des grandes grèves, des grandes luttes ouvrières.
On va avoir ce clivage entre une droite nationale sécuritaire et une gauche sociale humanitaire, qui va perdurer jusque dans les années 1970. C’est ce schéma qui va aboutir à une radicalisation des luttes sociales extrêmement forte dans les années 1930. La mise en place du Front antifascite (qui aboutit au Front populaire) en 1934 quand la république vacille. Dès 1938 les forces réactionnaires reprennent le dessus et aboutissent à Vichy. Sous Vichy, on a la Résistance qui amorce les années d’après guerre jusqu’à 1947 avec une coalition gaulliste-communiste qui va apporter tous les acquis sociaux sur lesquels on est encore aujourd’hui, peut-être plus pour longtemps, comme la Sécurité sociale, etc . On a là une période de lutte intense du mouvement ouvrier qui, je pense, a commencé à s’effondrer dès les années 1980. Une nouvelle structure de pouvoir a commencé à émerger à partir de ces années et on a du mal à la comprendre parce qu’on est dedans. On peut en analyser un certain nombre de symptômes, comme la délocalisation des entreprises dans les pays à bas salaires, la destruction des collectifs ouvriers avec la précarisation de l’emploi. Tous ces phénomènes ont contribué à saper les forces vives du mouvement ouvrier, à affaiblir les luttes sociales. Et, parallèlement une crise économique très grave se développe avec la montée du chômage. Mais à la différence de ce qui s’était produit auparavant, les crises économiques précédentes n’avaient pas duré extrêmement longtemps, car à chaque fois elles s’étaient terminées par une guerre mondiale. La crise économique qui a commencé dans la deuxième partie des années 1970 aurait dû en théorie, si on avait répété les périodes antérieures, conduire à une guerre mondiale vers la fin des années 1980. Ça ne s’est pas produit grâce à des formes de régulations nouvelles, mais l’état de crise, de chômage, d’appauvrissement d’une partie des classes populaires se pérennise. On ne peut plus parler de conjoncture mais d’effets structurels. L’autre difficulté pour comprendre la situation actuelle est due à la question de la mondialisation des échanges.
L’analyse sur la longue durée montre que Marx et Engels avaient une vision assez prémonitoire, dans la conclusion du Manifeste du parti communiste en 1848 : « Prolétaires de tous les pays unissez-vous ». Là, le mouvement ouvrier était en avance sur le capitalisme parce qu’il disait cela à un moment où le capitalisme était encore très très national, voire régional. Mais aujourd’hui on constate que le mouvement ouvrier ne s’est pas internationalisé vraiment, même pas au niveau européen, alors que le capitalisme, lui, a réussi à se mondialiser. Là, on a un déséquilibre dans les forces qui est l’une des explications de la crise que nous connaissons aujourd’hui.
Compte-rendu du débat :
Un intervenant : Je voudrais remercier Gérard pour cette synthèse brillante mais extrêmement provocatrice dans le local du Centre International de Recherches sur l’Anarchisme. Quand même, dire qu’il n’existe pas de société sans relations de pouvoir, nous en sommes un exemple. Ensuite, évoquer autant de grands noms en oubliant Pierre Joseph Proudhon, le père de l’anarchisme, ça nous choque un peu.
Un intervenant : Tu nous dis qu’après la deuxième guerre mondiale, il n’y a pas eu d’autres conflits mondiaux. Il y a quand même eu des conflits à caractère international : la première guerre du Golfe, la deuxième, le Viet-Nam, etc., où des États capitalistes rivaux mais complices se font une guerre par peuples interposés.
Gérard Noiriel : Je me suis mal exprimé. Ce que j’ai souligné est la faiblesse du mouvement ouvrier international, bien qu’il ait existé. Je suis obligé de rester au niveau des principaux rapports de force. Mais bien sûr, ces exemples invalident ce que je viens de dire mais n’ont pas pesé de manière centrale dans l’évolution de nos sociétés, peut-être parce que ces gens ont fait le choix de rester « en bas ». Je me reconnais d’ailleurs là-dedans, j’ai toujours fait le choix de refuser toute forme de pouvoir institutionnel, par crainte que le pouvoir me corrompe ou m’amène à faire des compromis. Maitron est l’exemple même d’une contre-histoire parce que c’est du collectif, des gens stigmatisés, mis de côté par l’establishment.
Une intervenante : Est-ce que dans les processus de domination, vous travaillez sur la question des femmes ?
GN : C’est un des points importants quand je parle des relations de pouvoir. J’analyse aussi dans mon livre les formes de domination qui existent à l’intérieur des classes populaires. Donc, ce qu’on appelle « la domination masculine » pour reprendre le titre d’un livre de Bourdieu, c’est une réalité qui a existé et qui existe encore au sein des classes populaires que je prends en compte au même titre que les formes de domination liées au critère national. La question de l’immigration, je l’inscris là-dedans. Au sein des classes populaires, il y a de la solidarité : si on prend 1936, les travailleurs immigrés et les travailleurs français luttent en commun, mais il y a aussi des périodes de division. J’essaie d’intégrer la question des femmes. En gros, on est passé d’une période où les historiens du mouvement ouvrier ignoraient complètement l’immigration, la colonisation, les femmes, à une période où aujourd’hui c’est la tendance inverse : une sorte d’oubli des dimensions populaires et on a beaucoup de choses autour du féminisme, du postcolonialisme qui ne sont pas suffisamment reliées à mon sens à la question sociale. Je plaide pour qu’on soit capables d’articuler les choses. Certains le font mais ce n’est pas la tendance dominante.
Ce sont des choses que je n’ai pas pu développer autant que j’aurais voulu. Mais je prends à différentes époques des formes de domination masculine, pour donner quelques exemples. Je l’aborde à l’époque de la royauté parce qu’il se trouve que l’une des faiblesses de la royauté française, l’une des raisons de la fragilité du pouvoir royal, c’était le fait que le pouvoir se transmettait par les mâles. Et ça on le voit, à chaque fois qu’il y a une crise qui menace vraiment le pouvoir, c’est lié à une crise de succession. Il n’y a pas d’héritier mâle, donc il y a une régente. Il y a le rôle des femmes, (même sans parler d’Aliénor d’Aquitaine, au point de départ de la Guerre de cent ans qui a duré même trois cents ans si on prend depuis son époque) qui occupent une position de dominées mais cela ne signifie pas qu’elles soient sans ressources. Donc je montre comment, à différentes époques, les femmes mobilisent les ressources qu’elles ont pour se défendre ou réagir. Par exemple au début du chapitre que je consacre au XVIIIème siècle, je parle de Madame du Châtelet. Je vais vous raconter cette anecdote, elle est un peu croustillante, vous m’excuserez, mais j’ai lu ça dans les mémoires du valet de chambre parce que pour moi les domestiques hommes ou femmes évidemment font partie des classes populaires et c’est même une fraction très importante des classes populaires à cette époque-là. Donc, on a les souvenirs de ce valet de Madame du Châtelet qui est considérée comme une figure féministe du XVIIIème siècle, c’était la maîtresse de Voltaire aussi par ailleurs. Il raconte que quand elle prenait son bain, il était chargé de verser l’eau chaude et que Madame du Châtelet de façon qui pourrait nous sembler aujourd’hui impudique, n’hésitait pas, écartait les cuisses, et lui il fermait les yeux et il versait, et elle l’accusait de la brûler. Cc’est très pathétique comme forme de souffrance. Il ressentait ça à la fois comme un mépris de classe parce que pour la noblesse, les domestiques n’étaient pas des êtres humains comme les autres, mais en même temps se greffait une question de genre, parce que lui évidemment, s’il fermait les yeux, c’est parce que c’était un homme aussi. Et donc il y avait cette double relation des deux aspects de son identité à la fois d’homme et de domestique considéré comme quantité négligeable par les nobles et en l’occurrence, une femme. Moi ça m’intéresse parce qu’intégrer la dimension de classe dans la question du genre, ça permet aussi de montrer que les femmes peuvent jouer des rôles dominants. Elles peuvent avoir du pouvoir parce qu’autrement on est dans des discours : voyez aujourd’hui dans les médias, on ressasse ça sans arrêt, on ne voit plus cette dimension-là. Ma mère était ouvrière, donc je connais ça aussi de l’intérieur, je sais combien la question de la classe sociale est importante dans l’identité des femmes. Il faut aussi veiller à ce que le discours sur les femmes ne soit pas accaparé par des porte-parole issues de la bourgeoisie.
Un intervenant : Pour aller un peu plus loin sur ce que vous venez de dire sur la question féminine, comment se fait-il que la question du partage des tâches à la maison soit toujours d’actualité ? Il y a les écritures inclusives, tout un tas de choses qui sont tout à fait bien, mais l’essentiel c’est qu’on le veuille ou non une forme de fascisme domestique larvé qui est là, d’une certaine manière. Il ne faut pas oublier qu’un prolétaire, sa seule richesse, c’est de fabriquer des enfants parce qu’il est prolifique, le mot lui-même est originaire de ça. C’est sa seule force et la démultiplication de la force de travail se fait par la femme. Autre chose : est-ce que vous vous êtes attardé sur les grandes figures féminines, révolutionnaires ?
GN : Ce n’est pas la perspective du livre, donc je ne l’ai pas fait, ni pour les grandes figures masculines. Je ne parle pas d’Olympe de Gouges, etc.
Une intervenante : Par rapport à l’anecdote de cette comtesse, en fait ce n’est pas parce qu’elle est femme qu’elle était exempte, elle a répliqué le schéma de domination quand elle a parlé à son valet. Ça s’apprend, le respect des autres personnes. Puisque vous parlez des femmes, des féministes, l’écriture inclusive peut donner la visibilité à toutes ces femmes qui pendant des siècles ont été absentes. L’écriture inclusive nous visibilise et est un outil de réparation historique.
Une intervenante : Je voudrais aborder la question du climat. Bruno Latour parle du climat en disant que c’est une nouvelle cause qui est une façon de cliver et pour certains dominants, de dominer encore les peuples. Pendant que la terre brûle, on développe un discours qui ne fait rien avancer et il y a des possédants qui en profitent. Peu importe ce qui se passera après leur génération.
GN : Je trouve que c’est vraiment important. Howard Zinn a eu la chance de vivre assez longtemps pour faire plusieurs postfaces à son livre, j’espère avoir la même chance. J’avais pris du retard dans l’écriture du livre, il fallait absolument que je termine et je n’ai pas eu le recul sur certaines choses, dont celle que vous venez d’aborder. Et dans la postface si postface il y a, lors de la prochaine édition, je l’aborderai exactement dans le sens de Latour. C’est un enjeu fondamental dans l’émergence d’une nouvelle cause, universelle. Notre rôle est de percevoir comment se reproduisent les formes de domination y compris dans des formes qui peuvent apparaître consensuelles ou progressistes. La question du climat nous met au cœur d’un nouvel enjeu. Certaines réponses vont dans le sens d’une lutte contre la domination et d’autres à l’inverse. Je pense que c’est une question que j’aurais pu traiter historiquement. Le rapport à la nature, Marx en parlait déjà d’ailleurs, se pose aussi historiquement. Je n’ai pas eu le bon réflexe à ce niveau-là, je n’ai pas assez creusé, mais je voudrais le faire pour mettre en perspective ce que disent les sociologues depuis la révolution industrielle. Ça a été des enjeux de luttes. A la fin du XIXème siècle, l’extrême-droite, le nationalisme, toute l’idéologie de la Lorraine rurale, c’est aussi une utilisation des effets de l’industrie sur la nature dans un sens réactionnaire. Ça mériterait d’être approfondi et je compte y revenir.
On peut dire qu’Elisée Reclus était visionnaire alors que Vidal de la Blache avec son idéologie de l’enracinement a eu les honneurs de la République et on voit où ça nous a menés. Donc, beaucoup d’exemples comme ça méritent d’être rappelés.
Un intervenant : Un livre, Le capitalocène vient de sortir, écrit par Armel Campagne qui critique la notion d’anthropocène et cette idée que l’on serait tous responsables du changement climatique. Il démontre exactement l’inverse : que ce sont les dynamiques de capitalisme industriel et en particulier les énergies fossiles qui sont imposées par les classes dominantes qui produisent le changement climatique actuel, et donc se sentir tous également responsables, c’est déjà une arnaque et il y a déjà là un jeu de domination énorme. Un petit exemple de ça au niveau international que j’ai pu entendre, c’est dans le cadre des discussions justement sur adaptation, transition, je ne sais plus quel ministre d’Amérique du sud qui au sein des discussions de l’ONU regarde les Occidentaux et leur dit : « Ecoutez, le problème du changement climatique, ce n’est pas notre problème, c’est votre problème et il n’y a pas une dette et un investissement qui serait à faire universellement par tout le monde. C’est vous qui nous devez déjà énormément, parce qu’on a subi, on subit au premier chef les conséquences de ce changement-là ». Donc il y a quelque chose à creuser de ce côté-là en terme de domination et à l’inverse, les classes populaires, ce sont celles qui subissent le plus la pollution, les effets du changement climatique, tandis que les riches seront bien protégés dans les tours dorées.
Un intervenant : Sur la question du pouvoir, pour moi il y a deux acceptions, il y a le pouvoir domination, mais il y a aussi le pouvoir d’agir. J’ai pas fini le livre, mais dans la construction de l’Etat que tu présentes, j’ai le sentiment qu’il y a un éloignement des zones où il y a un pouvoir d’agir pour un ensemble de la population. Il y a un éloignement des lieux du pouvoir par rapport à la population et je trouve que par rapport à la situation que tu décris au moment de la Révolution, où il y a des organisations de la population qui fonctionnent, aujourd’hui on est arrivé dans une situation où la phrase qui domine, c’est « On ne peut rien y faire, on n’a pas de lieu, on n’a plus d’instance où on aurait la possibilité d’agir » et je trouve ça très effrayant parce que j’ai l’impression qu’on n’a plus que le pouvoir de s’indigner, mais le réel pouvoir s’est éloigné.
GN : Je suis tout à fait d’accord avec ce que tu viens de dire, j’essaie de le montrer, on est aujourd’hui dans une société (j’hésite car ça peut être mal interprété) qui n’a jamais été aussi pacifique. Je vais préciser ce que j’entends par là. En gros, les gens aujourd’hui qui ont plus de 55 ans représentent la première génération qui n’a jamais connu la guerre sur son territoire. C’est pour ça que dans mon dernier chapitre, je dis que ça a été un évènement totalement fondamental, la pacification de nos sociétés. Quand je dis ça, je parle de violences physiques mais la violence symbolique, la violence douce n’a jamais été aussi forte. Prenez par exemple aujourd’hui internet, UBER, je n’aime pas utiliser trop souvent le mot fascisme parce que ça le galvaude, mais il y a quand même des éléments qui relèvent d’une sorte de fascisation des comportements sociaux puisque nous sommes appelés à être tout le temps les flics de nos voisins. Je ne sais pas si vous avez eu l’expérience avec Free ou avec Orange. Il suffit que vous preniez un abonnement quelque part, le lendemain vous avez un questionnaire : que pensez-vous de la personne que vous avez eu au téléphone ? Donc, on nous demande de jouer un rôle qui était auparavant celui des contremaîtres dans l’entreprise. Il y a cette surveillance généralisée qui se développe et ce n’est pas de la violence physique, ce n’est pas une armée en face de vous qui vous matraque mais c’est quand même de la violence sociale qui a des effets. Le burn-out, la souffrance s’intensifient. Si vous prenez les courbes de mortalité violente, la criminalité est en baisse, toutes les études le montrent. Mais la perception des gens est celle d’une société de plus en plus violente non parce qu’ils l’ont vécu, mais parce qu’ils l’ont vu à la télé.
Je pourrais vous donner mille et un exemples, des gens qui vivent dans des villages qui n’ont jamais vu un immigré et pourtant vont voter Front national parce qu’ils disent « On est envahi », c’est du fantasme véhiculé par les médias. Mais pour rejoindre ce que vous disiez effectivement, c’est que l’action c’est-à-dire le fait d’agir a beaucoup reculé, effectivement. Si on voit les luttes sociales qui se menaient dans les années 1930, entre les communistes et les fascistes, eh bien c’était le coup de poing dans la rue. Il y avait des morts, des violences, c’étaient des choses extrêmement physiques. Alors qu’aujourd’hui, effectivement, les gens croient qu’ils font de la politique parce qu’ils sont sur Facebook à échanger des propos. Regardez toute la logique des petites phrases, des choses qui passent par le langage. On peut trouver que c’est mieux que de se donner des coups de poing, mais j’ai tendance à penser quand même que les perdants sont toujours les mêmes. Ce sont ceux qui ont moins la maîtrise du capital linguistique, de la rhétorique. On pourrait faire beaucoup d’analyses. J’ai écrit des ouvrages là-dessus, sur la question du racisme, de la xénophobie, etc. On voit bien que ceux qui maîtrisent la langue vont euphémiser, ils savent que s’ils prononcent tel ou tel mot ils seront condamnés par la loi pénalisant le racisme, donc ils vont contourner, ils vont dire « communautarisme » ou je ne sais quoi. Vous avez comme ça un langage, un rapport au langage qui est extrêmement pernicieux et qui s’apprend. Il y a effectivement cette évolution-là qui fait qu’on est dans des contextes où l’action directe a reculé, ce qui fait que les actions collectives sont plus difficiles à organiser. Il y a une atomisation et on le ressent tous dans nos vies quotidiennes quand on est engagé, ça c’est sûr.
Une intervenante : Je voulais savoir si vous abordiez la domination sur les groupes d’origine étrangère alors qu’aujourd’hui on entend partout dire dans les hautes sphères qu’on veut réhabiliter les soldats de la Grande Guerre d’origine africaine et que parallèlement, tout ce qu’on voit en France en ce moment, c’est les expulsions de leurs descendants.
Une intervenante : Pourquoi n’abordez-vous pas la guerre de 1914-1918 en tant que telle et surtout les conséquences de cette guerre, notamment ce fameux traité de Versailles et le partage du monde entre les Occidentaux avec toutes les incidences que cela a aujourd’hui dans la situation des pays du Moyen-Orient ?
GN : Pour répondre à la première question, je développe beaucoup cet aspect-là parce que c’est aussi lié aux nombreuses recherches que j’ai faites sur ces questions, c’est-à-dire la question de l’immigration. Je montre que le mot même d’immigration est entré dans la langue française de façon courante à la fin du XIXème siècle à partir de 1881, c’est-à-dire à propos d’un incident où vous avez des immigrants, des enfants d’immigrants de l’époque, qui ont sifflé la Marseillaise. C’est le point de départ de ce qu’on appelle le problème d’immigration. Donc, ça nous rappelle des choses récentes, le battage autour de jeunes qui avaient sifflé la Marseillaise lors du match France-Algérie, ce n’est pas du tout nouveau. Quand on est historien, ce qui frappe, c’est le côté répétitif de ces choses-là. Vous savez, quand un symptôme se répète comme ça, c’est que c’est une névrose, c’est ce que j’appelle la névrose nationale. Les premiers qui avaient sifflé, c’était des immigrés italiens à Marseille et ça rejoint la question coloniale puisque c’est au moment où la France avait mis la main sur la Tunisie en chassant l’Italie. Du coup, ces braves soldats qui avaient réussi cet exploit arrivent à Marseille, on pavoise, et il y a les bâtiments où sont les Italiens qui sifflent. Chasse à l’homme pendant une semaine et trois Italiens y perdront la vie. C’est le début de toutes ces affaires-là et on trouve aussi ce clivage, c’est-à-dire que d’un autre côté, il y a des associations humanitaires qui accueillent les réfugiés, Victor Hugo qui s’occupe d’une association qui va accueillir les Juifs victimes des pogroms en Russie ou en Pologne ou des Arméniens déjà. Donc, il y a cette logique-là. C’est pour ça que quand on me parle des valeurs de la République, ce que je montre c’est qu’à toutes les époques, c’est un enjeu de lutte, à toutes les époques, on retrouve deux camps comme aujourd’hui. Ceux qui accueillent et ceux qui rejettent. Et il y a une phraséologie particulièrement importante en France, c’est ce discours sur les traditions républicaines d’accueil. Dans un livre sur l’histoire des réfugiés, je montre que, quand vous avez un homme politique qui dit « la France qui a toujours eu une tradition d’accueil », c’est qu’il prépare un mauvais coup contre les migrants. Donc on est confronté aujourd’hui à cette situation que vous évoquiez. D’un côté : « Voyez, on est fidèle à nos traditions supposées des droits de l’homme », on va faire des coups symboliques qui ne coûtent pas grand-chose. La mémoire sert bien pour tout ça, parce que en disant avec des trémolos dans la voix (je ne dis pas qu’il ne faut pas le faire) « nos tirailleurs sénégalais, les héros », on se donne un côté défenseur des droits de l’homme à peu de frais aujourd’hui parce que le travail a été fait avant par les historiens, les militants qui ont réhabilité cette mémoire-là, et de l’autre côté, on ferme les frontières. On a aujourd’hui une politique à l’égard des migrants qui n’a jamais été aussi dure. Tous les militants, les associations le savent. Donc il y a cette tension qui est je crois aujourd’hui plus dramatique peut-être que jamais, ce qui nous rapproche des années 1930. Pourquoi c’est plus dramatique que dans les années 1930 ? A mon avis, c’est que dans les années 1930, quand le Front anti-fasciste s’est mis en place, il a rassemblé des gens qui au fond s’en foutaient des migrants, des réfugiés, à l’époque c’était des juifs qui fuyaient le nazisme, ou des anti-franquistes ou des anti-fascistes italiens. C’était pas leur problème, mais ils étaient quand même dans le Front anti-fasciste parce qu’ils avaient peur pour eux, parce qu’ils disaient « si les fascistes prennent le pouvoir, ils vont nous supprimer la démocratie », donc il y avait une solidarité de fait. Alors qu’aujourd’hui, vous avez le Front National. Vous savez comment Le Pen a commencé à faire des scores extraordinaires ? C’est pas par les urnes au départ, c’est par la télé. Il a été invité en prime time à une émission qui s’appelait « L’heure de vérité », il a cartonné, il a fait 3 millions d’auditeurs. Comment croyez-vous que les Français puissent croire que le Front National représente un danger mortel pour la démocratie alors qu’on l’invite sur les chaînes publiques à 20h 30 ? Il y a une sorte d’hypocrisie incroyable qui n’est pas assez dénoncée, donc les gens banalisent tout ça, et ce discours d’hostilité à l’égard des migrants avec des chiffres qui sont complètement faux, toutes les études sérieuses le montrent. On n’est pas envahi, c’est absolument faux. Quand vous prenez les courbes de la population étrangère en France le pourcentage n’a pas progressé d’un pouce depuis 1980. La France est un pays où le taux d’immigration étrangère est stable. C’est une chose que j’ai montré dans mes ouvrages et que je rappelle dans ce livre : on parle de l’immigration quand elle a cessé et on en parle jamais quand on la fait venir, parce que là on en a besoin. Prenez dans les années 1960 où il a y eu plusieurs millions de travailleurs immigrés qu’on a fait travailler comme OS dans les usines, qu’on parquait dans les bidonvilles, personne n’en parlait. Ce n’était pas un sujet, il n’y avait que l’extrême-gauche qui en parlait. Et puis il y a eu le retournement des années 1980 où c’est l’extrême-droite qui a repris le truc. Donc on voit de manière très concrète, sans sortir de l’analyse historique, comment fonctionnent les formes de domination sur ces questions-là.
Sur la guerre de 1914-1918, ma logique était le basculement entre le social et le national, c’est-à-dire que je commence par la référence aux insoumis, et comment à partir de 1917 il y a cette fracture qui fait que la classe ouvrière, les classes populaires rebasculent du côté du social alors qu’en 1914, elles avaient accepté l’union sacrée. C’est ma ligne directrice. Le traité de Versailles, j’en parle un peu avec la Syrie car il y a un lien mais effectivement, vous avez raison, c’est un point qu’on pourrait creuser parce que toute une série de problèmes actuels, y compris pourquoi le nationalisme est si fort en Hongrie, qui a ressenti ce traité comme une chose terrible puisque ce pays a été réduit à rien du tout. Et puis dans l’empire colonial, les mandats, les partages, effectivement ont des effets sur notre actualité, mais ça me semblait un peu éloigné de ma perspective d’histoire populaire, c’est pour ça qu’au dernier moment je l’ai rayé.
Un intervenant : Vous avez évoqué au début de votre propos votre militantisme associatif. Est-ce que pour vous l’histoire et la sociologie peuvent avoir un effet thérapeutique ?
Je travaille en lycée avec des adolescents et je me rends compte, en particulier avec des personnes d’origine étrangère, mais aussi de toutes origines, qu’à partir du moment où on commence à parler d’histoire, ça les fait vibrer.
GN : C’est vraiment une question tout à fait fondamentale que je me suis posée pendant longtemps et je vais vous dire comment je l’ai résolue sans avoir la prétention d’avoir trouvé la solution miracle. Si je prends mon exemple personnel, l’histoire a été une thérapie personnelle, mais je ne dirais pas l’histoire qu’on m’apprenait à l’école, parce que j’appartiens à une génération où on nous enseignait à coup de baguette. C’est quand j’ai été étudiant, que j’ai découvert Marx, il y avait un lien avec ma vie. Mais c’est aussi le fait de faire de la recherche en histoire : je plaide au maximum pour faire le lien entre l’étude, la lecture, mais aussi la recherche, faire par soi-même. Et le lien entre sa propre histoire personnelle et la grande histoire peut se nouer à ce niveau-là et avoir un effet thérapeutique. C’est pour ça aussi que dans l’introduction de mon livre, je dis que mon espoir civique le plus fort, c’est pas tellement que les gens deviennent tous des grands défenseurs des droits de l’homme, je l’espère mais il ne faut pas se leurrer ; je dis que ça commence par un premier point qui nous concerne tous, c’est ce que j’appelle se rendre étranger à soi-même. Ca peut paraître bizarre, c’est un mot allemand, ça vient de Bertold Brecht qui pour moi est une source d’inspiration (je suis très lié aux gens de théâtre), en allemand c’est verfremdung. On a traduit ça en français par distanciation, mais ce n’est pas le bon mot à mon avis. Dans le terme allemand, il y a le mot étranger, se rendre étranger à soi-même, ça touche un peu la dimension émotionnelle que vous évoquiez en parlant de thérapeutique, ce n’est pas l’intellectuel c’est l’émotionnel, et c’est fondamental. Je m’en suis rendu compte après avoir tourné vingt-cinq ans avec des conférences où je disais aux gens de faire attention, de ne pas être racistes. Si j’étais honnête avec moi-même, la plupart du temps les gens qui étaient en face étaient tous convaincus, c’était la Ligue des droits de l’homme, les enseignants, les militants associatifs. Les autres, les quelques rares du Front National qui étaient là disaient à chaque fois : « Moi, je ne suis pas raciste » et il y a toute une stratégie de défense. On ne résout pas ces problèmes-là comme les problèmes mathématiques. C’est pour ça que je me suis mis à travailler avec des artistes et l’expérience de « Chocolat » a été extrêmement intéressante. Quand on a commencé avec cette association, mes amis artistes m’ont demandé si je ne connaissais pas un personnage qu’on pourrait prendre comme exemple pour essayer de raconter autre chose, sur ces questions de discrimination, que le laïus habituel. Je me suis souvenu avoir vu dans un bouquin une note de bas de page à propos de « Chocolat ». Rien n’avait été écrit mais en fouillant dans la presse de l’époque, j’ai trouvé cette histoire et on l’a mise en scène. J’ai écrit un texte de théâtre, on l’a joué. Dans la première version, j’étais moi-même sur scène avec un comédien et un musicien. Là j’ai souffert, je me suis rendu compte que la vie d’artiste, c’était pas facile. Question de remise en question de son identité professionnelle, c’est salutaire. L’effet que ça a eu sur les jeunes, les réactions des élèves (on va à Saint-Denis, à La Courneuve, on le présente dans des collèges, des lycées professionnels) m’ont fait changer de point de vue même sur la recherche que je faisais. C’est pourquoi j’ai écrit un deuxième livre. Dans le premier livre on avait mis l’accent sur les stéréotypes, (Toulouse-Lautrec présentait ce clown comme un singe par exemple), une dénonciation des préjugés de l’époque en France. Un jour, un élève d’origine africaine s’est levé à la fin du spectacle, très agressif, en disant : « C’est pas possible que votre Chocolat ait accepté tout ça sans rien dire ». Il s’était identifié à ce personnage et on s’est dit qu’on avait raté quelque chose en voulant trop bien faire, en dénonçant le racisme, que l’on n’avait pas vu l’autre côté. On est resté dans l’entre-soi des bien-pensants. Du coup, je suis retourné aux archives, j’ai de nouveau regardé notamment les images, parce que pour étudier Chocolat on a les petits films des Frères Lumière, cinq ou six sketches. Je les avais vus et ils ne m’avaient pas fait rigoler mais en les revoyant avec, dans la tête, ce qu’avait dit cet élève, j’ai essayé de voir si il n’y avait pas des éléments de résistance dans la façon de bouger son corps. Et effectivement, on voit que tout ce qui après a fait partie du patrimoine de l’Auguste au nez rouge (Chocolat a été le premier Auguste), Auguste qui résiste au clown blanc sévère en faisant comme un enfant espiègle, en ridiculisant un peu le pouvoir. Ça nous était passé à côté parce que notre déformation professionnelle est d’aller voir les textes mais Chocolat ne savait pas écrire, ne parlait même pas le français au début. Nous, en tant qu’enseignants, éducateurs… quand on est à l’écoute, quand on touche les gens auxquels on s’adresse, on tire aussi un bénéfice. Je crois beaucoup à cette dialectique, c’est pour ça que l’on fait ces conférences gesticulées. On en prépare une sur la question des migrations qui s’appelle « Nos ancêtres les migrants ».
Une intervenante : Je voudrais revenir sur l’idée d’une société pacifiée où il y aurait absence de violences directes. Toute personne aujourd’hui qui refuse cette société pacifiée, qui se déclare en guerre contre les dominants et les attaque frontalement sait assez vite qu’elle peut perdre un oeil, voire plus. Elle existe, cette violence physique directe pour toute personne qui refuse l’idée de cette société pacifiée et qui se sait en guerre, justement.
GN : C’est sûr que la répression policière est réelle, elle s’est même peut-être accrue dans la dernière période, c’est un fait. Quand on fait des analyses globales, on a toujours peur que ce soit interprété comme une sorte d’excuse ou de minimisation des formes de violence qui existent, on l’a vu récemment. Evidemment, malgré tout si l’on compare avec ce qui se produisait au XIXème siècle, avec le massacre de Fourmies, on n’est plus tout à fait dans la même logique. Mais il y a effectivement des gens qui peuvent être bléssés parce qu’ils défendent leurs idées ou manifestent. Quand on voit ces scandales d’Etat, Benalla, où des gens peuvent s’autoriser au-delà de toute loi, de tout contrôle démocratique à tabasser, matraquer des manifestants, on est hors de l’Etat de droit, c’est une atteinte à la démocratie. Il faut rester vigilant à cet égard, mais j’insiste beaucoup sur cette idée de pacification parce que je pense que l’une des raisons principales de la montée en puissance de l’extrême-droite aujourd’hui (je n’aime pas le mot populisme puisque vous savez que maintenant, dès qu’il y a des gens qui revendiquent pour les classes populaires on dit qu’ils font du populisme, donc il faut faire attention à ce mot, je préfère dire nationaliste, extrême-droite, etc.) on sait que c’est la logique sécuritaire, le discours sécuritaire qui prime donc rappeler aussi qu’aujourd’hui il y a moins de crimes que dans le passé, ou qu’on a plus de chance de se faire assassiner par quelqu’un de sa famille que par un terroriste est tout à fait évident. Un chercheur canadien a écrit un livre traduit en français, qui explique ça et, c’est bizarre, ils n’en ont pas parlé à BFM TV. On est bien là aussi dans des luttes importantes sur le plan symbolique.
Une intervenante : J’ai une petite question à propos du jeu corporel de Chocolat, ça me faisait penser aussi aux stratégies corporelles des homos et des trans dont on n’a pas parlé et également au retournement d’insultes, etc. Est-ce que Butler vous la placez dans la lignée de Bourdieu et Foucault, est-ce que c’est quelqu’un que vous lisez ?
GN : C’est quelqu’un que j’ai lu depuis longtemps puisque j’ai moi-même enseigné à Princeton. Je connais bien Joan Scott, toute la mouvance féministe américaine. Je dirais que je suis, au point de vue discipline, ancré dans les sciences sociales empiriques, ce qui amène à un certain nombre de divergences dans le type même d’enquête, ce qui n’empêche pas que l’on puisse utiliser des concepts qui peuvent venir de la théorie féministe ou d’autres formes de théorie dans nos propres travaux. Mais le problème pour nous c’est de trouver des ancrages, donc Butler ne m’a pas servi directement, mais peut-être indirectement, parce que justement ce que je montre dans mon livre sur le clown Chocolat (qui se déguisait fréquemment en femme, il y a cette dimension-là), ils ont été parmi les premiers à le faire et c’était même l’une des raisons principales de leur succès à la Belle époque. Ils avaient un succès extraordinaire, c’était vraiment des gens au niveau de popularité d’Omar Sy aujourd’hui. A l’époque, le cinéma n’existait pas, il est venu à la fin de leur carrière et les clowns étaient des artistes extraordinairement populaires, ils faisaient la une des journaux et Foutite et Chocolat se déguisaient en femmes. On a fait une exposition qui a beaucoup tourné où on voyait Chocolat déguisé en femme et un spectacle qui était très très marrant. Il jouait sur les inversions de couleur de peau et de genre avec de la poudre. Une sorte de vaudeville, de concurrence pour séduire. Ils avaient inventé un truc qui avait un grand succès, fondé sur une sorte de déconstruction des identités à la fois de genre et de race. Eric Fassin m’a un peu initié à tout ça. Parfois, quand on réfléchit à la façon dont on élargit son horizon, en tant qu’historien, ce ne sont pas forcément des outils fermement construits, ce sont souvent des choses que vous avez quelque part dans votre tête, vous ne savez pas où, vous ne savez même pas que vous l’avez et vous tombez sur quelque chose, une archive, un document, et ça vous sert. C’est ce qu’on appelle l’intertextualité, c’est pour ça que je conseille toujours à mes étudiants de lire beaucoup et de diversifier au maximum leurs lectures, même si ce n’est pas dans leur discipline.
CR de Jérôme et Jean-Louis Vauzelle.