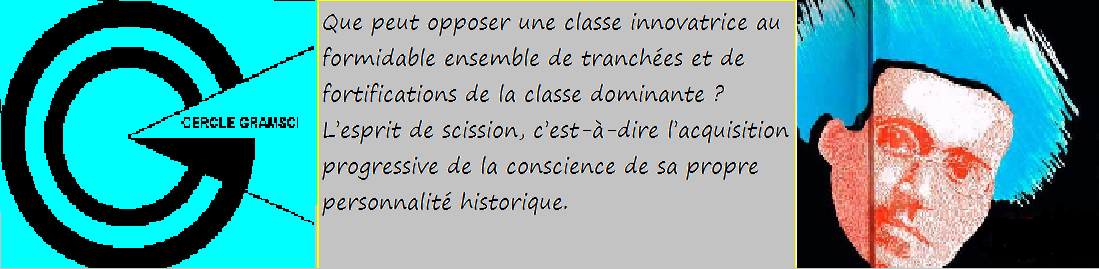début de l’article….Ces quatre points cardinaux offrent quatre dimensions différentes mais complémentaires de la culture: – l’intégration renvoie à la socialisation, à ses normes et à la formation de la personne dans un cadre sociétal (famille, école, métier et profession) ; – la distinction renvoie à l’expression de soi et à l’expression des goûts selon les classes, les groupes, les âges, les sexes, les territoires et leurs potentialités d’offre culturelle ; – la politisation renvoie à la promotion de la culture et au développement de ses équipements par les administrations de l’Etat et par celles des collectivités territoriales (choix politiques, budgétisation, monde des professionnels de la culture, médiatisation, idéal de démocratisation) ; – l’émancipation renvoie à deux modalités de l’engagement militant : soit en faveur de la culture comme cause à défendre en tant que telle (il s’agit alors d’émanciper la culture d’une tutelle quelconque qui la brime et, par là, de la défendre comme une liberté et un droit), soit en faveur de la culture comme moyen – pour une cause sociale, une cause politique ou une cause idéologique – d’être promue et défendue (il s’agit alors de s’émanciper par la culture et de valoriser à large échelle l’importance d’une cause par un acte culturel créateur, comme la diffusion d’une chanson, d’un spectacle, d’un concert, d’un événement festif, d’une peinture, d’une sculpture…). Je ne traiterai le point « intégration » que brièvement dans la mesure où il implique par lui-même, d’une part, une lecture de l’entrée de chaque individu dans la vie sociale et, d’autre part, une étude des phénomènes de socialisation, d’acculturation, d’interaction… relativement aux diverses situations successivement vécues par chacun de nous. J’insisterai davantage sur les trois autres points cardinaux : tous trois supposent un mode de participation à la vie culturelle qui peut tour à tour prendre les aspects les plus contradictoires, à savoir : aspect vulgaire ou cultivé, aspect passif ou créateur, aspect uniformisé ou résistant, aspect consumériste ou engagé, aspect traditionnel ou avant-gardiste, aspect réactionnaire ou révolutionnaire, etc. Distinction par le loisir de l’individu hors travail – culture se déployant dans le temps libéré du travail : elle ouvre des possibilités infinies d’expression de soi ; – culture de fréquentation des équipements culturels (maisons de la culture, théâtre, cinéma, musées…) : quelle initiative propre (liberté de faire ou de ne pas faire, de sortir ou de rester, sociabilité, individualité, repli sur soi…) ? Quelle sélection des événements culturels ? Quelle dépense consentie ? Quelle quête d’un capital symbolique ? Quelles pratiques en amateur ? – culture du goût : les classes, les groupes, les âges, les sexes se distinguent par leurs choix, leurs fréquentations, leurs expressions, l’intensité de leurs investissements, leurs jugements esthétiques. Tout goût est une forme de dé-goût.
Politisation par l’implication du citoyen, du professionnel et de l’élu – culture associative : l’initiative (quel domaine ? quel public ?), le bénévolat (quels groupes ? quelles classes ? quels âges ?), la reconnaissance (les minorités ethniques et leurs associations) [registre de la société civile] ; – culture politique : la qualification des biens culturels dans les programmes politiques, un budget de l’Etat et des collectivités, une administration et ses effets. La culture comme intérêt général [registre des pouvoirs publics] ; – culture comme service : une cause « différente », portée et défendue par les acteurs professionnels, médiateurs et intermittents [registre du service public culturel]. Emancipation de la culture et émancipation par la culture – culture émancipée : donner à la culture son autonomie, la couper de toute tutelle politico-idéologique ou de toute emprise médiatique ! Soit ! Mais comment ? La culture peut-elle se déployer sans les aides substantielles des pouvoirs publics ? Et ne développe-t-elle pas, elle-même, des « parts de marché » ? Son rapport à l’argent est-il contradictoire avec son rapport à la création ? Ne transige-t-elle pas avec le monde de l’entreprise par le mécénat ? La culture est-elle si émancipée que l’on veut bien le dire ? – culture émancipatrice : elle est à la source d’actes donateurs de sens. Par exemple, la création artistique peut aussitôt se mettre au service d’une mission, d’une cause, d’un cas, d’un droit… à promouvoir, à faire connaître, à diffuser, à défendre contre vents et marées. Tel chanteur engagé peut parler haut et fort pour une liberté… Tel metteur en scène peut mettre en image la précarité, l’exploitation, la stigmatisation… de tel ou tel groupe social… Picasso peint le martyre de la ville de Guernica pendant la guerre civile espagnole ! – culture, symbole de liberté et indice d’inégalités ? Partout dans le monde, des attaques contre la liberté culturelle se produisent, parallèlement à d’autres attaques contre d’autres libertés. Pourtant la démocratie ne peut se déployer que si la culture de l’individu est respectée comme un droit inviolable : droit d’accès, création artistique, expression de soi, lien social. Or elle reste le théâtre d’inégalités persistantes !
Yvon Lamy.
Nous faisons paraître la première partie du compte-rendu de la soirée avec Yvon Lamy, sociologue et philosophe. La partie débat paraitra ultérieurement. La soirée fut introduite par Jean-Pierre Juillard.
Il faut remercier Yvon LAMY d’aborder avec nous un sujet d’une grande complexité. Mais avant toute chose, je voudrais dire quelques mots sur la personne et le personnage, parce qu’il y a toujours un personnage et une personne en nous. Yvon Lamy est arrivé dans les années 2000 à Limoges, et il a créé ici le Département de sociologie. Après une carrière éminente à Bordeaux (il est agrégé de philosophie et professeur des universités) il a déverrouillé l’Université de Limoges, qui s’interdisait un peu d’ouvrir son champ d’investigation à autre chose que la littérature. C’est ainsi qu’ayant réussi, avec beaucoup de difficultés j’imagine mais avec beaucoup de succès, à créer un département de sociologie, il n’a pas réussi à ouvrir un département de philosophie. Il n’y a pas de département de philosophie à Limoges, ni de département de psychologie. Il y a quelques lacunes comme ça qui sont assez significatives, et qui mériteraient un petit mémoire de sociologie. Yvon Lamy a cette audace de nous parler d’un sujet extrêmement complexe, et de venir en parler dans le cadre de notre petite organisation. Au Cercle Gramsci, on l’a déjà reçu deux fois. Moi, ce qui m’a beaucoup intéressé, c’est de voir l’accueil et l’humilité d’Yvon Lamy face à nos exigences : on lui a demandé de ne parler que trois quarts d’heure au maximum (pour quelqu’un comme moi, c’est déjà une véritable contrainte !) puis on lui a demandé de faire un petit papier. Il a tout accepté. Pour ma part, j’attends beaucoup de cette réflexion. La culture, c’est une sorte de mot-valise : tout devient culture, et peut-être rien n’est culture. Dans le cadre qu’il nous a plus ou moins tracé, Yvon Lamy a établi quatre catégories de pensée : la distinction, la politisation, l’émancipation et l’intégration. Yvon Lamy est dans le cœur même du projet du cercle Gramsci. Le Cercle Gramsci a été fondé il y a une trentaine d’années. Je fais partie des fondateurs et notre idée était la suivante : fournir des armes aux gens qui voulaient bien partager avec nous une réflexion sans être instrumentalisés. C’est-à-dire des gens qui essayaient de s’arracher à l’idéologie (je crois qu’il y a un couple idéologie / culture) ; des gens qui essayaient de s’arracher à l’intégration brutale, à la « distinction » dont parle Bourdieu. Nous essayons tous de nous distinguer les uns des autres. On a plus ou moins réussi, mais dans tous les cas c’est dans cet état d’esprit que le cercle Gramsci se développe. Nous sommes des gens qui cherchons dans ce demi-chaos qui nous entoure des petites lueurs, ces lucioles dont parle Pasolini. Comme vous le savez, Antonio Gramsci fut l’un des premiers à souligner à quel point l’idéologie était fondamentale. Quelle que soit la place qu’ils peuvent avoir dans la production, les gens ne sont pas déterminés de façon probante, ils ne sont pas nécessairement ceci ou cela parce qu’ils sont dans une chaîne de production. Ils sont surtout ce qu’ils écoutent le soir à la télé, ou ce qu’ils lisent dans une salle d’attente chez le dentiste. L’idéologie, donc, nous a totalement envahis. Je pense que là-dessus il faudra que l’on réfléchisse beaucoup, parce que l’enjeu est de taille dans cette espèce de foisonnement terible, et c’est en même temps une de nos urgences. Parce que tout le monde a bien compris le jeu : jusqu’au fin fond de nos synapses on essaie de nous imprégner, avec parfois beaucoup d’habileté. Yvon, dans « l’émancipation » je voudrais que tu nous parles de la langue, du rôle de la langue, de la langue que nous sommes en train d’habiter, de quelle manière elle est en train de devenir une novlangue, et de quelle manière comme disait Mallarmé on peut retrouver un sens plus pur aux mots de la tribu. Nous sommes dans un état tel qu’il est nécessaire, parmi les outils de notre émancipation, de retrouver une manière de dire notre singularité. Un dernier mot : comment faire pour que « l’infracassable noyau de nuit » de chacun d’entre nous puisse rencontrer l’universel ? Yvon LAMY : Merci pour cette introduction. Je n’ai pas tout à fait axé les choses comme ça, mais il y aura une discussion tout à l’heure, et nous parlerons des problèmes qui sont soulevés par Jean-Pierre, même si je vais y faire quelques allusions. En fait, je me suis donné un programme extrêmement important : distinction, émancipation, politisation et intégration, ce sont les quatre points cardinaux de la culture. On s’intègre à une société, on se distingue, et puis la politique s’en mêle parce qu’il y a des problèmes d’équipement, des problèmes de budget, des problèmes de pratique et de public, et finalement on se pose la question philosophique de la fin : est-ce que la culture nous émancipe, nous libère ? C’est pourquoi j’avais noté ces quatre points. J’ai travaillé très longtemps sur cette question, et je vais la prendre de manière transversale en croisant ces quatre points et peut-être en simplifiant un peu les choses. Tout d’abord, je voulais vous dire que je vais parler en tant que chercheur, avec des hésitations par moments. Je vais m’appuyer sur des enquêtes sociologiques précises, sur des lectures que j’ai faites au cours de ma vie professionnelle. En tant que chercheur et enseignant, j’ai beaucoup lu et beaucoup enseigné la question culturelle. Au fond, mon problème va être de vous dire d’abord : Qu’est-ce que la sociologie peut nous dire en tant qu’elle est confrontée au phénomène culturel et artistique aujourd’hui ? Dans un deuxième temps, j’essayerai de vous parler de la manière dont on observe les pratiques culturelles et de ce que ça peut nous apporter aujourd’hui sur les questions que j’ai indiquées tout à l’heure. Sur la question de la sociologie confrontée au phénomène culturel et artistique avec l’impossibilité d’une définition, Jean-Pierre le disait bien : c’est très compliqué, la question de la culture. Il n’y a pas de définition philosophique de la culture, il n’y a pas d’essence de la culture, il n’y a pas de nature de la culture. Il y a des pratiques culturelles, il y a des groupes qui s’intéressent à la culture, il y a un langage qui parle de la culture. Vous me qualifiez de philosophe et de sociologue, et c’est vrai, je suis un peu les deux. J’ai une longue formation de philosophe (10 ans : 1962 – 1972), j’ai longtemps enseigné la philosophie dans l’enseignement secondaire (17 ans), puis j’ai bifurqué vers la recherche sociologique au début des années 1980. Je suis devenu sociologue à Bordeaux d’abord, et ensuite à Limoges comme professeur. Cette bifurcation n’a jamais été un renoncement à la philosophie. J’ai toujours essayé de faire servir ma formation de philosophe au travail du sociologue, et inversement. Pourtant on peut dire que la sociologie est une remise en cause des catégories philosophiques, parce qu’elle soumet le chercheur à un travail d’enquêtes : observations, questionnaires. Il pose des questions, mais il n’a en fait sur le phénomène qu’il étudie que des connaissances éparses ou toutes faites ; donc il essaie de les déconstruire et d’en proposer d’autres qui sont plus objectives et mieux fondées scientifiquement. C’est pourquoi la sociologie soumet le chercheur au travail statistique, au travail documentaire, à la critique des données, et c’est de là que le chercheur tire l’ensemble de ses connaissances et qu’il se forge les principaux modèles explicatifs qui tentent d’unifier tout un domaine de phénomènes et de problèmes sociaux. Dans le domaine culturel, j’ai repéré trois grands modèles explicatifs centraux, sachant qu’ils ne sont pas les seuls, mais il me semble que ces trois grands modèles explicatifs que je vais vous présenter vont nous permettre de mieux saisir la manière dont aujourd’hui on peut parler utilement, efficacement, scientifiquement de la culture. Ces trois modèles, ils analysent le spectre des phénomènes culturels, les pratiques, les publics, les structures, les emplois, la distribution des emplois dans l’espace social, les politiques et les budgets aussi (vous savez que les budgets sont extrêmement importants dans la gestion des cultures), ils expliquent les processus de qualification : vous savez qu’au fond on ne peut parler de bien culturel ou de culture que si on qualifie les biens culturels, les offres culturelles, les pratiques culturelles. Alors, comment cette qualification s’opère-t-elle ? Comment introduit-on cette idée de qualité culturelle dans un bien ? Par exemple je ne dirais pas que cette table est culturelle, mais je dirais que l’assemblée que nous formons aujourd’hui a quelque chose de culturel ; donc je la qualifie par mon langage. J’ai pris très souvent l’exemple du monument historique : vous savez, ces monuments, ces palais, ces châteaux, ces églises, ces cathédrales, ces entrepôts, qui aujourd’hui sont qualifiés de culturels ou de patrimoniaux, patrimoine national ou patrimoine historique. Là, il y a un processus de transmutation. Vous savez que dans la religion catholique, il y a un moment où on vous dit : « Ce morceau de pain-là va devenir le corps du Christ » – « Ah ! bon, très bien ». Il faut vraiment le croire. Les gens qui sont dans l’assistance le croient : quand le prêtre prononce une certaine parole, ce morceau de pain devient la présence réelle du Christ. Ça s’appelle la transsubstantiation. Il n’y a pas que dans la religion que cela se passe ; ça se passe aussi dans certaines opérations de l’État. L’État dit à un moment donné : « Ce château, cette ruine archéologique, cet objet d’art, je vais lui donner la qualité de patrimoine culturel, je vais la qualifier d’objet d’art culturel représentatif d’une histoire de la nation, représentatif d’un style régional ». Alors évidemment il y a des commissions qui se réunissent, des procédures qui se mettent en place, il y a des jurys, et tous ces gens-là mis ensemble forment la qualité culturelle, produisent de la qualité, produisent des qualifications. C’est ça qui me paraît important : comment on produit de la qualité culturelle. Les modèles dont je vous ai parlé tout à l’heure sont des producteurs de qualification. Bien sûr, ces trois modèles étudient aussi les emplois, les statuts et cette exception française que constituent les intermittents du spectacle avec leurs difficultés, ces négociations permanentes dans le cadre des ASSEDIC, la relative précarité des artistes qui doivent trouver chaque fois 507 heures de travail annuel. Les modèles dont je vais vous parler expliquent tout cela ; mais c’est foisonnant comme problème, et à un moment il faut se dire : « Je me spécialise sur les publics culturels » ou « Je me spécialise sur les industries culturelles », etc. En fait, la culture est un univers très fragmenté, et ce soir je vais essayer de vous montrer que cette fragmentation a quand même une unité. Elle a une unité selon ces trois modèles : on peut prendre la culture selon le modèle du marché (on va dire que tous les biens culturels sont sur le marché, la culture c’est une sorte de marché et je vais vous dire ce que j’entends par marché) ; ou bien on va dire que la culture crée des mondes de coopération, des mondes sociaux (par exemple, faire un film, c’est un monde culturel qui se construit et dans lequel des coopérations entre les scénaristes, les comédiens, les artistes s’opèrent), c’est le deuxième modèle explicatif ; enfin il y a un troisième grand modèle explicatif, qui est un peu la critique des deux précédents : c’est de montrer que la culture, c’est la société, au fond, et c’est une société en conflit, avec des oppositions, avec des tensions entre des emplois, entre des goûts, entre des œuvres ; et c’est plutôt la position assumée par Pierre Bourdieu. Le modèle du marché, c’est la position de Raymonde Moulin dans Le marché de la peinture en France. Elle a écrit ça dans les années 1970. Pierre-Michel Menger parle de la protection des intermittents du spectacle comme d’acteurs qui jouent un rôle sur un marché, avec des échanges, etc. Quand je parle des mondes de l’art comme des mondes de coopération, dans le deuxième modèle explicatif, je parle plutôt des Américains, des interactionnistes, des gens comme Howard Becker ou Erving Goffman qui considèrent que tout se négocie dans l’interaction pour produire le bien culturel. Vous en avez un exemple si vous avez la patience de rester à la fin d’un film, quand vous voyez défiler tous les noms avec toutes les activités. J’ai la patience de rester jusqu’au bout. Eh bien, je vois défiler devant moi un monde. C’est ça : un monde de l’art. C’est ce défilé, avec toutes ces personnes qui ont coopéré sur un plateau, qui ont coopéré non sans créer des tensions certainement, mais qui ont coopéré malgré tout pour produire cette œuvre. En fait, ce que va dire le troisième modèle, c’est que ce monde de l’art qui a produit le film, est pénétré par des conflits, par des contradictions, des antagonismes, que pointe en permanence quelqu’un comme Pierre Bourdieu. C’est le troisième modèle explicatif. Voilà ce que je voudrais vous dire dans un premier temps. Après, je vous parlerai davantage des pratiques culturelles et des publics. Le marché des œuvres culturelles Le marché des œuvres culturelles est fondé, comme n’importe quel marché, sur le rapport entre offre et demande. La demande, c’est celle des publics ; l’offre, c’est celle des structures, des équipements. Par exemple en Limousin il y a vingt et un grands équipements culturels sur toute la région (j’inclus le festival des Francophonies) qui font des offres que l’on appelle des programmations culturelles, qui sont consommables sur un marché. C’est un modèle économique, c’est un modèle qui considère le marché des œuvres d’art comme un marché où on dépense de l’argent pour acheter un service de consommation. Et donc, le problème de ce premier modèle, c’est de savoir comment ont produit de la valeur et de la rareté pour produire en même temps de l’intérêt de la part du public. Et puis, c’est aussi un modèle dans lequel on s’interroge sur la rationalité, la démarche des acteurs, la démarche des professionnels. Quelle est la rationalité des acteurs économiques dans le monde de la culture ? Qu’est-ce qu’ils cherchent à faire ? Qu’est-ce qu’ils veulent faire ? Est-ce qu’ils sont si à l’aise que ça ? Réponse : non. Le monde de la culture n’est pas tout à fait le monde de la santé. Dans le monde de la santé, il peut y avoir les grands laboratoires de pharmacie qui produisent des biens qui se vendent exactement comme peut se vendre un stylo, une voiture ou un appartement. Mais la culture, économiquement, fonctionne toujours à perte. Donc il lui faut (dans le système français, c’est très net) il lui faut tout le temps des systèmes de compensations financières, budgétaires, qui viennent rendre accessible la culture dans une perspective démocratique. Donc, on voit bien que ce n’est pas un marché tout à fait comme les autres. Il y a aux États-Unis une loi qui montre que si on devait payer le prix d’une place de spectacle ou d’une place de cinéma à son coût réel, eh bien, ça serait exorbitant. On le voit très bien dans le secteur privé de la culture : quand vous allez au Zénith, vous payez des places à un prix beaucoup plus élevé que quand vous allez à la Passerelle ou à L’Union. On voit très bien qu’il y a là un décalage et que la question économique est la question centrale. Parce que ce sont des structures qui sont aidées et qui sont subventionnées, en partie, par le Ministère ou par les collectivités. Donc on voit que cette question est très importante. Il y a une autre chose dont je voulais vous parler à propos de ce modèle : les acteurs qui travaillent se considèrent comme dans un monde incertain, un monde instable. Les statuts y sont précaires, flottants. On ne sait pas si demain on aura un travail qui pourra continuer le travail d’hier. On le voit bien dans la clôture de la fabrication d’un film : une fois le film fini, tout le monde part à la recherche d’autres cachets ou d’autres contrats. On est dans un monde relativement fragile, où les choses se négocient assez rapidement et où les statuts comptent assez peu. Le rendement des diplômes est assez faible. Alors, tous ces éléments sont fugaces, aussi bien du côté des emplois que des œuvres. Je prends par exemple le cas du marchand de tableaux, du collectionneur ; il prend des risques, parce qu’il va travailler sur le nom d’un artiste inconnu et il va essayer de le promouvoir, de parier sur lui, de sorte que son nom devienne connu. La figure du collectionneur est une bonne figure pour comprendre ce modèle du marché : comme un entrepreneur, il faut qu’il risque quelque chose. C’est un peu une loterie. Il se demande comment, en pariant sur une œuvre, il va en tirer des bénéfices intéressants. Vous avez aussi l’artiste qui cherche à faire carrière. Comment fait-il ? Ce n’est pas écrit dans un guide. L’artiste est obligé de se manager lui-même, de trouver lui-même les ressources pour essayer de se faufiler, de se faire connaître et de se distinguer des autres. La question de la distinction apparaît ici. L’artiste se demande comment faire carrière et trouve le système que l’on connaît bien, par exemple dans le cadre des Francophonies celui de la résidence. La résidence, c’est un calcul économique : avec la résidence, l’artiste peut se faire connaître dans un cercle restreint, mais il va produire une œuvre à certaines conditions dans le cadre d’un cahier des charges très précis. Dans toutes ces situations le rendement des formations est faible. Je veux dire que les formations comptent peu, le goût du risque est très fort, l’aspect psychologique de ce risque est très fort, et à mon avis tout ça est plus important que les considérations financières parce que ce qui est en jeu c’est la construction de quelque chose, la construction d’un bien culturel, la construction d’une œuvre, la construction d’une carrière… c’est vraiment un pari ! Quand ça marche, l’artiste, l’architecte, le compositeur, le chorégraphe, l’écrivain, décrochent le gros lot, ils se font un nom, leur carrière décolle, leurs revenus avec. Ce sont de stratégies conscientes de singularisation. On se singularise parce qu’on pense que la signature d’un artiste est essentielle pour que la valeur culturelle soit produite, et au fond la valeur culturelle n’est produite que quand on peut dire : « Voilà, cette œuvre appartient à Untel et elle est signée par Untel ». Si cet artiste est reconnu en tant que tel et reconnu par les médias, eh bien, sa carrière va décoller. Ce que je suis en train de vous dire, c’est comment on crée un artiste, comment on crée une œuvre, comment on crée un bien culturel. Et c’est là la complexité culturelle : vous pourriez trouver, pour chaque bien singulier, une trajectoire de vie très différente. Prenez le cas de Picasso. Moi, je ne sais pas comment Picasso est devenu Picasso. Prenez le cas de Rembrandt. Je ne sais pas comment Rembrandt est devenu Rembrandt. Prenez le cas de Depardieu. Je ne sais pas comment il est devenu Depardieu. Bien sûr, il a écrit des petites choses : lettre à mon père, lettre à ma mère, on le voit faire, etc. Mais ce que vous ne saurez jamais, c’est les coups de fil qu’il passe, c’est les commandes qu’il reçoit. Tout d’un coup vous savez qu’il va faire un film sur tel thème avec Fanny Ardant. Mais comment tout ça s’est passé ? Les coulisses de la fabrication du produit culturel, on ne le saura jamais. C’est ça qui est très compliqué, dans le travail d’un chercheur comme le sociologue. Un sociologue doit être un espion : il faut qu’il espionne pour essayer de voir ce qui se passe derrière les façades des maisons. S’il ne sait pas ce qui se passe derrière les façades des maisons, il ne saura rien de ce se passe dans la société. Il faut qu’il ouvre les portes, et pour qu’il ouvre les portes il faut qu’on l’aide et que l’on soit d’accord pour l’aider. C’est ça qui est compliqué. Vous voyez dans ce marché des œuvres culturelles des analogies avec le monde politique. Je suis persuadé que le monde politique fonctionne de la même façon. Le vote pour un élu est une première qualification, mais cette qualification il faut la rendre durable. Il faut que la légitimité qu’il a reçue du vote lui donne une persistance dans le temps pour rejoindre l’élection suivante, donc il faut qu’il soit crédible, il faut qu’il soit légitime. Comment construit-il tout ça ? Encore une fois, il n’y a pas de guide. Bien sûr, il y a des partis politiques qui le conseillent, bien sûr il y a des notables avec qui il peut en parler, mais comment construit-il cette continuité ? C’est ça qui est compliqué, ce sont ces mécanismes qui intéressent le sociologue quand il peut y pénétrer. Le premier modèle explicatif de la culture, c’est ce marché des œuvres, des objets d’art, des qualifications professionnelles, qui est un marché toujours fragile, toujours remis en question selon les sinusoïdes de l’offre et de la demande. Ce soir j’avais fait une offre, par exemple : venir parler de la culture avec la star Yvon Lamy. Évidemment, j’ai beaucoup moins de succès que les bouddhistes là-bas et que les migrants en face, qui sont certainement plus importants que la culture. Donc il y a eu une offre, elle est pas mal, elle est honorable, mais la concurrence a fonctionné d’une manière différente. Nous sommes tous comme ça, dans des positions où l’offre doit recevoir une demande et la demande ne peut vivre que par rapport à une offre. Tout ça me rend extrêmement modeste, parce ces questions culturelles sont très complexes. Le monde de l’art Deuxième grand modèle explicatif, après le modèle du marché : le modèle du monde de l’art. J’en ai un peu parlé tout à l’heure avec l’exemple du film. Je disais qu’à la fin on voyait défiler un monde de l’art, c’est-à-dire ceux qui ont permis cette œuvre, ceux qui ont produit cette œuvre, y compris les conseils régionaux qui ont une politique cinématographique, puisqu’à la fin vous voyez apparaître « avec l’aide du Conseil régional du Limousin, avec l’aide du Conseil régional des Pays de la Loire… » Le monde de l’art, c’est une autre façon d’aborder la question de la culture en mettant en évidence les pratiques. On part des pratiques. Les gens se réunissent sur un projet : faire un film, faire une sculpture, faire un tableau, composer un opéra, et ce projet attire de manière inductive des experts. Par un système de sélection on choisit des experts. On choisit de scénaristes, des comédiens, on fait appel à des grands noms. Il y a même des films sur les films, des films qui montrent comment on fabrique des films et ils sont passionnants, car ce sont des films qui réfléchissent sur eux-mêmes, qui montrent comment se fabrique ce bien culturel qu’est le film. Quelles sont les notions importantes pour comprendre ce monde de l’art ? Les mots importants, c’est le mot de « coopération », c’est le mot « étiquetage », c’est le mot « réseau », c’est le mot « interaction », c’est le mot « négociation » et finalement le mot « convention ». C’est le monde du contrat, ce n’est pas le monde de la carrière et du calcul rationnel comme dans le marché des œuvres. C’est un monde où on se construit des réseaux, on s’intègre dans des réseaux et on passe des contrats. Il y a des contrats entre des acteurs qui par ce biais produisent des œuvres et des événements culturels. Aujourd’hui, la culture dans son ensemble est totalement bouleversée par le numérique ; eh bien, le numérique implique en permanence que le monde culturel soit un monde de réseau et ces réseaux sont interindividuels, alors que les réseaux dont je parle dans le monde de l’art, ce sont des réseaux collectifs, des collectifs qui se créent à partir de pratiques. En quoi le monde culturel est-il différent d’un monde social ? Il y a peu de différences entre un monde culturel (par exemple la fabrication d’un film) et un monde social (par exemple la vie associative). Prenez n’importe quelle association : c’est un monde social qui se crée sous vos yeux. Quels sont les ingrédients de ce monde social, comment peut-on le caractériser ? Il y a plusieurs éléments. Premier élément : il y a un univers du discours qui se crée, ces gens parlent la même langue. On le voit quand on fabrique un film : il y a un jargon du monde social en question, qui est caractéristique ; et ce jargon, ce discours différencie ce monde social d’un autre monde social. C’est assez évident : quand vous êtes dans une association de pêcheurs à la ligne, vous avez certains mots, certains stéréotypes, certains préjugés de langage qui sont très différents de ceux que vous employez dans la fabrication d’un film. Prenez le corps enseignant : quels sont les mots qui reviennent le plus souvent quand il est réuni pour un conseil de classe ? Vous avez des mots qui tournent autour de la figure de l’élève, le bon élève, le mauvais élève, etc. Mais vous n’avez jamais le clap de fin ! Donc vous avez des discours qui sont spécifiques à chaque monde social. C’est une caractéristique que l’on trouve dans tous les mondes sociaux et dans les mondes culturels. Ça me paraît très important de le noter, parce que dans une réunion de commerçants, par exemple, vous allez avoir un discours tout à fait différent de celui d’une réunion de directeurs d’usine. Deuxième élément : tout monde social et tout monde culturel est défini par une activité première, une activité fondatrice, par exemple danser, par exemple diriger un orchestre, diriger un centre culturel, faire de la musique collectivement. C’est une activité primaire qui définit le monde social en question. Le cercle Gramsci, c’est un petit monde social qui est un peu intermittent parce qu’il ne vit pas au jour le jour, mais il est défini par un échange de paroles, par le fait de parler de problèmes importants pour la société, ça pourrait se définir et s’affiner comme ça. La réflexion du cercle Gramsci sur lui-même est encore à faire. Qu’est-ce qu’il fait ? Pourquoi le fait-il ? Même son histoire est à faire. Donc, toute cette activité première renvoie à une histoire. Troisième point important de ce monde social : des technologies spécifiques, des techniques de production. Comment produit-on ? Avec quelles techniques ? Les technologies de la fabrication du film sont très différentes des technologies de la fabrication d’un opéra ou d’une scène chorégraphique. Ce qui est très intéressant, c’est que quand vous parlez de culture, vous parlez à la fois d’art, de pratiques artistiques, et de professions. Un quatrième élément qui fait du monde social un monde à part, c’est le fait qu’il occupe un site. Il y a des structures, des équipements, des lieux de réunion, qui participent à la construction d’un discours. La salle Blanqui est une salle fondamentale pour le cercle Gramsci mais aussi pour d’autres associations, parce que ça permet l’échange de paroles, et puis ça regroupe les gens. Donc les lieux comme ça ne sont pas des lieux neutres. J’ai toujours cru à l’importance de la matérialité dans la sociologie. Je pense que regarder comment un village est construit, regarder où les gens habitent, ça donne déjà une clé sur la société que ce village supporte, dont ce village est la base. Quand vous habitez le 16ème vous n’habitez pas le 19ème ; ce ne sont pas les mêmes populations. Quand vous habitez le Marais vous n’habitez pas la place d’Italie. Ce qui est très intéressant, c’est cette morphologie qui constitue le site et qui permet de voir sur quoi repose une société et plus particulièrement un monde social. De ce point de vue-là, les mondes culturels reposent sur des sites, sur des institutions, sur des équipements, sur des structures et sur des lieux. Si on n’avait pas de lieux on n’aurait pas de sites, si on n’avait pas de sites on n’aurait pas de paroles, et si on n’avait pas de paroles on ne produirait pas des biens culturels. L’idée du site au sens large du terme nous situe et nous donne une situation, nous donne la possibilité de faire ou de ne pas faire. Dernier point : le monde social suppose des organisations avec une division du travail plus ou moins raffinée, c’est-à-dire que les gens n’y font pas la même chose. C’est pourquoi j’aime les défilés à la fin des films, qui d’ailleurs changent d’un pays à un autre : on voit presque à la longueur du défilé si le film est subventionné, s’il est à grand spectacle, si c’est un film plutôt d’art et d’essai, si le film est fait avec de grands moyens ou non. Donc il y a une division du travail qui s’opère. Cette division est remise en cause presque à chaque fois. Elle est remise en cause pour chaque fabrication d’un bien culturel, elle est plus ou moins raffinée, il y a des emplois qui sont doubles, des emplois qui sont plus ou moins réactifs, il y en a au contraire qui sont très spécialisés. Voilà comment je décrirais la structure d’un monde social ; mais il y a une infinité de mondes sociaux, plus ou moins visibles, plus ou moins hiérarchisés, plus ou moins imperméables, plus ou moins hétérogènes : des associations, des administrations, des institutions, des services publics. Tout ça, ce sont des mondes sociaux, des associations en particulier. Chacun a sa dominante : politique, intellectuelle, religieuse, artistique, scientifique, récréative, de loisirs… On trouve des logiques sociales analogues dans tous ces mondes sociaux et dans chacun. Qu’est-ce qu’il faut faire quand on entre dans le monde social ? Comment y entre-t-on ? Quel est le droit à l’entrée ? Comment je peux entrer dans la Franc-maçonnerie ? Il me faut un parrain ; si je n’ai pas de parrain je n’entre pas. Comment j’entre dans un parti politique ? Il me faut un parrain. C’est la question du droit d’accès. Comment j’entre dans une entreprise ? Il me faut un diplôme, sinon je n’entre pas. Donc votre liberté de faire ou de ne pas faire est conditionnée par le type de posture que vous avez, le statut qui est le vôtre, le diplôme que vous avez ou que vous n’avez pas. Vous ne pouvez pas prétendre à ce que vous n’êtes pas. Moi je suis professeur à la retraite ; je ne peux absolument pas prétendre à être médecin. Je ne serai jamais médecin. Je peux le regretter, ça peut me faire de la peine, mais de fait je ne n’ai jamais rien fait pour l’être. Je ne pourrai jamais être prêtre, ni dans une église catholique, ni pasteur protestant. Très rapidement les postures que vous pouvez avoir sont liées à des compétences ou à des ressources, et ce sont ces ressources que vous faites valoir pour entrer dans un monde social. Dans un monde social, on n’entre pas n’importe comment, c’est impossible. Même pour être étudiant, il faut le bac, il faut payer des frais d’inscription… Deuxième point : s’y faire reconnaître. Comment je me fais reconnaître comme légitime ? J’avais toute légitimité à être à la Faculté des lettres et des sciences humaines, d’ailleurs j’y allais en sifflotant, ça ne faisait pas peur ; mais quand j’entre dans une salle d’attente de médecin, déjà, j’ai pris un rendez-vous ; si je n’avais pas pris rendez-vous je n’y entrerais pas. Le rendez-vous me donne un droit d’entrée, alors que je peux me balader à la Fac de lettres sans raison précise et personne n’est étonné de me voir : je peux m’y faire reconnaître. Donc c’est très important de se faire reconnaître. Troisièmement, Il faut que j’y défende mon poste, ma position. Si on me demande par exemple : « Monsieur, qu’est-ce que vous faites ici ? » – « Ah ! J’ai rendez-vous, je suis professeur ici et j’ai le droit de m’y promener ». Très rapidement vous pouvez vous trouver dans une position où on vous demande de vous défendre, de défendre votre position, votre légitimité. Autre logique que suit toute personne dans un monde social : elle essaie d’innover, d’apporter quelque chose, et puis elle entre en concurrence avec d’autres et elle coopère. Dans ma vie professionnelle, j’ai toujours vécu dans des mondes culturels où il y avait de très nombreuses disputes. Les gens se disputaient, étaient en tension, se haïssaient, se claquaient la porte au nez. Mais dans l’ensemble, l’institution continuait à fonctionner. Ça m’a toujours frappé. Finalement il y a une espèce d’entente, une coopération s’opère pour produire un bien culturel même si les gens ne sont pas d’accord, ne se supportent pas et se considèrent mal réciproquement. Voilà les logiques qui constituent le monde de l’art en question. Il y a un auteur américain, Howard Becker, sociologue dit « interactionniste », qui a appliqué ce schéma au monde qu’il a appelé « les mondes de l’art ». Il est convaincu que toute chose est le travail de quelqu’un… C’est une intuition formidable, ça ! Par conséquent l’art est une action collective d’un type tout à fait original. D’abord, les mondes de l’art sont symboliques : les acteurs travaillent à y produire du sens et pour eux le social donne le sens, l’interaction sociale dessine le sens. Par exemple un autre auteur beaucoup plus ancien, qui s’appelait Georges Villeneuve et était contemporain de Max Weber en Allemagne, disait que la société était constituée par l’emboîtement des associations d’individus, c’est-à-dire que la réunion de ce soir par exemple contribue à faire société. Si cette réunion avait été reportée, ça n’aurait pas fait chuter la société, mais on voit bien que les trois réunions qui se produisent ici contribuent chacune dans leur ordre extrêmement différent à faire société et à prolonger la société. Qu’est-ce que serait une société si nous étions enfermés dans nos familles, dans nos foyers ? Si nous ne pouvions jamais sortir de notre cuisine, de notre salle de séjour ? Sans cesse nous sommes attirés par une espèce de dialectique entre l’extérieur et l’intérieur. Nous sortons, nous rentrons en permanence. Le monde du négoce, le monde de l’associatif, le monde de la culture nous fait vivre sans cesse cette dialectique entre l’interne et l’externe. On produit du sens, le social donne le sens, l’interaction sociale dessine le sens et la société n’est pas vue d’en haut comme un ensemble qui nous surplombe, mais elle est constituée d’emboîtements d’associations, d’emboîtements de formes sociales différentes et de mondes sociaux différents. Deuxième point : les acteurs qui coopèrent produisent du sens, mais ils ont une finalité pratique. Les acteurs construisent des réseaux pour rendre efficaces leurs actions collectives. Il faut qu’à un moment donné on produise un film. Regardez comment on s’arrache les cheveux quand Monsieur Depardieu ne se lève pas assez tôt le matin ! On l’attend à 8 heures et il arrive à 11 heures ! Tout le monde attend que Monsieur Depardieu finisse par arriver. Il arrive à 11 heures ou 11 heures 30, il y a un petit moment de tension : « Qu’est-ce que tu fais ? On films qui réfléchissent sur eux-mêmes, qui montrent comment se fabrique ce bien culturel qu’est le film. Quelles sont les notions importantes pour comprendre ce monde de l’art ? Les mots importants, c’est le mot de « coopération », c’est le mot « étiquetage », c’est le mot « réseau », c’est le mot « interaction », c’est le mot « négociation » et finalement le mot « convention ». C’est le monde du contrat, ce n’est pas le monde de la carrière et du calcul rationnel comme dans le marché des œuvres. C’est un monde où on se construit des réseaux, on s’intègre dans des réseaux et on passe des contrats. Il y a des contrats entre des acteurs qui par ce biais produisent des œuvres et des événements culturels. Aujourd’hui, la culture dans son ensemble est totalement bouleversée par le numérique ; eh bien, le numérique implique en permanence que le monde culturel soit un monde de réseau et ces réseaux sont interindividuels, alors que les réseaux dont je parle dans le monde de l’art, ce sont des réseaux collectifs, des collectifs qui se créent à partir de pratiques. En quoi le monde culturel est-il différent d’un monde social ? Il y a peu de différences entre un monde culturel (par exemple la fabrication d’un film) et un monde social (par exemple la vie associative). Prenez n’importe quelle association : c’est un monde social qui se crée sous vos yeux. Quels sont les ingrédients de ce monde social, comment peut-on le caractériser ? Il y a plusieurs éléments. Premier élément : il y a un univers du discours qui se crée, ces gens parlent la même langue. On le voit quand on fabrique un film : il y a un jargon du monde social en question, qui est caractéristique ; et ce jargon, ce discours différencie ce monde social d’un autre monde social. C’est assez évident : quand vous êtes dans une association de pêcheurs à la ligne, vous avez certains mots, certains stéréotypes, certains préjugés de langage qui sont très différents de ceux que vous employez dans la fabrication d’un film. Prenez le corps enseignant : quels sont les mots qui reviennent le plus souvent quand il est réuni pour un conseil de classe ? Vous avez des mots qui tournent autour de la figure de l’élève, le bon élève, le mauvais élève, etc. Mais vous n’avez jamais le clap de fin ! Donc vous avez des discours qui sont spécifiques à chaque monde social. C’est une caractéristique que l’on trouve dans tous les mondes sociaux et dans les mondes culturels. Ça me paraît très important de le noter, parce que dans une réunion de commerçants, par exemple, vous allez avoir un discours tout à fait différent de celui d’une réunion de directeurs d’usine. Deuxième élément : tout monde social et tout monde culturel est défini par une activité première, une activité fondatrice, par exemple danser, par exemple diriger un orchestre, diriger un centre culturel, faire de la musique collectivement. C’est une activité primaire qui définit le monde social en question. Le cercle Gramsci, c’est un petit monde social qui est un peu intermittent parce qu’il ne vit pas au jour le jour, mais il est défini par un échange de paroles, par le fait de parler de problèmes importants pour la société, ça pourrait se définir et s’affiner comme ça. La réflexion du cercle Gramsci sur lui-même est encore à faire. Qu’est-ce qu’il fait ? Pourquoi le fait-il ? Même son histoire est à faire. Donc, toute cette activité première renvoie à une histoire. Troisième point important de ce monde social : des technologies spécifiques, des techniques de production. Comment produit-on ? Avec quelles techniques ? Les technologies de la fabrication du film sont très différentes des technologies de la fabrication d’un opéra ou d’une scène chorégraphique. Ce qui est très intéressant, c’est que quand vous parlez de culture, vous parlez à la fois d’art, de pratiques artistiques, et de professions. Un quatrième élément qui fait du monde social un monde à part, c’est le fait qu’il occupe un site. Il y a des structures, des équipements, des lieux de réunion, qui participent à la construction d’un discours. La salle Blanqui est une salle fondamentale pour le cercle Gramsci mais aussi pour d’autres associations, parce que ça permet l’échange de paroles, et puis ça regroupe les gens. Donc les lieux comme ça ne sont pas des lieux neutres. J’ai toujours cru à l’importance de la matérialité dans la sociologie. Je pense que regarder comment un village est construit, regarder où les gens habitent, ça donne déjà une clé sur la société que ce village supporte, dont ce village est la base. Quand vous habitez le 16ème vous n’habitez pas le 19ème ; ce ne sont pas les mêmes populations. Quand vous habitez le Marais vous n’habitez pas la place d’Italie. Ce qui est très intéressant, c’est cette morphologie qui constitue le site et qui permet de voir sur quoi repose une société et plus particulièrement un monde social. De ce point de vue-là, les mondes culturels reposent sur des sites, sur des institutions, sur des équipements, sur des structures et sur des lieux. Si on n’avait pas de lieux on n’aurait pas de sites, si on n’avait pas de sites on n’aurait pas de paroles, et si on n’avait pas de paroles on ne produirait pas des biens culturels. L’idée du site au sens large du terme nous situe et nous donne une situation, nous donne la possibilité de faire ou de ne pas faire. Dernier point : le monde social suppose des organisations avec une division du travail plus ou moins raffinée, c’est-à-dire que les gens n’y font pas la même chose. C’est pourquoi j’aime les défilés à la fin des films, qui d’ailleurs changent d’un pays à un autre : on voit presque à la longueur du défilé si le film est subventionné, s’il est à grand spectacle, si c’est un film plutôt d’art et d’essai, si le film est fait avec de grands moyens ou non. Donc il y a une division du travail qui s’opère. Cette division est remise en cause presque à chaque fois. Elle est remise en cause pour chaque fabrication d’un bien culturel, elle est plus ou moins raffinée, il y a des emplois qui sont doubles, des emplois qui sont plus ou moins réactifs, il y en a au contraire qui sont très spécialisés. Voilà comment je décrirais la structure d’un monde social ; mais il y a une infinité de mondes sociaux, plus ou moins visibles, plus ou moins hiérarchisés, plus ou moins imperméables, plus ou moins hétérogènes : des associations, des administrations, des institutions, des services publics. Tout ça, ce sont des mondes sociaux, des associations en particulier. Chacun a sa dominante : politique, intellectuelle, religieuse, artistique, scientifique, récréative, de loisirs… On trouve des logiques sociales analogues dans tous ces mondes sociaux et dans chacun. Qu’est-ce qu’il faut faire quand on entre dans le monde social ? Comment y entre-t-on ? Quel est le droit à l’entrée ? Comment je peux entrer dans la Franc-maçonnerie ? Il me faut un parrain ; si je n’ai pas de parrain je n’entre pas. Comment j’entre dans un parti politique ? Il me faut un parrain. C’est la question du droit d’accès. Comment j’entre dans une entreprise ? Il me faut un diplôme, sinon je n’entre pas. Donc votre liberté de faire ou de ne pas faire est conditionnée par le type de posture que vous avez, le statut qui est le vôtre, le diplôme que vous avez ou que vous n’avez pas. Vous ne pouvez pas prétendre à ce que vous n’êtes pas. Moi je suis professeur à la retraite ; je ne peux absolument pas prétendre à être médecin. Je ne serai jamais médecin. Je peux le regretter, ça peut me faire de la peine, mais de fait je ne n’ai jamais rien fait pour l’être. Je ne pourrai jamais être prêtre, ni dans une église catholique, ni pasteur protestant. Très rapidement les postures que vous pouvez avoir sont liées à des compétences ou à des ressources, et ce sont ces ressources que vous faites valoir pour entrer dans un monde social. Dans un monde social, on n’entre pas n’importe comment, c’est impossible. Même pour être étudiant, il faut le bac, il faut payer des frais d’inscription… Deuxième point : s’y faire reconnaître. Comment je me fais reconnaître comme légitime ? J’avais toute légitimité à être à la Faculté des lettres et des sciences humaines, d’ailleurs j’y allais en sifflotant, ça ne faisait pas peur ; mais quand j’entre dans une salle d’attente de médecin, déjà, j’ai pris un rendez-vous ; si je n’avais pas pris rendez-vous je n’y entrerais pas. Le rendez-vous me donne un droit d’entrée, alors que je peux me balader à la Fac de lettres sans raison précise et personne n’est étonné de me voir : je peux m’y faire reconnaître. Donc c’est très important de se faire reconnaître. Troisièmement, Il faut que j’y défende mon poste, ma position. Si on me demande par exemple : « Monsieur, qu’est-ce que vous faites ici ? » – « Ah ! J’ai rendez-vous, je suis professeur ici et j’ai le droit de m’y promener ». Très rapidement vous pouvez vous trouver dans une position où on vous demande de vous défendre, de défendre votre position, votre légitimité. Autre logique que suit toute personne dans un monde social : elle essaie d’innover, d’apporter quelque chose, et puis elle entre en concurrence avec d’autres et elle coopère. Dans ma vie professionnelle, j’ai toujours vécu dans des mondes culturels où il y avait de très nombreuses disputes. Les gens se disputaient, étaient en tension, se haïssaient, se claquaient la porte au nez. Mais dans l’ensemble, l’institution continuait à fonctionner. Ça m’a toujours frappé. Finalement il y a une espèce d’entente, une coopération s’opère pour produire un bien culturel même si les gens ne sont pas d’accord, ne se supportent pas et se considèrent mal réciproquement. Voilà les logiques qui constituent le monde de l’art en question. Il y a un auteur américain, Howard Becker, sociologue dit « interactionniste », qui a appliqué ce schéma au monde qu’il a appelé « les mondes de l’art ». Il est convaincu que toute chose est
le travail de quelqu’un… C’est une intuition formidable, ça ! Par conséquent l’art est une action collective d’un type tout à fait original. D’abord, les mondes de l’art sont symboliques : les acteurs travaillent à y produire du sens et pour eux le social donne le sens, l’interaction sociale dessine le sens. Par exemple un autre auteur beaucoup plus ancien, qui s’appelait Georges Villeneuve et était contemporain de Max Weber en Allemagne, disait que la société était constituée par l’emboîtement des associations d’individus, c’est-à-dire que la réunion de ce soir par exemple contribue à faire société. Si cette réunion avait été reportée, ça n’aurait pas fait chuter la société, mais on voit bien que les trois réunions qui se produisent ici contribuent chacune dans leur ordre extrêmement différent à faire société et à prolonger la société. Qu’est-ce que serait une société si nous étions enfermés dans nos familles, dans nos foyers ? Si nous ne pouvions jamais sortir de notre cuisine, de notre salle de séjour ? Sans cesse nous sommes attirés par une espèce de dialectique entre l’extérieur et l’intérieur. Nous sortons, nous rentrons en permanence. Le monde du négoce, le monde de l’associatif, le monde de la culture nous fait vivre sans cesse cette dialectique entre l’interne et l’externe. On produit du sens, le social donne le sens, l’interaction sociale dessine le sens et la société n’est pas vue d’en haut comme un ensemble qui nous surplombe, mais elle est constituée d’emboîtements d’associations, d’emboîtements de formes sociales différentes et de mondes sociaux différents. Deuxième point : les acteurs qui coopèrent produisent du sens, mais ils ont une finalité pratique. Les acteurs construisent des réseaux pour rendre efficaces leurs actions collectives. Il faut qu’à un moment donné on produise un film. Regardez comment on s’arrache les cheveux quand Monsieur Depardieu ne se lève pas assez tôt le matin ! On l’attend à 8 heures et il arrive à 11 heures ! Tout le monde attend que Monsieur Depardieu finisse par arriver. Il arrive à 11 heures ou 11 heures 30, il y a un petit moment de tension : « Qu’est-ce que tu fais ? On t’attend ! » Tout le monde râle, il y a des gens qui sont partis boire un café, etc. Il faut bien que l’on soit efficace et pour être efficace, il faut qu’à un moment donné tout le monde joue le jeu, même quand on n’est pas d’accord, même quand on est une star. La star elle aussi doit jouer le jeu, la star doit être à l’heure, il faut qu’elle soit correcte et si elle n’est pas correcte on le lui fait savoir et ses commandes risquent de diminuer. Il faut que l’on soit efficace et on pense que l’action collective est d’autant plus importante qu’elle est efficace. Elle est efficace parce qu’elle est collective. La force de ce deuxième modèle culturel, c’est que c’est le collectif qui fait l’efficacité. Quelquefois c’est « Marche ou crève » ; les 35 heures, ça n’existe pas dans la fabrication d’un film, alors que faire avec la loi ? Voilà la question qu’a posée tout de suite Pierre Bourdieu : « Mais que font-ils pour travailler ensemble sans trop de conflits et avec efficacité ? » Question que je posais tout à l’heure : un monde de l’art se présente comme un réseau de coopération qui relie les participants selon un ordre établi, mais en faisant cela on bénéficie des ressources acquises par tous, on gagne en réputation par exemple. Le fait d’avoir travaillé avec Depardieu finit par rejaillir sur vous, le fait de mettre Depardieu dans un film donne de la notoriété au film. On y va parce que c’est Depardieu qui joue dans le film plus que pour le sujet du film, donc il y a des phénomènes de transfert et des phénomènes de mimétisme qui s’opèrent et qui permettent de créer des réputations. En faisant cela, on fait vivre le modèle en question et on fait vivre le monde de l’art en question. Bourdieu critiquera ce modèle, parce que ce modèle ne replace pas les interactions qui se créent dans ce monde dans l’espace des luttes et des rapports de force objectifs. Il dit que c’est un modèle qui élimine l’idée d’une classe en conflit, d’emplois en conflit et donc à travers ça, on n’a que la superficie des choses, on ne voit pas ce qui se trame dans la structure de la société. Le champ culturel Le troisième modèle explicatif de la culture, que j’appelle « le champ culturel » en reprenant le terme de Bourdieu, est fondé sur la critique des deux précédents, c’est-à-dire la critique du marché des œuvres et la critique (pour insuffisance) du monde de l’art. Le travail de Bourdieu fait du champ culturel un outil critique. Il dit que l’on ne peut pas être un sociologue sans être un sociologue critique. Il réfléchit sur sa propre pratique de sociologue et sur la valeur des objets qu’il étudie. Premier point : cette idée que la culture est un champ, la religion est un champ, l’école est un champ, l’université est un champ culturel, espace social (parfois on emploie le terme « espace »), nous conduit à la première caractéristique de ce champ. La notion de champ permet de dévoiler ce qui se joue socialement entre les producteurs, la structure des œuvres, et les catégories sociales des publics. Je vais reprendre ces trois points. D’abord du côté des producteurs : les producteurs, ce sont des artistes, des gestionnaires, des conservateurs, des directeurs de galeries, des critiques, des mécènes. Les critiques produisent de l’art, les mécènes promeuvent une image d’un film ou l’image d’une œuvre. Donc, qu’est-ce qui se joue entre ces producteurs d’un côté, et de l’autre la structure des œuvres dont ils parlent, leur genre, leur style, leur degré d’innovation, leur renommée, et puis du côté de la demande les catégories sociales du public, les récepteurs ? Comment ces trois groupes se classent-ils entre eux et à l’égard des œuvres ? Qu’est-ce qui se joue dans cette tripolarité ? D’un côté les producteurs, de l’autre les œuvres et enfin le public ? Dans cette triangulation, c’est là que se crée le champ culturel dont parle Bourdieu. Il y a un deuxième point important, c’est que les producteurs de biens et d’œuvres, c’est-à-dire les artistes, les gestionnaires, les conservateurs, les directeurs de galeries, les élus régionaux, municipaux chargés de la culture ; tous ces producteurs d’œuvres sont aussi producteurs de croyances. Ils produisent des croyances en l’œuvre d’art et ils n’existent que parce qu’ils produisent des croyances. Ils n’existent que parce que des croyances en face d’eux les assurent de la légitimité de leur propre croyance. La notion de croyance est très importante chez Bourdieu : vous pouvez l’appliquer en permanence à toutes sortes de réunions. Vous ne venez ici que parce que vous croyez en la culture et en ma capacité à vous en parler. Nous sommes tous des croyants, des croyants non religieux, car ça n’a rien à voir avec la religion. La croyance religieuse a une spécificité tout à fait à part. Comment produire la croyance en une œuvre d’art ? Comment produire la croyance en un personnage central comme un comédien du type de Depardieu ? La croyance est tout à fait importante, et Bourdieu ajoute que les producteurs de croyance sont eux-mêmes en lutte pour des positions sociales dans leur propre domaine. Ils ne sont pas là seulement côte à côte, ils sont en lutte pour se faire reconnaître, pour être sur le devant de la scène, pour obtenir une renommée. Du côté du public, il y a aussi un autre problème qui se pose, toujours dans la question de ce champ culturel : les publics n’accèdent à l’art que s’ils sont dotés de certaines dispositions. Les dispositions qui leur permettent de comprendre, de décoder le sens d’une œuvre, d’en saisir la signification. Bourdieu reprend ici un terme utilisé au moyen-âge, celui d’« habitus ». Il faut avoir un habitus nous permettant de comprendre précisément le film que nous allons voir, d’en saisir le sens, de voir quels effets ce film peut avoir sur notre propre vie, quels effets nous pouvons en tirer pour nos relations sociales au quotidien, etc. D’une certaine manière, cet habitus nous dispose à mieux comprendre. Comment l’acquiert-on, cet habitus ? On l’acquiert par le milieu, ou bien on se le forge par l’école. Mais ces habitus sont différenciateurs, distinctifs, ce sont des dispositions que l’on pourrait appeler des jugements de goût. Il y a des choses qui nous plaisent et des choses qui nous déplaisent. Chaque fois qu’il y a du goût, il y a du dégoût y compris en matière culturelle. Regardez la manière dont, face à certaines expositions d’art contemporain, les gens réagissent avec dégoût ou mépris en disant « Ça, je peux en faire autant ». Ce qu’ils ne disent pas face à un autoportrait de Rembrandt. Le problème est donc de savoir comment on décode une œuvre, comment on lui donne une signification et quels sont les effets qu’on va en tirer. Quels sont les usages sociaux qu’on va en tirer ? Le champ culturel est un monde social en mouvement, en tension permanente sous tous ces aspects et c’est la position particulière de Bourdieu. Regardez par exemple comment les intermittents du spectacle techniciens se pensent par rapport aux intermittents du spectacle artistes. Il y a une dichotomie, une polarité qu’il faut étudier dans le monde de l’intermittence. Les gens qui règlent les projecteurs par exemple, ceux qui font les balances sont des intermittents du spectacle. Comment sont-ils regardés par les artistes ? Comment eux-mêmes regardent-ils les artistes ? Ils peuvent se dire : « Si je ne fais pas une bonne balance, l’artiste ne passera pas et le spectacle sera profondément décevant ». Ce rapport entre techniciens et artistes est analogue à la tension qu’il peut y avoir entre le monde ouvrier et le monde de la direction, ou patronal, et pourtant on les coiffe d’un même mot : intermittents du spectacle. En cela, le champ social culturel ressemble à d’autres champs sociaux : à celui de l’école, à celui du religieux, à celui de la santé, au littéraire, au politique ; ce que Bourdieu appelle les homologies culturales rend possible les analogies entre champs différents. Qu’est-ce que c’est, l’analogie ? Je donne un exemple très simple : « Vous prenez votre corps et vous dites que le bras est à la main ce que la jambe est au pied, mais jamais vous ne dites que la main c’est le pied, ou jamais vous ne dites que le bras c’est la jambe ». Vous faites une analogie entre des mondes différents et vous vous apercevez que ces mondes fonctionnent de la même façon, d’une manière analogique. Un monde de l’analogie rapproche, compare, mais jamais ne nie. Par exemple, l’hérésie religieuse, le moment ou Luther dit qu’il ne veut plus être catholique, ce n’est pas purement et simplement une négation de l’orthodoxie ; la gauche ne nie pas la droite ; la droite ne nie pas la gauche. En fait, ce sont des mondes qui fonctionnent d’une manière très parallèle. La droite permet à la gauche d’exister, et inversement, et l’hérésie permet à l’orthodoxie d’exister. L’orthodoxie secrète l’hérésie et l’hérésie conforte l’orthodoxie dans son orthodoxie. C’est parce qu’il y a des hérétiques que les orthodoxes peuvent dire : « C’est nous qui avons la vérité ». Mais les hérétiques disent : « Vous vous trompez, c’est nous qui sommes l’avant-garde de la vérité ». C’est vrai dans toutes sortes de mondes. Les mondes sociaux se comprennent à partir de toutes sortes d’analogies qui les rapprochent, qui nous les rendent familiers, fonctionnels. Les mondes ne sont pas aussi différents que cela. On peut se les représenter d’une manière quotidienne. Je pense qu’il y a des rapprochements très intéressants. Je montre toujours deux rapports comparables : l’un nous fait comprendre la structure et le fonctionnement de l’autre et l’autre nous fait comprendre la structure et le fonctionnement de l’un. La droite nous fait comprendre le fonctionnement de la gauche et vice versa. Exactement comme avec les primaires : les discours et les personnes sont différentes, mais structurellement ce sont deux choses qui vont fonctionner en parallèle. Et l’un n’existe que par l’autre. En fait, les champs culturels sont relatifs et n’existent que les uns par rapport aux autres. Et ce n’est pas la peine de se lancer des vilenies sur le plan idéologique. L’idéologie fonctionne comme cela. Enfin, le champ culturel est fondamentalement symbolique. Les biens culturels sont des biens symboliques. Dans cette notion entrent celle de valeur et celle de prix : si le bien culturel est un bien symbolique c’est qu’il a une valeur et un prix. Mais en même temps il a une valeur esthétique, il a une renommée en la personne de son créateur, en la personne de celui qui porte ce bien en question. Le séjour de Bourdieu en Algérie a été déterminant pour comprendre la dimension de la valeur symbolique. C’est à partir de l’étude qu’il a faite sur la société kabyle, qu’on comprend la dimension de la valeur symbolique qu’il donne aux choses et en particulier aux biens culturels. Il y a décrit des structures pré-capitalistes. A l’époque il est enseignant à l’université d’Alger. Il parcourt avec Abdelmalek Sayad le bled et la Kabylie, où il assiste à des marchés, et il observe de manière ethnographique ce qu’il voit. Il décrit des structures agricoles et villageoises pré-capitalistes, où les échanges de biens particuliers portent sur des valeurs symboliques. Par exemple on y échange le sens de l’honneur, du prestige, du défi, de la riposte. Certains mots sont considérés comme des défis. On est totalement étranger au monde économique du donnant-donnant : je paie, je reçois. Non. Les mots y ont une importance considérable, et c’est ça qui donne toute sa force symbolique aux échanges. Il va assimiler à cette époque-là les pièces symboliques pré-capitalistes aux biens culturels. Pour lui le monde culturel, artistique, est un monde économique à l’envers. A l’envers, parce que le calcul rationnel est toujours relativement dénigré. Vous ne trouverez pas un artiste qui va vous dire : « Mon œuvre vaut tant ». Je suis un créateur, je ne suis pas dans l’horizon marchand. Je me situe ailleurs. Et ça, on le voit jusque dans la façon dont les intermittents du spectacle vivent leur précarité. Il y en a qui ne gagnent même pas le SMIC et qui sont quand même très fiers d’être intermittents du spectacle films qui réfléchissent sur eux-mêmes, qui montrent comment se fabrique ce bien culturel qu’est le film. Quelles sont les notions importantes pour comprendre ce monde de l’art ? Les mots importants, c’est le mot de « coopération », c’est le mot « étiquetage », c’est le mot « réseau », c’est le mot « interaction », c’est le mot « négociation » et finalement le mot « convention ». C’est le monde du contrat, ce n’est pas le monde de la carrière et du calcul rationnel comme dans le marché des œuvres. C’est un monde où on se construit des réseaux, on s’intègre dans des réseaux et on passe des contrats. Il y a des contrats entre des acteurs qui par ce biais produisent des œuvres et des événements culturels. Aujourd’hui, la culture dans son ensemble est totalement bouleversée par le numérique ; eh bien, le numérique implique en permanence que le monde culturel soit un monde de réseau et ces réseaux sont interindividuels, alors que les réseaux dont je parle dans le monde de l’art, ce sont des réseaux collectifs, des collectifs qui se créent à partir de pratiques. En quoi le monde culturel est-il différent d’un monde social ? Il y a peu de différences entre un monde culturel (par exemple la fabrication d’un film) et un monde social (par exemple la vie associative). Prenez n’importe quelle association : c’est un monde social qui se crée sous vos yeux. Quels sont les ingrédients de ce monde social, comment peut-on le caractériser ? Il y a plusieurs éléments. Premier élément : il y a un univers du discours qui se crée, ces gens parlent la même langue. On le voit quand on fabrique un film : il y a un jargon du monde social en question, qui est caractéristique ; et ce jargon, ce discours différencie ce monde social d’un autre monde social. C’est assez évident : quand vous êtes dans une association de pêcheurs à la ligne, vous avez certains mots, certains stéréotypes, certains préjugés de langage qui sont très différents de ceux que vous employez dans la fabrication d’un film. Prenez le corps enseignant : quels sont les mots qui reviennent le plus souvent quand il est réuni pour un conseil de classe ? Vous avez des mots qui tournent autour de la figure de l’élève, le bon élève, le mauvais élève, etc. Mais vous n’avez jamais le clap de fin ! Donc vous avez des discours qui sont spécifiques à chaque monde social. C’est une caractéristique que l’on trouve dans tous les mondes sociaux et dans les mondes culturels. Ça me paraît très important de le noter, parce que dans une réunion de commerçants, par exemple, vous allez avoir un discours tout à fait différent de celui d’une réunion de directeurs d’usine. Deuxième élément : tout monde social et tout monde culturel est défini par une activité première, une activité fondatrice, par exemple danser, par exemple diriger un orchestre, diriger un centre culturel, faire de la musique collectivement. C’est une activité primaire qui définit le monde social en question. Le cercle Gramsci, c’est un petit monde social qui est un peu intermittent parce qu’il ne vit pas au jour le jour, mais il est défini par un échange de paroles, par le fait de parler de problèmes importants pour la société, ça pourrait se définir et s’affiner comme ça. La réflexion du cercle Gramsci sur lui-même est encore à faire. Qu’est-ce qu’il fait ? Pourquoi le fait-il ? Même son histoire est à faire. Donc, toute cette activité première renvoie à une histoire. Troisième point important de ce monde social : des technologies spécifiques, des techniques de production. Comment produit-on ? Avec quelles techniques ? Les technologies de la fabrication du film sont très différentes des technologies de la fabrication d’un opéra ou d’une scène chorégraphique. Ce qui est très intéressant, c’est que quand vous parlez de culture, vous parlez à la fois d’art, de pratiques artistiques, et de professions. Un quatrième élément qui fait du monde social un monde à part, c’est le fait qu’il occupe un site. Il y a des structures, des équipements, des lieux de réunion, qui participent à la construction d’un discours. La salle Blanqui est une salle fondamentale pour le cercle Gramsci mais aussi pour d’autres associations, parce que ça permet l’échange de paroles, et puis ça regroupe les gens. Donc les lieux comme ça ne sont pas des lieux neutres. J’ai toujours cru à l’importance de la matérialité dans la sociologie. Je pense que regarder comment un village est construit, regarder où les gens habitent, ça donne déjà une clé sur la société que ce village supporte, dont ce village est la base. Quand vous habitez le 16ème vous n’habitez pas le 19ème ; ce ne sont pas les mêmes populations. Quand vous habitez le Marais vous n’habitez pas la place d’Italie. Ce qui est très intéressant, c’est cette morphologie qui constitue le site et qui permet de voir sur quoi repose une société et plus particulièrement un monde social. De ce point de vue-là, les mondes culturels reposent sur des sites, sur des institutions, sur des équipements, sur des structures et sur des lieux. Si on n’avait pas de lieux on n’aurait pas de sites, si on n’avait pas de sites on n’aurait pas de paroles, et si on n’avait pas de paroles on ne produirait pas des biens culturels. L’idée du site au sens large du terme nous situe et nous donne une situation, nous donne la possibilité de faire ou de ne pas faire. Dernier point : le monde social suppose des organisations avec une division du travail plus ou moins raffinée, c’est-à-dire que les gens n’y font pas la même chose. C’est pourquoi j’aime les défilés à la fin des films, qui d’ailleurs changent d’un pays à un autre : on voit presque à la longueur du défilé si le film est subventionné, s’il est à grand spectacle, si c’est un film plutôt d’art et d’essai, si le film est fait avec de grands moyens ou non. Donc il y a une division du travail qui s’opère. Cette division est remise en cause presque à chaque fois. Elle est remise en cause pour chaque fabrication d’un bien culturel, elle est plus ou moins raffinée, il y a des emplois qui sont doubles, des emplois qui sont plus ou moins réactifs, il y en a au contraire qui sont très spécialisés. Voilà comment je décrirais la structure d’un monde social ; mais il y a une infinité de mondes sociaux, plus ou moins visibles, plus ou moins hiérarchisés, plus ou moins imperméables, plus ou moins hétérogènes : des associations, des administrations, des institutions, des services publics. Tout ça, ce sont des mondes sociaux, des associations en particulier. Chacun a sa dominante : politique, intellectuelle, religieuse, artistique, scientifique, récréative, de loisirs… On trouve des logiques sociales analogues dans tous ces mondes sociaux et dans chacun. Qu’est-ce qu’il faut faire quand on entre dans le monde social ? Comment y entre-t-on ? Quel est le droit à l’entrée ? Comment je peux entrer dans la Franc-maçonnerie ? Il me faut un parrain ; si je n’ai pas de parrain je n’entre pas. Comment j’entre dans un parti politique ? Il me faut un parrain. C’est la question du droit d’accès. Comment j’entre dans une entreprise ? Il me faut un diplôme, sinon je n’entre pas. Donc votre liberté de faire ou de ne pas faire est conditionnée par le type de posture que vous avez, le statut qui est le vôtre, le diplôme que vous avez ou que vous n’avez pas. Vous ne pouvez pas prétendre à ce que vous n’êtes pas. Moi je suis professeur à la retraite ; je ne peux absolument pas prétendre à être médecin. Je ne serai jamais médecin. Je peux le regretter, ça peut me faire de la peine, mais de fait je ne n’ai jamais rien fait pour l’être. Je ne pourrai jamais être prêtre, ni dans une église catholique, ni pasteur protestant. Très rapidement les postures que vous pouvez avoir sont liées à des compétences ou à des ressources, et ce sont ces ressources que vous faites valoir pour entrer dans un monde social. Dans un monde social, on n’entre pas n’importe comment, c’est impossible. Même pour être étudiant, il faut le bac, il faut payer des frais d’inscription… Deuxième point : s’y faire reconnaître. Comment je me fais reconnaître comme légitime ? J’avais toute légitimité à être à la Faculté des lettres et des sciences humaines, d’ailleurs j’y allais en sifflotant, ça ne faisait pas peur ; mais quand j’entre dans une salle d’attente de médecin, déjà, j’ai pris un rendez-vous ; si je n’avais pas pris rendez-vous je n’y entrerais pas. Le rendez-vous me donne un droit d’entrée, alors que je peux me balader à la Fac de lettres sans raison précise et personne n’est étonné de me voir : je peux m’y faire reconnaître. Donc c’est très important de se faire reconnaître. Troisièmement, Il faut que j’y défende mon poste, ma position. Si on me demande par exemple : « Monsieur, qu’est-ce que vous faites ici ? » – « Ah ! J’ai rendez-vous, je suis professeur ici et j’ai le droit de m’y promener ». Très rapidement vous pouvez vous trouver dans une position où on vous demande de vous défendre, de défendre votre position, votre légitimité. Autre logique que suit toute personne dans un monde social : elle essaie d’innover, d’apporter quelque chose, et puis elle entre en concurrence avec d’autres et elle coopère. Dans ma vie professionnelle, j’ai toujours vécu dans des mondes culturels où il y avait de très nombreuses disputes. Les gens se disputaient, étaient en tension, se haïssaient, se claquaient la porte au nez. Mais dans l’ensemble, l’institution continuait à fonctionner. Ça m’a toujours frappé. Finalement il y a une espèce d’entente, une coopération s’opère pour produire un bien culturel même si les gens ne sont pas d’accord, ne se supportent pas et se considèrent mal réciproquement. Voilà les logiques qui constituent le monde de l’art en question. Il y a un auteur américain, Howard Becker, sociologue dit « interactionniste », qui a appliqué ce schéma au monde qu’il a appelé « les mondes de l’art ». Il est convaincu que toute chose est
le travail de quelqu’un… C’est une intuition formidable, ça ! Par conséquent l’art est une action collective d’un type tout à fait original. D’abord, les mondes de l’art sont symboliques : les acteurs travaillent à y produire du sens et pour eux le social donne le sens, l’interaction sociale dessine le sens. Par exemple un autre auteur beaucoup plus ancien, qui s’appelait Georges Villeneuve et était contemporain de Max Weber en Allemagne, disait que la société était constituée par l’emboîtement des associations d’individus, c’est-à-dire que la réunion de ce soir par exemple contribue à faire société. Si cette réunion avait été reportée, ça n’aurait pas fait chuter la société, mais on voit bien que les trois réunions qui se produisent ici contribuent chacune dans leur ordre extrêmement différent à faire société et à prolonger la société. Qu’est-ce que serait une société si nous étions enfermés dans nos familles, dans nos foyers ? Si nous ne pouvions jamais sortir de notre cuisine, de notre salle de séjour ? Sans cesse nous sommes attirés par une espèce de dialectique entre l’extérieur et l’intérieur. Nous sortons, nous rentrons en permanence. Le monde du négoce, le monde de l’associatif, le monde de la culture nous fait vivre sans cesse cette dialectique entre l’interne et l’externe. On produit du sens, le social donne le sens, l’interaction sociale dessine le sens et la société n’est pas vue d’en haut comme un ensemble qui nous surplombe, mais elle est constituée d’emboîtements d’associations, d’emboîtements de formes sociales différentes et de mondes sociaux différents. Deuxième point : les acteurs qui coopèrent produisent du sens, mais ils ont une finalité pratique. Les acteurs construisent des réseaux pour rendre efficaces leurs actions collectives. Il faut qu’à un moment donné on produise un film. Regardez comment on s’arrache les cheveux quand Monsieur Depardieu ne se lève pas assez tôt le matin ! On l’attend à 8 heures et il arrive à 11 heures ! Tout le monde attend que Monsieur Depardieu finisse par arriver. Il arrive à 11 heures ou 11 heures 30, il y a un petit moment de tension : « Qu’est-ce que tu fais ? On t’attend ! » Tout le monde râle, il y a des gens qui sont partis boire un café, etc. Il faut bien que l’on soit efficace et pour être efficace, il faut qu’à un moment donné tout le monde joue le jeu, même quand on n’est pas d’accord, même quand on est une star. La star elle aussi doit jouer le jeu, la star doit être à l’heure, il faut qu’elle soit correcte et si elle n’est pas correcte on le lui fait savoir et ses commandes risquent de diminuer. Il faut que l’on soit efficace et on pense que l’action collective est d’autant plus importante qu’elle est efficace. Elle est efficace parce qu’elle est collective. La force de ce deuxième modèle culturel, c’est que c’est le collectif qui fait l’efficacité. Quelquefois c’est « Marche ou crève » ; les 35 heures, ça n’existe pas dans la fabrication d’un film, alors que faire avec la loi ? Voilà la question qu’a posée tout de suite Pierre Bourdieu : « Mais que font-ils pour travailler ensemble sans trop de conflits et avec efficacité ? » Question que je posais tout à l’heure : un monde de l’art se présente comme un réseau de coopération qui relie les participants selon un ordre établi, mais en faisant cela on bénéficie des ressources acquises par tous, on gagne en réputation par exemple. Le fait d’avoir travaillé avec Depardieu finit par rejaillir sur vous, le fait de mettre Depardieu dans un film donne de la notoriété au film. On y va parce que c’est Depardieu qui joue dans le film plus que pour le sujet du film, donc il y a des phénomènes de transfert et des phénomènes de mimétisme qui s’opèrent et qui permettent de créer des réputations. En faisant cela, on fait vivre le modèle en question et on fait vivre le monde de l’art en question. Bourdieu critiquera ce modèle, parce que ce modèle ne replace pas les interactions qui se créent dans ce monde dans l’espace des luttes et des rapports de force objectifs. Il dit que c’est un modèle qui élimine l’idée d’une classe en conflit, d’emplois en conflit et donc à travers ça, on n’a que la superficie des choses, on ne voit pas ce qui se trame dans la structure de la société. Le champ culturel Le troisième modèle explicatif de la culture, que j’appelle « le champ culturel » en reprenant le terme de Bourdieu, est fondé sur la critique des deux précédents, c’est-à-dire la critique du marché des œuvres et la critique (pour insuffisance) du monde de l’art. Le travail de Bourdieu fait du champ culturel un outil critique. Il dit que l’on ne peut pas être un sociologue sans être un sociologue critique. Il réfléchit sur sa propre pratique de sociologue et sur la valeur des objets qu’il étudie. Premier point : cette idée que la culture est un champ, la religion est un champ, l’école est un champ, l’université est un champ culturel, espace social (parfois on emploie le terme « espace »), nous conduit à la première caractéristique de ce champ. La notion de champ permet de dévoiler ce qui se joue socialement entre les producteurs, la structure des œuvres, et les catégories sociales des publics. Je vais reprendre ces trois points. D’abord du côté des producteurs : les producteurs, ce sont des artistes, des gestionnaires, des conservateurs, des directeurs de galeries, des critiques, des mécènes. Les critiques produisent de l’art, les mécènes promeuvent une image d’un film ou l’image d’une œuvre. Donc, qu’est-ce qui se joue entre ces producteurs d’un côté, et de l’autre la structure des œuvres dont ils parlent, leur genre, leur style, leur degré d’innovation, leur renommée, et puis du côté de la demande les catégories sociales du public, les récepteurs ? Comment ces trois groupes se classent-ils entre eux et à l’égard des œuvres ? Qu’est-ce qui se joue dans cette tripolarité ? D’un côté les producteurs, de l’autre les œuvres et enfin le public ? Dans cette triangulation, c’est là que se crée le champ culturel dont parle Bourdieu. Il y a un deuxième point important, c’est que les producteurs de biens et d’œuvres, c’est-à-dire les artistes, les gestionnaires, les conservateurs, les directeurs de galeries, les élus régionaux, municipaux chargés de la culture ; tous ces producteurs d’œuvres sont aussi producteurs de croyances. Ils produisent des croyances en l’œuvre d’art et ils n’existent que parce qu’ils produisent des croyances. Ils n’existent que parce que des croyances en face d’eux les assurent de la légitimité de leur propre croyance. La notion de croyance est très importante chez Bourdieu : vous pouvez l’appliquer en permanence à toutes sortes de réunions. Vous ne venez ici que parce que vous croyez en la culture et en ma capacité à vous en parler. Nous sommes tous des croyants, des croyants non religieux, car ça n’a rien à voir avec la religion. La croyance religieuse a une spécificité tout à fait à part. Comment produire la croyance en une œuvre d’art ? Comment produire la croyance en un personnage central comme un comédien du type de Depardieu ? La croyance est tout à fait importante, et Bourdieu ajoute que les producteurs de croyance sont eux-mêmes en lutte pour des positions sociales dans leur propre domaine. Ils ne sont pas là seulement côte à côte, ils sont en lutte pour se faire reconnaître, pour être sur le devant de la scène, pour obtenir une renommée. Du côté du public, il y a aussi un autre problème qui se pose, toujours dans la question de ce champ culturel : les publics n’accèdent à l’art que s’ils sont dotés de certaines dispositions. Les dispositions qui leur permettent de comprendre, de décoder le sens d’une œuvre, d’en saisir la signification. Bourdieu reprend ici un terme utilisé au moyen-âge, celui d’« habitus ». Il faut avoir un habitus nous permettant de comprendre précisément le film que nous allons voir, d’en saisir le sens, de voir quels effets ce film peut avoir sur notre propre vie, quels effets nous pouvons en tirer pour nos relations sociales au quotidien, etc. D’une certaine manière, cet habitus nous dispose à mieux comprendre. Comment l’acquiert-on, cet habitus ? On l’acquiert par le milieu, ou bien on se le forge par l’école. Mais ces habitus sont différenciateurs, distinctifs, ce sont des dispositions que l’on pourrait appeler des jugements de goût. Il y a des choses qui nous plaisent et des choses qui nous déplaisent. Chaque fois qu’il y a du goût, il y a du dégoût y compris en matière culturelle. Regardez la manière dont, face à certaines expositions d’art contemporain, les gens réagissent avec dégoût ou mépris en disant « Ça, je peux en faire autant ». Ce qu’ils ne disent pas face à un autoportrait de Rembrandt. Le problème est donc de savoir comment on décode une œuvre, comment on lui donne une signification et quels sont les effets qu’on va en tirer. Quels sont les usages sociaux qu’on va en tirer ? Le champ culturel est un monde social en mouvement, en tension permanente sous tous ces aspects et c’est la position particulière de Bourdieu. Regardez par exemple comment les intermittents du spectacle techniciens se pensent par rapport aux intermittents du spectacle artistes. Il y a une dichotomie, une polarité qu’il faut étudier dans le monde de l’intermittence. Les gens qui règlent les projecteurs par exemple, ceux qui font les balances sont des intermittents du spectacle. Comment sont-ils regardés par les artistes ? Comment eux-mêmes regardent-ils les artistes ? Ils peuvent se dire : « Si je ne fais pas une bonne balance, l’artiste ne passera pas et le spectacle sera profondément décevant ». Ce rapport entre techniciens et artistes est analogue à la tension qu’il peut y avoir entre le monde ouvrier et le monde de la direction, ou patronal, et pourtant on les coiffe d’un même mot : intermittents du spectacle. En cela, le champ social culturel ressemble à d’autres champs sociaux : à
celui de l’école, à celui du religieux, à celui de la santé, au littéraire, au politique ; ce que Bourdieu appelle les homologies culturales rend possible les analogies entre champs différents. Qu’est-ce que c’est, l’analogie ? Je donne un exemple très simple : « Vous prenez votre corps et vous dites que le bras est à la main ce que la jambe est au pied, mais jamais vous ne dites que la main c’est le pied, ou jamais vous ne dites que le bras c’est la jambe ». Vous faites une analogie entre des mondes différents et vous vous apercevez que ces mondes fonctionnent de la même façon, d’une manière analogique. Un monde de l’analogie rapproche, compare, mais jamais ne nie. Par exemple, l’hérésie religieuse, le moment ou Luther dit qu’il ne veut plus être catholique, ce n’est pas purement et simplement une négation de l’orthodoxie ; la gauche ne nie pas la droite ; la droite ne nie pas la gauche. En fait, ce sont des mondes qui fonctionnent d’une manière très parallèle. La droite permet à la gauche d’exister, et inversement, et l’hérésie permet à l’orthodoxie d’exister. L’orthodoxie secrète l’hérésie et l’hérésie conforte l’orthodoxie dans son orthodoxie. C’est parce qu’il y a des hérétiques que les orthodoxes peuvent dire : « C’est nous qui avons la vérité ». Mais les hérétiques disent : « Vous vous trompez, c’est nous qui sommes l’avant-garde de la vérité ». C’est vrai dans toutes sortes de mondes. Les mondes sociaux se comprennent à partir de toutes sortes d’analogies qui les rapprochent, qui nous les rendent familiers, fonctionnels. Les mondes ne sont pas aussi différents que cela. On peut se les représenter d’une manière quotidienne. Je pense qu’il y a des rapprochements très intéressants. Je montre toujours deux rapports comparables : l’un nous fait comprendre la structure et le fonctionnement de l’autre et l’autre nous fait comprendre la structure et le fonctionnement de l’un. La droite nous fait comprendre le fonctionnement de la gauche et vice versa. Exactement comme avec les primaires : les discours et les personnes sont différentes, mais structurellement ce sont deux choses qui vont fonctionner en parallèle. Et l’un n’existe que par l’autre. En fait, les champs culturels sont relatifs et n’existent que les uns par rapport aux autres. Et ce n’est pas la peine de se lancer des vilenies sur le plan idéologique. L’idéologie fonctionne comme cela. Enfin, le champ culturel est fondamentalement symbolique. Les biens culturels sont des biens symboliques. Dans cette notion entrent celle de valeur et celle de prix : si le bien culturel est un bien symbolique c’est qu’il a une valeur et un prix. Mais en même temps il a une valeur esthétique, il a une renommée en la personne de son créateur, en la personne de celui qui porte ce bien en question. Le séjour de Bourdieu en Algérie a été déterminant pour comprendre la dimension de la valeur symbolique. C’est à partir de l’étude qu’il a faite sur la société kabyle, qu’on comprend la dimension de la valeur symbolique qu’il donne aux choses et en particulier aux biens culturels. Il y a décrit des structures pré-capitalistes. A l’époque il est enseignant à l’université d’Alger. Il parcourt avec Abdelmalek Sayad le bled et la Kabylie, où il assiste à des marchés, et il observe de manière ethnographique ce qu’il voit. Il décrit des structures agricoles et villageoises pré-capitalistes, où les échanges de biens particuliers portent sur des valeurs symboliques. Par exemple on y échange le sens de l’honneur, du prestige, du défi, de la riposte. Certains mots sont considérés comme des défis. On est totalement étranger au monde économique du donnant-donnant : je paie, je reçois. Non. Les mots y ont une importance considérable, et c’est ça qui donne toute sa force symbolique aux échanges. Il va assimiler à cette époque-là les pièces symboliques pré-capitalistes aux biens culturels. Pour lui le monde culturel, artistique, est un monde économique à l’envers. A l’envers, parce que le calcul rationnel est toujours relativement dénigré. Vous ne trouverez pas un artiste qui va vous dire : « Mon œuvre vaut tant ». Je suis un créateur, je ne suis pas dans l’horizon marchand. Je me situe ailleurs. Et ça, on le voit jusque dans la façon dont les intermittents du spectacle vivent leur précarité. Il y en a qui ne gagnent même pas le SMIC et qui sont quand même très fiers d’être intermittents du spectacle parce que, au fond, économiquement précaires, ils sont fiers et heureux de travailler pour l’art, quasiment sur un mode désintéressé, ce qui rejoint d’une certaine manière la critique du jugement de Kant, c’est-à-dire que le beau plaît d’une manière désintéressée. On échange des symboles, des paroles qui nous touchent au cœur, mais ce ne sont pas des échanges économiques, c’est un monde économique à l’envers en quelque sorte. On voit bien qu’il y a un marché de l’art derrière tout ça, mais le marché de l’art est mis de côté, il n’est pas exprimé en premier. Vous entrez dans un atelier d’artiste : ce n’est pas le prix de l’art qui va être mis en avant, mais l’œuvre elle-même ; c’est une sociologie des œuvres et non pas des prix, ce n’est pas une sociologie du marché. Voilà les trois modèles qui me semblent importants pour comprendre la culture. Mais on voit bien que par leur évolution technique rapide, leurs transformations économiques, les reclassements de leur hiérarchie par effet de mode, les faits culturels aujourd’hui tels qu’ils sont vécus et pratiqués nous obligent à relativiser les connaissances, les catégories et les modèles explicatifs que nous en avons. Le chercheur se doit de les rattacher à des contextes socio-économiques, à des situations de travail, de loisirs ou de divertissement. Il faut penser au fait que les acteurs culturels sont des travailleurs. Tous ceux qui occupent un emploi culturel sont des travailleurs alors que leur public (cinéma, concert, expositions) est composé de gens hors travail : ils sont dans le loisir, le temps libre. En face d’eux ils ont des travailleurs. La grève des intermittents du spectacle a rappelé à toutes et à tous que dans les coulisses de l’art il y a des travailleurs ordinaires, qui sont « infatigables » parce qu’ils se donnent souvent sans compter et qu’ils se trouvent devant des tâches à accomplir parce qu’il en va de la fabrication d’une œuvre d’art ou d’un bien culturel. Au lieu de partir d’un concept, la culture (que je traiterais philosophiquement à la manière de Socrate : « Qu’est-ce que c’est que la culture ?»), inlassablement définie, redéfinie dans son équivocité permanente, il me paraît plus pertinent de partir des biens et des pratiques de culture, ce qui est à la fois disponible sur un marché (objets, artefacts, tableaux, expositions, etc.) mais aussi les services qui en assurent la diffusion, la promotion, les usages sociaux. La culture concerne d’abord des objets, me semble-t-il. Toute institution culturelle a besoin de s’appuyer sur une culture objective, sur une culture d’objets. Au fond c’est en se fondant sur ces objets culturels, matériels ou non, que la culture et sa sociologie va pouvoir se développer en l’associant à des êtres, des pratiques, des idées, plus ou moins durables et institutionnalisés. Je vais vous donner trois exemple : quand vous voyez comment la langue se présente à nous – la langue française, elle est d’abord objectivée, réifiée dans et par des dictionnaires. Dans un dictionnaire vous avez une langue chosifiée avec des définitions en quelque sorte closes sur elles-mêmes. Vous cherchez par exemple le mot « beauté ». Vous aurez plein d’exemples (la beauté chez Pascal, chez Kant, etc.). En fait vous êtes devant un stock figé. La langue apparaît d’abord comme définie, réifiée. Une sorte de chose. Vous prenez le cas des chansons folkloriques, populaires : elles sont enregistrées sur des supports matériels (CD, cassettes), donc elles sont objectivées. Regardez ce qu’on utilise matériellement pour produire une œuvre d’art qui est elle-même un produit matériel ; même la musique que vous écoutez est fondée sur des partitions musicales qui nous permettent de la reproduire à l’infini. Ce que l’on ne saura jamais, c’est ce que les gens ont ressenti en entendant la première fois une symphonie de Beethoven. Cette objectivation est nécessaire si l’on veut avoir accès à la culture. Deuxième exemple : les rites, profanes ou sacrés, aussi bien une liturgie que le rite du repas, des politesses, etc., tous ces rites qui sont en quelque sorte pré-structurés, qui font que les gens s’attendent à quelque chose. Ils sont associés à des objets, transformés en eux, et eux-mêmes rappellent le rite. Par exemple avec cette soirée, vous vous attendiez à ce qu’une personne prenne la parole, et les absents auront la transcription en recevant La Lettre du cercle Gramsci. Troisième point, les croyances se nouent étroitement avec la trame des romans, des livres : si on ne les avait pas, nos croyances ne se renouvelleraient pas. A un moment donné on adhère au thème d’un livre. Il n’existe pas de représentation qui ne s’enracine dans quelque matérialité. Point de culture qui ne s’appuie sur une pluralité des supports physiques. Aujourd’hui on le voit d’autant plus que ce monde numérique nous assaille. Je pourrais vous lister la réalisation de la culture dans ces objets, les choses matérielles, techniques, les ustensiles de cuisine, les objets d’art, sculpture, peinture, collections, les monuments, les lieux de mémoires, les programmations culturelles, les équipements, les savoirs transmis, les livres, les partitions de musiques, les institutions… même dans les modes de vie et les traditions, vous avez des éléments qui symboliquement nous renvoient à la culture et cette liste n’est pas achevée. Compte-rendu réalisé par Monique Broussaud.
TRIBUNE