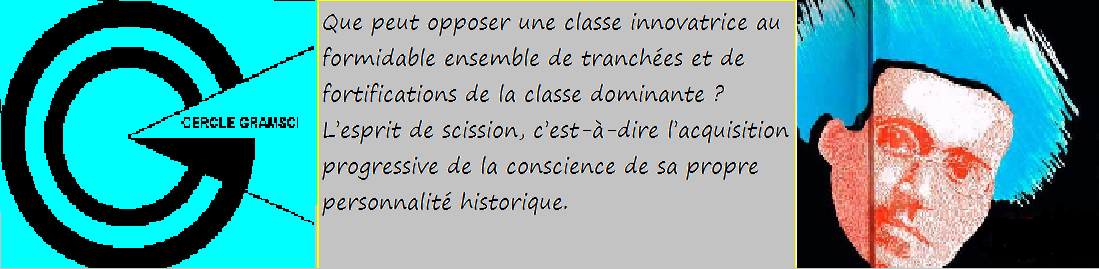S’engager hier,
aujourd’hui et demain
L’exemple de Pierre Monatte (1881 – 1960)
syndicaliste atypique
A la demande du cercle Gramsci, des Amis du Monde diplomatique et d’ATTAC, Colette CHAMBELLAND, historienne, est venue le jeudi 5 avril 2001 animer une soirée-débat sur le syndicalisme à travers l’itinéraire de Pierre Monatte.Lors de la soirée, une partie du débat n’a pas été enregistrée. Nous avons donc essayé de contacter différentes personnes qui sont intervenues. Deux contributions nous sont parvenues, qui nous ont permis de compléter l’enregistrement. Elles se trouvent à la suite du compte-rendu.
Daniel Couty, chargé de la présentation de la soirée, souligne le fait que si on est un tant soit peu militant on a envie de ressembler à des gens comme Pierre Monatte et ses amis. Alors pourquoi, dans les années 30, sont-ils restés minoritaires, entre l’ancien parti socialiste qui devenait réformiste et le parti communiste qui devenait stalinien ? La réponse est peut-être dans cette anecdote : souffrant de leur isolement, des jeunes disent à Pierre Monatte : « c’est affreux, quand on parle aux gens, c’est comme si on parlait à des murs », et Pierre Monatte répond : « mais il faut savoir parler aux murs, d’ailleurs les murs ont des oreilles ».
Colette Chambelland
La question essentielle est en effet de savoir pourquoi ces gens étaient minoritaires et pourquoi ils ont été oubliés si longtemps.
C’est un travail utile de les redécouvrir. Car quand on est militant, on a toujours, à une période de sa vie, un sentiment de doute et on a alors tendance à penser qu’avant on s’engageait plus facilement dans des voies meilleures. Il ne faut pas avoir cette nostalgie du passé. Toutes les périodes de militantisme ont été difficiles. Personnellement, les années de ma jeunesse en 47-48 ont été les plus oppressantes qu’on pouvait rêver, car il n’était pas question d’avoir des discussions sur le communisme comme il peut y en avoir maintenant. Donc des verrous ont sauté. Mais il est vrai qu’on a oublié beaucoup de gens. Les historiens, ainsi que les militants, en sont grandement responsables. L’histoire a occulté tout une catégorie d’hommes, tout ceux qui ne mettaient pas leur fauteuil dans le sens du vent. Parmi ces gens, les plus oubliés ont certainement été les militants syndicalistes. D’abord parce que le syndicalisme est mal connu : c’est quelque chose qui n’a pas encore de doctrine pré-établie et qui est surtout pragmatique. Ensuite parce qu’on a des idées erronées, par exemple sur ce qu’est le syndicalisme dit « révolutionnaire » (moi je préfère le terme « syndicalisme d’action directe »).
Quand on voit la façon dont les centrales syndicales font leur histoire, on est étonné de voir à quel point elles ont occulté la période d’entre deux guerres, peut-être parce qu’elles n’en sont pas très fières, on y atteignait en effet un niveau d’injures jamais atteint depuis. C’est pourquoi j’ai voulu faire cette biographie de Monatte, car je trouve qu’il est représentatif d’un mouvement syndical oublié et qu’en plus son itinéraire est long.
En effet, né en 1881 et mort en 1960, il n’a jamais cessé d’écrire, tout en ayant un parcours différent du parcours officiel de la plupart des militants, en ce sens qu’il n’a jamais occupé de fonction de permanent, ni de responsable d’organisation.
L’itinéraire de Monatte
Je voudrais rappeler quelques étapes de sa vie et de son engagement parce qu’elles sont caractéristiques de sa génération et qu’elles permettent de comprendre un certain état du mouvement ouvrier.
Tout d’abord il y a l’engagement du jeune homme. Je suis toujours étonnée, même en ayant tous les documents, de voir ce qui déclenche le sursaut militant chez ce fils de maréchal-ferrant des plateaux de la Haute-Loire, lieux qui ne sont pas particulièrement révolutionnaires. Cependant, dans la famille, il semble y avoir une tradition. L’arrière grand-père a en effet été le premier maire du village sous la Révolution, et dans le pays on parle de Monatte « les rouges ». Bien sûr, il pourrait y avoir confusion parce que la famille est rousse, mais comme on parle aussi de Monatte « les blancs » il est plus probable que l’appelation « les rouges » correspond à des tendances républicaines.
Je pense que ce qui déclenche le sursaut militant, ce sont des sentiments de révolte. Il y a des gens qui sont par nature des révoltés. Par exemple, Monatte qui était un très bon élève, (c’est pour ça qu’on l’a gardé à l’école et après au collège), n’a jamais supporté l’autorité. Il avait le réflexe du bagarreur. Du reste son père lui avait fait un cartable en fer, tellement il en avait assez de le voir revenir avec des gibecières déchirées. Comme il avait eu son certificat d’études premier du canton à neuf ans, on a voulu l’envoyer au séminaire. Quand il en a vu les portes il s’est sauvé. Il y a avait donc une révolte instinctive contre toute forme d’autorité, que ce soit celle du maître ou celle du curé. Et puis, il y a les lectures. C’est surtout la lecture des Misérables de Victor Hugo qui amène beaucoup de gens de sa génération et des générations suivantes au socialisme. C’est vrai pour beaucoup de jeunes bourgeois de l’époque.
« il faut que vous appreniez à connaître vos entreprises. Sachez lire un bilan pour pouvoir aller discuter avec le patron.
Un syndicalisme moderne doit comprendre les rouages du patronat. »
Après viennent des engagement plus profonds, à partir de la lecture de petits brûlots anarchistes (la propagande anarchiste ne se faisait pas seulement par les bombes mais aussi par les brochures). Monatte devient alors maître d’internat et part dans le Nord et le Pas-de-Calais. C’est là qu’il découvre le monde ouvrier et qu’il rencontre les premiers syndicalistes des années 1898-1899. Il apporte son aide à la constitution des syndicats de verriers dans le Pas-de-Calais, participe à des meetings anti-militaristes, pique une crise contre son principal de collège et se retrouve sans engagement, à Paris.
A l’époque on vivait facilement de petits « boulots ». Il travaille dans une grande revue qui s’appelait Page libre. Petit à petit il prend conscience de l’importance qu’il y a à donner des armes aux syndicats. Il revient à Lens où pendant un certain temps il fait un journal de mineurs : L’action syndicale de Lens. Il participe aux grandes grèves des mines. Après celle de Courrières, il est arrêté pour complot bonapartiste contre la sûreté de l’Etat (il fallait bien trouver des intitulés). Malgré un non-lieu, il fait huit mois de prison. Quand il revient à Paris, il rentre au Comité confédéral des Bourses, à la CGT. Il y avait deux comités : celui des Bourses et celui des Fédérations. Ceci est important car, à partir d’une certaine période, on a privilégié les fédérations, qui étaient une autre conception du syndicalisme, moins locale et plus hiérarchisée. Là, il voit naître une première crise, grande crise de la CGT, en 1908, au cours de laquelle on a découvert des problèmes d’argent. On a accusé un des secrétaires qui n’a pas voulu rendre de compte, s’en suivent des émeutes qui sont le prétexte pour arrêter tout le bureau confédéral. Et c’est là que Monatte et quelques amis pensent qu’il faut créer une revue pour donner un fond à la doctrine, mais aussi pour faire connaître ce qui se passe dans les industries, dans les régions, ainsi que dans le monde ouvrier. Et c’est en octobre 1909 que sort le premier numéro de La Vie ouvrière (qui n’est pas du tout celle que nous avons connue). C’était une petite revue de 64 pages à couverture grise, qui est parue jusqu’à la guerre de 1914 sous cette forme, deux fois par mois. C’est vraiment une revue essentielle pour comprendre ce qu’était le syndicalisme d’action directe de l’époque, car c’était à la fois une revue d’action et d’éducation. Il s’agissait de dire aux gens : « il faut que vous appreniez à connaître vos entreprises. Sachez lire un bilan pour pouvoir aller discuter avec le patron. Un syndicalisme moderne doit comprendre les rouages du patronat. »
Mais ce n’était pas du tout une revue fermée sur ce que l’on appellerait aujourd’hui le corporatisme, c’était une revue ouverte sur les problèmes internationaux. Ce qui montre que le syndicalisme révolutionnaire que l’on dit uniquement français et italien, avait de très forte racines aussi en Angleterre et aux Etats-Unis.
La Vie ouvrière rassemble un certain nombre de personnes qu’on retrouvera par la suite au début de l’Internationale communiste. Pour Monatte c’est la grande période d’activité de directeur de revue, la seule durant laquelle il est salarié, bien qu’il ne soit pas toujours payé (quand il part à la guerre en 14, il doit 25.000F à l’imprimeur). La Vie ouvrière est une période importante car elle correspond à une certaine structuration du syndicalisme révolutionnaire.
Autre période capitale, c’est la déroute de l’internationalisme prolétarien à la suite du déclenchement de la guerre de 14.
Monatte et son fidèle ami Alfred Rosmer acceptent mal, non pas qu’on n’ait pas lancé un mot d’ordre de grève générale en août 1914, parce que cela n’aurait été ni compris, ni valable, mais que la CGT, le parti socialiste se lancent dans la politique d’Union sacrée et refusent d’aller à la première conférence internatinale en Suède. Monatte, pour protester contre cette lâcheté, démissionne du comité confédéral et est donc immédiatement mobilisé. Il part en 1915 sur le front, va faire La Marne, Verdun et ne sera libéré qu’en avril 1919. Le plus tragique pour lui est de n’avoir pu rien faire pour éviter ce déferlement de patriotisme. Dans les tranchées il souffre surtout de découragement, et ce n’est qu’en 1917 qu’il reprend espoir avec la Révolution russe. Il écrit alors ses réflexions sur l’avenir syndical, réflexions qui sont à la fois un bilan (« nous n’avions pas avant la guerre la quantité mais nous n’avions pas non plus la qualité », dit-il) et une perspective. Le sursaut d’espoir engendré par la nouvelle de la révolution russe est intense. C’est d’abord la fin de la guerre, c’est aussi la première fois qu’une révolution aboutit, et surtout, il connaît les hommes tels que Trotsky (ils ont le même imprimeur) et bien d’autres dont il se sent proche.
Cette proximité d’idées explique l’adhésion de tout le groupe du syndicalisme révolutionnaire, non pas tout de suite au partic communiste, mais à l’idéal communiste.
L’après guerre
A la fin de la guerre, Monatte refait La Vie ouvrière, sous forme d’hebdomadaire. Une autre période difficile se profile avec la scission de la CGT, qui donne naissance, en 1922, à la CGT-U, Monatte étant contre cette scission. Puis il est encore une fois arrêté avec tout un groupe de militants, et va rester un an à la Santé pour complot communiste contre la sûreté de l’Etat, ce qui l’empêche de s’opposer à la scission qui se fait malgré lui. Libéré, il rentre comme rédacteur à l’Humanité où il s’occupe de la page sociale. Ce n’est qu’en janvier 1924 qu’il entre au PC pour en sortir en octobre de la même année, car il ne supporte pas, après la mort de Lénine, la direction du parti français qui fait une « bolchévisation » pour le moins autoritaire et maladroite. Au secrétaire général qui veut faire des cohortes de fer, il dit : « mais vous allez faire des régiments de limaces. »
Exclus du PC, Monatte et ses amis sont coupés d’une des parties dominantes du mouvement ouvrier français. La revue qu’ils créent alors va essayer de maintenir une ligne de syndicalisme indépendant, débarrassé de la tutelle autoritaire du Parti. Il règne un climat de tensions permanentes, d’insultes difficiles. Ils ont tous beaucoup souffert d’être considérés tantôt comme des suppôts de Staline, tantôt comme des suppôts de l’impérialisme. La collection de La révolution prolétarienne montre qu’il y avait un combat sur plusieurs fronts. D’abord sur l’indépendance nécessaire des peuples coloniaux. Par exemple Robert Louzon est banni de Tunisie parce qu’il a fait un journal communiste en langue arabe, ce qui était formellement interdit. Daniel Guérin publie des articles contre la colonisation française en Indochine. Puis, dès 1933 contre la montée du national-socialisme. Des compte-rendu sur Dachau sont publiés, ce qui montre qu’on n’ignorait pas les choses. Et enfin, contre l’URSS à cause de la façon dont elle traite la classe ouvrière. Ca a été un drame pour toute cette génération, qui a vu se transformer ce qu’elle pensait être un idéal, en un totalitarisme sanglant. On a du mal actuellement, alors que plus personne ne conteste les crimes de Staline, à comprendre pourquoi, bien qu’on ait eu les moyens de connaître la vérité, on n’a pas voulu l’entendre. Le déshonneur le plus grand revient aux intellectuels français qui savaient (on le voit quand on lit leurs lettres personnelles) et qui n’ont rien fait alors qu’ils ne risquaient rien. Pour des gens qui croient à une révolution émancipatrice pour l’individu et qui voient un Etat qui détruit ceux qui l’ont créé, c’est une période particulièrement dramatique. Ca explique peut-être l’oubli dans lequel on les a laissés.
Le choc de la deuxième guerre mondiale
Là, la dignité quand on ne résiste pas serait au moins de se taire et de ne pas écrire. Parfois on a des surprises quand on voit les signatures au bas des publications de l’époque, signatures qui commencent à s’éffacer à partir de la fin 1943. Tout le groupe autour de Monatte était anti-pétainiste presque de naissance. Le nazisme, bien entendu, on n’en parle pas. Un certain nombre d’entre eux a été arrêté. La résistance a été un problème compliqué. La question se pose encore de savoir ce qui a pu se passer entre les trotskystes et les communistes orthodoxes dans certains maquis. Monatte avait déjà 60 ans. Pour gagner sa vie il faisait des corrections chez des éditeurs. Son carnet de correction donne un assez bon panorama de ce que l’on pouvait publier officiellement sous l’occupation allemande. C’est lui qui a corrigé l’Aurélien d’Aragon, L’être et le néant de Sartre, l’Invité de Simone de Beauvoir. Je veux bien que tous aient été ultra-résistants après mais quand on publiait en 42 ou 43, qu’on faisait jouer ses pièces, ça se discute.
Après la guerre, la CGT se reconstruit. En 45-46, avec des ministres communistes au gouvernement, elle n’est pas très revendicative. La formule du premier congrès CGT est : « La grève est l’arme des trusts ». On voit partout, sur les murs de Paris : « Retroussons nos manches, ça ira mieux ». C’est aussi une nouvelle scission, celle de Force Ouvrière qui se prépare, dont l’étude est encore à faire. FO n’était pas à l’époque uniquement une centrale réformiste, elle avait ramassé tous ceux qui ne se sentaient pas à l’aise à la CGT. Monatte travaille toujours, il est correcteur d’imprimerie comme au début de sa carrière. Puis il prend sa retraite en 1950. C’est une période qu’il vit tristement, il emploie la formule : « on est dans la boue des basses périodes historiques ». Non seulement il ne sent pas de courant nouveau dans le mouvement syndical mais il y a tout le problème des guerres coloniales. Il essaie d’avoir une action en pensant que les plus prolétaires des prolétaires sont « les travailleurs coloniaux » (c’était le terme de l’époque) et que leurs frères de classe ne font pas grand chose pour eux. La période algérienne est particulièrement difficile parce que la toute-puissance du FLN s’impose et Monatte pense qu’il est un parti plus totalitaire qu’ouvrier. Il connait bien Messali Hadj, fondateur du MNA. Là encore, il y a des exterminations et là encore des gens savaient que ça allait mal tourner et ils n’ont pas su se faire entendre. Comme à l’époque du stalinisme, il y avait occultation d’un courant.
Monatte à ce moment-là travaille beaucoup avec l’Union syndicale des travailleurs algériens. Symbole d’un des derniers combats de sa vie, il est à noter que la seule gerbe déposée au Père Lachaise lors de son incinération était justement celle de l’Union syndicale des travailleurs algériens.
Si j’ai pu reconstituer l’itinéraire de Monatte c’est qu’il a laissé une masse considérable de documents. De ses cahiers d’écoliers à sa correspondance avec les militants en passant par les lettres de sa mère, il gardait tout. De plus, c’est à ma connaissance le seul militant ouvrier qui ait tenu un journal tout au long de sa vie.
Des pessimistes gais
A travers ce fond d’archives on peut vraiment saisir sa personnalité. C’est ainsi qu’on sait qu’il lit des romans, qu’il va au cinéma, au théâtre, qu’il aime les chats et les roses, qu’il aime la vie. Quand il se penche sur son passé, je ne sais pas s’il est optimiste ou pessimiste. J’ai employé une fois la formule : « C’étaient des pessimistes gais » car ils pensaient qu’il fallait être pessimiste pour agir mais qu’il ne fallait pas que ça vous empêche de vivre. Une chose est certaine c’est qu’il s’interroge. Par exemple il se posera éternellement la question : « est-ce qu’on aurait dû entrer au Parti communiste? Est-ce qu’on a fait ce qu’il fallait pour empêcher la chape de plomb qui est tombée sur le mouvement ouvrier? » Il y a tout un noeud de réflexions sur la façon dont une idée devient totalitaire et, ce qui est l’essentiel de sa vie, sur ce qu’est le syndicalisme. S’il y a une chose à laquelle il croit encore à la fin de sa vie c’est la nécessité d’une lutte syndicale, même au niveau le plus primaire, en essayant de changer les rapports de production, l’ordre économique des choses. Je crois qu’il a aussi pensé avec ses amis, qu’il faut toujours refuser les dogmatismes et avoir le doute permanent, qu’il faut s’éduquer et qu’il n’y a de syndicalisme possible sans une transformation du militant. Faire « des hommes fiers et libres » formule de Fernand Pelloutier, créateur de la fédération des bourses du travail, « amants passionnés de la culture de soi-même ». Hier la culture, l’éducation et l’action ont été les traits dominants des syndicalistes de cette époque et de ce courant. Leur vie a été souvent difficile. Mon père a écrit, et cela correspond bien à Monatte et à lui : « Quand l’amertume me monte à la gorge, je pense à Voltaire qui disait : « C’est un bien grand mal d’être hérétique, mais est-ce un grand bien de soutenir l’orthodoxie par des soldats ou des bourreaux ? ». C’est quelque chose dont il faut se rappeler et accepter d’être minoritaire. A ce sujet Monatte note dans le journal d’André Gide la phrase suivante : « Le levain est dans la pâte, mais il ne faut pas oublier que le levain est un corps étranger ».
Il ne s’agit pas de faire une hagiographie des minoritaires, on n’est pas minoritaire de vocation, mais il faut accepter de penser qu’on a raison, même si ce n’est pas avec la masse, même si ce n’est pas dans le courant.
Le débat
Daniel Couty propose un débat sur l’engagement, non seulement d’hier, de Monatte et de ses amis, mais sur l’engagement d’aujourd’hui et sur celui de demain. Daniel se demande ce que Monatte, qui était contre les permanents qu’il appelait les « fuyards de l’atelier », pensait de la question de la hiérarchie.
Colette Chambelland : Monatte était contre les permanents à vie. Il y avait une règle dans le monde syndical français : pas plus de trois mandats successifs. C’est Thorez qui, en 1923, au congrès de Bourges, a fait annuler cette mesure.
Daniel Couty continue à s’interroger sur le militantisme actuel. Depuis la mort de Monatte il y a eu la chute de l’URSS, le supradéveloppement du capitalisme, qu’on appelle le néolibéralisme. On a vu aussi apparaître de nouvelles formes de militantisme du type ATTAC, AC!, Ras l’Front, qui ne se situent pas sur le terrain de la lutte des classes ou de la lutte au sein des entreprises.
Dans le Monde diplomatique, ce sont des choses qui sont bien vues, qui apparaissent novatrices. On en voit les côtés positifs du fait que sans ça bien des gens se seraient désintéressés de la question politique en général.
Mais est-ce que ça n’a que des côtés positifs ? Est-ce qu’il n’y a pas une démission dans le fait de s’écarter d’un endroit chaud qui est le travail? Est-ce que ce n’est pas une abdication pour aller vers un nouvel ordre mondial qui voudrait nous faire croire que la lutte des classes n’existe plus ? Lors de la préparation de la soirée j’ai eu un terme assez polémique, que je mettrais ce soir entre guillemets : dans les années 90 on a vu apparaître des « para-militants ». Il est vrai que le syndicalisme garde des défauts importants tels que la bureaucratie, par exemple, mais en évitant ces questions est-ce qu’on n’évite pas le combat le plus essentiel ? Car on voudrait nous faire oublier une chose, c’est que sans la base qui fait sa richesse, il n’y aurait pas de libéralisme, sans les gens pour produire, il n’y aurait pas de finance.
Jean-Pierre Clausse (secrétaire d’ATTAC) : Le terme de para-militant est intéressant parce qu’il y a pas mal de militants qui n’ont pas forcément trouvé dans la notion de base de l’entreprise une vision plus large par rapport à la lutte quotidienne. Personnellement, je suis délégué du personnel dans mon entreprise, et ce qui me choque, c’est qu’on pose toujours la question de l’usine de Limoges sans penser aux autres usines du groupe à travers le monde. Prenons le cas de Danone. La partie produite par les salariés, on s’en moque parce qu’elle fait baisser le taux de l’action et on ferme deux sites de production. Là-dessus ATTAC appelle au boycott. Ce que je trouve intéressant dans la démarche d’ATTAC c’est qu’elle tient compte à la fois du niveau local et du niveau global. On voit que tout se tient. L’impact qu’a notre manière de consommer sur les gens d’à côté est important.
Ce qui n’empêche pas que je reconnais la valeur de mon délégué syndical qui est quelqu’un d’extraordinaire, qui sait éplucher un bilan et est capable de discuter avec la direction.
Colette C : Il y a tout une mécanique complexe. Bien avant Seattle, un mouvement social commence à se construire à l’échelle planétaire. Il se heurte à deux difficultés : celle de l’internationalisation de l’économie et celle liée au crédit d’impôt. Dans ce dernier cas, ce ne sont plus les salaires qui assurent la rémunération des personnes, mais aussi l’Etat. On sort donc de la simple relation patron-salariés. Il faut dès lors intégrer toutes les luttes telles que celles des précaires, des chômeurs, des sans-papiers, intégrer les mouvements de migrants. On se rend compte, par exemple, que ce sont les ONG de solidarité internationale qui sont les meilleures acteurs du développement entre le Nord et le Sud. A partir des mouvements de résistance à la mondialisation, au travers des grandes centrales syndicales, des associations, une certaine sauce commence à prendre, point de départ pour une reconquête par rapport aux sociétés transnationales qui concentrent le pouvoir et l’argent.
Jean-Pierre Juillard : Un mot sur l’incapacité du syndicalisme à construire une vision du monde, c’est-à-dire à transformer une société. Je suis assez d’accord sur la manière dont le passé nous est rapporté à travers les historiens. On a le sentiment que les syndicalistes, type Monatte et autres, avaient un projet de société, sinon tout ficelé, du moins dans la tête. Et ça, c’est pour l’instant une grande carence des syndicats, de ne pas pouvoir construire d’alternative. C’est là que des mouvements comme ATTAC ou d’autres sont précieux, car ils enrichissent par des jeux de croisements ce qui fait défaut dans les structures institutionnalisées telles que les syndicats. Ce qui ne veut pas dire qu’il faille jeter ces derniers, ce sont des outils encore indispensables. Imaginez qu’il n’y ait plus un seul syndicat dans ce pays, comme il n’en existe quasiment plus en Angleterre, on pourrait s’en féliciter en disant qu’on a tout nettoyé mais pendant un quart ou un demi siècle qu’est-ce qu’on ramasserait. ! Je compte, pour ma part, sur l’enrichissement apporté par la proximité des courants de pensée comme ATTAC, AC! et d’autres. Or, il est vrai qu’actuellement, emportés dans des logiques restrictives du quotidien, nous syndicats, n’apportons pas notre contribution.
Nous sommes parfois en pleine schizophrénie : si je trouve, (vous allez me dire il ne faut pas le faire), si je trouve sur le périphérique 50 kg de pommes de terre à 50F, je m’arrête et je le prends, et en rentrant à la maison je dis à ma femme que j’ai fait une affaire. Or ce n’est pas jouable, je suis un véritable receleur. Sans parler de la voiture à 30000F de moins de l’autre côté de la frontière et des gobelets en plastique pas chers du tout parce qu’ils sont faits par des petites mains chinoises de six ans. Il faut avoir l’honneteté intellectuelle de reconnaître nos contradictions. Sans parler non plus de cette grande symbolique d’une efficacité fantastique qui fait Zidane ambassadeur de l’ONU. Qui fabrique ces concepts? cette sémiotique ? C’est le capitalisme. Et nous en face, on n’est pas au point.
Colette C. : On a oublié qu’il y a eu dans le syndicalisme français et anglais, à une certaine époque, une réflexion sur ce qu’on appelait « les en-dehors ». Il a même eu un journal, Le trimard, organe des gens qui prenaient la route. Et ça on l’a complètement oublié. De même qu’on a oublié certaines formes d’action. Par exemple il y a eu un militant (Cochon) qui a fondé un syndicat de locataires dans les années 1900. Son action était de venir déménager gratuitement et clandestinement les gens qui ne payaient pas leur loyer. En ce qui concerne la consommation, en 1832 à Lyon, deux saint-simoniens lancent le « commerce véridique et social » parce qu’ils pensent qu’il faut moraliser le commerce pour ne pas acheter au détriment du producteur. C’est le premier magasin de coopérative ainsi créé. Le mouvement des coopératives, après avoir eu un immense succès, a fini par être « bouffé » par l’argent, et faire des faillites frauduleuses.
Dans une période de ma vie, j’ai travaillé à la fédération des coopératives de consommation. On a essayé de faire des circuits courts entre coopératives agricoles et coopératives de consommation. Personne n’en a voulu. Et pourtant c’était le seul moyen de sortir du système capitaliste traditionnel.
Un intervenant : l’Espagne en 1936, par rapport à l’organisation des agriculteurs et des ouvriers, qu’en pensez-vous ?
Colette C. : C’était bien, c’était une vrai idée. Mais en période de guerre civile, ce sont des réalisations qui sont condamnées. Ce n’est pas pour ça qu’il faut porter l’échec au débit de l’idée.
Francis Juchereau : En examinant la période à travers laquelle Monatte a vécu, on voit un espèce de modèle, ce que l’on a appelé après le « socialisme réel », sorte de paravent optimiste pour ceux qui voulaient transformer la société, paravent sur lequel était dessiné le paysage des « lendemains qui chantent ». Et ça a encore une force terrible aujourd’hui quand on parle de commerce juste, équitable, équilibré. Puis la révolution bolchévique est arrivée, avec ses modèles finalement inspirés du capitalisme de guerre. Et ce n’est que maintenant que l’on revient, après une grande parenthèse, aux inspirations du XIXème siècle. Avec la date anniversaire de la loi de 1901, dans le socialisme associatif, dans le mouvement coopératif, en parlant de commerce équitable, on imagine la société telle qu’on la voudrait, non pas politiquement dirigée militairement avec une construction administrative massive, mais dirigée d’une manière plus directe, démocratique. Monatte s’est heurté à un mur de fer, les autres en face étaient de bonne foi, ils disaient la voie du socialisme c’est ce qui se passe en URSS. Il y a eu cette espèce de grande illusion et à la fois de grand affrontement.
Colette C. : Je trouve qu’on peut reprendre la formule du romancier italien Ignacio Silone : « Le grain sous la neige ». Il y a effectivement des courants du XIXème siècle et du début du XXème qui remontent. La chute du communisme et 1968 a libéré les esprits, on ne fonctionne plus en lançant l’excommunication sur les uns et les autres. Maintenant, on peut lire Proudhon ou Bakounine sans éternellement les opposer à Marx, parce que chez eux aussi il y a des levains de la pensée. On a donc retrouvé une certaine liberté.
Jean-Pierre Juillard : Je voudrais rajouter pour redonner de l’optimisme, que si la puissance du système capitaliste est quasi totale, presque absolue, elle est en même temps d’une très grande fragilité, ne serait-ce que parce que le système n’est pas transposable de façon universelle. Imaginons un instant que les deux milliards et demi d’Indiens et de Chinois veuillent vivre comme nous, tout explose. D’ailleurs les crises de la vache folle, de la fièvre aphteuse, etc., montrent bien la fragilité du système.
Colette C : Ca va vous paraître bizarre, mais je crois qu’il vaut mieux être opprimée par le capitalisme, parce qu’on sait qu’il est l’ennemi, plutôt que par le stalinisme parce qu’on pensait que c’étaient des amis, et qu’il est toujours plus douloureux d’être torturé par des amis.
Elie : Je suis plus pessimiste que vous, car je pense qu’il y a une « dépolitisation » de la vie publique. S’il y a effritement du mouvement syndical, c’est qu’actuellement il n’y a pas unification des volontés, mais une tendance à tomber dans le piège du spectaculaire. Par exemple, sur un dossier bien précis tel que celui de la fièvre aphteuse, alors qu’on est en plein génocide du bestiaire européen, il n’y a pas de contact entre les syndicats et les citoyens. Finalement malgré Internet et le reste, on communique beaucoup moins qu’avant. Il faudrait peut-être revenir en arrière, être un peu plus modestes pour ne pas verser dans ce système de starmania, via Zidane, et s’éloigner de ce monde complètement factice fabriqué par des capitalistes qui savent très bien que notre esprit manque de sens critique. On a le syndicat qu’on mérite. Actuellement s’il y a moins de ferveur syndicale c’est qu’il y a moins de conscience politique citoyenne.
Colette C. : Je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste. Monatte lui-même, mon père qui avait toujours milité, ne savaient pas à la fin de leur vie s’ils étaient optimistes ou pessimistes. Ils auraient sans doute employé la formule de Guillaume d’Orange : « Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». L’optimisme béat rend idiot et le pessimisme total rend stérile.
Jean-Pierre Juillard : Gramsci dit « le pessimisme de la raison et l’optimisme de la volonté », c’est-à-dire avoir la lucidité de voir le monde tel qu’il est et ce n’est pas drôle, et en même temps vouloir rester debout.
Un intervenant : Une remarque en ce qui concerne l’expérience soviétique. Elle a d’abord été un exemple, puis un contre-exemple. On nous dit que le communisme n’est pas possible, parce qu’on en a déjà fait l’expérience et que ça n’a pas marché. Mais il faut se méfier, ce n’est pas parce que cela a raté que ça ne peut pas marcher. Sur un autre plan, être militant c’est essentiellement faire de la communication. Il est vrai que par rapport aux médias actuels, on a du retard. Donc il faut se mobiliser beaucoup plus, tout en sachant qu’on baigne dans un milieu où on est piégé, il suffit de voir José Bové à l’émission de Michel Druker, menottes aux mains, pour se dire que quelque chose « cloche » au niveau de la médiatisation. Cela décrédibilise beaucoup l’action militante. Je me souviens des débats de Marchais à la télé, tout le monde regardait, parce qu' »on se fendait la gueule », c’était mieux que les Guignols, mais au point de vue du résultat militant, il n’est pas sûr que cela ait été vraiment efficace.
Colette C. : Pour en revenir à l’expérience soviétique, je crois qu’on ne peut pas imputer à Marx et à Lénine toutes les déviations qu’il y a eu. Effectivement, ce n’est pas le communisme qui a échoué, c’est une certaine forme de communisme et il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Maintenant, tout le monde est anti-communiste, mais comptabiliser les crimes des uns, des autres, est-ce que c’est la même chose que le nazisme ? etc., ce ne sont pas des vrais débats. Ce qui importe, c’est d’essayer de comprendre et de ne pas recommencer si on refait une expérience de ce genre.
Daniel Couty : A propos de Seattle, il y a un peu trop d’optimisme de penser que le capitalisme est en train de trembler parce qu’il y a quelques escarmouches. Pourtant ce serait important de gagner maintenant car si des militants sincères avaient quelques succès, ils gagneraient d’autre gens à leur cause. Or, à l’heure actuelle, il y a quelqu’un qui est plus fort que moi en lutte de classes, c’est mon patron à l’hôpital où je travaille.
Sur les visions du monde, je suis d’accord, mais il faut moduler : je préfère quand même des gens courageux, capables de défendre leurs collègues, d’affronter leur patron même s’ils n’ont pas une grande vision du monde, que le contraire.
Jean-Pierre Juillard conclut : « Il faut maintenant que tout ça trotte dans nos têtes, que l’on essaie d’utiliser les petits quelque chose qu’on aura pu saisir là où on est ».
Compte-rendu : Michèle MANDON.
« Compte sur toi-même et sur tes camarades »
Pourquoi intervenir dans ce débat ? Parce que je ne peux plus entendre des contre-vérités, parce que peut-être j’ai le droit si ce n’est le devoir de transmettre ! Parce que aussi les jeunes générations ont le droit de savoir « La cime de l’arbre peut-elle ignorer ses racines? »
Transmettre malgré mes difficultés, mes limites et toute la subjectivité dont je suis capable, c’est le lot je crois du témoin ! Mais l’Histoire, la grande, se fait avec des historiens certes, et aussi l’ensemble des témoins tels qu’ils sont. Cette intervention n’aura donc valeur que de témoignage et n’engagera que moi!
Je me suis engagé syndicalement au début des années 60. En 1962 ou 1963, la date exacte n’est plus très précise dans ma mémoire. Pour situer mon témoignage je suis contraint, je crois de donner quelques explications.
Je revenais à l’époque de ce que l’on appelle enfin aujourd’hui « la guerre d’Algérie » où j’avais côtoyé le pire et le meilleur, l’horreur et le sublime. J’étais revenu complètement déstabilisé et mon obsession était de construire, contrairement à ce que l’on m’avait invité à faire! De plus un mouvement de jeunes, la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) m’invitait entre autres à l' »engagement ». C’était le maître mot!
J’ai adhéré à l’USC-CGT (Union syndicale de la construction), organisme de coordination pour le département des syndicats du bâtiment et des travaux publics. Je pensais que le paiement d’une cotisation à un syndicat « général » suffisait. Une garantie, une assurance, en quelque sorte! Ce n’était pas du tout l’orientation de l’organisation syndicale de l’époque, qui se battait au contraire pour décentraliser la création de syndicats d’entreprise.
J’ai embauché dans une entreprise de second oeuvre (peinture en bâtiment) où nous étions à l’époque environ 110 à 120 salariés! Malgré une ou deux tentatives il n’y avait jamais eu de syndicat dans cette entreprise. Avec un autre camarade, l’aide et le soutien de l’USC, nous avons mis en place un syndicat d’entreprise et un comité d’entreprise. La principale difficulté : trouver des candidats, car le mandat de délégué impliquait beaucoup d’engagement, d’abnégation, de don de soi! Je voudrais insister ici sur tout ce que nous a apporté et fait vivre cette expérience.
Sur le plan du dialogue : notre rôle de porte-parole, d’intermédiaire nous faisait rencontrer régulièrement les travailleurs qui nous avaient mandatés et le patron qu’il a fallu habituer à nous recevoir! Nous établissions et exercions en quelque sorte un « contre-pouvoir », ce que les patrons, en règle générale n’appréciaient pas!
Sur le plan matériel je ne voudrais pas m’exercer ici à un bilan, mais les augmentations de salaire, les changements de classifications, la formation que nous nous efforcions de promouvoir, les problèmes de déplacement, d’hygiène et de sécurité inhérents à la profession et à l’entreprise et que nous devions souvent régler au cas par cas… tout cela a apporté incontestablement une grande amélioration dans nos conditions de vie. Notre rôle au comité d’entreprise fut surtout de gérer des oeuvres sociales que nous avions mises en place mais ce fut d’un apport considérable pour une entreprise de cette taille. Tout cet acquis a été obtenu souvent par la négociation et parfois aussi par le rapport de force : deux mouvements importants, 1968, trois semaines de grève et quelques années plus tard un mois de grève, à raison d’une puis deux heures chaque jour devant le siège de l’entreprise où nous avons obtenu une amélioration sur l’accord de « petit déplacement ». L’importance de la vie syndicale dans l’entreprise c’est que, entre autres, nous étions devenus les propres acteurs de notre libération! C’est dans cet esprit que je reprends volontiers ce que dit Colette Chambelland en citant Monatte dans la Lettre du cercle de mars-avril 2001. « Monatte pense que la lutte syndicale à la fois révolutionnaire et réformiste est porteuse de changements essentiels dans la vie quotidienne des opprimés… » et plus bas « compte sur toi-même et sur tes camarades ».
A souligner aussi dans cette expérience des valeurs vécues et partagées telles que entr’aide, solidarité, fraternité. Je ne sais si cette dimension peut être prise en compte par des historiens, des sociologues ; alors qu’on me laisse rêver une seconde seulement ! En tout cas je le pense ces valeurs sont à transmettre et à reconstruire, chaque jour la vie continue.
Enfin je voudrais répondre à des idées souvent répandues, parfois reprises dans les médias. « Les syndicats sont en perte de vitesse, ils sont dépassés ; ils ne mobilisent plus. C’est de l’histoire ancienne ». Il est vrai qu’il faut toujours ramer à contre-courant dans ce système basé sur le profit. Je pense pour ma part que si les syndicats n’existaient plus il faudrait les réinventer. Nos anciens n’ont pas trouvé d’autres moyens pour se libérer!
« Il n’y a plus de classes sociales! » Ceux qui disent cela souvent sont ceux qui ont intérêt à ce que la société reste divisée en classes. « Il n’y a pas de lutte des classes » : devant la couleur noire peut-on dire qu’elle est blanche? « Il n’y a pas de démocratie dans un syndicat, c’est l’affaire de « petit chefs » ». Dans notre organisation les décisions importantes se prenaient souvent en assemblée générale au moyen d’un vote. Fréquemment nous consultions nos camarades soit directement soit par tract. La chanson de Jean Ferrat me revient en mémoire : « On me dit à présent que ces mots n’ont plus court… », « je twisterais les mots…. »
Aujourd’hui faut-il « raper » les mots ? Comment faut-il transmettre ?
Robert COURIVAUD.
Syndicalisme et lutte des classes
Un abîme sépare le syndicalisme de lutte auquel nous devons les conquêtes essentielles du monde du travail, du syndicalisme actuel.
Il n’y a jamais eu de cadeaux, sinon empoisonnés, des patrons et des gouvernements. Seule la lutte les a fait reculer.
Le syndicalisme actuel, fait de rencontres fréquentes et de discussions, appelle régulièrement à la négociation, alors que la mobilisation et l’appel à la grève sont la base de l’action de classe.
La dispersion et des revendications souvent décevantes sont la règle aujourd’hui. Les grèves de 24 heures, symboliques, n’apportent rien. La solidarité, arme de classe essentielle dans la lutte des classes, est ignorée.
Les acquis dont parle le syndicalisme actuel n’ont jamais existé. Il n’y a que des conquêtes toujours menacées. Les acquis prouveraient une progression régulière et jamais remise en cause par le patronat. Ils justifieraient partenariat et participation commune dans la gestion de fonds appartenant aux seuls travailleurs ; or le patronat n’a jamais cessé depuis qu’il existe de tenter de reprendre ce qu’il a dû concéder. La Bourse le prouve chaque jour : chaque recul des travailleurs est fêté par le capital comme une victoire.
Le syndicalisme actuel, aveugle ou soumis, ne veut plus admettre cette vérité évidente : les intérêts de travailleurs et des exploiteurs sont inconciliables aujourd’hui comme hier. Le syndicalisme de lutte en avait tiré les leçons, toujours valables. Ennemies de classe, ces deux catégories ne pouvaient que s’affronter. L’épreuve de force est inévitable et permanente. La paix sociale était et est duperie, seuls les armistices sont concevables.
Le syndicalisme actuel conciliant, participatif, est fait de confiance réciproque. Mais les patrons ne jouent pas le jeu. Devant cette « mauvaise volonté » patronale, déçu, le syndicalisme actuel appelle à la rescousse les politiques qui avouent « on ne dirige pas l’économie », pendant que Tietmeyer[1] rappelle que « les gouvernements sont sous la surveillance des marchés ».
Pour le syndicalisme actuel, le libéralisme, l’ultra-libéralisme, sont des erreurs momentanées, des perversions d’un capitalisme qui doit revenir à la raison. Pour le patronat toutes les occasions, tous les moyens, sont bons pour accroître les profits. Licenciements, délocalisations, menaces, chantage, précarité, violences quotidiennes, le prouvent amplement. Cela n’est pas nouveau. L’absence de réactions sérieuses ne peut que les encourager à persévérer.
Pendant ce temps, le syndicalisme actuel se livre à ses sempiternelles querelles de chapelles, querelles qui sont le plus souvent le reflet de choix politiques étrangers aux intérêts des travailleurs et servant des factions politiques sans rapport avec la lutte des classes. L’ultralibéralisme n’est que le capitalisme triomphant qui ne trouve aucun adversaire sérieux face à lui, mais des luttes dispersées, impuissantes. L’occasion fait le larron. Il est maître sur le terrain.
Devenus ambassadeurs et généraux sans armée réelle, les responsables font semblant de croire que leurs proclamations valent mieux que l’épreuve de force que préparaient les partisans de la lutte des classes, qu’un de leurs discours vaut mieux que des millions de travailleurs en lutte.
A la demande d’un patronat toujours plus puissant, les lois Auroux, Balladur, Delebarre, Rocard, Aubry ont fait sauter tous les verrous qui le gênaient. Ce qui confirme ce que disait Tietmeyer. Bien regroupés, les grands trusts dirigent Bruxelles et veillent à ce que les pays de la Communauté obéissent.
Le syndicalisme actuel ne sait qu’appeler au civisme et à la citoyenneté que le patronat a toujours ignorés. Quel patron a jamais hésité entre licenciements et bénéfices accrus ? Où sont les entreprises citoyennes ?
Les leçons de morale ne s’adressent qu’aux exploités.
La violence patronale est toujours enrobée de bonnes raisons. L’inavouable est toujours derrière. La misère croissante partout dans le monde en est la preuve.
Dans le monde, les accidents du travail font un million de morts par an (officiellement), le nombre d’enfants esclaves est énorme, les salaires des smicards sont en baisse régulière, leur nombre est passé de 2 à 15 %, en France. Tout est fait pour que les salaires soient tirés vers le bas.
Dans le syndicalisme actuel, les travailleurs sont des pions que l’on compte à chaque élection. Dans la lutte des classes, ils sont des acteurs essentiels et irremplaçables. L’isolement des secteurs les plus combatifs détruit la solidarité de classe. D’exemples à suivre, ils deviennent des maudits. Les travailleurs anglais payent cher ces tristes opérations.
Comme tous les chiffres le prouvent nous reculons, nous régressons dans tous les domaines.
L’emploi devient majoritairement précaire, flexible. Le CDI n’est plus l’essentiel du contrat social. 85% des emplois créés sont précaires. Le PARE[2] et l’impôt négatif ne visent qu’à recréer le STO (de sinistre mémoire), à faire disparaître l’indemnité de chômage au profit d’un assistanat, produit de la compassion et de la charité, en lieu et place de la solidarité.
L’encouragement des gouvernements aux bas salaires va dans le même sens. Aux 120 milliards offerts chaque année au patronat, s’ajoutent ces opérations créatrices de parias corvéables à merci. La couverture sociale se réduit chaque jour, des millions de travailleurs ne peuvent plus se soigner correctement. L’espérance de vie des plus pauvres est inférieure de six ans à celle des nantis. La médecine à deux vitesse va aggraver encore cette situation.
Les retraites sont visées. Leur versement dans cinq ans, dans trente ans ne posera aucun problème. C’est prouvé. Mais une campagne intense des banques et assurances vise à faire main basse sur la masse des cotisations. Cela dans un des pays les plus riches du monde, où le capitalisme affiche des bénéfices records (15 à 130 % de plus chaque année).
Il faut dire haut et fort, et cela confirme le bien-fondé de la lutte des classes aujourd’hui en panne, que la part des salaires dans le PIB est passée de 68 à 56% en dix ans. Mille milliards ont changé de poche, sont passés de la poche des travailleurs à celle des actionnaires.
La liste est longue de nos défaites, de nos reculs. Elle risque de s’allonger encore si les travailleurs sont divisés. Les transnationales font bloc lorsqu’il s’agit de baisser le coût du travail.
Le bilan du syndicalisme de participation, partenarial, est lamentable. C’est un bilan de faillite.
Le ralliement à la CES[3] (pseudo-syndicat créé par les libéraux de Bruxelles) de la majorité des confédérations européennes qui souhaitent son développement, et à qui Prodi a donné comme consigne de veiller à la modération salariale (blocage des salaires), l’approbation de la Charte européenne, régressive par rapport aux législations du travail nationales, tout cela confirme un ralliement à la pensée unique, une caution apportée à ces organismes intégrés. On proteste mais on y siège. Le débat d’idées entretient les illusions et les espoirs toujours déçus.
Rien ne remplace, ne remplacera, l’épreuve de force pour combattre la violence patronale.
Seuls les militants de base de plus en plus conscients de leur impuissance et des résultats décevants de leurs luttes peuvent combattre cette division destructrice voulue par les sommets. Il leur faut lui opposer solidarité et unité dans les luttes. Quelques luttes exemplaires, trop rares, trop isolées montrent la voie. Contestataires et résolues, elles inquiètent patronat et syndicats. Elles sont la preuve qu’elles ont donc retrouvé la ligne de la lutte des classes.
Revenir à ce syndicalisme dynamique et efficace sera long, difficile, mal accueilli. Il est nécessaire et porte en lui l’espoir de tous ceux qui ne veulent plus subir ni se résigner.
Raymond FRUGIER.
[1] Dirigeant de la Banque centrale européenne, NDLR.
[2] Plan d’aide au retour à l’emploi, nouvelle convention de l’UNEDIC qui régit les conditions d’indemnisation des chômeurs et définit par là même une norme d’emploi, NDLR.
[3]Confédération européenne des syndicats, NDLR.