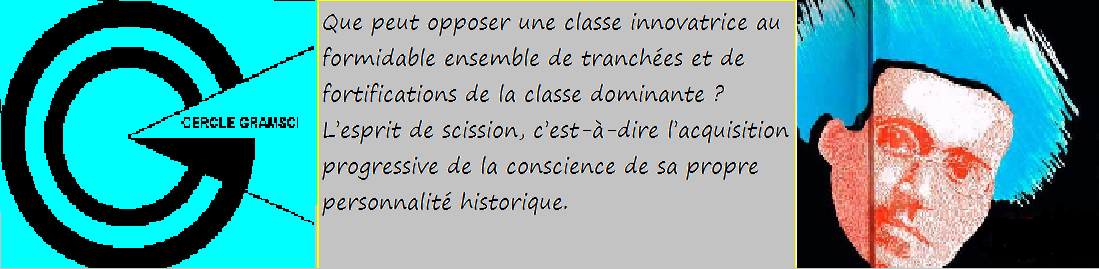Christophe Nouhaud au nom du cercle Gramsci explique le déroulement de cette soirée co-organisée avec le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples : Jacques Chevassus, du MRAP, va introduire le propos, puis laisser la parole aux trois intervenants qu’il va présenter.
Jacques CHEVASSUS : À l’occasion de la seconde Guerre mondiale les chemins des deux régions, Alsace et Limousin, se sont à plusieurs reprises croisés et se croisent encore. Deux régions différentes par la géographie, l’histoire, l’économie ; deux régions d’une même nation et d’un même État. L’Alsace est française depuis 1648, mais sa culture et sa langue sont germaniques. Notre objectif ce soir est de débattre entre nous des relations qui unissent le Limousin avec l’Alsace et la Moselle. Débattre de manière paisible, dépassionnée, mais dans la vérité, pour mieux comprendre et mieux se comprendre. Le MRAP et le cercle Gramsci ont invité Roland RIES, ancien maire de Strasbourg, et récemment élu sénateur du Bas-Rhin. Il s’est rendu, en tant que maire de Strasbourg, à Oradour le 10 juin 1998 : c’était la première fois qu’une telle visite avait lieu, et nous l’en remercions ici.
Les relations entre nos deux régions remontent à septembre 1939, au moment où le gouvernement a décidé d’évacuer les populations civiles des zones les plus menacées d’Alsace et de Moselle. Daniel BERNUSSOU, professeur d’histoire, parlera de la rencontre entre le Limousin et l’Alsace en 1939-1940. Auteur de Une saison d’Alsace en Limousin, Jean-Jacques FOUCHÉ vient d’écrire un ouvrage sur le procès de Bordeaux1. Nous avons aussi sollicité des témoins : Jean-Louis RISSE, professeur honoraire d’allemand à l’Université de Limoges, et Catherine LORICH qui vit en Limousin et dont une partie de la famille a été massacrée à Oradour. Il y aura peut-être d’autres témoignages au cours de la soirée.
Les relations entre Alsace et Limousin ne sont pas que dramatiques. Il y a aussi des jumelages : des Alsaciens et Mosellans reviennent à Chateauponsac, à Saint-Yrieix, à Saint-Sulpice-les-feuilles, à Eymoutiers, etc. Des Limousins vont en Alsace. Nous voulons que nos différences soient perçues comme des enrichissements.
Roland RIES : Je vous remercie et suis très heureux d’être ici ce soir. En dehors de mon initiative de 1998, je n’ai guère de titre pour vous parler de cette période.
Je suis le petit-fils d’un paysan du nord de l’Alsace qui ne parlait pas le français, et qui en découvrant une autre région a découvert une langue, une culture et des modes de vie qu’il ne connaissait pas. Il a appris en Limousin ses premiers mots de français rudimentaires. Je veux dire ici combien ces événements tragiques, ce déracinement des populations les a marquées. En-deçà d’Oradour, il y a eu des rapprochements de populations qui étaient inouïs : il faut se replacer dans le contexte d’une époque où les voyages étaient rares.
Mon histoire familiale m’a conduit à prendre l’initiative de 1998 avec Raymond Frugier, le maire d’Oradour. J’avais un devoir personnel à l’égard de mon père, qui a été enrôlé de force dans l’armée allemande, et qui a eu un destin classique en Alsace : militaire de carrière dans l’armée française en 1939, il a été démobilisé après la débâcle et remobilisé en 1943 comme incorporé de force, puis blessé sur le front Ouest (la plupart des Alsaciens étaient envoyés sur le front Est), et après la guerre il est revenu dans l’armée française. On comprend que toute cette génération a été ballottée par des événements qui la dépassaient. Mais voici une autre raison : un groupe de jeunes Alsaciens a fondé l’association Alsace-Tambov, et ils avaient décidé d’aller à Tambov, à 500 km au sud-ouest de Moscou : c’était un camp d’internement pour Alsaciens déserteurs de l’armée allemande ou prisonniers des Russes, dans lequel il y a eu beaucoup de morts. Ces jeunes avaient décidé de fleurir les fosses communes de Tambov, et parallèlement, ils voulaient aussi aller à Oradour. Ils ont été accueillis dans les familles d’Oradour, et à leur retour sont venus me voir et m’ont demandé, en tant que maire, de renouer le contact entre l’Alsace et le Limousin. J’ai téléphoné immédiatement, sous leurs yeux, au maire d’Oradour que je ne connaissais pas. C’est lui qui m’a suggéré de venir le 10 juin 1998 et de participer aux cérémonies commémorant le crime de guerre du 10 juin 1944. Je l’ai fait, et cela a été pour moi un moment d’extrême émotion. C’est sûrement le moment le plus fort de mon itinéraire personnel et politique.
J’en tire quelques leçons. On attend beaucoup des pouvoirs publics, mais il arrive souvent que les pouvoirs publics soient bloqués, et que des initiatives de citoyens aient débloqué des situations. C’est grâce à ces jeunes que les choses se sont faites. C’était la première fois qu’un élu important d’Alsace venait à Oradour commémorer le 10 juin 1944. Autre leçon : il se produit parfois des phénomènes imprévus. Je ne connaissais même pas le nom de Raymond Frugier ; pourtant dès les premiers coups de téléphone nous étions tous les deux motivés, ce qui a permis de surmonter bien des obstacles, car vous devinez que les choses ne se sont pas faites facilement. Encore aujoud’hui il reste des séquelles lourdes, notamment chez ceux qui ont vécu les événements. À travers un événement symbolique, c’est je crois cinquante ans de malentendu, cinquante ans de suspicion et de relations difficiles entre le Limousin et l’Alsace qui ont pu être dépassés. Il y avait dans cette situation un paradoxe : la France et l’Allemagne, ennemis héréditaires, se sont réconciliées au lendemain de la guerre en l’espace de quelques années. Le Conseil de l’Europe a été institué à Strasbourg en 1949. Mais il a fallu plus de cinquante ans pour que deux régions d’un même pays puissent de nouveau se rapprocher et essayer de se comprendre ! De mon point de vue, d’ailleurs, les choses ne sont pas encore définitivement gagnées. Les oppositions, aussi bien en Alsace qu’en Limousin, n’ont pas complètement désarmé : deux des trois statues que la ville de Strasbourg avait offertes à la commune d’Oradour en 1999, au moment de l’inauguration du Centre de la mémoire, ont été vandalisées. L’une des trois, paraît-il, avait été brisée par la tempête : elles étaient fragiles, comme l’indique le titre que l’artiste leur avait donné. De l’autre côté, en Alsace j’ai reçu des lettres d’insultes qui dénonçaient mon voyage : » Qu’êtes-vous allé demander pardon, alors que nos jeunes ont été incorporés de force dans l’armée allemande et que l’État français a abandonné l’Alsace ? » Or, je ne suis pas venu en Limousin pour demander pardon. Je suis venu pour tendre la main, et, sans oublier quoi que ce soit, essayer de dépasser cette incompréhension et renouer le contact entre nos deux régions. Aujourd’hui, à l’occasion du soixantième anniversaire (10 juin 2004) une délégation importante d’élus alsaciens du plus haut niveau (députés, sénateurs, Président du Conseil régional d’Alsace, Président du Conseil général, maire de Strasbourg) est venue à Oradour pour relancer ce processus.
Je veux dire un mot sur le fond de la question. Je pense que beaucoup d’approximations ont marqué les arguments échangés. Les passions ne sont pas complètement éteintes. Il faut continuer à expliquer qu’en Alsace nous avons une dette à l’égard du Limousin, d’une part à cause de l’accueil de 1939-1940, et d’autre part à cause de ce crime de guerre dans lequel quatorze Alsaciens (treize Malgré-nous et un volontaire) ont été impliqués. Cela doit être dit parce que c’est une vérité historique. Mais les Limousins ne doivent pas oublier non plus qu’à Oradour, parmi les 642 victimes, il y avait une cinquantaine d’Alsaciens et de Mosellans ; surtout il faut essayer de comprendre la réalité de ce qu’a été l’incorporation de force pour des fils de l’Alsace obligés d’endosser un uniforme qu’ils n’avaient pas choisi. C’est la raison pour laquelle le monument aux morts de Strasbourg ne porte que cette inscription : « À nos morts ». Il représente deux jeunes hommes torse nu, sans uniforme, dans les bras de leur mère. Les Alsaciens qui sont morts sous l’uniforme allemand, incorporés de force, ont été considérés dans ces circonstances-là comme morts pour la France. Cela peut paraître un paradoxe énorme, mais cela a été reconnu officiellement par les autorités françaises très tôt, et encore confirmé récemment à l’occasion d’un voyage du ministre des Anciens combattants à Tambov.
Voici mon analyse des événements et mes conclusions pour le présent et l’avenir : la responsabilité collective n’existe pas en droit. Il y a des individus, qui sont placés dans des circonstances particulières, et qui agissent comme ils peuvent d’après ce qu’ils sont. Il faut demander des comptes à ces individus, c’est normal ; mais en tirer des conclusions sur un état d’esprit collectif est très dangereux. C’est réducteur, et c’est construire des oppositions en cherchant à identifier des groupes humains. La création récente du Tribunal pénal international va dans ce sens : le TPI juge des individus, pas des groupes.
Le développement du terrorisme aujourd’hui (et Oradour était bien un crime terroriste) se fonde sur la distinction entre de supposés vrais humains, et des impies qui ne seraient pas tout à fait humains. À partir du moment où manque le respect de la vie humaine dans sa diversité, le pire devient possible.
Daniel BERNUSSOU : Je vais vous parler d’une rencontre virtuellement organisée dès 1934, par une planification2, et qui a été réalisée au moment de la déclaration de guerre. C’est ce que j’ai appelé un mariage arrangé.
Voici d’abord quelques données brutes, pour éclairer un dossier très mal connu, car nous sommes seulement quelques-uns à travailler là-dessus. De septembre 1939 à septembre 1940, 67 000 Alsaciens originaires du nord du Bas-Rhin (incluse la banlieue nord de Strasbourg) vivent parmi un petit peu plus de 200 000 Limousins, essentiellement Haut-Viennois. Le département compte 330 000 habitants, mais Limoges a été exemptée d’accueil car elle est susceptible d’être bombardée. Les Alsaciens sont donc placés en milieu rural. Cela fait un apport massif, dans un rapport de un à trois. Cela fait aussi un accueil extrêmement lourd : c’est pendant un an une prise en charge totale dans un contexte dramatique, car la » drôle de guerre » est tout de même la guerre. C’est donc une épreuve.
C’est une épreuve pour les deux populations : l’une est en exil intérieur, l’autre se voit imposer la présence d’une population qui lui est totalement étrangère. Je voudrais vous livrer quelques informations sur cette coexistence imposée, puis quelques hypothèses sur ce que j’appelle un effacement mémoriel.
Comment les deux populations ont-elles vécu cette coexistence ? En recoupant la presse locale, les archives, des entretiens, on obtient une réponse assez claire : ce fut un apprentissage très difficile, mais réussi. Pendant les trois premiers mois les tensions furent vives. Il y eut beaucoup de plaintes des Alsaciens, des critiques des Limousins, des circulaires préfectorales au ton alarmiste. Dans certaines communes du nord du département, les pouvoirs publics durent intervenir pour ramener le calme. Ces frictions ont deux causes : le fossé entre les deux populations était culturel et psychologique.
Pour les Limousins, la langue alsacienne est une étrangeté culturelle ; et certains Limousins (moins qu’on le dit) ont assimilé les Alsaciens aux Allemands : ils ont confondu langue et sentiment national.
L’administration a fait son travail, elle a très vite déminé le terrain. Au début, quelques Alsaciens se plaignent qu’on les traite de Boches, mais cela disparaît vite. Je crois que c’est aller trop loin que de considérer, comme certains historiens, que les Limousins ont fait aux Alsaciens un procès en patriotisme. Le sobriquet de » Ya-ya » traduit un agacement amusé, et surtout la gêne de communiquer avec une population adulte très peu francophone. Malgré la promotion de jeunes interprètes, cette gêne est sensible : les maires ne cessent de s’en plaindre. Pour les Alsaciens, l’étrangeté limousine, ce sont les conditions de vie : elles provoquent chez eux un véritable ahurissement. Les Alsaciens découvrent les WC au fond du jardin, l’absence d’eau courante et d’électricité, etc. Il y a eu sans doute des gestes, des mimiques, qui ont humilié des accueillants qui offraient ce qu’ils avaient.
Il y a aussi un malentendu sur le statut psychologique (non pas juridique) des Alsaciens. Les Limousins ont assisté au spectacle de leur arrivée : des cortèges de femmes, de vieillards, d’enfants harassés après une journée et demie de train, en tenue d’été, avec très peu de bagages car ils sont partis très vite ; donc des réfugiés, comme l’avaient été les Espagnols. On les acccueille avec le même sentiment de compassion. Mais comme les Espagnols, on estime qu’ils ne doivent manifester ni exigence ni critique. Les Alsaciens, eux, se considèrent (même s’ils s’appellent, je crois, des fugitifs) comme des évacués, « victimes » d’une mesure administrative, et ils ne veulent pas être victimes une deuxième fois. L’État qui les évacue doit leur assurer des conditions de vie satisfaisantes. Ils s’autorisent la revendication, ils mobilisent pour cela leurs élus. La deuxième explication, moins importante à mon avis, ce sont les déficiences de l’accueil et notamment de l’hébergement. Il faut reconnaître que la situation fin octobre est difficilement tenable. À cette date (un mois après leur arrivée) un rapport préfectoral signale qu’il y a encore un quart des évacués qui sont en hébergement collectif, c’est-à-dire dans des granges, des écoles, des hangars, des salles de bal, et le plus souvent sur la paille. Le préfet s’inquiète de ce que ces familles alsaciennes supportent de plus en plus mal les conditions d’inconfort et même d’insalubrité dans beaucoup de communes. Un famille limousine sur cinq héberge des évacués, ce qui est maximal compte tenu de l’exiguité du parc immobilier. Il y a eu assez peu de refus d’héberger. Les Limousins ont fait le maximum ; mais ce maximum était très loin de couvrir les besoins.
L’explication de cette défaillance, c’est qu’il y a eu un raté dans la planification ; et ce raté fut un raté alsacien. Je vais entrer dans des détails techniques. Les plans d’évacuation prévoient le départ de 38.000 habitants de la zone » avant « , c’est à dire celle comprise entre la frontière et la ligne Maginot. Ces gens-là sont évacuables dès la déclaration de guerre.
28.000 habitants de la zone » arrière » sont, eux, évacuables selon l’appréciation de l’Armée et l’évolution des hostilités. Il était prévu que les évacués de la zone » avant » seraient accueillis dans certaines communes limousines, et les évacués de la zone » arrière » dans d’autres. Le ratio de charge est de 32%. Mais à la mi-octobre, dans certaines communes de l’arrondissement de Bellac et de Rochechouart, la charge dépasse 56% et la situation devient critique. Il est arrivé beaucoup plus d’évacués de la zone » avant » que prévu ; il y a aussi 24 000 Parisiens, évacués volontaires, qui reviennent dans leurs familles. Malgré cela, à partir de la fin décembre 1939 les tensions s’atténuent, les plaintes se font plus rares, les propos alarmistes se dissipent, on voit apparaître des activités communes (chorales, sports) et la coexistence s’apaise.
Quatre grands facteurs
d’apaisement
Le premier, c’est que l’administration a pris à bras-le-corps le problème de l’hébergement avec un programme très lourd de construction de baraquements et de réparation de logements privés, et surtout parce qu’on a redistribué géographiquement les évacués. On a à peu près déplacé 10% des arrivés de septembre en organisant une deuxième évacuation pour les installer dans des communes parfois très éloignées. Par exemple à Darnac il y avait deux communes alsaciennes, dont l’une a demandé à être déplacée ; on lui a fait traverser tout le département pour l’installer à Nexon, qui n’avait pas reçu d’évacués car Nexon devait recevoir une commune » arrière « . Voici une anecdote qui, vous allez le voir, a son importance : dans le cadre de cette redistribution géographique, il a été prévu dès fin septembre de construire des » villages alsaciens « , en fait des agglomérations de baraques. Réalisés trop lentement, ils ne furent finis qu’au moment où ils devenaient inutiles. Pourtant, ils ont servi à autre chose quelques mois plus tard : Saint-Paul, Nexon, Saint-Germain3… les Alsaciens (qui n’y sont évidemment pour rien) ont laissé là un » cadeau » dont on se serait passé.
Le deuxième facteur d’apaisement est l’autonomisation des familles alsaciennes. Début janvier, les Alsaciens sont devenus des acteurs de leur propre séjour, capables d’acheter, de négocier.
Le troisième facteur d’apaisement, ce sont les retombées économiques de la présence des Alsaciens. L’État a équipé, et il s’est adressé pour cela à des maisons limogeoises. Je ne citerai pas de nom, mais certaines de ces maisons ont fait des bénéfices rondelets. Les commerçants disent tous qu’ils ont beaucoup vendu, à des gens qui payaient comptant. Les Alsaciens furent même accusés dans certaines communes de faire monter les prix. Les agriculteurs ne se sont pas plaints non plus de cette main-d’œuvre courageuse, et très peu chère parce que non déclarée, aucune des deux parties n’ayant intérêt à déclarer : les Alsaciens percevaient une indemnité qu’ils auraient pu perdre. Une centaine d’auxiliaires de mairie limousins ont été recrutés pour renforcer les secrétariats : voilà encore de petites retombées.
Quatrième facteur : deux initiatives très heureuses. Une pédagogie de l’Alsace a été réalisée par Michel Walter, président du Conseil général en résidence à Périgueux. Dans six articles extrêmement fouillés il a tenté d’expliquer aux Limousins et Dordognards ce qu’était l’Alsace. Il y a eu aussi l’organisation commune (suggérée par le gouvernement) de la fête de l’arbre de Noël en décembre 1939, avec distribution de jouets et de bonbons aux enfants limousins et alsaciens, marseillaise, discours, boissons. Cela a créé un moment d’émotion propice à l’apaisement. Au printemps 1940, les Alsaciens ne sont plus des réfugiés aux yeux des Limousins. Ils sont devenus des acteurs de la vie limousine.
Absence de mémoire collective
Des mémoires individuelles ou familiales se sont construites très tôt, sur la base de liens tissés en diverses occasions. Mais ce qui m’intéresse ici c’est la mémoire publique, la mémoire collective, qu’elle soit officielle ou non. Or jusqu’aux années 1970, il n’y a pratiquement pas de trace mémorielle, aucun rappel de l’épisode, aucun écrit, aucune étude ni aucune commémoration.
Pourquoi un tel silence ? Voici trois hypothèses. Premièrement, même s’il y a eu apaisement, il y a eu maintien d’une distance sans doute irréductible entre les deux populations. C’est plus profond que le fossé linguistique : en septembre 1939 s’est installée en Limousin une petite Alsace, avec sa spécificité irréductible, linguistique, administrative et juridique (le régime concordataire). Ce fut une imposition plutôt qu’une greffe. Un exemple : l’école, c’était l’occasion rêvée du brassage, avec des gosses curieux et francophones. Or cette occasion n’a pas été saisie. L’école publique alsacienne est confessionnelle. En quelques semaines est née une seconde école publique en Limousin. Sur les 11.000 élèves alsaciens, seulement 800 (7%) sont éduqués sur les mêmes bancs que les petits Limousins ; et ils ne sont que 4% à fréquenter la cantine, tellement la soupe limousine est appréciée.
Une deuxième hypothèse est l’impossibilité pour les Limousins de se forger une représentation claire et globale de l’épisode alsacien. La visibilité des Alsaciens dans le département est kaléidoscopique : certaines communes ont des évacués, d’autres non ; certaines communes ont l’ensemble d’une entité communale alsacienne, d’autres non. Par exemple Schiltigheim compte 8700 évacués, répartis sur 20 communes limousines.
Comment un habitant d’Oradour-sur-Glane, qui vit parmi 500 évacués, pourrait-il comprendre la réalité de Schiltigheim ? Le séjour alsacien est inintelligible pour les Limousins, essentiellemnet parce qu’il n’y a pas eu de pédagogie limousine. La presse se contente de reproduire le discours administratif ; ses tentatives d’investigation sont soumises à la censure. Les seules tentatives ont été celles de Michel Walter et de L’Écho de Saint-Yrieix. Il n’y a eu aucun discours politique pendant le séjour des Alsaciens ; le maire de Limoges Léon Betoulle leur fait un petit bonjour rapide. Cela n’a jamais été une affaire politique : c’est une affaire administrative. Pas de discours syndical non plus, sauf celui du SNI4 qui a une approche strictement corporatiste et se désole de la mise en place de la deuxième école et de quelques cas d’empiètement de curés alsaciens. En fait, il y a un seul discours clair, tenu du début jusqu’à la fin : c’est le discours catholique. L’évêque, relayé par des curés très actifs, essaye de ne pas laisser passer la chance historique de la présence alsacienne. Comme le dit le curé du Dorat, il faut provoquer le réveil de » la foi endormie par cinquante ans de laïcisme « . Les Limousins ont donc une perception très éclatée. Ils ont un vécu, mais sans compréhension. Cela va faciliter un effacement mémoriel, car il est très difficile de construire une mémoire sur quelque chose d’aussi flottant.
Troisième explication : le séjour alsacien n’a pas fabriqué de mémoire parce qu’il a été très rapidement considéré comme un non-événement. D’une part, l’administration tient aux Limousins le discours suivant : » Vous faites votre devoir patriotique, qui vous coûte ; mais d’autres font plus (les soldats, les Alsaciens eux-mêmes qui sont en exil) et on ne va pas vous féliciter car ce que vous faites est normal. » Et comme ce discours s’adresse à une population culturellement dominée, à une population pauvre qui a l’habitude de se priver, il est facilement accepté. D’ailleurs, en minorant l’importance de la contribution, on efface aussi les humiliations, les blessures d’amour-propre. D’autre part, il y a eu le grand jeu de la concurrence mémorielle au sortir de la guerre. Le séjour alsacien ne pèse rien : pas de héros dans cette affaire, donc pas de droit sacré au souvenir ; cela ne peut pas lutter contre la mémoire de la Résistance. Pas de victime, donc pas de devoir de mémoire au nom de l’humanité meurtrie, et ce souvenir ne peut pas concurrencer non plus Oradour. L’épisode alsacien s’inscrit dans une histoire ordinaire et mérite d’être oublié.
Pourtant, depuis vingt ans cette mémoire est réactivée. C’est souvent à l’initiative des Alsaciens des deuxième ou troisième générations. Il y a une quinzaine de jumelages, des visites, des baptèmes de rues. Le travail des historiens continue. Fidélité au passé et connaissance du passé : voilà les deux piliers sur lesquels se construira peut-être la paix des mémoires.
Jean-Jacques FOUCHÉ : Je parle à partir d’une documentation, d’un dépouillement des archives. Mais je parle aussi à partir d’un vécu personnel, puisque j’ai travaillé quelques années vers 1970 à Strasbourg et en Moselle.
J’y ai rencontré Lucien, un secrétaire général de mairie qui m’a raconté sa vie. Incorporé de force en 1943, envoyé sur le front russe, il déserte. Les Russes lui donnent un porte-voix avec lequel il appelle ses camarades alsaciens à déserter. A Tambov, il a fait partie des 1500 rescapés qui ont été rapatriés vers l’Ouest via l’Irak. Voilà quelqu’un qui est parti de chez lui en uniforme allemand, puis qui a revêtu un vague vêtement russe, puis un uniforme britannique en Irak. Par l’Égypte et la Libye, il est arrivé à Alger et est entré dans l’armée de Delattre car il était venu pour cela. Il a fait le débarquement de Provence et a remonté la vallée du Rhône, et il est revenu chez lui. C’est un héros.
Voilà : il y a cette figure de l’incorporé de force qui est un héros. Elle est un peu effacée. Pourquoi ? Parce qu’au moment ou Lucien renre chez lui en Alsace, des » camarades » participent au massacre d’Oradour. Ce n’est d’ailleurs pas le seul massacre auquel des Alsaciens aient participé, bien qu’on en parle peu. Mais on peut, ici ou là, au fil d’un livre de souvenirs (et il y en a beaucoup, de ces livres souvent édités à compte d’auteur) retrouver en filigrane, à peine dite, une expérience indicible. C’est un village encerclé quelque part entre l’Ukraine et la Biélorussie ; les mitrailleuses pointées ; le feu mis au village et tous les habitants qui en sortent mitraillés. Il y a un silence dans ces récits de vie, sauf quelques mots au détour d’une phrase sur les atrocités nazies auxquelles les incorporés de force ont participé. C’est en effet de l’ordre de l’indicible. Et la vingtaine (je crois que le nombre est plutôt de cet ordre-là) de Français d’Alsace qui ont participé au massacre d’Oradour n’ont pratiquement pas pu raconter ce qu’ils ont fait pendant l’après midi où ils s’y sont trouvés.
Je crois qu’en particulier pour ceux qui étaient présents à Oradour, on est en présence d’un rituel d’incorporation dans la communauté des SS : cela en a tous les aspects.
Donc il y a l’indicible et le silence, malgré cette profusion de témoignages et de récits de vie. Il y a eu ensuite exploitation politique de ce qu’un sociologue de Strasbourg, Freddy Raphael, nomme » le dénuement des mémoires » des incorporés de force. C’est une mémoire de l’absurde, que montre bien le récit que faisait Roland Ries des pérégrinations de son père entre une armée et l’autre. Cette situation d’absence de sens a été exploitée par les partis politiques du début de la IVè République. La situation morale, politique, juridique des incorporés de force d’Alsace et de Moselle n’a pas eu de solution dans les années qui suivent la guerre. Là-dessus, les élus d’Alsace portent une responsabilité flagrante : ils n’ont pas fait le nécessaire. Or il y a des élus d’Alsace dans les gouvernements, dès le Gouvernement provisoire. Le RPF5 se crée à Strasbourg en avril 1947, à une période charnière où le gouvernement Ramadier SFIO6 vire les membres communistes du gouvernement. C’est le moment où s’opère la vraie naissance de la guerre froide. Le RPF se constitue en Alsace, et sera par la suite dominant dans la région comme le défenseur attitré des incorporés de force. Il les inclut littéralement dans son discours politique. Le RPF développe un anti-communisme véhément et une opposition farouche à toutes les initiatives du gouvernement auquel participe la deuxième force politique d’Alsace, le MRP7 démocrate social, issu des mouvements de la Résistance. Le RPF se constitue en récupérant un personnel politique ancien. Ainsi Georges Bourgeois, grand élu alsacien du Haut-Rhin sous la IVè République, est-il sénateur, puis député, président du Conseil général en permanence, et en même temps président de l’association départementale des incorporés de force. Le RPF a contrôlé ces associations. Au procès de Bordeaux en 1953, la défense va être organisée par des élus RPF qui sont dans le groupe des avocats qui s’appellera » la Défense alsacienne « . Ils vont aussi venir témoigner : c’est le cas de Georges Bourgeois.
Bourgeois a raconté sa vie. Huissier de justice mobilisé en 1939, démobilisé en 1940 et fait prisonnier, il revient en Alsace sans avoir rien demandé (il aurait pu rester dans un stalag). Il quitte son ministère d’huissier parce que l’annexion l’obligeait à un acte d’allégeance, et il devient secrétaire de mairie d’un petit village. Il déclare à l’audience de Bordeaux : » J’agissais à la satisfaction de tous « … Mais qui est-ce, » tous « , à ce moment-là ?
Georges Bourgeois est incorporé de force. Il hésite à déserter, car il y a une répression sur les familles. C’est un thème constant chez les incorporés de force : le sacrifice. L’incorporé de force endosse l’uniforme honteux de l’occupant pour que la famille ne subisse pas la répression. Il se sacrifie. Ce thème du sacrifice va être re-malaxé ensuite, pour pouvoir rejoindre le sacrifice des résistants et des réfractaires.
Incorporé dans un tribunal militaire, Bourgeois s’évade après avoir, dit-il, reçu l’autorisation de sa femme. Il se cache jusqu’à la libération du territoire mosellan, puis rentre chez lui derrière les troupes alliées et prend le commandement des FFI le lendemain de la libération de son village… Ah ! tiens. Voilà comment une carrière s’ouvre, voilà comment un notable se construit.
Ce discours est celui de la déresponsabilisation. Que l’incorporation de force soit un crime de guerre, on le sait depuis l’ordonnance du 28 août 1944 ; mais la construction d’un discours de la victimisation va servir une instrumentalisation politique, et le RPF va en être le promoteur.
La loi du 15 septembre 1948, annoncée par Vincent Auriol (et son secrétaire d’Etat aux Anciens combattants François Mitterand) à Oradour dès le 10 juin 1947 lors de la pose de la première pierre du nouveau bourg, est anticonstitutionnelle, mais elle est votée par les deux chambres à l’unanimité après amendement. Elle instaure l’incorporation de force comme une excuse absolutoire. L’éventuel accusé (du crime d’Oradour, mais d’autres aussi) doit prouver qu’il n’a pas participé au massacre et/ou qu’il était incorporé de force. Les élus alsaciens ont fait le forcing pour le » ou « , mais c’est le » et » qui s’est imposé grâce aux élus issus de la Résistance. La loi de 1948 a été votée par les élus alsaciens parce qu’elle était favorable à leur électorat. Un élu ne vote pas par inadvertance ; lorsqu’en 1953 ces élus disent qu’ils ont mal voté ou n’ont pas compris, ils mentent. En 1948 il y a un conflit d’influence entre le PCF et la faction conservatrice représentée par le RPF et le MRP. Le PCF souhaite le châtiment des bourreaux d’Oradour ; une telle demande, ajoutée à l’affaire de Tambov, cela va ruiner l’influence du PCF en Alsace. Mais le PCF joue une carte contre les socialistes dans le centre de la France, notamment en Limousin, et l’idée est la suivante : l’influence perdue à l’Est sera regagnée dans le Centre. Le procès de 1953 apparaît comme vraiment inutile : pour les victimes, du fait de l’amnistie ; pour les accusés, car cette amnistie les enferme dans le silence, dans l’incapacité d’une reconstruction personnelle. Qu’est ce que ces hommes (et j’en connais) ont pu léguer à leurs enfants et à leurs petits-enfants ? Est-ce qu’une histoire peut se construire avec une absence de demande de pardon ? Seules les victimes sont capables de formuler un tel pardon, si on le leur demande. Elles peuvent le refuser : elles ont cet ultime pouvoir de pardonnner ou non. Or aucun des prévenus, condamnés puis amnistiés à Bordeaux, n’a jamais formulé la moindre demande de pardon. Donc quelque chose n’est pas fini. Ni les victimes ni les criminels n’ont eu la possibilité de renouer le fil de leur histoire personnelle.
TÉMOIGNAGES ET QUESTIONS
Camille SENON : En 1939, à cause du travail de mon père, momentanément nous n’habitions pas à Oradour-sur-Glane. Nous vivions à Oradour-Saint-Genest, où il y avait un village alsacien réfugié. J’avais quatorze ans et j’ai tissé des liens d’amitié avec les jeunes Alsaciens de mon âge. Lorsqu’ils sont repartis en 1940 ce fut le silence ; mais dès que l’Alsace a été libérée, une lettre est arrivée. Elle était passée par Oradour qui était détruit, pour venir me trouver à Limoges et j’ai retrouvé des amis alsaciens.
J’ai passé un concours des PTT en 1945, et en 1946 j’ai été nommée aux Chèques postaux de Strasbourg. Ce concours avait été ouvert dans toute la France spécialement pour l’Alsace-Lorraine : les jeunes Alsaciens-Lorrains de mon âge avaient fait leur scolarité dans des écoles allemandes, et les PTT ont refusé de faire un concours spécial pour eux. Nous avons ainsi été environ 800 jeunes de toute la France nommés stagiaires puis titularisés en Alsace, tandis que des jeunes Alsaciens étaient embauchés comme auxiliaires. On voit quelle faute l’administration a commise.
En arrivant, j’ai découvert ce que l’Alsace avait vécu durant l’annexion. L’interdiction de parler français, de porter un béret basque, etc., et aussi comment des familles étaient déchirées entre collaborateurs et francophiles. Il y avait même eu des résistants, dans des conditions très difficiles. De nombreux jeunes avaient perdu la vie sur le front de l’Est. Avec mes collègues et amis alsaciens, je n’ai jamais fait mystère de ce qui s’était passé à Oradour, où j’ai perdu des membres de ma famille. Le quotidien du Parti socialiste d’Alsace m’a même demandé de donner un témoignage. Je suis restée jusqu’en 1950 à Strasbourg et j’en suis partie avec des liens d’amitié très forts.
Losqu’en 1953 est intervenu le procès de Bordeaux, dans lequel j’ai été appelée à témoigner, j’ai eu du mal à comprendre le changement d’attitude de mes amis. Je croyais qu’à Bordeaux on ne jugeait pas l’Alsace, mais des hommes qui avaient participé à un massacre (et malheureusement, pas les principaux responsables). Je suis donc d’accord avec ce que dit Monsieur Fouché : il y a eu une instrumentalisation ; et si elle a pris de façon massive, c’est parce qu’il y avait des fautes de l’administration française.
Un autre exemple de ces fautes est celui des Chèques Postaux de Strasbourg, repliés en 1939 à Limoges. Je me souviens d’une collègue qui m’a dit : » En 1940, quand on nous a donné la possibilité de revenir à Strasbourg, nous sommes allés demander à la préfecture si nous rentrions bien en Alsace française. On nous a garanti que oui, mais dans la première gare alsacienne où nous sommes arrivés, il y avait la fanfare de l’armée allemande pour nous accueillir « . C’était resté comme une blessure en elle. Toutes ces choses expliquent que la population se soit massivement laissé entraîner par l’instrumentalisation politique. Certains de mes amis alsaciens ont été assez froids avec moi pendant quelques années. On entend encore des Alsaciens se plaindre que les victimes alsaciennes à Oradour ne soient pas mentionnées, ce qui est faux.
Jean-Louis RISSE : Je connais bien, pour différentes raisons, tous ceux qui sont à la tribune. Je ne suis » que » Mosellan, et la Moselle est petite par rapport à l’Alsace. Je suis né dans un village à 3 km de l’Allemagne et à 3 km de l’Alsace. J’avais en Limousin un vieux copain qui me demanda un jour d’où j’étais précisément. Je répondis : de la région de Sarreguemines. « Hou ! C’est mauvais par là ! » dit-il ; pour lui il y avait là-bas des gens un peu louches, qui auraient volontiers collaboré avec leurs voisins. J’ai dû lui expliquer longuement que s’il y en avait en effet, tous n’étaient pas germanophiles, loin de là.
Je revois le garde champêtre arriver devant la maison le 1er septembre 1939. J’avais cinq ans. Il a dit qu’il fallait laisser tous les animaux (vous imaginez ce que cela veut dire, pour des paysans) et être sur le quai de la gare à quinze heures avec trente kilos de bagages. Nous sommes partis en wagons à bestiaux, ce qui amusait beaucoup les enfants (pas les adultes) et après un long voyage nous sommes arrivés en Charente où une partie des Mosellans étaient réfugiés, comme on disait (il faudrait dire : évacués). Nous avons été surpris par la gentillesse des gens qui nous accueillaient, des paysans pour la plupart. C’est au point que beaucoup de Mosellans étaient malheureux de quitter ensuite leurs amis charentais en rentrant chez eux. Je me souviens que mon père s’est posé longuement la question, car j’avais trois frères plus âgés que moi et susceptibles d’être incorporés. Mais il avait confiance en Pétain, et pensait que ce vieux monsieur allait arranger les choses. Nous sommes partis. Nous avons commencé à déchanter à Saint-Dizier, où il y avait une sorte de camp de triage pour les réfugiés. On y refusait les mauvaises têtes, les Gitans, les Juifs. Je vois encore mon père sortir de cette immense salle où il y avait un portrait d’Hitler. Mon père était décomposé. Ces gens avaient toutes les archives de mon village et ils ont reproché à mon père d’avoir fait partie du Souvenir français, une association qui s’occupe des tombes des soldats. Nous sommes tout de même rentrés chez nous, où tout était en désordre : les armées (française et allemande) n’y étaient sûrement pas pour rien. Mais nous nous sommes installés ; nous nous croyions chez nous. Or un Gauleiter8, ami personnel du Führer, mettait de l’ordre dans la région. On a incorporé mon deuxième frère dans le service militarisé du travail ; pas le STO, le service allemand : les gens avaient un uniforme, ils » travaillotaient » un peu et subissaient surtout de l’endoctrinement. La deuxième alerte, c’est quand on a incorporé mon frère dans la Wermacht. Pensez que mon grand-père avait été soldat français. Mon père avait été incorporé dans le 99è régiment d’infanterie allemande à Saverne. Il n’aimait pas les Allemands du tout, et encore moins les Prussiens, mais le traité de Francfort avait dit que la Lorraine était allemande. Mon frère aîné était soldat français et je le vois encore en tenue bleu horizon avec ses bandes molletières qui tombaient toujours, puis en tenue kaki quand il a été rappelé pour occuper la ligne Maginot. Après la débâcle, il nous a rejoints en Charente car il avait été libéré comme Alsacien-Lorrain. Mon troisième frère a été incorporé dans le service du travail allemand, mais nous avons pu le récupérer et le cacher : il n’a pas été incorporé dans la Wermacht comme l’autre. Celui-ci est allé sur le front russe, il a été blessé, bien soigné par les chirugiens allemands, et il est revenu chez nous en convalescence. Il y a eu une longue discussion dans la famille : fallait-il qu’il retourne dans la Wermacht, ou non ? Il a décidé que oui. Il a été fait prisonnier par les Américains qui l’ont amené à Sarreguemines ; et là des FFI l’ont reconnu et ramené chez mes parents. Quant à moi, après avoir été prétendu allemand pendant quatre ans, j’ai été incorporé dans l’armée française et je suis allé en Algérie et au Maroc.
Libéré, j’ai repris mon métier d’enseignant. J’ai rencontré une Limousine et ma future belle-mère m’a demandé si j’étais Alsacien ou Lorrain. Quand j’ai dit que j’étais Lorrain, elle m’a dit : « Vous avez de la veine, sinon vous n’auriez pas eu ma fille ». Il faut dire qu’elle était Limousine, Limougeaude, Ponticaude9 et qu’elle défendait son honneur. Il y avait le terrible drame d’Oradour qui était comme une barrière entre nous. Mais les choses se sont bien passées. Elle a compris que ni moi ni ma famille n’y étaient pour rien… bien qu’on ne puisse guère savoir ce qui se passe, une fois que les gens sont incorporés dans une armée.
À l’école des officiers, pendant des manœuvres on nous a amenés à Oradour. Je m’attendais à ce qu’un officier supérieur nous dise : « On vous a montré ce qu’une armée ne doit pas faire ». Eh bien, je n’ai jamais entendu cela. En revanche, j’ai appris pendant mes classes qu’il fallait exécuter les ordres, et qu’on ne pouvait protester qu’ensuite. Alors je me pose des questions. Est-ce que c’est si facile que ça de se singulariser, quand on est dans une armée en campagne ? Ma belle-mère disait toujours qu’il fallait être un héros ; mais on sait bien que les héros, c’est plutôt rare. Je me demande ce que j’aurais fait, si j’avais été à la place de ces Alsaciens qui se sont trouvés pour leur malheur à Oradour. La réponse est très difficile. Je souhaite de tout cœur pouvoir être un héros dans ce cas-là, mais est-ce que j’en aurais la capacité ? Les gens sont malheureusement comme ils sont. Ils ne sont pas tous des héros, ils ne sont pas tous capables de se singulariser.
Cela n’a pas de sens, d’opposer les provinces ; l’accueil des Limousins et des Charentais aurait dû lier à tout jamais l’Alsace-Lorraine à ces régions. Malheureusement cela ne s’est pas passé comme ça. L’espoir, ce sont les efforts des jeunes pour surmonter cet oubli curieux, mais explicable. Mon souhait est qu’ils réussissent.
Quand ma fille s’est mariée, elle a cherché un peu tard une salle disponible pour la fête. Il n’y en avait plus, sauf à Oradour. Parmi les nombreux invités, il s’en est trouvé un seul pour me dire : » Comment avez-vous pu choisir Oradour ? » Je lui ai expliqué que nous n’avions pas choisi, mais que j’étais content de venir à Oradour, car les gens qui y vivent veulent vivre comme les autres [applaudissements].
Claude LAURETTE J’ai écrit au jour le jour ce que je faisais pendant la Libération, et j’ai donné mes carnets à des historiens. Je suis né dans un petit village à côté de Rochechouart, pas loin d’Oradour. Mes parents étaient les instituteurs du village. Un jour, les Espagnols ont rempli l’école, je m’en souviens très bien ; puis ce furent les Alsaciens qui ont rempli l’école, et après ça, il y a eu des étrangers, presque tous juifs, qu’on planquait là parce que c’était un coin perdu. Je n’ai pas eu l’impression (mais j’étais jeune, j’avais quatorze ans) que cela s’était mal passé avec les Alsaciens.
Les Espagnols sont presque tous restés. Certains Alsaciens sont restés aussi. Les uns et les autres se sont mis en valeur par le sport : le football. L’équipe de Rochecouart, à l’époque, jouait au plus haut niveau amateur. J’ai des souvenirs heureux du séjour des Alsaciens, dont l’un était amoureux de ma sœur, le pauvre ! et qui pleurait au moment de son départ.
Je connaissais bien Oradour, où j’avais un oncle dont la fille était institutrice. Elle, son époux et ses deux petits enfants ont été tués comme les autres. Vers mes dix-sept ans, j’étais élève-maître au lycée Gay-Lussac, car il n’y avait plus d’École normale. J’allais parfois jouer au football à Oradour : j’aurais pu m’y trouver le jour du massacre. Mon oncle était marchand de vin et son chai a été un lieu de massacre. Mon oncle, qui était la crème des hommes pourtant, se prétendait Croix de feu : c’était un mouvement de droite, qui s’est un peu racheté à la fin de la guerre en mettant l’accent sur le patriotisme.
Je suis entré au maquis le matin du 7 juin 1944. Quand les Allemands sont venus, ils ont envoyé des troupes à Saint-Junien et à Rochechouart, ils ont tiré sur quelques paysans qui passaient par là, et nous avons déménagé dans un château à Étagnac pour nous rapprocher des Allemands. Le lendemain, les chefs ont dit : « Il y a un convoi de la Croix rouge allemande qui doit passer sur la route d’Angoulême. On va l’attaquer, puisque c’est comme ça ». Vous voyez ce qu’on peut faire par esprit de vengeance. Le peu de temps que je suis resté aux FFI, j’ai vu et laissé faire des choses, comme des fusillades.
Roland RIES : Les témoignages que j’entends, et qui sont émouvants, montrent l’extrême complexité de situations qui ont dépassé des acteurs souvent très jeunes : dix-huit, dix-neuf ans, c’est l’âge des bourreaux d’Oradour. Je suis en désaccord avec ce qui a été dit tout à l’heure à propos de la demande de pardon. Elle annulerait à mon avis la notion de culpabilité directe ; or culpabilité il y a, certainement, mais culpabilité dans un contexte donné. Moi j’en reste à l’idée de la reconnaissance du crime. Ce n’est pas tout à fait la même chose : il faut reconnaître ce qui s’est passé, mais sans oublier un contexte très particulier. Je me tiens à cette idée-là parce que si en Alsace aujoud’hui vous parlez de demander pardon, alors nous ne sommes pas au bout de nos malentendus. Je suis d’accord pour que ce crime de guerre soit reconnu comme tel par les Alsaciens, mais on ne doit pas omettre le contexte.
Comme le montre le témoignage de Madame Senon, il y a eu dans toute cette période des maladresses commises à l’égard de l’Alsace. N’oublions pas qu’avant cette re-francisation d’après 1945 à laquelle, Madame, vous avez participé à votre manière, il y a eu la Umschaulung allemande ( » changement d’école « ) de 1940 à 1945, qui était une tentative de transformation culturelle ; il y a eu en 1918-1919 une tentative de francisation et de réduction de la différence alsacienne (en particulier les statuts locaux et le Concordat) qui a coûté très cher à la gauche alsacienne ; et avant cela entre 1870 et 1918, il y a eu une longue tentative pour intégrer l’Alsace dans le giron du Reich. Une bonne partie de Strasbourg aujourd’hui date architecturalement de cette époque-là. Elle a été construite grâce aux dommages de guerre payés par les Français après 1870. Strasbourg était la vitrine de la Germanie en direction de la latinité.
Jean-Jacques FOUCHÉ : Bien sûr qu’il n’y a pas à faire de demande de pardon collectivement, pas plus qu’il n’y a de responsabilié collective. Je parlais de la reconstruction possible des personnalités qui ont vécu ces événements. Ces gens-là ne peuvent pas se reconstruire. Que peuvent-ils transmettre ? Voilà quelle était ma question.
Le débat existe en Alsace, mais il est étouffé. En effet il y a disproportion entre le grand nombre de ceux qui ont accepté l’instrumentalisation politique, qui se sont lovés dans les plis d’une histoire-fiction, et le petit nombre de ceux qui ont été des réfractaires et qui ont porté une autre parole : par exemple la communauté juive, qui a été maltraitée en Alsace dès l’évacuation de 1939. Un certain nombre de problèmes ne sont pas résolus. L’histoire n’est pas écrite. Sur les incorporés de force, par exemple, il n’y a pas d’histoire quantitative : les nombres qui sont donnés sont contrôlés par des associations. La compréhension mutuelle ne viendra pas d’un impératif (le devoir de mémoire) mais d’un travail d’histoire, progressivement assumé. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, d’autant plus que les traces de la déresponsabilisatin instaurée par les élus de droite dans les années 1947-1950 sont encore très visibles aujourd’hui, notamment dans le vote alsacien d’extrême droite. Sur ce point, entre autres, un historien ou un politologue pourrait travailler. Il y a beaucoup d’archives qui n’ont pas été dépouillées. L’histoire de l’incorporation de force reste à faire.
La responsabilité collective est un non-sens. En revanche, il y a plusieurs fomes de responsabilité individuelle et il faut introduire des distinctions. Le philosophe Karl Jaspers l’a fait à l’intention des Allemands dans les années 1945-1946 et son livre De la culpabilité allemande (avec une préface de Pierre Vidal-Naquet) est remarquable. Il existe des niveaux différents de responsabilité. Il n’y a pas que la responsabilité pénale : il y a aussi la responsabilé politique, la responsabilité morale, la responsabilité métaphysique qui est de l’ordre de la solidarité. Une réflexion devrait pouvoir s’engager et des gens comme Freddy Raphael pourraient y aider. Mais je crains au contraire une fermeture : j’ai suivi la construction du mémorial Alsace-Moselle de Schirmeck, et dans le parcours muséographique proposé au visiteur, l’histoire d’Oradour n’apparaît qu’en 1953, au moment du procès, pas avant ! Le drame des Malgré-nous est présenté ; mais ce n’est pas tellement le drame d’avoir été à Oradour, c’est surtout celui d’avoir été impliqués dans un procès ! Cette affaire-là n’étant pas réglée, et en l’absence d’une histoire globale des incorporés de force, il est difficile d’aller plus loin tant que les chercheurs n’ont pas travaillé.
Catherine LORICH : On a beaucoup parlé de l’Alsace et c’est normal, mais nous sommes au moins deux Mosellans dans la salle. Pour prolonger ce que dit Monsieur Fouché, je dirai que l’histoire de l’Alsace n’est pas écrite, mais celle de la Moselle non plus, alors qu’on connaît un tout petit peu l’Alsace et pas du tout la Moselle. Il m’a fallu de nombreuses années pour découvrir l’histoire de ma propre famille. Mon grand-père a perdu un frère à Dachau et un frère et une sœur à Oradour-sur-Glane. Cela, je l’ai su très tôt ; mais le pourquoi du comment, je ne l’ai compris qu’imparfaitement, et après des recherches. Je savais bien que ce qu’on me racontait avait un aspect partisan.
Il est très difficile de faire parler les gens. Je n’ai pas réussi à faire parler mon père assez tôt pour réussir à comprendre un petit peu, alors qu’est-ce que je vais dire, moi, à mes enfants ? Et que sauront mes petits-enfants, au train où vont les choses et où l’on malmène la démocratie ? Il faut se dépêcher de recueillir les témoignages, parce que l’Alsace et la Moselle ont beoin de dire ce qu’elles ont été, en négatif et en positif.
Jean-Louis RISSE : J’évoquerai Jacques Gandeboeuf, qui devait être des nôtres ce soir. Il n’est ni Mosellan ni Alsacien, mais Auvergnat, c’est-à-dire presque Limousin. C’est un des rares Français « de l’intérieur » comme on dit, qui ait essayé de comprendre l’esprit compliqué des Mosellans. Il y est relativement bien arrivé, dans ses livres comme Le Silence rompu.
Mr BABAUDOU : Je veux dire un mot sur la complexité des choses. En 1940 les usines Proust de Rochechouart ont brûlé. Vous vous souvenez ? [acquiescements] Une collecte a été faite immédiatement par les Alsaciens pour les ouvriers des usines Proust. De tels gestes de solidarité ont été nombreux. Les Alsaciens sont repartis presque tous, car ils n’avaient pas perçu la germanisation de l’Alsace qui était en cours. Les seuls pour qui cela a fait débat, c’étaient les enseignants. Quelques familles d’enseignants se sont déchirées : je pense à une famille dont les deux parents sont repartis, et les deux filles sont restées.
Jacques CHEVASSUS : Cette soirée débat fait suite à un colloque qui s’est tenu dimanche et lundi à Château-Chervix et à Limoges, qui avait pour objet les conditions d’accueil des enfants juifs en Limousin pendant la guerre. Il y a eu de nombreux témoignages, qui ont tous relevé la générosité et la gentillesse de très nombreux Limousins.
Roland RIES : Sans Raymond Frugier, maire d’Oradour, qui est dans la salle, rien n’aurait pu se faire. Notre geste de 1998 a représenté une avancée décisive, même s’il y a des reculs.
Rédaction du compte rendu : Marc Guillaumie.