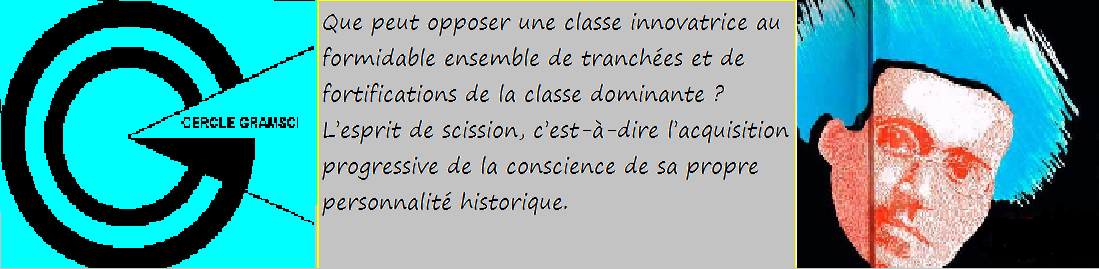Débat animé par : GEORGES CHATAIN
L’objectif de la soirée était de s’interroger, à l’aide d’une palette suffisamment large de témoignages de militants de tous âges, sur ce qui subsistait de la grande époque du Limousin Rouge, ouvrier et paysan (la première moitié du vingtième siècle).
L’autre question était de savoir, à travers ces multiples interventions et un débat collectif, comment se transmet cette tradition politique très particulière et son importance aujourd’hui.
Cette soirée de témoignages-réflexions a rassemblé un nombre important et diversifié d’intervenants qui ont faits preuve d’efforts d’introspection en termes de souvenirs et de réflexion sur leurs vies et expériences militantes.
Cependant l’ampleur du projet (large expression de témoignages, puis débat à partir de ceux–ci permettant de caractériser l’héritage militant du Limousin Rouge) ne pouvait se satisfaire d’une simple soirée de moins de trois heures .
Ainsi malgré la satisfaction de se retrouver, le 14 mai 2002 dans une salle d’assemblée bien remplie (130 à 150 participants), et d’avoir pu collecter une partie de la mémoire militante de la région, certains sont ressortis de cette soirée avec une certaine déception, celle de ne pas avoir véritablement eu un débat abordant le fond du sujet proposé.
Francis Juchereau ouvre la soirée en remerciant tous les témoins présents. Il rappelle que cette soirée s’inscrit dans le cadre des manifestations organisées par Mémoire ouvrière en Limousin, intitulées « Un siècle militant ». Cette soirée rassemble des acteurs du mouvement syndical, associatif ou politique pour débattre de leur propre histoire, en la reliant à une histoire commune : histoire vécue ensemble dans le présent, histoire héritée du passé par chacun en cette terre du Limousin.
Un certain nombre de personnes sont là ce soir, dont André Santrot, René Legros, Michel Pêcher, Roger Gorce, Michèle Gay, Louis Ballard, Jean-Pierre Juillard, Christophe Soulié, Philippe Babaudou, Angelo Campaner.
Georges Chatain :
Vous avez vu le titre : c’est bien « Limousin, terre d’une gauche spécifique », ça c’est historique ; mais il y a aussi le deuxième terme : « quel héritage dans les luttes d’aujourd’hui ? ».
Pour cette spécificité de gauche, j’ai relevé quelques exemples que je vais énumérer maintenant.
J’ai commencé par me souvenir d’une spécificité, celle de grands mouvements sociaux qui ont marqué l’histoire du Limousin : en 1895 la naissance de la CGT et en 1905 les célèbres émeutes-grèves insurrec-tionnelles, agitation qui avait fait de Limoges une ville que les gouverneurs de l’époque jugeaient dangereuse.
En 1895 et en 1905 il y a eu ces mouvements qui ont eu une particularité, je crois très limousine : c’est qu’ils n’ont pas été motivés par une revendication économique ou salariale, mais dans les deux cas par une revendication de dignité et de reconnaissance, indépendamment des grands thèmes de l’époque qui étaient la journée de huit heures et les retraites ouvrières.
En 1895, lorsque la CGT a réuni son congrès constitutif à Limoges, il y avait une grève des corsetières qui était motivée par le fait que le patron surveillait les pratiques religieuses de ses ouvrières et les obligeait à faire la prière du matin avant de se mettre au travail. Cette grève qui a duré près d’un mois a valu à une des meneuses, Marie Saderne, d’être à la tribune de la séance inaugurale du congrès constitutif de la CGT. Ce qui à l’époque avait suscité bien des moqueries d’un certain nombre de journaux nationaux, qui avaient dépêché des envoyés spéciaux et qui voyaient dans le fait de cette présence d’une femme à la tribune la preuve que tout ça n’était pas sérieux et que ça n’aurait pas de lendemain.
En 1905 le mouvement a commencé non pas sur des revendications salariales ou de temps de travail, mais sur des problèmes de harcèlement sexuel à l’intérieur d’une usine où un certain nombre de contre-maîtres s’étaient arrogé le droit de cuissage sur les ouvrières. Dans une usine de chaussures, un ouvrier avait été licencié parce qu’il avait enterré civilement son enfant mort en bas âge. Dans ces deux cas il y avait une caractéristique vraiment particulière à ce mouvement.
En 1914, lorsque la guerre a éclaté et que le Parti socialiste après l’assassinat de Jean Jaurès a décidé de participer au gouvernement d’Union sacrée avec la droite et a versé dans des propos extrêmement belliqueux, la Fédération de la Haute-Vienne a été l’une des rares à protester et à se dire opposée à la guerre. Le jour de la déclaration de guerre, dans le Populaire parut un éditorial de Paul Faure qui était sans équivoque et qui n’était pas du tout va-t-en-guerre et fleur au fusil, ce qui valut au Populaire d’être extrêmement surveillé par la censure militaire et de paraître pendant toute la guerre avec un certain nombre caviardages.
Cinq ans plus tard, avec le Congrès de Tours, il y a eu la scission qui a provoqué la naissance des deux partis de gauche rivaux : le congrès de Tours avait décidé d’adhérer à la troisième Internationale et la minorité, autour de Léon Blum, a décidé de continuer à exister en tant que parti socialiste, d’où la scission. A ce congrès, il y a eu une troisième motion, oubliée maintenant, la motion Pressemane, du nom du secrétaire fédéral de la Haute-Vienne, qui avait déposé une motion pour essayer de sauvegarder l’unité du parti ouvrier. Dans les passions du moment, évidemment, cette motion n’a eu que quelques voix, mais elle manifestait encore la singularité du regard limousin sur la politique.
Entre les deux guerres, le parti communiste a eu affaire avec des responsables, mal vus de la direction nationale : je pense au docteur Fraisseix qui était maire d’Eymoutiers, et qui a été mis sur la touche par la direction nationale du parti parce que il s’était opposé au mot d’ordre « classe contre classe » qui faisait que le Parti communiste voyait le Parti socialiste comme un adversaire à peu près égal à la droite. Fraisseix n’avait pas cette position, il a donc été écarté de la candidature à la députation. Il y a eu le député de Corrèze, Marius Vazeille, qui a été le premier député communiste rural et qui a rompu avec le Parti communiste au moment du pacte germano-soviétique.
Pendant la guerre, il y a évidemment « l’affaire Guingouin ». Guingouin qui avait désobéi aux ordres de la direction nationale clandestine du parti communiste, qui estimait que c’était un leurre de pouvoir organiser la lutte en milieu rural ; Jacques Duclos avait un point de vue très ouvriériste, pensant que seule la classe ouvrière pouvait lutter efficacement contre l’occupant. Guingouin a été considéré tour à tour comme un dangereux gauchiste, puis comme un opportuniste lorsqu’en 1944 la direction clandestine du Parti communiste a donné l’ordre d’attaquer les villes au moment du débarquement. Guingouin avait refusé d’attaquer Limoges parce qu’il estimait que ça risquait d’être trop lourd en vies humaines.
Après la guerre : c’est l’exemple des prêtres ouvriers, puisque Limoges était une terre de mission pour la reconquête par l’Eglise du monde ouvrier. A Limoges, il y avait un fort contingent de prêtres ouvriers. Lorsque la crise a éclaté, elle s’est beaucoup cristallisée sur Limoges et a abouti à la rupture de ces prêtres avec l’Eglise, et la plupart d’entre eux ont rejoint les syndicats ouvriers et souvent le parti communiste. Il y avait la figure d’Henri Chartreux qui a joué un rôle théorique très important dans cette rupture.
Et puis il y a eu la crise plus récente du Parti communiste avec Marcel Rigout, Jacques Jouve, Ellen Constans, députés, ainsi que la majorité des élus limousins communistes qui ont à ce moment-là rompu avec le Parti pour créer l’ADS.
Il y a eu aussi les dissidences paysannes qui avaient abouti à la création du Comité de Guéret, dissidence régionale de la ligne du syndicalisme agricole officiel, la FNSEA, tenue par les agrariens du Bassin parisien, les gros céréaliers. Ce comité avait joué un rôle très important dans les luttes paysannes des années 60.
Voilà : toutes ces ruptures, toutes ces dissidences, toutes ces indisciplines ont donné à cette région son visage si particulier.
Dominique Danthieu :
Je représente l’association « Mémoire ouvrière en Limousin ». On parle de tradition militante, et c’est vrai qu’en Haute-Vienne on a quelque chose d’intéressant qui est cet aspect très identitaire de la gauche.
Il faut savoir que la Fédération de la SFIO de la Haute-Vienne, dans les années 30, c’est pour beaucoup d’autres Fédérations en France un exemple, un modèle. C‘est un exemple par le travail de ses militants, par la force de ses organisations, à tel point que lorsque des hommages sont rendus, il y a des personnalités du parti socialiste SFIO qui viennent à Limoges et qui tiennent le même discours : « Finalement si tout le monde avait fait comme les militants de Haute-Vienne, la révolution serait déjà faite en France ». C’est une certaine forme d’hommage rendu au travail accompli localement par les militants.
Un deuxième point est aussi important : c’est la diversité, la richesse des organisations ouvrières (on pourra rapidement évoquer les organisations paysannes) de natures très diverses. Il y a les organisations politiques proprement dites, les partis classiques ; il y a aussi tout ce qui relève de l’association ouvrière : les coopératives, les mutuelles. Il faut rappeler la puissance de ces mouvements à Limoges, notamment du mouvement mutualiste qui est très bien implanté à Limoges à la fin du 19ième, au début du 20ième siècle ; du mouvement coopératif, riche de plusieurs expériences au long du 19ième siècle : coopératives de production, coopératives de consommation. Cela permet une tradition d’organisation, de structuration.
Deux bornes chronologiques qui sont importantes : 1895, 1905. C’est une décennie importante pour la tradition militante. Elle constitue un point de rencontre, entre le militantisme du 19ième siècle très associationniste, mutualiste, et un militantisme plus politique. Il y a un creuset militant dans ces années-là, l’affirmation d’une identité de contestation, (refus du travail en usine dans les conditions économiques de l’époque et traditions héritées de l’association) qui va rencontrer les théories du socialisme révolutionnaire de la fin du 19ième siècle. Je crois que tous les militants importants qui vont compter dans les années 1920-30, se forment dans les années 1895-1905. Ils sont jeunes, ils se sont engagés dans les syndicats, dans les mutuelles. Leur parcours est extrêmement riche et il cumule souvent plusieurs engagements ; on peut parler d’une véritable génération de 1905, dont le type est Adrien Pressemane.
Mais il faut souligner aussi la dimension rurale qui est importante, on l’a rappelée avec le comité de Guéret. C’est une des singularités. Et pour les historiens, c’est plus facile de travailler sur les villes, parce que l’on a souvent plus d’archives.
André Santrot :
Depuis 1943 jusqu’à ce jour, j’ai plus été confronté à l’action du moment qu’à la réflexion sur le passé historique de la région, qui a indiscutablement marqué et marque encore notre comportement. Dans la résistance à 17 ans, puis dans l’action politique et syndicale pendant 50 ans, je me consacre maintenant au rôle qu’ont encore à jouer les anciens combattants pour le devoir de mémoire, face à tous les révisionnismes et au fascisme toujours présent. Le comportement de gauche est particulier à notre région comme le conservatisme l’est dans d’autres régions. Le « pourquoi » est sans doute indispensable pour faciliter la tâche des historiens, difficile mais exaltante. Nul doute, la pauvreté de notre région a été un ferment de la lutte pour une vie meilleure. Les travailleurs au 19ième siècle qui quittaient le pays pour sauver leurs familles de la misère ont appris à lutter et ont laissé des enseignements qui probablement ont des retombées aujourd’hui. Des chercheurs compétents se penchant sur ces questions qui, je l’avoue, n’ont pas été à ce jour le premier de mes soucis. C’est sur eux que nous comptons pour éclairer l’histoire, car l’acteur est souvent inconscient d’en avoir écrit une page.
Que puis-je donc bien modestement apporter à la discussion, sinon relater des faits ?
Né en 1926, élevé dans le café-épicerie de ma grand-mère. Le dimanche après midi c’était le lieu de rendez-vous de quatre anciens combattants de 1914-18, et l’enfant que j’étais ne perdait pas une miette de leur discussion. J’ai la certitude d’avoir acquis à cette période l’amour de la paix et de la justice et aussi l’indifférence envers les décorations. C’est sans doute dès ce moment que des questions me sont venues à l’esprit. Je ne sais si elles ont influencé mon comportement ; ce que je sais c’est que je ne les ai jamais oubliées. En 1941, apprenti à la SNCF, je me suis trouvé dans une ambiance favorable pour réfléchir à la situation de l’époque. Les cheminots avaient en effet une conscience de classe très marquée. La vie à l’atelier du dépôt, c’était 10 heures par jour avec le ventre creux et un chef de dépôt allemand accompagné de son inséparable revolver. Nous avons appris à nous fabriquer des chaussettes russes avec les chiffons dans les sabots de bois et des bleus en lambeaux. Lorsqu’on travaille sur des machines à vapeur, sans savon pour se laver, c’est dur. Nous connaissions des résistants, mais ils ne voulaient en aucun cas nous enrôler dans la Résistance. Nous étions trop jeunes. J’ai le souvenir d’actions spontanées chez les apprentis. Elles auraient pu conduire à la catastrophe, car peu réfléchies. Un magnifique portrait de Pétain en couleur trônait au-dessus du tableau noir de la salle de cours. Quelle ne fut pas la stupeur du professeur de français, qui après s’être absenté quelques instants pendant que nous planchions sur le dernier discours du Maréchal, constata que l’image de notre sauveur avait été réduite en miettes avec des sabots récupérés aux vestiaires. L’affaire cependant ne dépassa pas les limites de l’Apprentissage, la sanction : un mois de suppression de détente du jeudi après-midi et la ration de biscuits caséinés supprimée. La promotion 1940-43, après le travail, prit le chemin de l’avenue des Bénédictins jusqu’à la place Jourdan sans être passée par le vestiaire. Le défilé, sans mot d’ordre, avait fière allure en tenue de travailleur sortant des entrailles d’une machine à vapeur. Ils protestaient à leur manière contre les conditions de travail. A partir de 1943, la majorité de cette promotion s’enrôla dans les légaux FTP, comme pour ma part je le fis en novembre 1943.
A partir de juin 1944, beaucoup de légaux rejoignirent les unités combattantes. Je puis affirmer que tous ces jeunes n’avaient pas été attirés par le drapeau et le patriotisme, mais plus simplement par le fait qu’ils refusaient de vivre à genoux, en esclave sous la botte du fascisme et que le spectre de la mort n’était rien par rapport à la vie qu’on leur proposait. Je n’évoquerai pas le rôle des maquis dans notre Limousin, les écrits sont nombreux. Je pense que notre région est restée fidèle aux traditions dans la lutte pour la liberté et la justice.
Concernant les traditions, j’ai constaté, pour avoir été pendant 30 ans délégué des roulants pour le dépôt et l’arrondissement de Limoges, des différences marquées entre chaque établissement. Lors des grèves, par exemple, on agissait différemment dans un centre par rapport à un autre. Si le but était le même, l’approche, l’action, les méthodes étaient particulières. A Périgueux, Aurillac ou Montluçon, ce n’était pas comme à Brive et c’était encore autre chose à Limoges. Cela se retrouvait également dans les délégations auprès de la direction. A Brive et Périgueux, par exemple, le point fort dans une grève, c’était le piquet de grève à l’entrée, voire l’occupation de l’atelier. Je voudrais citer ici un fait qui s’est passé à Limoges au cours d’une des grandes grèves des roulants de 1969, dans la foulée de Mai 68. 100% de grévistes à Limoges sans piquet de grève aux entrées ; le préfet téléphone au chef de dépôt, s’inquiétant du nombre de grévistes, et lui demande s’il souhaite l’intervention de la police pour évacuer les grévistes, qui vraisemblablement empêchent l’entrée de ceux qui veulent travailler. Et l’étonnement du préfet, quand le responsable SNCF lui dit : mais ici, il n’y a aucun piquet de grève. Le préfet de la Haute-Vienne n’était pas sur la même ligne que celui de la Corrèze, ou celui de la Dordogne. Ne peut-on pas voir dans cet exemple une tradition locale, et à quoi l’attribuer ? Dans la clandestinité, pourquoi un souvenir m’est-il revenu à l’esprit ? J’avais un arrière grand-père, décédé en 1931, chez qui j’allais souvent. Il m’avait acheté un fusil à flèches et comme cible, m’avait offert six dragons en terre cuite, magnifiquement peints. C’étaient mes cibles. J’avais 19 ans lorsque ce souvenir m’est apparu, je n’y avais jamais repensé avant. Ne doit-on pas voir là une image forte léguée par mon arrière grand-père ?
La tradition se forgeait sans doute autrefois autour des veillées familiales. Maintenant, après la radio, nous avons la télévision. La mémoire collective risque d’être orientée par les professionnels de la communication vers une pensée unique qui remplacera la pensée diversifiée. Nos journaux quotidiens, dans leur très grande majorité, ne sont plus le reflet d’une pensée locale. Ne parlons pas de la presse hebdomadaire qui a pour cible une partie très spécifique de notre société. A chacun son public, bien ciblé, pour ramener l’ensemble à une pensée unique.
Pourquoi en France a-t-on vu disparaître les petits journaux locaux de quartier, par exemple ? On se prive ainsi d’une littérature, sans doute pas très académique, mais qui avait le mérite d’avoir fait réfléchir des milliers de citoyens.
Par exemple le petit bimensuel, puis trimestriel qui a disparu dans ma commune faute de moyens financiers. Pendant trente ans, ce journal format 21×29 est sorti régulièrement à 2500 exemplaires, mais le dernier numéro en 1985 revenait à 5000F. Chaque numéro figure aux archives départementales et c’est sans doute intéressant pour quelqu’un qui voudra se pencher un jour sur la vie de cette commune. On pourra y trouver des choses intéressantes concernant les traditions. Si de tels écrits étaient encore possibles et conservés dans toute la France, n’aurait-on pas une vue plus réelle de ce que pense notre peuple au travers de sa diversité ? N’y a t-il pas là une identification des limites éventuelles d’une tradition ?
La responsabilité de ce muselage ne peut être nettement identifié, car les responsables de l’Etat, comme ceux de tous les partis, ont toujours considéré que cette diversité de langage nuisait à leur standing de dirigeant. Ils préfèrent pour faire peuple, à la veille d’élections, visiter les marchés et les foires qu’ils ont souvent ignorés pendant leurs mandats.
Les questions des jeunes sont parfois troublantes et j’avoue que j’ai été très surpris lorsqu’un groupe de jeunes collégiens qui préparait le concours de la Résistance était venu me contacter en 1992. La première question posée fut : combien avez-vous tué d’Allemands ? Sans doute y avait-il une confusion entre un western et le maquis ? mais ceci est une autre histoire.
René Legros :
Ancien valet de ferme, ancien manœuvre des Ponts et Chaussées et puis cheminot, j’ai 84 ans et je me pose beaucoup de questions :
Actuellement, où en est la gauche ? Quelles perspective ouvre-t-elle à l’avenir et où va-t-elle ?
Si la gauche est plurielle, pluraliste, si elle a les mêmes objectifs, elle ne parvient pas à s’unir sur les moyens pour y parvenir.
Dans l’après guerre, la gauche a-t-elle répondu aux besoins de la situation, qu’elle soit dans l’opposition ou au gouvernement ? Et comment peut-elle faire pour y parvenir maintenant ?
C’est à partir de l’expérience vécue que je livrerai ma réflexion. C’est vrai que l’enracinement de la gauche est un fait en Limousin. Elle a été à l’origine de la modernisation de syndicats devenant de plus en plus puissants, avec des luttes de plus en plus nombreuses et posant de mieux en mieux les problèmes de société. De là, le mot d’ordre de manifestations diverses « classe contre classe » a fait son chemin. La gauche en Limousin n’a jamais été absente dans les grands événements de l’histoire de notre pays. Pénétrant peu à peu et avec difficulté au sein de nos campagnes, elle va aider le paysan à mieux comprendre son état d’exploité par les hobereaux sans scrupule. Ainsi organisé, en y apportant des idées parfois confuses de lutte, de solidarité, de négociation, de transformation de la société, les premiers théoriciens de la gauche ont développé leurs idées sur des bases anticapitalistes, mais souvent ouvriéristes. Cela dure encore de nos jours. La gauche est nécessaire au mouvement social.
Je voudrais parler de 1938 : il y a eu des grèves, il y a eu l’accord de Munich, le 20 septembre. Cet accord de Munich a désorienté l’opinion, même dans la gauche. Je pense que la majorité de l’opinion approuvait l’accord : la paix sauvée pour des générations. Et un an après, c’était la guerre. Le 30 novembre, il y a eu la grève générale contre les décret-lois, grève déclenchée par la CGT contre le gouvernement Daladier qui brise la grève, avec la répression et de nombreux licenciements. Je crois que le corps enseignant a payé très lourd son engagement. Après 1947, les promesses de la Libération se sont vite évanouies, le programme du Conseil National de la Résistance, mis aux oubliettes ; les efforts demandés pour la reconstruction du pays ne sont pas récompensés. Dès juin 1947, la grève éclate chez les cheminots. Salaires et conditions de travail sont à l’ordre du jour. Le résultat n’est pas probant. La grève générale à l’appel de la CGT dure de novembre à décembre 1947. Elle sert d’annonce à la scission syndicale : la création de Force Ouvrière. Au plan national, naît la Fédération Générale des Agents de Conduite chez les cheminots. C’est un affaiblissement considérable du mouvement syndical. Des fédérations passent majoritairement à FO. Chez les cheminots, la CGT résiste mais elle est diminuée. Il faut reconstituer l’organisation syndicale éclatée. A Limoges, en particulier au dépôt, des militants sollicités pour rejoindre FO restent à la CGT et exposent leur attachement profond à l’unité syndicale, entraînant avec eux de nombreux indécis. Au plan national c’est la répression, y compris sur notre secteur. Brive, Périgueux, Saint Sulpice Laurière sont durement frappés. Des militants sont révoqués. Des camarades sont suspendus de leur fonction, mis à pied, d’autres sont déplacés dans des résidences où ils ne peuvent jouer aucun rôle militant utile. C’est une période difficile qui s’ouvre pour les militants restant et les nouveaux, les jeunes, souvent sans expérience syndicale.
Le syndicat CGT des cheminots de Limoges n’avait pas de statuts déposés, il s’est trouvé complètement dans l’illégalité. C’est dans ce contexte que s’ouvre une nouvelle ère à la SNCF : le démantèlement programmé de l’entreprise. Les luttes successives engagées ne parviennent pas à stopper l’engrenage. La lutte contre les projets de la SNCF de démolir l’outil de travail, en vue de la privatisation future, continue de nos jours avec les multiples actions, rassemblements, délégations, manifestations des cheminots et usagers.
L’action dans les années 54-55 voit une première grève pour les 40 heures. Elle ne dépasse pas le cadre de l’Entretien des Bénédictins. Les sanctions pécuniaires tombent sur les militants. Même isolée, cette grève ouvre la voie à une revendication qui fera son chemin vers la réduction du temps de travail.
Pendant toute une période, avant 1968, des grèves de 24 heures, de 48 heures éclatent pour les salaires, pour les conditions de travail, sans oublier la grève contre les décret-lois de Laniel. Elles prennent diverses formes, le plus souvent unitaires mais quelquefois à l’appel de la CGT seule, des grèves calées aux grèves tournantes de deux heures, service par service. Cette action permanente et diversifiée a ouvert la porte à ce qu’on a appelé, après, les événements de 1968. Cette grève de 1968 a été victorieuse parce que menée avec l’appui des travailleurs et des forces de gauche. Elle a ouvert une nouvelle voie pour les revendications. Ca a été un succès chez les cheminots.
Il y a des moments où il faut savoir composer par la négociation la fin d’un mouvement. C’est ce qui a été fait malgré les embûches de quelques irresponsables ultra révolutionnaires. Mais la fin d’une grève, même victorieuse, n’est pas une fin en soi. Ce sont des revendications satisfaites en grande partie à un moment donné. C’est le contraire du tout ou rien.
Aujourd’hui la situation est très complexe. Le réveil républicain du 2ième tour des présidentielles n’a pas enlevé une certaine confusion ni ouvert des perspectives claires. Pour ouvrir un nouveau chemin pour la vie des citoyens de gauche, la gauche a besoin de clarifier ce qu’elle entend devenir. Il y a aujourd’hui un grand courant de changement.
Pour ma part, je pense que la gauche aura à tirer les enseignements nécessaires.
Michel Pêcher :
Pourquoi suis-je devenu militant syndical ?
Les premières rencontres c’est un peu historique, c’est mon enfance, ma petite enfance : je me souviens, chez ma grand-mère, avoir entendu mes grands-parents, mon père, parler du maquis, de la Résistance. Je me souviens aussi avoir visité très jeune Oradour. C’était après guerre et j’avais été profondément marqué par ses ruines. Je ne comprenais peut-être pas tout, mais ça m’avait fortement troublé. Et puis, plus tard, en 1958 je suis arrivé à la cité de la Bastide. Et sur mon palier (j’étais adolescent) il y avait une dame qui s’appelait Madame Tixeron qui était veuve. Son mari était un résistant que la Gestapo était venu chercher dans sa cordonnerie et cet homme était mort à Buchenwald. Cette femme âgée me parlait régulièrement, me racontait des histoires de son mari. L’ensemble de ces moments, de ces rencontres, de ces visions, a bien commencé à constituer une certaine forme de compréhension des choses. Puis je me suis rendu compte en discutant, en préparant un peu cette soirée, qu’un certain nombre de copains militants que je côtoie ont à peu près le même parcours. Des copains comme Jean-Jacques Jeandillou qui est conseiller prud’homme, a lui aussi une histoire (pourtant il n’a pas connu la guerre, il est plus jeune) avec sa famille et la Résistance. Donc on a pour certains d’entre nous, ce lien, ce témoin à passer aux générations futures.
Le deuxième moment de cette rencontre, c’est la période contemporaine, c’est-à-dire mon activité professionnelle, mon activité de représentant de commerce, et l’exploitation capitaliste qui était faite sur cette profession où il n’y avait pas de temps de travail, avec l’illusion d’être bien payé, mais le fait d’être surtout énormément exploité. Il y avait cette fatalité : un grand nombre de représentants vivaient un peu au jour le jour, et à un moment donné, il y a eu une prise de conscience, et la rencontre avec le syndicat. C’est à ce moment-là que j’ai rencontré Georges Huguet, et Lucien Dussouchaud. Ces camarades aujourd’hui sont des gens qui m’ont fait connaître les anciens qui ont beaucoup compté pour moi. Je pense à Lulu Lasserre qui s’occupait du secteur juridique de la CGT ; Léon Bouchemousse qui était le responsable du syndicat de la chaussure en Haute-Vienne, et qui a été conseiller prud’homme ; Paul Manigaud de chez Legrand, avec qui j’ai beaucoup discuté, Bernard Toulet, et puis Junien, que j’adorais. Junien passait régulièrement dans tous les services du syndicat et partout pour dire quelques mots gentils, cette fraternité, cette camaraderie est toujours si importante.
La défense des salariés devant le Tribunal des prud’hommes est un aspect un peu particulier du syndicalisme. Il est complémentaire du salarié syndiqué ou du militant qui est dans l’entreprise. A la permanence syndicale, il passe beaucoup de monde : des victimes de cette gestion capitaliste, qui subissent les licenciements, parfois par grosses vagues. Mais même quand ils sont individuels, ils font très mal. Vous savez, j’ai vu des gens pleurer, j’ai vu la colère, j’ai vu la souffrance de tous ces gens. Mais souvent beaucoup de dignité chez ces petites gens qui sont victimes. Alors que faire, comment répondre ? Bien sûr, il faut leur faciliter cet accès à la Justice. Parce que pour eux la Justice c’est quelque chose qui est loin, qui est haut : « haut-perché », comme ils disent. Tout simplement il fallait apporter de l’écoute ; parfois en les écoutant on devient leur confident. Ils racontent leurs histoires, leurs problèmes familiaux qui découlent de la perte de l’emploi, le divorce, l’échec scolaire, les difficultés matérielles, financières, l’exclusion. Alors il faut leur redonner confiance, c’est-à-dire leur redonner l’espoir et puis l’envie de renaître, de s’organiser, de se battre. Ça passe par les valeurs : la solidarité, la fraternité et puis les valeurs qui nous animent tous, je crois, ce soir.
Je crois que, dans cette activité que je fais à temps plein, j’ai beaucoup de chance de pouvoir participer à quelque chose qui me plaît énormément et de pouvoir échanger, redonner : redonner un peu de goût, un peu de vie, de l’espoir et souvent des résultats, parce qu’on a également de la réussite dans cette activité devant la Justice quand l’action se met en marche, que les salariés sont solidaires dans l’entreprise et accompagnent leurs collègues. Eh bien, il y a de la réussite, le patronat recule. Et c’est ça la vie militante, pour moi du moins.
Cette vie militante, je l’ai prolongée dans un autre domaine, associatif, politique. C’est extrêmement riche également. Il y a une dizaine d’années, mon camarade Gilbert Mondiot qui est éducateur m’appelle et me dit : voilà (il travaille sur le quartier du Vigenal) les jeunes du quartier sont en train de monter un club de foot, voudrais-tu participer ? J’habitais en 1958 à La Bastide, je vous l’avais dit, en 1961 je jouais au Vigenal parce qu’il n’y avait pas de club de foot à La Bastide. J’ai retrouvé, 30 ans plus tard, ce que j’avais connu à La Bastide, ces grandes familles issues de l’immigration. Ce n’était plus la même immigration ; avant c’était une immigration qui venait d’Espagne, d’Italie. Là c’est l’immigration d’Afrique du Nord, avec des familles gitanes sédentarisées, des familles africaines. Je venais pour participer à une vie associative, sportive, et puis j’ai rencontré autre chose. J’ai rencontré un besoin social important, puisque je rencontrais à nouveau les problèmes de précarité, d’exclusion ; des problèmes encore plus graves pour moi : ceux du racisme.
On s’est attaché avec quelques copains sur le quartier à faire vivre une vie militante sur des valeurs que sont la tolérance, la citoyenneté, et puis des valeurs tout simplement humaines, parce qu’on a vu un certain nombre de jeunes de ce quartier qui vivaient en marge. Et aujourd’hui : s’inscrire pour aller voter. J’en ai vu dans la dernière manif du 1er mai. Ils se responsabilisent, ils ont envie eux aussi de militer, et c’est pour ça que je suis heureux de pouvoir passer ce témoin à des jeunes, à ma façon, tout simplement et sans autre ambition.
Michèle Gay :
Je vais vous dire quelques mots sur mon engagement en tant que militante féministe dans le cadre du Planning Familial.
Je suis entrée au Planning en 1970, c’est-à-dire au moment des luttes pour la libération de la contraception et de l’avortement, sans doute vous en souvenez-vous. La contraception venait juste d’être légalisée, mais il y avait encore de très fortes réticences pour la prescrire ; et quant à l’avortement, il était toujours interdit par le Code pénal. Entre 1970 et 1975, il y avait partout de grosses mobilisations pour en obtenir la légalisation. A Limoges, nous nous sommes bien sûr inscrites dans ces mobilisations. Elles n’avaient en soi rien de spécifique, sauf que, ce qu’on peut dire, c’est qu’on n’a pas rencontré d’opposition particulière de la part des responsables locaux. On ne peut pas dire non plus que notre action les passionnait. C’était l’indifférence. Mais ils nous trouvaient sympathiques.
Je vais vous donner une anecdote. Quand on a voulu un local pour le Planning, un peu plus grand que celui qu’on avait, on est allé voir le maire qui était à l’époque monsieur Longequeue. Quand il a vu arriver les deux militantes du Planning, il leur a dit : « Ah ! vous tombez bien, justement j’ai quelque chose pour votre club ! » C’est vraiment authentique ! Il y a une autre petite remarque de couleur locale dont je peux parler : on parle toujours du « limogeage » ; nous, à cette époque-là on a profité d’un limogeage puisqu’on a pu vraiment mener l’action au niveau de l’avortement et de la contraception avec l’appui d’un gynécologue qui avait une belle carrière devant lui dans les hôpitaux de Paris, et qui a été limogé à Limoges à cause de ses positions trop turbulentes sur la question.
Aujourd’hui, où en est-on ? 30 ans après, nous restons deux au Planning Familial. C’est bien dommage, parce que nous avons en Limousin une spécificité, qui est d’avoir le plus grand taux d’avortement en France. Nous sommes une petite organisation au niveau du Planning, mais comme le dit Jacques Bertin, le chanteur : « Nous tenons la lampe allumée ».
Je voudrais ajouter : ce que j’ai appris au Planning, et dont je lui serai toujours reconnaissante, c’est qu’il faut toujours remettre son action en question quand on est militant et toujours se demander pourquoi on fait ce qu’on fait. C’est ce qu’on appelle l’analyse de la pratique ; toujours revenir aux objectifs que l’on se donne en tant que groupe et confronter la pratique qu’on a avec les objectifs. Je crois que ça évite beaucoup de dérives et il me semble que c’est une bonne façon de militer.
Roger Gorce :
Je suis natif de la Dordogne. J’ai essayé d’examiner quels avaient été les chemins que j’ai pu suivre pour en arriver là. C’est un droit d’inventaire qu’on se doit tous. Rien d’atypique, dans la mesure où j’ai eu, moi aussi, une origine familiale rurale. Une grand-mère, bien sûr, et un père qui étaient originaires de Saint-Junien, Oradour. Ma grand-mère, pour l’anecdote, est partie d’Oradour à vélo pour réintégrer son village la veille du massacre. C’est des choses qui, lorsqu’elles nous sont contées à plusieurs reprises, peuvent avoir une importance significative.
Une mère native de Bussière-Galland et qui elle aussi nous expliquait la peur qu’elle avait lorsque enfant, elle était cachée dans la forêt. Ma grand-mère était une ravitailleuse des maquisards.
C’est des choses qui ont formaté ma conscience et mon engagement à venir.
Né en 1960, j’ai été rapidement confronté à l’activité syndicale ; par inconscience, mais surtout par envie d ‘en découdre avec un adversaire pas toujours identifié et identifiable, mais qui faisait toujours du mal. Initialement c’était le fermier qui venait récolter la production de la ferme. Là, la manière de lutter de mes parents, c’était d’essayer d’en planquer un peu, sinon on ne s’en sortait pas. Ca peut paraître ridicule mais c’était ça : cacher un sac de blé ou deux, ça pouvait assurer quelques mois. C’était aussi une forme de résistance ; et c’était quelque chose d’assez difficile parce que mes parents ont toujours été fermiers, métayers, journaliers agricoles ; ils ont pris leur retraite avec 7 vaches. On était trois enfants, on n’a jamais vécu dans le malheur ; on a tous mangé à notre faim, et été élevés dignement avec respect, humilité.
L’environnement communiste dans lequel j’ai été bercé a fait que j’ai pris mon engagement en 1976, à 16 ans. Je voulais entrer aux Jeunesses communistes. Le parcours n’était pas si pénible que cela : on m’a fourni une petite carte, on m’a expliqué qu ‘il fallait discuter, même si on ne discutait pas trop. 1981 est arrivé : combat, espoir… On embauche à la SNCF. J’étais dans un contexte plus collectif où effectivement le mouvement syndical était très ancré avec un esprit de combativité fréquente, des organisations syndicales, telles la CGT, fortement ancrée. En 1986, trois semaines de grève. On commence comme ça, un beau jour, et puis on se retrouve avec des potes qui te disent : tu sais pas, il y a de la lumière, viens avec nous, puis on va essayer de faire un bout de chemin ensemble au syndicat. Progressivement, secrétaire du syndicat, un mandat de conseiller prud’homme aux côtés de Michel Pêcher, diverses expériences qui font qu’ensuite je me suis retrouvé, en 1995, responsable régional de la CGT au secteur des cheminots de Limoges et un peu animateur de cette « grande grève de 95 ».
Ce mouvement de 1995, on pense que Limoges a fortement contribué à ce qu’il prenne de l’ampleur, parce que c’est à l’issue d’une réunion de délégués du personnel, à la région Limoges, qu’on nous a annoncé, le 24 novembre, la suppression de trente emplois. Alors on s’est dit, c’est pas possible ! Je ne sais pas, un miracle de spontanéité, peut-être même un peu d’irresponsabilité, j’ai dit au directeur d’établissement : « Ecoutez, si ça continue, dans une demie heure, vous avez 400 cheminots dans la salle ». J’avoue que moi-même je ne pensais pas en récolter beaucoup, mais lorsqu’ils ont descendu à la queue leu-leu la rue Aristide Briand, là j’ai compris qu’il se passait quelque chose. Je crois que ça a donné ce dynamisme qui a fait qu’on a vécu des assemblées générales de 7 à 800 cheminots dans la cour, avec une démocratie directe, pas toujours des gens satisfaits des décisions prises, mais au moins qui se prenaient, à main levée, après discussions, échanges.
Je finirai sur les prédictions qui ont été faites à la SNCF : La Vie du Rail, journal fortement connu dans le milieu ferroviaire, titrait : « en l’an 2000, il n’y aura plus que 150.000 cheminots ». Aujourd’hui, en l’an 2002, nous sommes 174.500. En 4 ans, 40.000 jeunes sont entrés dans l’entreprise, c’est une forte responsabilité pour la CGT ; parce qu’il faut les accueillir, les « éduquer », continuer ce militantisme que j’essaye de promouvoir.
Louis Ballard :
Je suis né à Sète le 19 septembre 1925. Mon père était cheminot et je me destinais à une carrière de musicien. Je suis arrivé en Limousin en 1942 parce que dans le Midi on avait faim. Je suis arrivé dans le petit village où je suis encore, où un agriculteur m’a dit : j’arrive de la guerre, mon exploitation a besoin d’être remise en état, tu ne connaîtrais pas quelqu’un qui voudrait venir travailler avec moi ? Ma carrière musicienne étant pratiquement condamnée, je vais venir avec vous, lui dis-je, si mon père y consent. Mon père accepta : il m’a dit, d’une pierre tu feras trois coups, tu te ravitailleras, tu mangeras à ton aise, tu nous ravitailleras et tu ne partiras pas en Allemagne. Voilà ce qui a décidé de mon avenir.
J’ai adhéré à la Fédération des exploitants agricoles de la Haute-Vienne, Fédération qui déjà adhérait au Comité de Guéret, constitué par un noyau dur, c’est-à-dire quatre départements (la Dordogne, la Haute-Vienne, la Creuse et l’Allier). Ce Comité était en contestation permanente avec la Fédération nationale des exploitants agricoles : syndicat officiel qui avait tout traité, sauf l’avenir de l’exploitation familiale. Et c’est dans le cadre de cette exploitation familiale que je me suis battu, que j’ai suivi tous les rassemblements du Comité de Guéret. La Fédération nationale avait complètement dédaigné la couverture sociale des exploitations du sud de la Loire, à commencer par la maladie, l’accident. Les retraites aussi, il n’en avait pas été question. Et le Comité de Guéret, par tous les rassemblements qu’il a faits, a obtenu tout ça, vers 1952- 53.
Après la chute des cours des produits agricoles, le Comité de Guéret, en 1958, avec comme premier ministre Gaillard a obtenu les prix agricoles indexés sur les prix industriels.
En 1960, les lois d’orientation agricoles qui faisaient déjà allégeance à la politique agricole commune devaient nous ouvrir les marchés européens. On nous disait : « Vous avez devant vous un marché de 360 millions de consommateurs, vous n’avez pas besoin de vous faire du mauvais sang, les prix indexés : on vous supprime ça, retroussez vos manches, produisez et vous gagnerez votre argent ». Ce que nous avons fait. Si au début ça marchait bien, par la suite nous avons déchanté.
Alors nous avons tenu la route jusqu ‘en 1973, moment où les prix agricoles se sont effondrés. C’est à ce moment-là que le Parti communiste nous a dit : « La politique agricole commune va se faire sur le dos des agriculteurs français ». Ce qui m’a poussé à l’adhésion au Parti communiste en 1973.
Le combat du Comité de Guéret ne s’est pas arrêté là, puisque dans le cas de la politique agricole commune on nous disait : « Le nord de la Loire et le front atlantique doivent suffire à nourrir la population, le Massif Central doit devenir le poumon vert de l’Europe ». Il fallait tout planter en résineux.
Voilà pourquoi je me suis engagé à aller sur les terres labourables agricoles qui se plantaient ; aller arracher derrière les planteurs les sapins. Et ce combat n’a pas été inutile puisque avec mon voisin Jean Balloche (Jean Balloche était directeur de la chambre d’agriculture et il a été mon premier confident), nous avons réussi à mettre en place sur le plan départemental, le zonage agricole et forestier qui a permis de conserver l’outil paysan.
Ce combat s’est poursuivi par la défense des retraites agricoles. Dans les années 1980-90, la section nationale des retraités agricoles ne se penchait pas sur la situation des individus. La Dordogne et la Haute-Vienne ont créé l’Association nationale des retraités de France, parallèle à la section nationale des retraités de France rattachée à la Fédération nationale. Celle-ci à l’époque nous disait : « Vous avez le Fonds social vieillesse, le Fonds national de solidarité qui vont vous permettre de vivre correctement ». Or le Fonds national de solidarité c’était une allocation qu’on donnait aux cas sociaux, mais dans notre situation (les agriculteurs), il fallait rembourser les sommes qui avaient été perçues par les enfants. Alors nous avons dit : « Nous ne sommes pas des cas sociaux, nous sommes des vieux travailleurs qui avons généré les richesses de la France et nous devons avoir la contrepartie de ces richesses ».
Effectivement, le combat a été long, ça dure depuis 10-12 ans, mais si au début on ne nous entendait pas, maintenant nous constatons une petite avancée. J’espère, malgré le changement de gouvernement, que ces avancées se concrétiseront.
Je parlerai aussi des agricultrices qui ont tout donné au pays : les enfants, l’éducation des enfants, le travail, les soins ménagers et tout ce qui était possible pour faire de la France le pays riche que nous avons. Ces personnes-là sont moins considérées que des cas sociaux. Je citerai le cas d’une agricultrice du canton d’Eymoutiers qui a travaillé deux ans dans l’Education nationale comme institutrice. Elle a 300F de retraite par mois qui vient de l’Education nationale, elle a 1500F de retraite forfaitaire agricole. Ça lui fait 1800F par mois. Et malgré toutes les actions que nous faisons, elle ne peut pas toucher des augmentations de retraite agricole parce qu’elle est poly-pensionnée. Je cite ce cas, mais ils sont des milliers à travers le pays à être dans cette situation. Nous ne pouvons pas accepter cette injustice. Et nous continuerons plus fort encore à nous battre si la retraite par répartition arrive à être privatisée par les fonds de pension, chose que nous refusons catégoriquement, comme les autres syndicats du régime général. Nous voulons conserver la retraite par répartition. Et croyez que nous ne sommes qu’au début de notre combat.
Il ne faut pas attendre des politiques qu’ils nous servent sur un plateau ce qui est nécessaire à la dignité du travailleur.
Philippe Babaudou :
Pour faire simple, moi j’avais 16 ans en 1981 : la gauche au pouvoir. Je suis issu d’une famille de paysans, du canton de Pierre-Buffière, précisément de la commune de Saint-Genest sur Roselle qui a toujours été très à gauche, dans un canton qui a eu des conseillers généraux communistes, là aussi pendant de nombreuses années. Donc pourquoi militer à gauche ?
D’une part, un large atavisme familial. Mes grand-parents ont connu la guerre ; ils n’ont pas été résistants, mais prisonniers pendant cinq ou six ans en Allemagne. On a entendu ces histoires-là étant jeune, ça marque. On a également entendu les grand-mères raconter combien ça a été dur pour elles d’assumer le travail à la ferme. L’engagement de mon père dans la militance agricole et politique a fait qu’on a été plongé très tôt dans l’activité politique et syndicale. Il y a eu des débats à la maison, je me souviens de débats qu’on a pu avoir dans la famille, depuis tout petit : ça doit finir par marquer.
Ensuite, les choix qu’on peut être amené à faire. Mon parcours d’étudiant m’a conduit à une époque dans la région de Clermont-Ferrand, pour faire des études agricoles, et ça a eu comme conséquence de découvrir le syndicalisme agricole dans le Puy de Dôme qui était encore plus particulier qu’en Haute-Vienne, puisqu’en Haute-Vienne il y a une fédération départementale des syndicats d’exploitants agricole de gauche, mais adhérente à la FNSEA, alors que dans le Puy de Dôme elle était de gauche, mais exclue de la FNSEA. Cette situation m’a permis de comprendre des parcours différents, des choix différents qui avaient été faits par des dirigeants syndicaux : en Haute-Vienne de rester à l’intérieur de la FNSEA en espérant pouvoir y apporter une contradiction, qui a pu atteindre une certaine réalité avec le Comité de Guéret ; mais à mon sens il a été très vite repris en main et n’a pas contribué finalement à pousser cette contradiction assez loin ; et dans le Puy de Dôme, d’aller jusqu’à l’exclusion.
D’un point de vue personnel, ça a été en tant qu’étudiant la participation à un certain nombre de manifestations étudiantes. Je me souviens de la lutte contre le plan Devaquet. Ça a été aussi le choix de l’objection de conscience, qui était finalement le premier acte militant important. Ça a été aussi la prise de conscience des dégâts de l’agriculture productiviste, à l’occasion d’un certain nombre de voyages d’études qu’on avait été amené à faire, en particulier en Bretagne, où on a vu à quel point l’industrie agroalimentaire qui avait la mainmise sur toute l’agriculture avait pu réduire un certain nombre de paysans à un niveau d’intégration impressionnant. C’est le discours d’un certain nombre de chefs d’entreprises de coopératives agricoles qui, avec un certain cynisme, nous disaient que finalement leur souhait, ce n’était pas d’avoir des salariés dans des poulaillers ou dans des porcheries pour fournir une matière première, mais bien d’avoir des agriculteurs parce qu’au moins eux il étaient, d’une part, beaucoup plus dociles, et puis beaucoup plus entreprenants. On leur faisait à la fois supporter le travail et les investissements nécessaires pour fabriquer cette viande industrielle. Cette prise de conscience à travers des discussions avec des responsables de coopératives agricoles qui nous disaient à nous, jeunes étudiants futurs ingénieurs agricoles, qui théoriquement auraient dû entrer un petit peu dans leur jeu : « Vous savez, nous préférons polluer la Bretagne plutôt que de voir s’y installer des pêcheurs à la ligne ».
Une autre étape importante de mon engagement ça a été mon retour à l’agriculture qui n’était pas la chose pour laquelle j’avais été programmé. Ça a été un acte militant, y compris au sein de ma propre famille. S’installer en agriculture, faire un autre choix d’un point de vue syndical (l’atavisme familial a des limites) vers la Confédération paysanne plutôt que vers la FDSEA.
La Confédération paysanne, c’est un syndicat qui s’est créé en 1987 et qui a deux origines. Une origine qui est liée au mouvement des Travailleurs paysans qui étaient plutôt gauchistes. Et puis une autre tendance qui était à la fois des fédérations, organisées dans les départements, et des gens qui avaient été exclus de la FNSEA. Ces deux tendances se sont regroupées pour constituer en 1987 la Confédération paysanne, pour être plus forts face, à l’époque, à un ministre de l’agriculture qui s’appelait François Guillaume et qui était l’ancien président de la FNSEA.
Ce qui explique ce non ralliement à la FDSEA, c’est une remise en cause beaucoup plus fondamentale du productivisme par la Confédération paysanne et qui est beaucoup plus tardive à la FDSEA. Le courant communiste au niveau rural et agricole n’a finalement remis en cause ce productivisme que depuis très peu de temps.
Donc 16 ans en 1981, c’est la génération Mitterrand ; c’est aussi toute l’évolution du parti Socialiste vers ce social-libéralisme et l’abandon d’un certain nombre de valeurs qui le conduit aujourd’hui à ne pas être capable de comprendre et d’analyser la situation du premier tour des élections présidentielles. Je crois que c’est là aussi quelque chose qui marque, quand on commence à militer à gauche dans les années 1980-90 : les années fric, les années Tapie.
C’est cet ensemble de choses qui fait qu’aujourd’hui je me retrouve à militer à la Confédération paysanne, bien évidemment sur des thèmes alors locaux comme des bagarres foncières ou la prise en charge de la défense d’un certain nombre d’agriculteurs en difficulté. Cela me conduit également à militer dans des associations comme Attac, ce qui pose le problème de la militance à gauche de manière sans doute un peu différente, en dehors des partis politiques, avec les syndicats ouvriers, avec les syndicats paysans.
Là aussi, particularité de la Haute-Vienne et du Limousin : un groupe Attac relativement important et dynamique dans ce département.
Jean-Pierre Juillard :
Je n’ai pas du tout la même expérience ; d’abord je ne suis pas d’ici. Je suis arrivé il y a 30 ans et j’avais 30 ans. Pas mal de choses étaient déjà achevées. Est-ce qu’en arrivant ici, on a affaire à une région qui, en effet, a une singularité critique, rebelle, telle que l’histoire vient de le démontrer ? C’est vrai que dans les rappels qui ont été faits, aussi bien des vieux militants que de Georges Chatain, il y a indiscutablement des faits d’histoire qui montrent que la Haute-Vienne au moins, sinon le Limousin dans son entier, a une tradition en effet rebelle : une singularité. Mais il y a 30 ans, où était cette singularité ?
Eh bien, je peux dire que le rebelle que j’étais a rencontré des rebelles ici. C’est au moins ça. C’est-à-dire que je n’étais pas seul. Parce que quand je suis arrivé (je suis l’aîné d’une famille nombreuse de six enfants, j’ai fait toutes mes études à Paris en travaillant) je venais de la gauche critique, Socialisme ou Barbarie, qui était sur des positions marxistes critiques. En arrivant, j’ai eu la surprise de pouvoir parler avec des gens divers : dans la rue, des artisans, des commerçants, des ouvriers pouvaient se comprendre ; on pouvait se parler sur les bases sur lesquelles j’étais.
Il y a parallèlement des blocages, un micro-climat très pesant, très lourd aussi en Haute-Vienne et en Limousin.
Et c’est ainsi qu’on a construit ici le CERES, dans la mouvance du Parti Socialiste, à laquelle j’avais adhéré en 1974 sur des bases anticapitalistes ; on a tenté de faire un courant critique en partant de la base. C’est là que j’ai pu labourer toute la Montagne limousine, la circonscription de Rodet aujourd’hui, pour faire passer nos idées. C’est là où j’ai rencontré la culture paysanne, la tradition de résistance des agriculteurs, tout un tas de choses passionnantes. En effet il y avait des rebelles un peu partout. Pas aussi nombreux qu’on aurait pu le souhaiter, mais il y en avait. Donc c’est vrai.
Il y des gens qui dans leur pratique professionnelle avaient un singularité. Gérard Vincent qui était docteur endocrinologue, avec quelques autres médecins, très peu nombreux, était en rupture avec le Conseil de l’Ordre. C’était d’ailleurs une des 101 propositions de François Mitterrand, supprimer le Conseil de l’Ordre, qu’il n’a évidemment pas respectée. Le problème de la santé en Haute-Vienne est très important. On avait tenté de faire des centres de soins intégrés, un observatoire de la santé, etc. Il y avait un peu partout quand on est arrivé ici des phénomènes de rupture, des gens en rupture avec un certain nombre de logiques de pensée unique.
Je me suis trouvé candidat pour le Parti socialiste au Conseil général : j’ai été conseiller général de 1982 à 88. J’ai passé la main parce qu’un certain nombre de choses ne m’intéressaient plus beaucoup, trop de choses commençaient à peser trop lourd. C’était sur le canton de Limoges Beaupuy.
Est–ce que oui ou non ici j’ai rencontré des gens singulièrement de gauche ? Eh bien oui, je les ai rencontrés. Et de tous âges.
C’est ainsi que je vois les choses. Je suis évidemment un militant syndical, j’essaie moi aussi d’arracher aux griffes de la précarité, de la dureté d’Etat, etc., un certain nombre de collègues et camarades. J’ai vu aussi le service public de l’enseignement grignoté lentement mais sûrement et profondément par le privé. J’ai vu la précarité et presque la misère au milieu de mes collègues, les CES, etc. Des gens qui survivent en enseignant aujourd’hui. Et donc j’ai essayé, puisque je suis à la retraite depuis quelques mois, tout au long de ma petite histoire personnelle, d’arracher tout ça, autant que faire se peut, mais j’ai vu des dégâts fantastiques. Et puis j’ai vu ce qui devait arriver, à savoir qu’une partie du peuple avait trouvé, pour s’exprimer, la bouche vénéneuse de Le Pen. Et là aussi c’est un sacré élément de réflexion.
Christophe Soulié :
Je vais parler du mouvement des chômeurs. Ce ne n’est pas du tout une histoire de vie parce que c’est une période qui a duré trois mois. Je vais raconter trois mois d’expérience.
Je suis investi depuis 1994, dans le collectif Agir ensemble contre le Chômage, de Limoges.
A Limoges en 1997-1998, il y a eu un vrai mouvement sur la question du chômage et de la précarité, dans le sens où les organisations habituellement présentes sur ce secteur ont réussi à élargir leur base habituelle et à se fondre un temps dans un mouvement plus large, où les personnes présentes se sont mises à analyser, à débattre et à agir ensemble sur la question du chômage et de la précarité, en en faisant un problème de société dans son ensemble.
Le mouvement avait à la fois une dimension nationale et une dimension locale. Toutes les villes n’ont pas connu la même mobilisation que Limoges. C’est un fait aussi. Ici, il a duré de 15 jours à trois semaines, dans le sens que je donne au mot « mouvement ».
Après, des clivages ont repris très fortement le dessus, les jeux politiques aussi, le contexte national aussi et on allait lentement vers la décomposition.
On peut dire que ce mouvement était ancré à gauche, par son exigence d’égalité, de justice, et cette volonté de ne pas accepter la fatalité, de prendre son destin en main. En effet, la lutte contre le chômage n’est pas forcément porteuse de ces valeurs-là. Pour l’Etat et le patronat, on l’a bien vu, ça a été un prétexte pour démanteler les acquis sociaux et faire baisser les salaires notamment, en les maintenant au SMIC. L’extrême droite, elle, va mettre en avant la purification ethnique comme solution. Mais rien de tout cela n’est apparu dans les revendications du mouvement. Ce n’était pas d’ailleurs une lutte contre le chômage, mais une lutte de chômeurs et de précaires pour améliorer leur sort. Le travail n’était pas la revendication centrale, c’était le revenu. Cela s’exprimait à travers la revendication de la prime de Noël et le relèvement immédiat de 1500F de tous les minima sociaux. Par contre, le mouvement a mis en avant un mot d’ordre qui était très fédérateur et qui a bien marché : « Un emploi c’est un droit, un revenu c’est un dû ». Cela étant, c’était bien la revendication du revenu qui était centrale, revenu sous différentes formes : gratuité ou tarif social pour l’eau, le gaz, l’électricité, l’accès aux soins, les transports, le relèvement des allocations, l’arrêt de la dégressivité des indemnisations chômage. A cette revendication sur le revenu s’en est ajoutée une autre : la présence des chômeurs partout où on décide de leur sort. Autrement dit, une exigence de démocratie.
Voilà la présentation générale du mouvement. Il y a un contexte qui est la fin de l’année 1997 ; il y a la publication du rapport Guaino qui à l’époque était Commissaire général au plan. Ce rapport met en avant le chiffre de 7 millions de personnes en situation de précarité très grande et très forte, donc dans lequel on peut mettre les chômeurs qui sont inscrits, mais aussi tous les allocataires de minima sociaux, tous les travailleurs intermittents, que ce soit dans l’intérim ou en CDD, tous les salariés à temps partiel. Ce chiffre allait tout à fait à l’encontre de la représentation officielle du chômage qui, elle, saucissonne les choses de manière à ce que ce soit beaucoup moins visible.
Il y a un autre aspect important. Il y a deux mouvements différents qui s’amorcent en même temps. Ce qui fait qu’au début, les choses n’ont pas été tout à fait claires pour tout le monde, mais ça a donné une force qui a payé par la suite. C’est d’abord à Marseille, les comité chômeurs CGT qui ont lancé le mouvement pour la prime de Noël. C’est une tradition CGT des chômeurs de Marseille, chaque année, de se mobiliser là-dessus. Mais en 1997, ils se sont mis à occuper des Assedic. Le 11 décembre, ils se sont mis à occuper les antennes de l’Assedic dans les Bouches du Rhône ; et dans la même période il y avait la semaine d’action « Urgence sociale » qui, elle, était lancée par AC !, l’Apeis (qui est une autre association de chômeurs), le MNCP aussi, et puis un mouvement féministe la CADAC, le Comité des sans logis, Droit devant, le Groupe des dix, la CGT finances, la FSU et « CFDT en Lutte » (des oppositionnels à Notat au sein de la CFDT).
Dans ce cadre-là, à Arras, 200 chômeurs occupent l’Assedic. Ils mettent en avant, non seulement la prime de Noël, mais aussi le relèvement des minimas sociaux et l’accès au RMI pour les moins de vingt-cinq ans. Autour de ces deux moments de décembre, il y a d’autres figures qui émergent, du moins pour les médias, mais qui ont un rôle très structurant aussi : c’est Charles Hoareau pour la CGT à Marseille et Jean Marie Honnoret pour AC ! à Arras.
Le mouvement à partir de là devient « représentable » par les médias, ça c’est important pour la suite.
A Limoges, pour la semaine d’action d’Urgence, le collectif AC !, prend contact avec la CGT EDF, à la fin du mois de novembre, pour monter une action contre les coupures de courant pour les impayés concernant les précaires. C’était la première fois qu’on contactait un syndicat CGT pour un action très précise. On a rédigé un tract ensemble, on a monté l’action ensemble, on a lancé l’opération avec des distributions de tracts dans les différents centres EDF de la ville où on appelait les agents EDF à désobéir : à refuser d’obéir aux ordres de couper. La CGT soutenait l’action et c’est eux qui nous ont amenés dans les locaux d’EDF de Limoges. Et puis, en même temps, le syndicat CGT avait lancé un débrayage et on avait prévu ensemble de faire irruption dans une réunion de la Direction, ce qui a été fait. En même temps un copain qui, depuis des mois travaillait avec nous dans nos AG, et voulait faire quelque chose sur Brive, est allé voir les gens de la CGT-chômeurs à Brive et avec eux ils ont monté l’occupation des Assedic de Brive, à la fin décembre. On a vécu un moment d’occupation avec eux. Pour nous ça a été une expérience très forte et on a appris des choses : le quotidien de l’occupation.
Début janvier, les déclarations de Martine Aubry et de Nicole Notat, qui étaient assez révoltantes, n’ont pas calmé le mouvement, mais l’ont même dynamisé. « AC ! Limoges » est entré en action le 7 janvier. On s’était préparé, et on a occupé l’ANPE à côté de la mairie place Franklin Roosevelt. C’était notre première occupation. On a tenu la matinée et à 14 heures on a laissé notre ANPE et on est allé devant le siège de l’Assedic avenue Baudin, sachant qu’on avait aussi pensé s’emparer de l’antenne Assedic mais, ce jour-là, elle était fermée, comme par hasard. On est allé sur la manif où il y avait plusieurs centaines de personnes. Il y avait aussi une autre association de chômeurs qui s’appelle l’Association Limousine des Chômeurs, et puis la CGT et nous. On a réussi à entrer dans le siège qui était fermé, on a réussi à l’investir. Ce qui fait qu’on a été maître des locaux et tout de suite on a proposé, à la première assemblée générale, l’occupation ; que chaque organisation se fonde dans un collectif qui s’appelle le Collectif des occupants. C’était une démarche très forte de renoncer à nos sigles et d’essayer d’élargir le mouvement. Le 10 janvier au soir, on a été évacué par les CRS. Le lundi, collectivement, on a décidé d’occuper la mairie. Là, les objectifs avaient été longuement discutés pour savoir sur quoi on allait se focaliser après avoir été évacué des Assedic. Le 15, quatre jours après, on a laissé la mairie pour occuper la Chambre de commerce. Le 19, six d’entre nous se sont retrouvés assignés au tribunal et, là, il y a eu un fort soutien devant le tribunal, le lundi matin, et la CCI a retiré sa plainte. On a fait une AG devant le tribunal et ensuite on est allé petit à petit vers la décomposition du mouvement. Le lendemain on a occupé EDF. Et après il y a eu des occupations sporadiques, mais qui ne pouvaient plus durer parce que c’était très vite l’évacuation par la police. On a occupé l’Hôtel des impôts, le Crédit Lyonnais, la Direction régionale du travail… C’était de plus en plus difficile de tenir. Donc il a fallu trouver d’autres formes d’action, mais en même temps la décomposition arrivait.
Alors, les faits marquants de ce mouvement : ce sont les deux grandes manifestations dont le trajet a été déterminé par les occupants qui étaient en tête du cortège. Les deux manifs correspondaient à des occupations. Il y a une manif qu’on a amenée à la mairie occupée, une autre à la CCI. L’autre point marquant, ça a été un débat public organisé dans le hall des Assedic. Il y a eu beaucoup de monde ; il y a eu des discussions très intéressantes ; il y a des gens qui sont venus de Creuse, des syndicalistes, des chômeurs. L’autre action aussi intéressante, c’est une opération train gratuit, c’est-à-dire prendre le train sans payer pour aller collectivement manifester à Toulouse. C’est un truc qui a bien marché aussi.
Les points forts du mouvement, sur le plan du fonctionnement : un certain temps en AG souveraine, une expérience de démocratie directe. Et puis, il y a eu des discussions que l’on menait avec les autorités diverses et variées par rapport à des revendications, là il y avait la base d’un mandat impératif devant les AG.
Un constat : en liant les questions politiques à des situations vécues très concrètes, l’occupation des lieux n’est pas que physique, elle a été politique. Je crois que l’Assedic, on l’a vraiment occupée politiquement ; je l’ai senti dans le débat qu’on a eu avec le cadre des Assedic qui est resté avec nous pour discuter. Au bout d’un moment il est resté sans voix, il est parti.
Le mouvement n’a pas pu se passer tout seul. Il y avait des ressources que l’on a su mobiliser et qui se sont mobilisées avec nous. Côté AC ! il y avait les alliés historiques : Sud PTT, CFDT interco. Ce sont des copains qui ont été très présents. Et puis dans l’action, c’est tous les syndicats CGT qu’on a rencontrés et qui ont donné un appui très important sur le plan de la logistique, du soutien financier, allant des repas aux distributions de tracts : la CGT EDF, la CGT PTT, la CGT SNCF, la CGT Legrand , le Secours Populaire, et puis la commission juridique de la CGT. Tout ça, se sont des gens sur lesquels on a pu compter, localement, alors que dans d’autres villes ce n’était pas comme ça.
Il y a eu beaucoup de gens de passage ; et puis, ce qui a montré un peu l’impact du mouvement, c’est qu’on a été évacué de l’Assedic par les CRS, on allait se replier à la gare où on a fait une assemblée générale, parce qu’il était plus de huit heures du soir, on n’avait pas d’autre lieu où aller. Là je suis allé voir un employé au guichet pour lui demander à rencontrer des syndicalistes cheminots. Le type n’était pas syndiqué mais il a pris son carnet, il a passé des coups de fil, et puis il m’a dit : pour vous le dernier train à bloquer passe dans un quart d’heure. Donc ça, ça montrait un certain soutien local mais, à mon avis, l’action a aussi révélé des limites.
Notamment le poids de la mairie, qui a une capacité très ancienne d’intégration du mouvement social. C’est ce qu’on peut appeler le socialisme municipal. John Merriman l’évoque dans Limoges la ville rouge ; en tout cas après 1905 et la défaite de 1912 c’est la conquête de la mairie. Et après il y a une intégration progressive. Peut-être qu’il y une trace de ça, je n’en sais rien, je ne suis pas du tout historien, mais c’est quelque chose que j’ai ressenti. Et on l’a senti dans une réaction d’une personne de l’UD CGT quand on occupait la mairie : je l’ai eue au téléphone, elle était vraiment très en colère et elle m’a engueulé comme un proviseur engueulerait un collégien. Il y a aussi la réaction de colère d’une dirigeante du Point Rencontre (on était adhérent de ce collectif à l’époque).
En tout cas « l’objectif » de la mairie avait pourtant été débattu : ce n’était pas AC ! qui était responsable ; on était partie prenante d’un collectif. On avait un fonctionnement qui a fait qu’on a eu un débat politique et, pour des raisons de sécurité, il y avait un groupe plus restreint, mais qui représentait les différentes sensibilités, qui a choisi l’objectif. On avait ciblé quelque chose qui pour nous correspondait à la situation, sachant que l’évacuation par les CRS c’était bien l’Etat, que le maire et le premier adjoint sont députés, donc sont parties prenantes de cette majorité qui, elle, a envoyé ses CRS évacuer les antennes Assedic ; et ensuite que la mairie est un lieu intéressant sur le plan de la visibilité en ville, en même temps qu’il est une représentation de l’Etat sur laquelle on faisait pression pour la satisfaction de nos revendications. L’occupation de la mairie a été le moment où le mouvement s’est énormément élargi, ce qui a posé des problèmes par la suite. On l’a vu aussi lors de la manif qu’on a amenée à la mairie : on invitait les gens à venir boire un coup avec nous, à discuter ; on a bien vu qu’il y avait beaucoup de gens qui avaient une réticence à entrer dans la mairie occupée. Je pense que ça révèle quelque chose, qui peut être creusé par les historiens.
Je voudrais terminer par un autre problème qu’on a rencontré : la contradiction entre l’action collective qui vise à une transformation sociale, et les désirs de réussite individuelle ou de promotion sociale qui peuvent amener certains à jouer un jeu perso. Les autorités en place, les pouvoirs qu’on rencontre, en usent et en abusent. Combien de fois on a pu rencontrer le maire de Limoges qui a dit : « Les cas individuels, on va les recevoir après ». Beaucoup de gens se précipitent tout d’un coup, ce qui a pour effet de casser un collectif et c’est terrible à vivre.
Angelo Campaner :
J’ai un parcours surtout syndical, mais aussi politique.
Je suis entré chez Legrand en 1947, au Comité d’entreprise en 1949 ; j’ai quitté Legrand parce qu’à la suite de mon service militaire il ne voulaient pas me reprendre. Je suis entré ensuite à l’Arsenal, pendant 13 ans, j’ai continué à la Saviem, puis à RVI.
J’ai toujours été syndiqué depuis 1948 à la CGT et ai toujours eu des mandats électifs, soit délégué du personnel, soit au Comité d’entreprise.
Lors d’une grève importante au bâtiment K où j’étais très mal à l’aise pour voir les copains, alors qu’ils étaient en grève, pour les soutenir, mon organisation n’était pas tout à fait d’accord pour qu’ils fassent grève. C’est là que s’est posé le problème par rapport à l’adhésion et au congrès qui a eu lieu au mois de juillet 1973. Je suis intervenu, en disant que je ne comprenais pas pourquoi mon organisation syndicale ne soutenait pas suffisamment ce personnel en grève qui se battait pour les conditions de travail ; dans ce bâtiment il y avait un délégué CGT et deux CFDT. Je leur ai dit au congrès à la Maison du Peuple : je me considère comme démissionnaire. Je crois qu’ils étaient contents que je parte, parce que je posais un certain nombre de problèmes. Ce qui m’intéresse c’est que ce n’est pas par rapport aux idées qu’il faut se déterminer, c’est par rapport aux valeurs. Si on se détermine par rapport aux valeurs, on fait beaucoup moins d’erreurs, que ce soit syndicales ou politiques. Les droits de l’homme, c’est quelque chose qui compte, le respect de la dignité de chacune et de chacun, c’est primordial.
Mon parcours politique : j’ai adhéré assez rapidement, mais toujours dans des partis très jeunes, très minoritaires. Parce que mon tempérament c’est : il faut que ça change. La routine ça ne peut amener à rien, d’ailleurs aujourd’hui à quoi ça nous a menés ? Je crois qu’il faut se remettre en question. Je suis entré au Mouvement de libération du peuple avec le journal qui s ‘appelle Le monde ouvrier qu’on distribuait dans les quartiers. Tous les dimanches matin, on allait faire notre tournée. Puis ça s’est élargi à l’UGS (Union de la Gauche Socialiste) avec d’autres mouvements qui se sont rajoutés. Puis est venu le PSU et les comités Juquin, auxquels j’ai adhéré. J’avais une grande espérance dans la transformation du Parti communiste. Maintenant je suis aux Verts. Le monde du travail a besoin de nous tous, il ne faut pas le couper en tranches. Le monde du travail, il va des salariés jusqu’aux retraités parce qu’ils sont encore citoyens : ils peuvent apporter et leur expérience dans le militantisme, et aussi leur bulletin de vote, en passant par les chômeurs, les précaires et les exclus. Et tout ça, ça devrait être pris en compte par les confédérations, parce que je crois qu’une confédération doit regrouper tous les professionnels et l’inter génération, on ne peut pas avoir une organisation qui soit meilleure que celle-là. Or il y a un problème : c’est vrai qu’il y a la division et le corporatisme qui, dans le syndicalisme, a fait des ravages énormes. Si on écoutait un peu plus ceux qui souffrent, on n’en serait pas là aujourd’hui. Vous savez que, en France, on n’arrive en nombre de syndiqués que juste devant la Grèce.
LE DEBAT
Guillaume Bertrand :
Actuellement je travaille à la Maison des droits de l’homme, je suis membre d’Attac. Les vingt premières années de ma jeunesse, je les ai vécues dans un monde très ferroviaire. J’ai remarqué que ce thème revenait souvent ce soir. Ce que j’ai ressenti, c’est une certaine idée du service public et aussi tout un accompagnement social. Ma mère était garde-barrière, mon père travaillait à la voie. Ce que j’ai ressenti dans cette entreprise c’est un très fort sentiment de solidarité et tout un tas de services assurés : l’Economat pour les cheminots, les voyages en train gratuits, la sécurité et la Caisse de prévoyance. C’est là que je me suis rendu compte que les luttes sociales avaient toute leur importance et apportaient un certain confort de vie, une certaine qualité de la vie.
Ce qui m’a amené, au cours de l’adolescence (fin des années 80) à me poser la question de l’engagement politique. En 1988 je me suis engagé au Parti socialiste. Je m’étais engagé surtout par rapport à des valeurs qui étaient la paix, la solidarité, la lutte contre le racisme. Mais j’ai été frappé par le désenchantement, parce que j’étais en rupture avec ce qui se passait. A ce moment-là, par rapport à l’armée, j’avais une position qui était l’objection de conscience ; j’ai senti très vite que même dans un parti qui se disait de gauche, cette position-là n’était pas admissible. Je me suis aussi senti en rupture par rapport à des questions de solidarité, de lutte contre le racisme. J’ai senti que, au sein de ce parti, il n’y avait pas de position claire. Et c’est vrai, quand j’ai vu des politiques se mettre réellement en œuvre – c’était la guerre du Golfe – je me suis senti complètement en désaccord avec cet engagement politique, ce qui m’a amené, à partir de 1992, à m’engager dans le milieu associatif. Je me suis engagé dans l’objection de conscience, ce qui m’a amené à la lutte militante réelle, l’engagement contre le service national. C’est vrai qu’au départ c’était un engagement contre, et puis au fur et à mesure de mes investissements, j’ai découvert qu’il y avait tout un tas de luttes à mener.
A travers cet engagement associatif, j’ai retrouvé mes valeurs de départ qui étaient paix, droits de l’homme, solidarité.
Récemment j’ai effectué un séjour à Porto Alegre. Ce que j’ai vu sur place, les différentes rencontres que j’ai pu faire avec les mouvements militants, m’ont amené à faire le lien avec la question du service public et l’engagement politique. C’est-à-dire qu’à une époque je crois qu’il y a des luttes sociales qui ont été bousculées par la mondialisation. Dans les pays où règne une pauvreté extrême comme en Amérique du Sud, on trouve des formes de lutte qui peuvent ressembler à ce qu’étaient peut-être des luttes d’autrefois, des luttes pour l’acquisition de droits.
Ca m’amène à me poser plusieurs questions. C’est vrai qu’aujourd’hui on peut se poser des questions sur les partis politiques de gauche, que ce soit au niveau national ou au niveau local ; c’est ce que j’ai vu un peu au Brésil où il y a certains partis politiques qui ont clairement construit un discours tout à fait en rupture avec le capitalisme.
Je m’interroge aussi sur la spécificité du mouvement social en Limousin et aussi son alternative politique : quelle rupture par rapport au libéralisme, et quel engagement par rapport aux mouvements qui sont engagés dans la précarité et contre le libéralisme ?
Paul Angleraud :
Je suis né à Limoges dans une famille militante.
Je voudrais, à partir d’un témoignage personnel, souligner la place de la famille. Parce que c’est effectivement au sein de la famille que se transmettent des valeurs, des histoires, des légendes aussi. A titre personnel, j’ai grandi dans l’idée qu’il existait autrefois des quartiers ouvriers. Ce n’est pas une légende, à Limoges il y avait le Pont Saint Martial, il y avait les ponticauds ; il y avait des luttes, il y avait des solidarités ; il y avait des fêtes aussi. Enfin toute cette belle histoire pouvait se poursuivre, autrement, aujourd’hui.
Je pense que la place de la famille est tout à fait importante et je voudrais trouver une piste de réflexion.
J’ai passé quelques années dans un mouvement de jeunesse qui s’appelle la JOC. Il n’a jamais eu une très grande ampleur en Limousin, mais je crois qu’il a produit quelques filières militantes intéressantes.
Aujourd’hui qu’est ce qui reste dans les quartiers populaires comme structures de socialisation de la jeunesse ? Qui est-ce qui va transmettre cet héritage militant et donc ces valeurs, ce militantisme de gauche ? Je disais la famille et puis les organisations de jeunesse. C’est vrai que j’ en veux un petit peu à la gauche gouvernante, même si pour plein de choses je suis très fier de ce qu’elle a fait, même si je ne suis pas du tout un enfant de la génération Mitterrand, même si j’avais 15 ans en 1981, j’en veux un peu à cette gauche qui a complètement négligé les organisations de jeunesse, qui a essayé de les instrumentaliser, alors que si on leur avait donné les moyens de vivre, donné les moyens de se développer, aujourd’hui on se poserait peut-être moins la question de la transmission et de l’héritage.
Je crois qu’une des clés du débat de ce soir, est là. C’est : comment transmettre ? Je le dis honnêtement, je suis un héritier. Philippe Babaudou qui est là dirait la même chose que moi. Quelque part, il a hérité de quelque chose .
Après, chacun fait fructifier cet héritage à sa façon.
Louis Chedemois :
Et arrivant en Creuse (je viens de Bretagne et de la région parisienne), j’ai trouvé un mouvement social et syndical organisé sur des positions de classe. En particulier dans les services publics, et pas dans entreprises privées creusoise. Il y a toute une tradition. Je n’en donnerai qu’un exemple. En 1934-36, un instituteur, responsable du SNI (à l’époque à la CGT) qui s’appelait Sylvain Lelache, organisait dans chaque canton creusois un comité antifasciste. C’était déjà la Résistance qui se préparait.
Je voulais surtout faire part d’une de mes inquiétudes. S’il y a effectivement un mouvement syndical qui se défend bien dans la Creuse, il y a un très grand problème dans les petites et les très petites entreprises qui sont non seulement ce qu’on appelait autrefois des déserts syndicaux, mais qui sont des zones de non droit.
J’ai connu la répression syndicale chez Citroën, chez Simca. Il y avait à l’intérieur des noyaux cégétistes, des noyaux communistes qui se battaient et qui se faisaient (malgré la présence de syndicats patronaux fascistes), quand même entendre, qui organisaient une certaine résistance. Dans beaucoup de petites PME de la Creuse, dans des petits bourgs, le droit syndical n’existe pas. Il ne peut pas s’exprimer, il ne peut pas s’organiser. Alors bien sûr : désertification, chômage, très bas salaires aidant, on est dans une situation que je considère comme extrêmement grave.
Martine Chéfaine :
Je travaille dans une société d’édition. Je crois qu’on ne naît pas militant, je crois qu’on le devient. C’est un long parcours et aussi un choix quelquefois.
J’ai milité au SNESUP dans le courant « Unité et Action » quand j’étais à l’Education nationale. Je travaillais en secteur universitaire, donc j’ai fait toutes les manifs, tous les défilés. Aujourd’hui je suis beaucoup plus inquiète quant à la jeune génération. Je me suis retrouvée ces derniers temps avec elle dans la rue. Je pense qu’en fait, la gauche a perdu beaucoup de vitesse et je ne sais pas si tous les jeunes qui étaient dans la rue étaient vraiment de gauche. Ce que je sais, par contre, c’est qu’ils manifestaient contre la montée du fascisme. Moi je dis les choses par leur nom ; il ne faut pas avoir peur des mots quelquefois , il ne faut pas se voiler la face non plus. Ce qu’ils revendiquent en fait, c’est le droit d’être entendus. Or je pense que ces dernières années on n’a pas fait un débat d’idées et qu’on n’a pas posé les vraies questions qu’il fallait poser aux Français au moment où il fallait les poser. Donc, à partir de là, il y a une certaine couche de la population qui a été carrément évincée des choix politiques. Je milite pour la tolérance, je milite pour la citoyenneté et le civisme. Je ne sais pas si ce sont des notions qui ont encore un sens aujourd’hui pour la transmission de la mémoire. Parce que ça c’est aussi quelque chose de très important.
Cette notion de militantisme c’est un cheminement, ce n’est pas inné, c’est quelque chose qui vient au fil des années et selon le vécu de chacun. Dire parce qu’on est militant qu’on est rebelle, je ne suis pas d’accord non plus ; quand j’ai vu Mitterrand arriver au pouvoir j’étais vraiment heureuse que ce soit la gauche qui arrive. Je peux vous dire aussi plus tard que j’ai été désenchantée par la gauche, comme beaucoup de personnes, parce que quand on exposait certains problèmes, ils ne voulaient pas en tenir compte. Et c’est vrai qu’à la limite je peux être assimilée à des révolutionnaires, je peux être assimilée à des anarchistes, à des rebelles, à tout ce qu’on peut imaginer. Mais je ne me considère pas comme telle parce que je respecte la loi française, parce que j’estime que je vis dans un pays qui est un des plus beaux pays du monde et que je voudrais bien qu’il le reste.
Cécile Dupont :
J’ai été aussi dans les manifs du premier mai, j’étais même dans celles d’avant. Des jeunes, j’en ai vu et je peux vous dire que les trois quart des étudiants, ce sont tous des gens qui ont voté. D’ailleurs il y avait beaucoup de gens même très à gauche qui étaient dans la rue. Il ne faut pas se méprendre sur la jeunesse, ce n’est pas non plus des pauvres abrutis qui ne savent pas où ils en sont. J’ai peur ce soir d’entendre aussi un discours qui dirait : « Les jeunes sont manipulables, influençables ».
Je ne suis pas fille de militant. La question que je me pose ce soir c’est : est-ce que la jeunesse d’aujourd’hui se retrouve systématiquement dans un Parti communiste, dans un syndicat ?
A propos de la spécificité du Limousin. Je suis née ici de parents qui sont d’ici aussi, et il y a une chose dont je suis persuadée, c’est qu’ici c’est une terre très rurale. Alain Corbin, historien qui a écrit Archaïsme et modernité en Limousin , montre la spécificité de la ruralité du Limousin ; cet espèce de glissement, ce déracinement des paysans qui ont été conduits dans les villes et notamment à Limoges à la fin du 19ème siècle, qui se sont trouvés déracinés dans des quartiers comme les Ponts, comme Montjovis. Je crois que la force du militantisme tient aussi à ce déracinement qui a toujours été mal vécu. Je m’occupe d’un Institut d’histoire sociale ; ça c’est pour répondre à la question sur la transmission. Cet Institut d’histoire sociale fait quelque chose qui me tient à cœur. Depuis quelques années j’avais commencé un travail sur les loisirs ouvriers à Limoges et il se trouve que je n’avais aucun document émanant des ouvriers. Jeannette Chartreux un jour [m’a aidée] . Ce qui me paraît important c’est ce travail de dépouillement d’archives, de pré-archivage, c’est quelque chose qui permet la transmission. Ce que j’y trouve, moi, c’est quatre générations avec des avis politiques différents ; franchement c’est une force !
Michel Kiener :
Je suis arrivé il y a 30 ans, je viens tout à fait d’autres mondes. Je suis fils de résistant. Ce qui m’a frappé en Limousin, ce sont deux choses qui me paraissaient dans les années 1970-80 complètement contradictoires : d’une part un monde nouveau pour moi, extrêmement militant, très riche en associations, en gens qui ne comptaient ni leur temps ni leur force, un monde profondément laïque, soucieux de liberté. Cet enracinement : une tradition de quelque chose dont on ne parle plus aujourd’hui : 1905. Plus personne n’en parle, sauf les vieux, nous. Au contraire, en 1970, 75, 80 les gens qui étaient là me paraissaient tous des héritiers d’une profonde tradition de résistance, de luttes sociales etc. Et ça c’était donc l’aspect positif. D’autre part, l’aspect négatif, c’était un monde qui me paraissait profondément cloisonné, et couvert d’une chape de plomb politique, dominé complètement par des appareils impénétrables à ceux qui n’étaient pas de la famille, incapable d’admettre qu’il y avait des problèmes nouveaux. Je pense que ça pose un problème pour aujourd’hui aussi. Par exemple, le Planning familial : il était un peu scandaleux, il ne fallait pas trop en parler. La condition des femmes, l’objection de conscience… Combien de fois ai-je entendu : il leur faudrait une bonne guerre, aux jeunes ! C’était en 1975, à l’époque des comités de soldats et compagnie. Tout ça, ça faisait évidemment des jeunes qui débarquaient par exemple au PS, qui restaient 15 jours, et se barraient vite fait.
L’environnement : dire « On n’est pas forcément contre les mines d’uranium, mais acceptons de nous poser des questions sur les conséquences », c’était provoquer des réactions d’une violence inouïe. Je parle de la gauche, je ne parle pas des ingénieurs du CEA !
Je pense aussi à la culture, il y avait une plus grande écoute au PC. Et le nombre de gens qui ont tenté des choses sur le plan culturel dans les années 1970-80, et qui ont craqué !
Tous ces champs de lutte-là étaient des domaines où les appareils politiques ne les aidaient pas. Et il y a toujours eu un décalage de presque dix ans.
Il y a un problème de transmission de témoin à la jeunesse. Je suis enseignant, j’en sais quelque chose. Mes élèves en 1993 et en 1995 me disaient en face, alors qu‘ils venaient de la gauche, « J’irai voter Chirac, j’irai voter à droite, car lui au moins il parle des jeunes ». Quand ils étaient des petits bourgeois, des bourgeois, ou des fils de bourgeois en 1975, représentant seulement 20% d’une classe d’âge, c’était pas trop inquiétant. Mais quand 80% d’entre eux sont maintenant au lycée, il faut se poser des questions. Deuxième challenge : c’est la transformation de beaucoup de gens en petits bourgeois égoïstes qui sont dans les lotissements. Pourtant dans certains lotissements on fait les feux de St Jean ensemble, il y a cette solidarité et c’est très frappant que la couronne banlieusarde de Limoges soit une couronne vivante. Ca, ça me paraît une des richesses de la région. Mais c’est vrai aussi que les habitants de ces lotissements peuvent basculer, peuvent se transformer en petits bourgeois soucieux de leurs petits intérêts, qui perdent complètement le sens de ces solidarités qui ont été évoquées tout au long de ce soir.
Comment faire pour que ces gens-là, qui sont pourtant des travailleurs ou des employés ordinaires, puissent continuer de se sentir solidaires de ceux qui habitent, par exemple, dans les cités ? de ceux qui sont chômeurs, de tous ceux qui ont été évoqués ce soir ?
Michèle Normand :
Je n’étais pas enfant de militant. Ce que j’ai ressenti dans ma jeunesse c’est que, vivant dans un milieu rural, corrézien, les difficultés de la vie, le manque d’argent dans la maison, c’est ça qui a forgé mon militantisme politique au Parti communiste et ensuite à la CGT. Le problème des injustices existe toujours. Le problème de savoir pourquoi on travaille pendant huit heures dans des boutiques pour gagner pas grand-chose quand les salaires en Limousin sont très bas. Je suis un petit peu inquiète effectivement pour la jeunesse. C’est certain que mes enfants n’auront pas connu le manque que j’ai connu dans mon enfance. Comment se positionneront-ils dans la vie quand ils seront salariés ou quand ils seront amenés à faire leur chemin ?
J’ai été un petit peu déçue de voir dans cette assemblée très peu de jeunes. Je côtoie des camarades qui ont aujourd’hui la cinquantaine et qui ont des enfants. Que font les enfants de ces militants qui sont présents dans la salle ? Comment se positionnent-ils ? Que veulent-ils ? J’ai tout espoir en tous ces jeunes que j’ai rencontrés dans la rue, en manifestant à côté d’eux dès le 21 avril au soir, mais c’est vrai que il y a des questions qui restent aujourd’hui sans réponse. Il faut qu’il y ait une transmission, alors elle se fait encore familialement sans doute, mais je crois qu’il faut qu’elle se fasse peut-être aussi dans toutes les couches de la société, l’école, la famille et les institutions. Peut-être qu’une réunion comme ça aujourd’hui, on aurait dû la faire sur la campus de Vanteaux ?
Serge Tissot :
Je suis à SUD-PTT. Je ne pense pas qu’il y ait un gène inné de transmission du militantisme. J’ai milité par rébellion contre les injustices et à partir des syndicats de soldats. A l’époque, c’est vrai qu’on a été un peu au casse-pipes. J’ai fait de la prison à ce moment-là. Et c’est vrai qu’on n’était pas soutenu par les organisations syndicales traditionnelles, y compris la CGT.
Je ne crois pas qu’il y a un formatage pré-établi pour des militants. Il faut pas croire que les jeunes militeront comme nous on a milité. Croire ça, c’est une erreur totale.
Deuxième point, une chose qui m’affole : les jeunes qui ont le droit de vote ne savent pas ce que c’est qu’un syndicat. Je me suis aperçu qu’il y avait une faille complète, à ce niveau-là. Alors il faut s’interroger sur la transmission du savoir.
On a un peu évacué le problème de ce qui s’était passé le 21 avril avec le vote Le Pen. J’ai le privilège à France Télécom d’appartenir à une organisation où nous avons été désignés comme les ennemis internes de l’entreprise (sous un gouvernement de gauche, il faut le rappeler). Je ne me sens absolument pas responsable de ce qui s’est passé le 21 avril. La gauche gouvernementale, pour des raisons x ou y, s’est coupée du mouvement social. Je ne suis pas sûr que les leçons ont été tirées. D’une part, on n’a pas pris en compte la misère qui existe. Comment ça se fait que les gens ont voté Front national dans des endroits comme la Creuse ? Je ne crois pas que ce soit uniquement le racisme qui fait le vote Front national. Moi je crois que c’est la désespérance. J’ai mon beau-fils qui travaille en Creuse avec des salaires de misère, avec des patrons « Si tu l’ouvres c’est dehors », et c’est comme ça, c’est pas il y a 50 ans, c’est aujourd’hui que cela se passe. Des gens qui travaillent, qui défendent des gens aux prud’hommes, ils savent très mal ce qui se passe dans les petites entreprises. C’est la loi du patron, du plus fort. Donc ces gens-là n’ont pas de réponse à ça. Ils n’ont pas d’organisation.
Il n’y a pas de génération spontanée ; ce qui s’est passé, c’est réjouissant. Ça ne veut pas dire que ça va changer quelque chose s’il n’y a pas de débouché qui est donné à ce qui s’est passé. J’entendais Hollande nous expliquer que la gauche avait compris ; je vous signale que, juste avant de partir, Pierret (pour la défense du Service public !) a signé un décret autorisant la Poste à vendre tout son bien immobilier. C’est une réalité ! Ils viennent de prendre une claque aux élections et le lundi avant de partir ils signent un décret pour autoriser ça.
Je ne suis pas optimiste pour la suite. Ce qui s’est passé le 21 : on a arrêté le 5 mai le plus gros danger, mais il n’y a pas de débouché sur la crise qui est ouverte. S’il n’y a pas de débouché, s’il n’y a pas une prise de conscience plus collective et si on ne va pas vers d’autres propositions, je vous dis que ce ne sera peut-être pas Le Pen, ce ne sera peut-être pas le Front national, mais ce sera l’extrême droite qui comblera le vide politique qui s’est créé.
Danièle Kelder :
Je travaille dans un quartier et la gauche m’a donné les moyens de travailler correctement sur le plan culturel.
Je suis artiste et je voudrais vous dire : eh bien, allez là où est la misère, et vous serez étonnés de voir les merveilles qui peuvent ressortir d’un quartier quand on sait regarder les gens autrement qu’en leur proposant
d’aller aux Restaurants du cœur. Je dois dire que je travaille avec des Gitanes, avec des Maghrébines, avec des petites Françaises : elles ont créé des danses, elles ont donné des spectacles, notamment à Jules Noriac.
Dans les zones pavillonnaires, comment pourrait-on faire pour qu’il y ait la solidarité, qu’elle ne se perde pas ? Allez dans les quartiers, proposez votre emploi du temps, proposez votre bénévolat et vous serez heureux. Moi je reçois du bonheur à longueur de journée. Alors je voudrais pouvoir dire que, les Restaurants du cœur, c’est peut-être bien pour ceux qui ont à manger tous les jours, mais croyez-moi, quand on doit y aller avec ses enfants et le panier, c’est vraiment indigne pour notre pays. Alors donnons du travail aux gens, donnons des salaires décents, pour qu’ils aillent eux-mêmes acheter leurs commissions dans les supermarchés, comme les autres, et donnons aussi de la culture, parce que par la chanson, par la danse, les êtres humains peuvent se mettre debout, ils peuvent aussi trouver du travail, on peut aussi avoir un autre regard sur eux quand on sait que les pauvres ont aussi autre chose à nous offrir.
Les jeunes, qu’est-ce qu’ils font aujourd’hui ? Ils reproduisent ce qu’ils ont vu chez les adultes, et ils disent ce que nous-mêmes nous avons entendu.
Georges Chatain :
Je crois que ce serait très réducteur d’essayer d’imaginer quelque conclusion que ce soit.
Compte-rendu : contraction de la transcription mot à mot de Francis Juchereau.