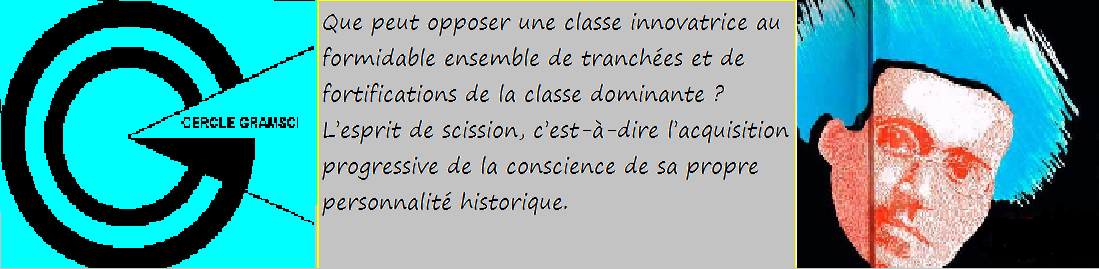Avec Maurizio Lazzarato
Ce soir (5 avril 2012) le thème est celui de la dette et de sa place dans le monde et dans notre pays. Notre invité Maurizio Lazzarato est l’auteur d’un petit essai, La fabrique de l’homme endetté. Cette soirée a été concoctée en collaboration avec le CAC 87.
Maurizio est philosophe, Italien qui vit en France pour les raisons que l’on devine. Dans les années 1970 et début 1980 le mouvement social en Italie a été tel que parmi ceux qui s’y sont investis un certain nombre s’est réfugié en France. Maurizio est à la fois un militant, un chercheur, un philosophe, et un sociologue.
Guy Dauge (le CAC 87) :
En 2011 dans plusieurs pays se sont développés des collectifs citoyens (dont l’objectif est de décortiquer les mécanismes de la dette dans leurs pays respectifs), qui se demandaient ce qui se passait, s’il n’y a pas d’autres solutions pour en sortir. En France aussi un collectif national s’est créé à l’automne. CAC : Collectif Citoyen pour un Audit public. Aujourd’hui il y a 120 collectifs locaux qui amplifient le travail du collectif national. Le CAC 87 existe depuis janvier 2012. On met en lumière les origines réelles de la dette. C’est donc un travail de recherche et d’explication essentiel. Expliquer par un travail d’éducation populaire de manière à ce qu’il y ait un débat entre nous. En février plus de 200 citoyens se sont réunis ici pour en débattre. On anime des débats dans les communes de la Haute-Vienne. Ce travail est fondamental ; nous ne sommes pas des spécialistes mais nous nous sommes retroussés les manches pour décoder, comprendre des choses qu’on veut nous faire croire trop compliquées pour nous. Nous allons faire tout un travail à propos des prêts toxiques. Les prêts toxiques ce sont ces méchants prêts qui sont faits par des méchants banquiers auprès des collectivités, des communes, des hôpitaux. Ces prêts ont été montés de façons suffisamment complexes avec des indexations sur des montages financiers complexes c equi fait qu’aujourd’hui les index ayant explosé, les charges de remboursement pour les collectivités sont beaucoup plus importantes qu’elles ne l’étaient initialement et ceux qui paient les intérêts des communes ce sont les contribuables. On fait un espèce de déshabillage des prêts contractés ces dernières années, auprès des communes de plus de 2000 habitants auxquelles nous avons envoyé un dossier afin de voir si elles nous ouvrent leurs comptes pour mettre en lumière des prêts qui ont été faits de cette manière. D’autres actions seront lancées. Notre collectif est un regroupement de citoyens qui ont pris à bras le corps la question de la dette et qui essaient de faire en sorte que tous les citoyens puissent s’en emparer, parce qu’on considère qu’on ne pourra sortir de ce problème de la dette de manière saine que si les citoyens se l’approprient. Si on laisse faire les financiers dans la manipulation par rapport aux politiques, on vivra ce que vit la Grèce.
Le CAC 87 c’est un collectif qui rassemble des gens d’horizons sociaux, économiques, politiques, différents et ont fait l’effort de se rejoindre sur une démarche commune qui dépasse nos engagements personnels.
Dette et austérité, le modèle allemand du plein emploi précaire
Maurizio Lazzarato :
L’endettement de l’État était, bien au contraire, d’un intérêt direct pour la fraction de la bourgeoisie qui gouvernait et légiférait au moyen des Chambres. C’était précisément le déficit de l’État, qui était l’objet même de ses spéculations et le poste principal de son enrichissement. A la fin de chaque année, nouveau déficit [1]. Au bout de quatre ou cinq ans, nouvel emprunt. Or, chaque nouvel emprunt fournissait à l’aristocratie une nouvelle occasion de rançonner l’État, qui, maintenu artificiellement au bord de la banqueroute, était obligé de traiter avec les banquiers dans les conditions les plus défavorables. Chaque nouvel emprunt était une nouvelle occasion de dévaliser le public qui place ses capitaux en rentes d’État…
Karl Marx,
Les luttes de classes en France.
Moins de vingt ans après la » victoire définitive sur le communisme » et quinze ans depuis » la fin de l’histoire « , le capitalisme est dans l’impasse. Depuis 2007 il vit sous perfusions de sommes astronomiques d’argent public. Malgré cela, il tourne à vide. Au mieux, il se reproduit en achevant avec rage ce qui subsiste des conquêtes sociales des deux derniers siècles. Depuis la » crises des dettes souveraines « , il exhibe le spectacle pour partie hilarant de son fonctionnement. Les normes de » rationalité » économique que les » marchés « , les agences de notation et les experts imposent aux Etats pour sortir de la crise de la dette publique sont celles-là mêmes qui ont causé la crise de la dette privée (à l’origine de celle de la dette publique). Les banques, les fonds de pensions et les investisseurs institutionnels exigent des Etats la mise en ordre des bilans publics, alors qu’elles détiennent encore des milliards de titres pourris, fruits de leur politique de remplacement des salaires et des revenus par des crédits [2]. Après avoir noté AAA des titres qui aujourd’hui ne valent rien, les agences de notation prétendent, contre toute évidence, détenir la bonne évaluation et la juste mesure économique [3].
Les experts (professeurs d’économie, consultants, banquiers, commis d’Etat, etc.) – dont l’aveuglement sur les ravages que l’autorégulation des marchés et la concurrence produisent sur la société et la planète est directement proportionnel à leur servitude intellectuelle – ont été catapultés dans des gouvernements » techniques » qui rappellent irrésistiblement les » comités d’affaires de la bourgeoisie « . Il s’agit moins de » gouvernements techniques » que de nouvelles » techniques de gouvernement « , autoritaires et répressives, en rupture avec le » libéralisme » classique.
La palme du ridicule revient sans doute aux médias. L' » information » des journaux télévisés et les talk shows expliquent que » la crise c’est de votre faute, vous partez trop tôt à la retraite, vous vous soignez sans modération, vous ne travaillez ni aussi longtemps ni aussi intensément qu’il le faudrait, vous n’êtes pas suffisamment flexibles et vous consommez trop. Finalement, vous êtes coupables de vivre au dessus de vos moyens « .
Pour sa part, la publicité qui alterne avec les discours culpabilisants des économistes, des experts, des journalistes et des hommes politique énonce exactement l’inverse : » Vous êtes absolument innocents, vous n’avez aucune responsabilité ! Aucune faute et aucune culpabilité n’entachent votre âme. Vous méritez tous, sans exception, le paradis de nos marchandises. Il est même de votre devoir de consommer de manière compulsive « .
Les » ordres » et les injonctions des sémiotiques signifiantes de la culpabilité [4] et celles des sémiotiques iconiques et symboliques de l’innocence se télescopent. Morale ascétique du travail et de la dette et morale hédoniste de la consommation de masse se contredisent ouvertement, sans plus se composer.
Plus qu’à une sortie de crise, toute cette agitation ressemble à un cercle vicieux dans lequel le capitalisme semble bien empêtré. La vision de nos élites ne dépassant jamais leur porte-monnaie, il faut s’attendre au pire. La férocité avec laquelle les gouvernements techniques et les autres poursuivent le remboursement de la dette et la défense de la propriété privée ne recule devant rien. Selon le New-York Times, les représentants de banques et de fonds créditeurs de la dette grecque ont été tentés de porter plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme ; l’Etat grec violerait les droits fondamentaux car » property rights are human rights « ). Même la récession et la dépression (Grèce), sont des maux mineurs face à l’éventualité de ne pas tenir la promesse de s’acquitter de la dette. Dans une interview récente, le président de la BCE propose, avec le cynisme thatchérien d’usage, des recettes qui non seulement ont causé la crise, mais qui ne peuvent que l’aggraver : baisser les impôts pour enrichir les riches et réduire les dépenses sociales pour appauvrir les pauvres.
Les hommes politiques ne sont plus que des comptables et des » fondés de pouvoir » du capital. Sarkozy a proposé que les recettes pour payer » les intérêts de la dette grecque soient déposés sur un compte bloqué, qui garantirait ainsi que les dettes de nos amis grecs seront réglées « . Favorable à cette idée, Angela Merkel a estimé que cela permettrait d’être » sûr que cet argent sera durablement disponible. »
S’il y a une constante dans le capitalisme c’est l’état de guerre auquel le libéralisme conduit de façon quasi » automatique « . La guerre inter-capitaliste semble aujourd’hui moins intense que celle que chaque capital national mène contre son ennemi intérieur. En désaccord sur comment se partager le gâteau de l’exploitation mondiale, les différents capitalismes convergent sur la manière de l’intensifier à l’échelon de chaque Etat.
Pour sortir de la crise, le temps est donc aux » réformes » de structure : régulation de la finance ? Redistribution de la richesse ? Réduction des inégalités, de la précarité, du chômage ? Fin de l' » assistance » scandaleuse de l’Etat Providence, voire des cadeaux fiscaux aux riches et aux entreprises ? Les » réformes de structure » envisagées et mises en œuvre sont au nombre de deux : restructuration drastique du marché de l’emploi accompagnée de réduction des salaires et de vigoureuses coupes dans les dépenses sociales en commençant, comme toujours, par l’assurance chômage [5]. Le modèle de référence est allemand. Lors d’une récente prestation télévisuelle, Sarkozy [6] a cité 9 fois l’exemple de l’Allemagne et le gouvernement » technique » de Mario Monti est sous le charme de la nouvelle » dame de fer » dont il reçoit directement les » conseils » (des ordres).
Le modèle allemand
Depuis 10 ans, l’Allemagne poursuit des politiques de flexibilisation et de précarisation du marché de l’emploi et de coupes sombres dans le Welfare State. Au parlement européen Daniel Cohn-Bendit a interpellé Angela Merkel : » Comment est-il possible qu’un pays riche comme l’Allemagne ait 20% de pauvres ? » [7]. L’ex-soixante-huitard est-il naïf ou amnésique ? Plutôt hypocrite et cynique, puisque c’est le gouvernement » rouge-vert » de Schröder qui, entre 2000 et 2005, a introduit l’essentiel des lois à l’origine de la situation actuelle : celle d’un » plein emploi précaire » qui a opéré la transformation des chômeurs et des » inactifs » en une masse impressionnante de » travailleurs pauvres « .
Un peu d’histoire et quelques données sont nécessaires pour mettre en lumière les misères d’un modèle allemand que la Troïka ( Europe, FMI et BCE) est en train d’imposer à tous les pays européens.
Entre 1999 et 2005 le gouvernement » rouge-vert » a mené, en s’appuyait sur le slogan « Fördern und fordern » (« promouvoir et exiger »), quatre réformes de l’assurance chômage et du marché de l’emploi (les quatre lois Harzt), chacune étant particulièrement catastrophique.
En janvier 2003, la loi Harzt II introduit les contrats » Mini-job » qui constituent une sorte de travail au noir légalisé (ils exonèrent les employeurs des cotisations sociales et n’assurent aux employés ni assurance-chômage ni retraite) et » Mini-job » au salaire de 400 à 800 euros par mois, en incitant tout le monde à devenir » entrepreneur » de sa propre misère.
En janvier 2004 la loi Hartz III restructure les agences nationales et fédérales pour l’emploi en vue d’intensifier le contrôle et le suivi des comportements et de la vie des travailleurs pauvres. Une fois préparés ces dispositifs de gouvernement des travailleurs pauvres, le gouvernement rouge-vert approuve une série de lois pour les » produire « .
Entrée en vigueur le 1er janvier 2005, la loi Hartz IV prévoit :
* la réduction de la durée des indemnités de trois ans à maximum un an, le durcissement des conditions d’accès et l’obligation d’accepter tout emploi proposé. Pour ouvrir des droits à l’assurance chômage, il faut désormais avoir été employé pendant douze mois au cours des deux années précédant la perte d’emploi. Après un an d’allocations chômage, le chômeur perçoit l’aide sociale (équivalent du RSA) de 374 euros. Un rapport de l’Agence fédérale pour l’emploi indique qu’un travailleur sur quatre qui perd son emploi touche directement l’aide sociale (Arbeitslosengeld II : ALG II) plutôt que l’indemnité chômage (ALG I). Les raisons tiennent à la nature de l’emploi que le travailleur vient de perdre : précaire ou mal payé.
* la réduction des indemnités versées aux chômeurs de longue durée qui refuseraient d’accepter des emplois en dessous de leur qualification.
* les chômeurs doivent accepter des postes pour un salaire de 1€ de l’heure (additionnel à l’allocation chômage qu’ils perçoivent).
* la possibilité de réduire les allocations des chômeurs qui possèdent des économies, et pour cela un droit d’accès aux comptes bancaires des » assistés » ; la possibilité également de décider du standard de l’appartement de l' » assisté » et d’exiger, le cas échéant, un déménagement.
On estime à 6,6 millions de personnes – dont 1,7 million d’enfants – les bénéficiaires de l’aide sociale d’Hartz IV. Les 4,9 millions d’adultes sont en réalité des travailleurs pauvres employés moins de 15 heures par semaine. En mai 2011, les statistiques officielles faisaient désormais état de 5 millions de Minijobs, avec une augmentation de 47,7% devancée par un boom de l’intérim qui atteint 134%. Ces formes de contrats sont également très répandues chez les retraités : 660 000 d’entre eux combinent leurs pensions à un Minijob [8]. Une partie importante de la population, 21,7 %, est employée à temps partiel en 2010.
L’équivalent de l’Insee en France, le bureau Destatis a mesuré l’augmentation de la précarité et des formes qu’elle recouvre : entre 1999 et 2009, toutes les formes de travail atypiques se sont accrues d’au moins 20% [9]. Les plus touchés sont les familles monoparentales (les femmes) et les seniors. Dans les conditions du plein emploi précaire, le taux officiel de chômage affiché comme une marque du » miracle économique allemand » ne signifie pas grand chose !
En expansion rapide, cette armée de travailleurs pauvres n’est pas composée exclusivement d’employés à statut précaire, mais aussi de travailleurs en CDI et à temps complet. En août 2010, un rapport de l’Institut du travail de l’université de Duisbourg – Essen a en effet établit qu’en Allemagne plus de 6,55 millions de personnes touchent moins de 10 euros brut de l’heure – soit 2,26 millions de personnes en plus en 10 ans. Ce sont en majorité d’anciens chômeurs que le système Hartz a réussi à « activer » : des moins de 25 ans, des étrangers et des femmes (69% du total).
En outre, 2 millions d’employés gagnent Outre-Rhin moins de 6 euros de l’heure et en ex-RDA, ils sont nombreux à vivre avec moins de 4 euros par heure, c’est-à-dire moins de 720 euros par mois pour un temps complet. Résultat, les travailleurs pauvres représentent près de 20 % des employés allemands.
Pendant la crise financière le gouvernement a massivement recouru au chômage partiel qui permet aux entreprises de ne verser que 60 % de la rémunération normale aux salariés et de ne payer que la moitié des cotisations sociales.
Autre résultat du tournant engagé par Schröder, depuis 2002, : la part des salaires a baissé de 5% du PIB.
Le changement introduits par les » rouges-verts » sont qualitatifs : après des années de développement chaotique et sauvage de la précarité, des sous- emploi et de sous-salaires, il était temps d’introduire une régulation et une rationalisation de la pauvreté et de la précarité, en constituant un » véritable » marché de l’emploi des » gueux « , » cohérent « , il poussera aussi les mieux employés à la flexibilité et à la raison économique. C’est l’ensemble de la population, (précaires, travailleurs pauvres, travailleurs qualifiés) qui devient flottante, disponible à la flexibilité permanente. Les différentes composantes de la » force de travail » sociale sont désormais une simple variable d’ajustement de la conjoncture économique.
Le programme » rouge-vert » porte bien son nom, » Agenda 2010 » [10], et dix ans après la première loi Hartz les résultats sont meurtriers. Et il ne s’agit pas là d’une métaphore ! L’espérance de vie des plus pauvres – ceux qui ne disposent que des trois quarts du revenu moyen – recule en Allemagne ; pour les personnes à bas revenus, elle est tombée de 77,5 ans en 2001 à 75,5 ans en 2011 selon les chiffres officiels ; dans les Länder de l’Est du pays, c’est pire, l’espérance de vie est passée de 77,9 ans à 74,1 ans.
L’Allemagne est le premier pays d’Europe à suivre les USA sur la voie du progrès libéral. Encore deux décennies d’efforts pour » sauver de régime de retraites » et la mort coïncidera avec l’âge de la retraite [11]. La guerre interne a aussi ses » frappes chirurgicales » ciblées. Toutes choses égales par ailleurs, dans l’ancienne Allemagne de l’Est l’espérance de vie tomberait à 66 ans, juste avant les 67 ans du droit à la retraite. » Mors tua, vita mea » ! (ta mort c’est ma vie). Qu’importe ! l’économie est saine, les » agences » la notent bien, les créditeurs s’empiffrent et l’espérance de vie de la partie la plus riche de la population continue de progresser.
Il faut dire un mot de Peter Hartz, qui est à l’origine des lois sur l’assurance chômage et l’aide sociale. Sa condamnation à deux ans de prison avec sursis et à une amende de 576 000 euros, est un exemple de la corruption consubstantielle au modèle néo-libéral. Peter Hartz, ancien directeur des ressources humaines de Volkswagen et grand moralisateur des » Anspruchdenker » (des » profiteurs du système « ), a reconnu avoir versé à Klaus Volkert, syndicaliste de l’IG Metall et ancien président du comité d’entreprise du constructeur automobile, diverses primes, pour payer des prostituées et des voyages exotiques. Klaus Volkert, quant à lui, a été renvoyé devant les tribunaux pour incitation à l’abus de confiance, au même titre que l’ancien directeur du personnel, Klaus-Joachim Gebauer, accusé de complicité.
Faire de la pauvreté et de la précarisation une variable stratégique de la flexibilité du marché de l’emploi, telle est la politique mise en œuvre en Italie, en Portugal, en Grèce, en Espagne [12], en Angleterre et en Irlande.
La » réforme » du marché de l’emploi que le gouvernement » technique » italien est en train d’organiser s’inspire directement du modèle allemand. Le Ministre du Travail et du Welfare, Fornero, le dit très clairement dans La Stampa le 4 mars. La lecture de la réalité dramatique vécue par une majorité de salariés et de la population allemande dans la novlangue dans laquelle s’exprime la » gouvernance » est un chef d’œuvre d’hypocrisie et de langue de bois : » L’exemple le plus proche d’une reforme générale du marché du travail et de la protection sociale – si on excepte le processus entamé récemment par l’Espagne – nous est offert par les interventions réalisées en Allemagne il y a dix ans quand le pays était considéré comme le » malade de l’Europe « , incapable de croître faute de dépasser le poids de la réunification. Les reformes allemandes ont concerné tous les aspects du marché du travail et du Welfare : amélioration des instruments de formation professionnelle, soutien à la participation au marché du travail et à l’emploi, même partiel, des couches sociales moins favorisées ; liaison plus forte entre la jouissance de traitements particuliers et l’effectivité de l’action de requalification et de recherche de travail ; développement de l’activité de centres pour l’emploi ; introduction de plus de flexibilité aussi bien à travers de nouveaux types de contrats qu’à travers la négociation entre entreprise et travailleur « .
Sous le chantage de la dette, l’Etat veut achever le passage entamé dans les années 80 du welfare (droits et services sociaux) au workfare (subordination des politiques sociales à la disponibilité et à la flexibilité d’un plein emploi précaire). Le tournant autoritaire du néo-libéralisme est en train d’en finir avec le » modèle social européen « , car, comme affirme l’inénarrable Mario Draghi, on ne peut plus se permettre de » payer les gens sans travailler « .
Le RSA français,
produire le « travailleur assisté »
La France est elle aussi engagée sur ce terrain, même si les résultats ne sont pas si éclatants qu’en Allemagne. Grâce encore une fois à un homme de centre gauche, Martin Hirsch, embauché cette fois par un président de droite, on expérimente la transformation d’un maigre droit au revenu, le RMI, (revenu minimum d’insertion, 417 euros par personne), en machine à fabriquer des travailleurs pauvres, avec le RSA, revenu de solidarité active.
C’est avec les techniques de gouvernement des pauvres que l’on expérimente des dispositifs de pouvoir et de contrôle dont on étend ensuite l’emprise sur l’ensemble de la société. Mais cela semble laisser indifférents la gauche et les syndicats.
L’instauration du RSA prolonge et amplifie le dépassement des dualismes fordistes à l’oeuvre depuis plus de trois décennies. Les dualités chômage/emploi, salaire/revenu, droit du travail/droit de la sécurité sociale, loi/contrat ne tiennent plus, et le RSA organise désormais leur imbrication et leur agencement sous la figure du travailleur pauvre. A simplement considérer la hausse phénoménale du nombre de « chômeurs en activité à temps réduit » (près de 40% des chômeurs indemnisés par l’assurance chômage, par exemple), c’est-à-dire inscrits comme chômeurs, indemnisés à ce titre par tel et ou tel dispositif et employés par une ou des entreprises, la dislocation de ce dualisme et de ses frontières était déjà amplement manifeste. Pour sa part, le RSA institue un nouveau statut pérenne du travailleur assisté où se cumulent salaires d’activité et une fraction du revenu de » solidarité « . Poursuivant le brouillage entre les figures du » salarié » et de l' » assisté « , rendant caduques les frontières entre emploi, chômage et aide sociale, ou entre droit du travail et droit de la sécurité sociale, le RSA conditionne un énième segment du marché de l’emploi, une nouvelle norme du sous-emploi et du sous-salaire. L’adoption de ce dispositif signe implicitement l’abandon officiel de l’objectif du plein emploi et la mise en place d’une politique de la » pleine activité » conçue comme une activité pour tous, indépendamment de la durée et de la qualité de l’emploi.
Avec le RSA, on est passé d’une logique statutaire et institutionnelle qui, à l’époque du RMI – malgré diverses exclusions, de catégories d’étrangers, des moins de 25 ans, et un très économique calcul du revenu sur la base du ménage – restait celle des droits égaux pour tous, à une logique contractuelle et discrétionnaire où chaque allocataire doit signer un contrat qui conditionne le maintien des droits et qui cible chaque situation particulière. Le RSA approfondit le propre de toute politique sociale néo-libérale : l’individualisation. Le contrat d’insertion est un hybride de la » loi » et du » contrat » qui, selon Alain Supiot, ne signifie pas l’égalité et l’autonomie des contractants mais l’affirmation d’une asymétrie de pouvoir : » Leur objet (du contrat d’insertion) n’est pas d’échanger des biens déterminés, ni de sceller une alliance entre égaux, mais de légitimer l’exercice d’un pouvoir « , puisque le contractant est obligé de signer pour obtenir que l’allocation lui soit versée. On passe d’une logique de droits qui institue un » ayant droit » à un dispositif qui conditionne l’allocation, à un engagement subjectif dont la première épreuve est constituée par un » travail sur soi » à fournir pour » être disponible » aux sous-emplois et aux sous-salaires. Le RSA opère un renversement de la logique de l’aide sociale, c’est-à-dire un renversement de la » dette « . Il bouche la brèche que le RMI avait ouvert dans le droit de la sécurité sociale : une allocation indépendante de » l’emploi » et sans » contrepartie » directe.
De façon ambiguë, le RMI affirmait une dette de la » nation » envers les “ citoyens les plus démunis “ : » Aux termes des débats parlementaires (loi RMI), malgré la persistance de positions opposées sur le sens du contrat et l’adoption d’un texte de compromis, la volonté du législateur de rompre avec la demande de contrepartie dans l’assistance était sans ambiguïté : l’insertion était un droit, et sa mise en œuvre engageait l’institution d’abord envers elle-même. Du point de vue de l’allocataire, l’insertion était un objectif et non un préalable au versement de l’allocation » (Nicolas Duvoux). Le RSA, au contraire, a comme objectif d’indexer l’allocation à un sous-emploi, à la disponibilité à l’employabilité et à un contrat d’insertion. Il n’institue pas seulement le » travailleur » pauvre, mais aussi sa culpabilité, puisque ce dernier est tenu, implicitement ou explicitement selon les cas, pour responsable de sa condition et donc comme étant en dette vis-à-vis de la société et de l’Etat.
A chaque changement de phase économico-politique on trouve toujours l’Etat et ses administrations au commandement des opérations. De la même manière qu’il a initié et favorisé les politiques néo-libérales du crédit dans les années 1980 et 1990, c’est à l’Etat que revient l’organisation de leur continuité sous les nouvelles formes autoritaires et répressives du remboursement de la dette et de la figure de l’homme endetté [13].
Une autre illusion de la gauche tombe : celle d’opposer à la logique de la propriété privée du marché une sphère publique étatique. Il n’y a ni autonomie du politique, ni neutralité de l’Etat. Ses administrations agissent en profondeur sur l’économie, la » société » et les subjectivités, comme le démontre de façon paradigmatique la construction du marché de l’emploi et sa restructuration permanente.
Crise de la finance
ou crise du capitalisme ?
Il s’agit pourtant moins de montrer la toute puissance du capitalisme que de relever sa faiblesse dans le moyen et long terme. Si les contre-réformes structurelles vont toucher dramatiquement une grande partie de la population, elles ne tracent aucune sortie de crise. Les experts, les marchés, les agences de notation et les hommes politiques, ne sachant où aller ni comment, approfondissent les politiques néo-libérales de production et d’intensification des différences de classes qui sont la vraie origine de la crise.
La machine capitaliste s’est emballée, non pas parce que elle n’est pas bien régulée, non pas parce qu’il y aurait des excès ou parce que les financiers sont avides, etc. (laissons ces illusions à la » gauche » régulatrice !). Tout ça est vrai mais ne saisit pas la nature de la crise actuelle qui n’a pas commencé avec la débâcle financière. Cette dernière est plutôt le résultat de la faillite du programme néo-libéral (faire de l’entreprise le modèle de toute relation sociale) et de la résistance que la figure subjective qu’il cherchait à imposer (le capital humain ou l’entrepreneur de soi [14]) a rencontré. C’est cette résistance, même passive, qui, en entravant la réalisation du programme néo-libéral, a transformé le crédit en dette. Si le crédit et l’argent manifestent leur nature commune d’être des » dettes « , c’est que l’accumulation est bloquée, incapable d’assurer de nouvelles rentabilités et de produire de nouvelles formes d’assujettissement.
Aux USA, entre 2001 et 2004, une croissance de 10% du PIB a été possible uniquement parce que des mesures de relance de l’activité ont injecté 15,5 points de PIB dans l’économie : une baisse d’impôts pour 2,5 points de PIB, un crédit immobilier passé de 450 à 960 milliards (1300 avant la crise de 2007), des dépenses publiques qui ont augmenté de 500 milliards.
A l’orée du XXIème siècle, l’Allemagne était dans une situation similaire. La croissance du PIB allemand entre 2000 et 2006 a été de 354 milliards d’euros. Mais si on la compare aux chiffres de la dette sur la même période (342 milliards) on peut aisément constater que le résultat réel est une » croissance zéro « .
Mais c’est le Japon qui, depuis que la bulle immobilière a explosé dans les années 1990 et que la dette, pour renflouer le système bancaire a à son tour explosé, est le premier entré dans une » croissance zéro » qui cette année tourne à la récession. Le Japon montre mieux que d’autres pays, la nature de la crise contemporaine. Il ne faut pas chercher les raisons de l’impasse du modèle néo-libéral seulement dans les contradictions économiques, pourtant très réelles, mais aussi et surtout dans ce que Guattari appelle une » crise de la production de subjectivité » [15].
Le » miracle japonais » a été capable de forger une force de travail collective et une force sociale » très intégrée au machinisme » (Guattari), mais il semble tourner à vide, pris lui aussi comme c’est le cas de tous les pays développés, dans les rets de la dette et ses modes de subjectivation. Le modèle subjectif » fordiste » (emploi à vie, temps uniquement dédié à l’emploi, fonction de la famille et de sa division patriarcale des rôles, etc.) est épuisé et on ne sait par quoi le remplacer.
La crise de la dette ce n’est pas une folie de la spéculation, mais la tentative de maintenir en vie un capitalisme déjà malade. Le » miracle économique » allemand est une réponse régressive et autoritaire aux impasses qui s’étaient manifestées dès avant 2007. C’est pour cette raison que l’Allemagne et l’Europe sont aussi féroces et inflexibles avec la Grèce. Non seulement parce que » I want my money back » (l’argent des créditeurs), mais aussi et surtout, parce que la crise financière ouvre une nouvelle phase politique où le capital ne peut plus compter sur une » promesse de richesse future » pour tous comme dans les années 1980. Il n’a plus à disposition les miroirs aux alouettes de la » liberté » et de l’ » indépendance » du capital humain, ni ceux de la société de l’information ou du capitalisme cognitif. Pour parler comme Marx, il ne peut compter que sur une extension et un approfondissement de la » plus-value absolue » [16], c’est-à-dire sur un allongement du temps de travail, une augmentation du travail non rémunéré, des bas salaires, des coupes dans tous les services, des conditions de vie et d’emploi précaire, la diminution de l’espérance de vie.
L’austérité, les sacrifices, la fabrication de la figure subjective du débiteur, ne constituent pas un mauvais moment à passer en vue d’une » nouvelle croissance » mais bien des techniques de pouvoir. Un autoritarisme qui n’a plus rien de » libéral » peut seul garantir la reproduction de rapports de pouvoir. Le gouvernement du plein emploi précaire et la rançon du payement de la dette nécessitent l’intégration de pans entiers du programme de l’extrême droite dans le système politique démocratique.
La résistance passive qui n’a pas intégré le programme néo-libéral s’est, depuis 2007, diversement engagée et représente le seul espoir d’échapper aux techniques de pouvoir des gouvernements par la dette. Face à la foire aux horreurs des plans d’austérité imposée à la Grèce, chacun devrait bien admettre que, d’une façon ou d’une autre, » de te fabula narratur » ! (c’est bien de toi dont on parle).
Le débat
Un intervenant :
Est-ce que les pays du Nord qui ne sont pas dans la zone euro, (je pense au Danemark, à la Suède, à la Norvège), échappent dans un premier temps à cette nouvelle logique, ou est-ce qu’ils vont tomber dans perte d’indépendance ?
Un intervenant :
Je pense qu’au-delà du paysage qui vient d’être esquissé il y a quelque chose qui frappe, c’est la manière dont on a fabriqué parallèlement un être subjectif. On sait que, les uns et les autres, on s’est laissé séduire par tout un tas de systèmes compliqués, de propositions, par exemple tout un système de crédits, avec le refus de l’impôt au sens de contribution à un collectif, à partir des années 1982 1983. Ca fusait de partout, les réductions d’impôts. Parallèlement à cette machine économique il y a eu une formidable machine idéologique, et c’est là où je rejoindrai Gramsci, où parallèlement ils ont gagné culturellement. Si on avait gardé les réflexes d’une économie auvergnate classique où quand on allait acheter une chemise, on regardait si on avait les sous, et il n’était pas question d’acheter si on n’avait pas les sous… je n’ai pas l’impression qu’avec l’accumulation du capital tout au long du XIXème siècle les choses se soient faites de cette façon-là. On était sur des esprits différents, qu’il a fallu sûrement façonner pour que des choses aussi abracadabrantesques puissent arriver, comme de dire à des pauvres gens : » Acheter votre maison vous la payerez dans 50 ans. » C’était tellement énorme et ça marchait si bien.
Je connais la Crète, c’est inouï comment ça fonctionnait et ça a marché, avec une telle évidence.
Un intervenant :
Il fallait que le système englobe tout pour faire pression sur l’emploi, les acquis sociaux.
ML :
Je dis dans mon petit livre qu’on ne peut pas penser l’économie sans penser la subjectivité. Cette subjectivité elle est produite et effectivement les débuts du capitalisme avaient une autre façon de penser la subjectivité des gens impliqués dans la production. La consommation était limitée, il y avait une morale du travail. A partir des années 1920 aux États-Unis, en Europe après la deuxième guerre mondiale, s’est couplée à cette morale du travail (ascétique) une morale hédoniste (et c’est de cela qu’est venue la consommation), le crédit s’est développé. Ce que je soutiens c’est que d’une certaine façon il y a eu, avec la crise, un passage à la condition de l’homme endetté. Je prends une réflexion de Nietsche : la relation créditeur-débiteur n’est pas seulement seulement une relation subjective. Pour qu’un débiteur soit construit, il dit que cette relation est le fondement du rapport social avant la relation d’échange, aussi bien économique que symbolique. Mais pour construire cette relation il faut construire une mémoire à l’individu parce qu’il doit être capable de tenir la promesse de rembourser. Pour construire une subjectivité, il faut le dresser d’une certaine façon ; l’homme c’est fondamentalement un animal de l’oubli. Mais comment on fait pour se souvenir ? Nietsche dit que c’est à travers le corps, à travers la torture. Il y a encore des restes de cette façon d’indexer la dette sur un gage corporel.
On ne peut pas penser le crédit sans penser la subjectivité qui va avec. Il faut construire cette subjectivité et construire le débiteur c’est construire sa culpabilité. Historiquement le libéralisme dans les années 1980 avait favorisé une figure subjective différente : celle que des économistes libéraux américains appelaient » capital humain » en faisant de chaque individu une entreprise individuelle. L’individu est responsable de sa propre initiative. Il assume sa formation, son travail qui sont son propre capital. Cette logique collective autour du travail qui a dominé jusqu’aux années 1970, ça a échoué. Aujourd’hui la figure subjective c’est celle de l’homme endetté ; la morale du travail, la morale de la dette, et la morale hédoniste de la consommation se téléscopent. Donc il y a un problème. Je suis tout à fait d’accord. On ne peut pas séparer l’économie de la position de la subjectivité.
GD : La zone euro est affectée d’un vice qui lui est propre, c’est que les origines de la dette (cela touche la France en particulier) reposent sur deux éléments majeurs : la chute des recettes de l’État par rapport à la richesse nationale. En France depuis le gouvernement Fabius, un mouvement a été enclenché qui fait que les recettes (impôts, taxes) de l’État ont diminué en proportion par rapport à la richesse nationale. Le deuxième élément moteur dans la dette que les citoyens doivent régler maintenant, a été déclenché en France en 1973 avec l’interdiction faite à la Banque Centrale de prêter à l’État. Pour se refinancer l’État n’a plus eu le droit de s’adresser à la Banque de France mais s’adresse au système financier classique. 1973 c’est la loi Pompidou-Giscard, élément déclencheur : c’est une règle qui a été intégrée dans le Traité de Lisbonne, qui fait que les Etats de la zone euro n’ont pas le droit de s’adresser à leur banque centrale pour se refinancer ; ce qui fait qu’un Etat au lieu d’emprunter à un taux de 1% par exemple, doit le faire aux taux du marché, 3, 4 ou 5% selon la qualité de sa signature. La raison de base est imposée par l’Allemagne : tout Etat qui s’adressait à sa Banque centrale faisait marcher la » planche à billets « , système largement inflationniste. Cette règle d’inspiration allemande s’applique à tous. Ce système est pervers parce que chaque année les Etats sont en déficit, et ils doivent emprunter à 3, 4 ou 5% au lieu de 1%, donc vous imaginez l’effet boule de neige de l’addition qui devient astronomique, rien qu’avec les intérêts de la dette qu’ils doivent rembourser aux banques. Si ce système continue on va droit dans le mur.
L’avantage des pays qui ne sont pas dans la zone euro, c’est qu’ils ne sont pas assujettis à cette règle-là. C’est un élément de souplesse supplémentaire même si ce n’est pas rédhibitoire. L’analyse réelle de la dette telle qu’elle existe en France, ce n’est pas du tout l’explosion des dépenses parce que les citoyens gaspilleraient l’argent, parce qu’ils abuseraient du système de santé, etc. L’élément central de la dette c’est l’effondrement des recettes et cet aspect mécanique avec l’interdiction. A titre d’exemple, en décembre la BCE a prêté aux États de la zone euro plus de 500 milliards d’euro et fin février plus de 529, au taux de 1%. Quand on a essayé de savoir en France si les principales banques françaises avaient emprunté auprès de la BCE en décembre ou février il n’y a eu aucune réponse. Cet argent elle ne l’ont pas prêté, comme certains dirigeants politiques l’ont dit, aux PME, PMI qui en avaient urgemment besoin ; elles ont réinjecté cet argent dans des circuits financiers, d’autres diraient de spéculation financière ou l’ont replacé à la BCE : j’emprunte à 1% à la BCE et je replace à un peu plus. Ce système financier, de par ces blocages juridiques, s’auto-enrichit, fait boule de neige et si le système n’est pas modifié il est impossible d’en sortir.
ML :
Les Etats-Unis marchent avec la planche à billets. C’est-à-dire que le Trésor se finance directement à la Réserve fédérale. Il y a un système différent du système européen, pour autant ils sont en crise, ils sont l’origine de la crise. C’est complètement con que la BCE fasse un prêt de plus de 1000 milliards et fasse un détour pour donner de l’argent aux banques qui au passage gagnent de l’argent.
GD :
Deux petits éléments techniques, à propos de Mario Draghi qui est l’actuel président de la BCE : il était dans les années 2002-2005, vice-président Europe de Goldman Sachs. Goldman Sachs c’est l’établissement financier qui a conseillé le gouvernement grec pour son entrée dans la zone euro. Donc il était aux premières loges pour constater que si les Grecs sont entrés dans la zone euro ils l’ont fait en pleine connaissance de cause de la part des institutions politiques et financières, donc tout n’est pas de la faute du citoyen grec de base comme certains veulent nous le faire croire. Deuxième élément concernant les agences de notation : elles existent depuis 1920, et les trois principales regroupent 94% du chiffre d’affaires de la profession. Elles opèrent contre rémunération des établissements qu’elles notent. Que dit l’histoire ? Vous vous souvenez de la société Enron qui a fondu les plombs en 2008 ? Jusqu’à quatre jours avant sa faillite elle était notée A. Autre exemple avec Lemon brothers qui, la veille de son effondrement, est également noté A. Cela permet de prendre un peu de recul par rapport à la qualité de leur estimation. Dernier élément à propos de Standar and co, elle appartient au groupe Business work qui parallèlement détient aussi des droits sur des réseaux télévision et des journaux financiers. Si vous avez un même groupe qui détient des parts importantes dans une agence de notation et dans le même temps dans des journaux de télévision et financiers on ne peut guère lui apporter de crédit sur l’objectivité de ses informations. Sur la rentabilité de ces agences, en 2011 elles ont réalisé des marges de 39 à 58%.
Un intervenant :
Je trouve qu’on se regarde un peu le nombril, on parle essentiellement des vieux pays capitalistes qui vont vers une espèce de sclérose et on ne parle pas de ce qu’on appelle les pays émergents, on ne met pas sur la table les problèmes d’accumulation sauvage qui ont des répercussions du fait que tout est interpénétré dans le cadre d’une globalisation. Quand on ouvre sur le paysage mondial, bien plus contrasté, l’histoire apparaît peut-être un peu différente quant aux possibles, aux surprises, aux contradictions qui pourraient se présenter dans la décennie actuelle. Je ne peux pas ne pas penser qu’aujourd’hui, derrière ce marasme, il y a des choses qui se construisent. L’histoire a toujours montré que, dans une période historique de profondes transformations, il y avait sous les phénomènes de crises, de bouleversements, une société nouvelle, non visible, qui se pointait. Je pense qu’aujourd’hui il y a les linéaments d’une société nouvelle possible, en réponse à une situation historique qui est relativement inédite. On peut considérer qu’il y a un blocage du capitalisme mais il y a une situation au niveau de la biosphère qui fait que, là aussi, c’est intenable.
Un intervenant :
En 1933 c’était pas évident de voir, de sentir le neuf qui surgissait du vieux. Il a fallu passer par des cataclysmes. On voit bien que, malgré tout, le capitalisme a encore de l’avenir, il a des réservoirs de main-d’œuvre partout, il y a aussi la guerre de tous contre tous : il n’est pas nécessaire aujourd’hui que les États s’entretuent, il y a une autre solution avec l’ennemi de l’intérieur. Tout ça fout un peu la trouille. Il ne faut pas trop désespérer malgré tout. Il y a des stratégies de transition. Ce qui m’intéresserait c’est de savoir s’ il y a une dette saine, acceptable et une dette inadmissible ? Est-ce que l’on peut effacer totalement une dette ? Dans toute l’histoire, en partant des templiers auprès desquels les rois de France avaient une dette, on les bousille et terminée la dette, on résout le problème et ça a été ça tout le temps. Je me souviens des fameux emprunts russes que tout le monde avait dans ses sabots à la campagne : le gouvernement soviétique a dit non on ne paie plus, démerdez-vous. Quant tu parles de ces méchants verts-rouges, en Allemagne effectivement les différents plan Hartz c’est quelque chose, mais ils ne sont pas aussi méchants partout. Est-ce qu’il vaut mieux, demain, avoir Sarkozy ou Hollande, est-ce que c’est blanc bonnet ou bonnet blanc ? Pour moi c’est pas terrible mais je préfère le deuxième. Quand on dit séparer les banques d’affaires des banques d’investissement, est-ce que ça a un sens, ou est-ce que c’est du cinéma et qu’on ne touche pas à l’essentiel ?
Un intervenant :
Ce que j’ai compris c’est qu’en fin de compte la dette c’était une chaîne, c’était un moyen d’asservir les peuples et de les pressurer jusqu’à la gauche, si on peut dire. C’est d’ailleurs pas très différent de la dette du Tiers-monde qui permet d’avoir la main mise sur les anciennes colonies. En ce qui concerne les espoirs par rapport aux élections, je crains fort que de choisir entre la peste et le choléra cela ne nous amène pas à grand-chose. Parce que même quand les socialistes ont été au pouvoir, je pense à 1936, ce qui a fait la différence ce sont les mouvements populaires qu’il y a eu à cette époque-là ; aucun progrès social sans mouvement populaire. Je peux me tromper mais… En ce qui concerne la dette, le piège c’est le début de la loi Pompidou-Giscard de 1973 qui fait qu’on ne pouvait plus emprunter à la Banque de France, chose pérennisée dans les différents traités et qui se retrouve dans le traité de Lisbonne. De ce côté-là on a perdu la souveraineté monétaire et la souveraineté tout court car, quelle que soit la chambre, si on veut faire quelque chose on nous dira : » C’est pas possible, il y a des règles à Bruxelles, il faut les respecter sinon vous aurez des amendes « . Donc ma conclusion, qui est bête et simple, est que d’une part il ne faut pas payer la dette (ce qu’on appelle un défaut souverain, ce n’est ni la première ni la dernière fois que ça se fait et en règle générale ça se passe très bien) et ensuite il faut se réapproprier notre monnaie, c’est-à-dire qu’il faut sortir de l’euro ce qui n’empêche pas d’avoir une monnaie commune avec les autres, on a eu ça avec l’Ecu. La chose difficile, c’est qu’il n’y a rien de prévu dans les accords pour sortir de l’euro. Ben ça fait rien. Mais ça demande une volonté populaire qui pousse, parce que même si par miracle c’était Mélanchon qui était au deuxième tour et qu’il était élu, si il n’y a pas derrière de mouvement populaire il n’y aura pas de modification spécifique.
Un intervenant :
Les crises du système capitaliste, qu’elles soient financières ou économiques, réhabilitent en quelque sorte la critique marxiste. Dans ce cas précis comment expliquez-vous le recul des forces sociales qui s’en réclament ?
ML :
La dette ne concerne pas que les pays du centre. La dette c’est un dispositif politique, pas économique, qui naît avec le néolibéralisme. Si vous prenez la Chine, le rapport Chine Etats-Unis est construit sur la dette, donc l’organisation de la mondialisation ce n’est que le surplus que la Chine accumule et ne distribue pas à l’intérieur ; il sert pour acheter des bons du Trésor américain, donc ce mécanisme est au cœur, parce que les deux puissances économiques qui gèrent la mondialisation sont construites autour de la dette. Avant d’arriver en Europe il y a eu la dette au Mexique, en Asie, en Amérique latine. C’est un instrument de gestion politique des rapports sociaux et politiques. La dette est un dispositif immédiatement social : il n’y a pas de dissension entre salariés, chômeurs, actifs, retraités, tout le monde est concerné. C’est un dispositif de capture de la richesse beaucoup plus général que celui du travail. C’est un mécanisme très efficace du point de vue politique.
Effectivement on peut refuser de payer la dette. C’est une question politique. Il faut trouver des rapports de force, des stratégies politiques. Il n’y a aucune raison objective, économique de la payer. Pendant les Trente glorieuses il n’y a eu aucune crise financière. Depuis la fin des années 1970 il y en a eu 150, petites et grandes. Pourquoi ? Parce qu’il y a eu un compromis politique : il y avait eu deux guerre mondiales, la Révolution russe, la peur du communisme, des mouvements populaires très forts, qui ont imposé ce type de contrôles. On a régulé la finance parce que derrière il y a eu des rapports de force politiques. Il faut trouver la façon de reconstruire des mouvements politiques. C’est un tout autre type de débat.
Je ne pense pas être négatif, j’essaie de décrire ce qui est en train de se passer. En même temps c’est un aveu de faiblesse du capitalisme parce qu’il se trouve en train de gérer une situation de façon autoritaire : on a une montée des contradictions à l’intérieur du capitalisme. Tant qu’il n’y a pas une montée de mouvements populaires qui assument cette problématique je ne vois pas tellement de possibilité de sortie. Il n’y a pas de sortie, pour eux aussi, et c’est un problème.
D’un certain point de vue cette histoire de la finance, du crédit, je pense que c’est un déplacement du terrain de la lutte des classes. Autour des des années 1960/70 on avait trouvé une façon de bloquer l’impact du capital à travers le mouvement ouvrier, on avait réussi à conquérir pas mal de choses et là il y a eu déplacement : ce n’est plus la relation capital/travail même si elle est toujours là, mais la relation débiteur/créditeur, et marxiste ou pas je trouve qu’on n’est pas capable de se placer à ce niveau-là. Les syndicats sont encore organisés de façon » corporative « , ils défendent encore les salariés à plein temps ; tandis que là c’est la société dans son ensemble qui est mobilisée et exploitée, mise au travail. Ce déplacement que le capital a réussi à faire avec cette histoire de la dette, (parce que je le répète la dette touche la société dans son ensemble, tout le monde va payer, même les chômeurs, à travers ce que l’on achète, ça coupe les services publics, sociaux, c’est toute la chaîne), touche toutes les articulations de la société. Si on ne trouve pas la façon de sortir de la séparation partis politiques/syndicats, forme d’organisation du XIXème siècle où le syndicat bataille sur le salaire et le parti se bat au niveau de la représentation politique, on n’en sortira pas. Je pense que ce n’est plus valable cette séparation entre politique et social. Il y a des choses nouvelles qui se mettent en place, qui ne sont pas encore mûres : les mouvements comme les Indignés ou Occupy Wall Street qui mettent à disposition de la représentation autour de : » Est-ce qu’on doit déléguer le pouvoir et comment on doit le déléguer ? aux partis politiques ou au syndicat ? Qu’est-ce que ça veut dire se réapproprier les choses ? » Avec le développement du néolibéralisme il y a celui des experts ; il y en a partout. Cela marginalise la capacité de réappropriation de mécanismes comme celui de la dette, mais pas seulement. La constitution du mouvement ouvrier a mis beaucoup de temps. On est dans une phase qui a des caractéristiques semblables. On est dans une rupture et les vieilles formes d’organisations, comme les partis et les syndicats, ne sont plus adéquates ; il faudra une forme d’organisation qui soit à la fois politique et sociale, c’est très vague ce que je dis là, et il faudra pas mal de temps. Ou ça peut aller très vite : le capitalisme financier est très instable. Il va très vite, mais contre un mur aussi. On est obligé de répondre très vite à ce qu’il se passe. Le spred augmente, donc il faut répondre vite. C’est une forme de puissance de la finance mais aussi un aveu d’impuissance. C’est une situation ambigüe.
Un intervenant :
Est-ce qu’on peut savoir ce qu’il se passe en Islande ?
ML :
C’est un tout petit pays mais effectivement ils ont refusé de payer. Il y a eu deux référendums pour ça ; Roberto Lavagna, l’ancien ministre argentin de l’économie pendant la crise de la dette argentine, dit que le problème c’est qu’il ne faut pas suivre les indications du FMI. C’est comme ça qu’ils s’en sont sortis. » La sortie de la crise se fait en dehors du chemin tracé par le FMI. Cette institution propose toujours le même type de contrat d’ajustement fiscal qui consiste à diminuer l’argent qu’on donne aux gens, les salaires, les pensions, les aides publiques mais également les grands travaux publics, etc., pour consacrer l’argent économisé à payer les créanciers. C’est absurde. Après quatre ans de crise on ne peut pas continuer à prélever l’argent aux mêmes. Or c’est exactement ce qu’on veut imposer à la Grèce. Tout diminuer pour donner aux banques. Le FMI s’est transformé en institution chargée de protéger les seuls intérêts financiers. Quand on est dans une situation comme l’était l’Argentine en 2001, il faut savoir changer la donne « . Et lui, ce n’est pas un révolutionnaire. Ce qu’on est en train de faire va aggraver la crise. Les Argentins, tous ceux qui sont sortis de la crise c’est parce qu’ils ont refusé de suivre les indications du FMI.
GD :
Le refus de payer de l’Argentine en 2001, dans les médias ça a très peu transpiré, comme lorsque les deux référendums islandais ont dit » on ne paye pas « , cela n’a pas été relayé à la hauteur de ces évènements. C’est quand même singulier de constater que les éléments positifs, lorsque les citoyens luttent, sont très peu relayés dans les médias. L’esprit critique quand on écoute, lit, regarde, doit être très aiguisé.
Un intervenant :
Je voulais aussi parler de l’Islande, puisque non seulement le peuple islandais a refusé de payer la dette, mais il s’en est suivi une crise politique où tous les gouvernants au pouvoir ont été virés et une nouvelle constitution est en train d’être mise en place par une assemblée constitutionnelle. De cette assemblée sont exclus les partis politiques : ce sont des citoyens volontaires tirés au sort qui planchent ensemble sur la future constitution islandaise. Donc là on est bien en train de s’approcher d’un nouveau modèle où on casse un peu les standards existants. Les partis politiques servent dans cette élaboration puisqu’ils viennent s’expliquer et donner leur point de vue à l’Assemblée. Ils sont entendus mais au final ce sont les citoyens tirés au sort qui élaborent la nouvelle constitution.
Sur le refus de payer la dette par le peuple islandais, si les autres pays en faisaient autant ça ne poserait, à mon avis aucun problème, car sur les quarante dernières années la finance mondiale a gagné en France 1400 milliards d’euro au titre des intérêts de la dette. Ils ne vont pas évidemment s’assoir sur une telle possibilité de continuer de faire du pognon à partir de rien, donc ils accepteront d’effacer la dette puisqu’ils vont continuer à l’avenir à engranger, si le système n’est pas réformé, des intérêts faramineux. Donc le système leur convenant ils vont perdre d’un côté ce qu’ils vont continuer à engranger de l’autre.
GD :
Je crois qu’il y a un vrai problème de respiration démocratique qui fait qu’on fonctionne avec un système entre les citoyens et les élus qui ne marche plus. Et je crois que le problème de la dette passera par la résolution de ce problème fondamentalement politique.
Prenons l’exemple du Traité européen tel qu’il est actuellement » négocié » : ce mécanisme européen de stabilité a été validé par tous les chefs d’Etats sans problème mais pour qu’il soit mis en place il faut qu’il soit validé par l’ensemble des pays de la zone euro. La validation passe soit par un référendum soit par l’approbation des parlements, au libre choix de chaque pays. Notre président a déjà exclu la possibilité du référendum en disant que ce serait trop compliqué, qu’il y aurait trop de questions, donc le citoyen n’est pas capable de se positionner sur ce sujet, donc c’est le Parlement qui décidera. Et ça nous rappelle ce qui s’est passé quelques années auparavant dans notre pays où le peuple français avait refusé le nouveau traité et il est passé devant le Parlement. Ca c’est un problème qui est tout à fait fondamental, d’autant plus que ce nouveau traité, en matière de souveraineté, contient des éléments très graves : en schématisant, le budget français ne pourra être validé que s’il a reçu l’aval de de la Commission européenne. S’il est validé vous imaginez le recul en arrière. Comment peut-on imaginer que le peuple français ne soit pas associé à la validation de ce traité ? Ca c’est une vraie question politique.
Un intervenant :
C’est la question démocratique qui est à nouveau posée, ses formes, sa résurgence. J’ai trouvé des traces de cette question dans ton bouquin où tu dis que ce n’était pas qu’une question de connaissance, une question de savoirs, mais il y a aussi une question de force, de volonté qui doit être motrice de ces renouveaux. On a vu quelque chose de formidable qui s’est passé chez nous, en 2005, au moment de la discussion sur le Traité constitutionnel ; ce sont des choses nouvelles, historiquement. Cette espèce de ferment, d’intelligence collective qui a amené à ce refus. La démocratie telle qu’elle a été toujours plus ou moins pratiquée, c’est une démocratie entre les mains de quelques-uns. Là il y a des alternatives concrètes même à grande échelle, de formation d’intelligence individuelle et collective.
Un intervenant :
Les théoriciens du néolibéralisme n’ont-ils pas dévié un peu les idées de Michel Foucault sur le gouvernement de soi ?
ML :
Cette fabrication de la subjectivité, (tout à l’heure j’ai parlé de Nietsche avec cet homme capable de promettre, capable de mémoire pour honorer sa dette), c’est un travail sur soi qui est demandé. Je ne sais pas s’ils se sont inspirés de Foucault mais ils parlent de ce rapport à soi comme processus de subjectivation. Il y a quelque chose à voir là-dedans. La théorie de la subjectivité néolibérale, c’est le capital humain. C’est une subjectivation individuelle qui implique un travail sur soi, qui devient son propre entrepreneur : il n’y plus de distinction entre le capitaliste et l’ouvrier, chaque individu devient entrepreneur de soi.
Je ne suis pas pessimiste : je pense que toute forme de lutte qui émerge fait apparaître des nouveautés politiques qui sont importantes.
Personnellement j’ai participé à la lutte des intermittents du spectacle avec les coordinations qui se sont formées en dehors des syndicats, et même dans une petite lutte comme ça on voit qu’il y a des manifestations qu’on retrouve chez les Indignados ou à Occupy Wall Street. Une des revendications des intermittents de la coordination c’était : » Nous sommes les experts » et ce n’est pas au gouvernement de nous donner des indications sur notre travail, sur notre façon de vivre. On a fait ensemble une enquête sociologique sur les façons de travailler, on a impliqué des centaines de personnes de différentes villes et on a produit ensemble une analyse politique, sociologique. Dès qu’il y a une lutte comme ça, elle manifeste des qualités politiques différentes. Donc je ne suis pas pessimiste. Il faut trouver, sur des luttes petites ou grandes, la forme d’organisation, de diffusion.
Un intervenant :
Sans être pessimiste on peut quand même se rendre compte qu’il y a d’un côté un internationalisme du capital, que la Communauté européenne a un pouvoir important, et qu’en face il n’y a pas de mouvements collectifs européens. C’est une raison d’être fortement pessimiste. Pour reprendre une phrase fameuse, la lutte des classes se fait au-dessus des nations du côté des classes dirigeantes, et elle se fait à l’intérieur des nations du côté des classes populaires. Cette phrase faisait référence au fait que les capitalistes ont gagné la lutte des classes, ils ont gagné aussi puisqu’ils raisonnent à l’échelle du monde et les classes populaires raisonnent à l’échelle nationale.
ML :
J’ai une autre phrase, héritage du monde ouvrier. La Première Internationale disait : » Travailleurs du monde entier, unissez-vous « , après il y a eu l’idée du socialisme dans un seul pays. A ce moment-là, même la Première Internationale a anticipé sur le mouvement d’internationalisation du capital. C’est ce qu’on a perdu, et je ne vois pas de bons signes dans cette campagne électorale. Si on ne sort pas de cette dimension nationale ça va être impossible de construire un mouvement qui se mette au même niveau que la dimension du capitalisme. Le minimum c’est l’Europe. On pense encore en termes nationaux et là on est dans une impasse.
GD :
Je ne partage pas ce pessimisme. Sur le marché de l’eau, au niveau de la planète, savoir si c’est un bien économique de base, si sa gestion doit échapper au marché, est une question profondément politique. Est-ce que ma commune doit avoir une régie municipale ou non, etc ? Les multinationales de l’eau, d’origine française essentiellement, ont essayé de promouvoir un forum mondial de l’eau. C’était à Marseille en mars dernier. Etaient invités les principaux financeurs, les principales entreprises mondiales, forum financé à 80% par le contribuable. Dès l’instant où ce forum a été connu, un forum alternatif a été mis en place avec quantité de structures alternatives qui posent la question non pas de comment on va financer l’eau, mais est-ce que c’est un bien qui doit être financiarisé ou un bien commun de l’humanité ? Ce forum a rassemblé à Marseille des citoyens qui s’intéressent à la problématique de l’eau partout à travers le monde. Sont venus à Marseille des représentants d’organisations, des citoyens, d’Europe, d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Nord et beaucoup d’Amérique Latine. Au final le FME officiel a été une catastrophe puisqu’un quart des personnes prévues est venu, le forum alternatif a été un succès. Cette contre-organisation a été le fruit de réflexions des citoyens de base, absolument pas construites par des organisations politiques ou autres. Des gens agissent. Mais où allez-vous retrouver la retranscription de ce qui se passe dans les médias ? Des mouvements existent, de façon beaucoup plus riche que ce que l’on peut imaginer. Je prends l’exemple de l’Amérique du Sud : depuis quarante ans, (des traditions de dictature, de censure, de torture appartiennent au passé, même si tout n’est pas terminé), à partir d’organisations citoyennes de base il se passe des choses très intéressantes qu’on ne voit pas ici.
ML :
Il ne faut être ni pessimiste ni optimiste. En Italie un référendum contre la privatisation de l’eau a été gagné mais après il ne s’est rien passé. Il manque encore cette dimension d’imposer la chose. Mais je suis d’accord sur cette richesse, surtout en Amérique Latine où c’est un peu un modèle de construction entre les mouvements sociaux et la dimension politique qui a été mise en place avec des nouveautés remarquables, notamment dans certaines constitutions. Ils ont des traditions animistes et ils disent que ce n’est pas seulement l’aliénation de l’humain et sa libération qu’il faut viser, mais aussi celles des non-humains. Par rapport à notre façon de penser c’est une autre culture politique. Parce que quand on sort de la modernité, même marxiste, le problème pour nous c’est l’humanité. Eux ils posent le problème différemment. Il y a l’émergence, dans des luttes spécifiques, dans des pays spécifiques, de nouvelles façons de penser, de s’organiser. Ce qu’ils ont fait en Bolivie, cette nouvelle constitution qui parle de cette libération, c’est une ouverture pour le millénaire à venir et pas juste pour cinq ans.
Compte rendu réalisé par Anne Vuaillat.