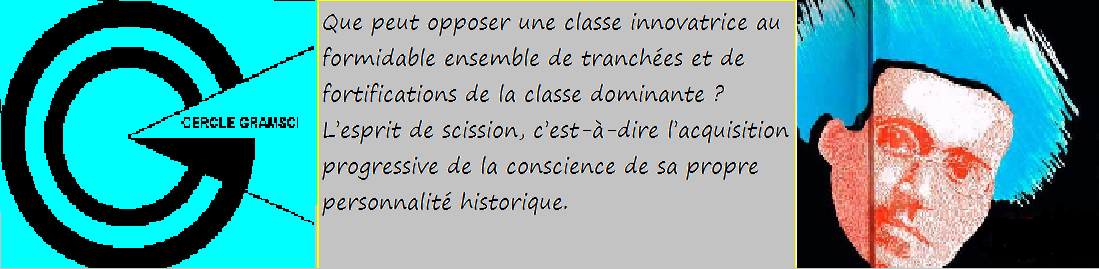25 ans du Cercle : Tables rondes avec la revue EcoRev
Présentation de la soirée
Francis Juchereau :
Voilà 25 ans que notre association (j’insiste sur ce mot), qu’un certain nombre de militants, de citoyens, au départ un petit groupe de communistes, bien dans la tradition limousine, très vite rejoint par des gauchistes, des socialistes, des libertaires, des cathos de gauche, des non-identifiés, des écolos, des trotskystes, des maos, etc., se sont retrouvés sur cette » terre sensible et rebelle » comme dit Georges Chatain, qui a animé une des premières réunions du Cercle du temps où cette revue, M, qui est devenue Mouvement, se crée en même temps que le Cercle. Dans son premier numéro, un article de Claude Gobaux et de moi, où nous présentions la démarche de notre association. Plusieurs revues ont accompagné la vie de notre association, sans pour autant être d’une mouvance, d’une revue ou d’un journal : par exemple Transversales, avec qui on faisait un échange de revues, et ce n’était pas sur la valeur marchande. Aujourd’hui encore avec Partage, Citoyens, A contre courant.
Nous avons essayé de marquer ce 25ème anniversaire de façon particulière, avec ces tables rondes qui commencent, sur un thème générique : Sortir du capitalisme aujourd’hui, réalités, illusions, enjeux. Il y a plus de dix ans nous nous proposions d’inviter André Gorz. A cette époque-là il ne souhaitait plus se déplacer pour faire des débats et c’est Jacques Robin qui l’a » remplacé » ; il a demandé à rencontrer des associations dans le quartier de Beaubreuil.
Tous les thèmes de la période ont été brassés dans notre association auberge espagnole, le travail notamment, le chômage, la remise en cause du travail avec les technologies et l’évolution des sociétés occidentales, la globalisation. On a été marqué par d’autres thèmes » existentiels » comme le communisme, puisque les fondateurs initiaux étaient dissidents du parti communiste. Le communisme qui, en quelques années, en ce qui concerne le bloc soviétique, s’est effondré symboliquement en 1989. Et juste avant la chute du Mur de Berlin on avait une soirée sur ce sujet. Et l’écologie aussi. Les fondateurs marxistes, par curiosité et aussi en voulant comprendre le monde d’aujourd’hui, ont voulu dialoguer et agir avec cette sensibilité politique de l’écologie sociale qui a germé véritablement à l’époque où le Cercle s’est créé. Le premier qui a été invité, hormis Albert Jacquart qui nous avait parlé du monde fini, c’était Vincent Labeyrie, communiste, scientifique. On a parlé de l’effet de serre, de la marchandisation avec Serge Latouche. Notre association a voulu s’interroger et débattre sur des thèmes y compris de la vie quotidienne.
Un intervenant :
Il a eu aussi Bertrand Lajudie sur les articulations possibles entre une pratique analytique et le discours marxiste dans son développement et dans sa finitude. Ce qui est une première : les marxistes orthodoxes ont découvert qu’ils avaient un inconscient depuis 1979. Il a fallu l’excellence de Catherine Clément, normalienne, professeur de philosophie, qui était allée en Union soviétique et avait fait des exposés sur l’inconscient.
Francis Juchereau :
On a abordé tout un champ de réflexions qui correspondent aux bouleversements du monde d’aujourd’hui, avec également la situation internationale puisqu’on a eu des invités sur le Rwanda et l’Afrique avec Colette Braeckman ; Serge Latouche et l’économie informelle dans un quartier de Dakar ; des alternatives concrètes, régionales avec notamment des gens du plateau de Millevaches, les SCOP, etc. On a réuni des témoins du mouvement ouvrier et des acteurs d’associations pour témoigner d’un siècle militant ici. Donc tout un bilan qu’on peut voir à travers les affiches et la collection de notre bulletin. On a aussi publié un texte, en brochure, de Balibar suite à sa venue ; on a fait un livre avec Guingouin, qui était un fidèle abonné de La Lettre, où il confie un peu ses dernières pensées politiques. Depuis l’après-guerre Peuple et culture développe des activités, en Corrèze, dans la sphère politico-culturelle, un petit peu comme nous. Quand Claude Julien est venu parler de la démocratie, l’enregistrement a été tiré à part par Peuple et Culture.
J’ai voulu rappeler le chemin parcouru par notre association, avec cette activité déployée dans le champ de la culture qui est une activité concrète, militante et aussi spécifique, détachée du pouvoir et de l’action et en même temps chacun pouvant se l’approprier, se construire, puisque finalement c’est celui qui pense, qui essaie de penser, qui peut agir d’une manière convenable.
Je parlais d’André Gorz et on vient naturellement à la revue Ecorev’ qui a dix ans cette année et qui a publié, notamment dans son numéro 28 consacré à André Gorz, un texte testamentaire qui nous a servi un peu de fil rouge pour aujourd’hui. Marc Robert qui fait partie de la rédaction d’Ecorev’ va nous développer un peu cette idée : urgence écologique, les enjeux actuels d’un sortie civilisée du productivisme. Aujourd’hui on est dans une phase historique très particulière de l’humanité. Ce paysage il faut essayer de le déchiffrer et agir. Gorz nous a donné une piste en disant que d’une certaine manière on avait commencé à sortir de l’époque du capitalisme et qu’un autre mode de production s’esquissait dans le cadre de cette globalisation dont on pense qu’elle est fatale. Urgence démocratique, avec un invité qui va reposer l’hypothèse communiste, mot devenu un gros mot. Aujourd’hui comment peut-on se réclamer de cet idéal ?
Marc Robert :
C’est intéressant de partir de la figure d’André Gorz, qui a été un peu le parrain de la revue Ecorev’ à ses débuts, et avec qui ont a eu l’occasion, à de multiples reprises, d’échanger sur un certain nombre de thèmes, parce qu’il a été un des tout premiers, au début des années 1970, à lier les effets de la crise environnementale, de la crise du mode de vie ultra consumériste, les dégâts de l’industrie pharmaceutique sur les individus, de relier tout ça plus globalement à la crise qui commençait à affecter le capitalisme et à bien montrer que la crise à laquelle on est confronté aujourd’hui, ce n’est pas une addition. Il n’y a pas d’un côté une crise sociale, de l’autre côté une crise de l’environnement, une crise de la finance, une crise de la démocratie ; tout ça forme un tout. Et il est extrêmement important de penser les termes de cette crise ensemble. A travers la notion d’écologie politique, on arrive à relier tous ces éléments ensemble et à se donner des pistes pour penser les choses autrement. En particulier si on part de la crise écologique, on n’est pas seulement en train de parler du fait de l’épuisement des ressources naturelles, qu’il y a moins de biodiversité, qu’il y a une fuite de pétrole quelque part dans le monde ; on est en train de parler de ce que les gens vivent au quotidien. Dans les banlieues, la crise écologique c’est la crise de l’habitat urbain qui est totalement dévasté, c’est l’impossibilité de se déplacer par exemple. Les transports sont conçus pour que les gens soient enfermés quelque part. La crise écologique, c’est aussi une crise du rapport à la technologie et au savoir. Les gens sont dépossédés des objets technologiques qui sont conçus. La crise, c’est également cette injonction permanente à surconsommer, à toujours créer des besoins qu’on ne peut pas tous satisfaire puisqu’il y en a toujours un qu’on ne peut pas satisfaire, de vivre toujours dans cet état perpétuel de manque, en consommant, comme le dit Gorz, des produits qu’on ne fabrique pas et fabriquant des choses qu’on ne consomme pas. Donc il y a dissociation fondamentale entre le monde vécu par les gens et tout ce qui nous entoure.
Gorz aussi, si on continue à se placer dans ses traces, a beaucoup analysé notre rapport au travail, la transformation du travail et la transformation des modes de production. Aujourd’hui on est arrivé à un point (avec la robotisation, l’automatisation) où ce qui est produit est basé d’une part sur les savoirs, l’intelligence et d’autre part sur la mise en réseau des savoirs et de l’intelligence. C’est-à-dire que ce qui est produit, la valeur ajoutée des choses aujourd’hui, c’est la somme des savoirs qui est incorporée dans les objets, et ça c’est le résultat d’une production qui est collective. Ce qui veut dire que les gens sont capables, ensemble, de produire de la valeur, de la richesse en se mettant en réseau, en faisant circuler leurs savoirs et leurs connaissances et éventuellement en s’affranchissant d’une production centralisée et contrôlée. C’est ce qui se passe autour du mouvement des logiciels libres où des informaticiens, des gens qui travaillent sur les réseaux sont tout à fait capables de produire des logiciels qui vont échapper au contrôle d’un firme comme Microsoft et qui vont petit à petit se construire en circulant, prendre de la valeur, se complexifier, se développer par les apports des uns et des autres dans un régime de la collectivité, de la coopération. Ca, ça nous fait entrer dans un régime de production de la richesse qui est connu depuis très longtemps, mais qui est réellement basé sur la mise en réseau et la coopération. Et ça, ça introduit quelque chose de vraiment particulier.
Un autre aspect de la pensée d’André Gorz, c’est tout ce qui tourne autour de la notion de revenu social garanti. Ca a été une longue maturation dans sa pensée. Il n’y était pas favorable au départ. Dans ce bouleversement de la production de richesse il y a quelque chose d’important : c’est la possibilité d’être en position d’avoir une autonomie. Pour la construire il faut les moyens de cette autonomie. Et un des outils essentiels pour pouvoir se réapproprier la production, notre mode de vie vécu, c’est d’avoir des conditions matérielles permettant d’aller dans cette voie. Et une des notions qu’il a explorées c’est celle de revenu social garanti pour donner les moyens financiers d’exercer réellement son autonomie, dans une optique qui devrait être celle d’une relocalisation des modes de production. Si on souhaite réellement aller vers une réappropriation, les modes de production en réseau doivent être associés avec un mode de production avec des circuits courts, avec une relocalisation basée sur des communautés locales s’appuyant sur des conditions matérielles rendant possible ce type d’évolution et de révolution.
Evidemment cette question de la relocalisation des modes de vie n’est pas dissociable des enjeux démocratiques. Il faut aussi des outils de démocratie collective, et se les réapproprier sous différentes formes, pour pouvoir mettre en place de telles idées.
Je pense qu’avec cette figure d’André Gorz, (même s’il y a bien d’autres figures qu’on a côtoyées, d’autres pistes qu’on a explorées) on a les outils pour faire l’analyse de l’épuisement du capitalisme face à la globalité des crises auxquelles on est confronté. Parler de la crise écologique et de ses différentes facettes, bien évidement reliées à la crise sociale, financière, économique. Aussi bien l’épuisement des ressources naturelles que les changements des modes de production, que l’ampleur de la crise financière et de la suraccumulation, nous met aujourd’hui à un moment charnière dans lequel il entrevoyait deux types d’évolutions possibles : une sortie du capitalisme qui serait une sortie » barbare « , qui se ferait en amplifiant le mode ultralibéral qui préside au fonctionnement de notre société, à l’échelle globale ou locale, ou bien une sortie » civilisée » qui serait basée sur une réappropriation des modes de production par une relocalisation de nos modes de vie, de production, par la mise en réseau et l’échange de savoirs. Il n’était pas contre le développement technique ou scientifique, mais une bonne technologie c’est une technologie appropriable par tous et dont le critère d’acceptabilité doit être un critère de plus-value sociale à la fois individuelle et collective. Typiquement c’était travailler sur ce type d’outils en basant ça sur une articulation démocratique et politique sous-tendue par le fait de donner les moyens à chacun de reprendre prise sur sa vie, les moyens de son indépendance à travers par exemple la notion de revenu social garanti. C’est un peu autour de ça qu’on a construit le numéro » Penser l’après-capitalisme avec André Gorz » qui complète le n° 28 plus axé sur le travail. Ce serait bien que Jean Zin dise quelques mots : il a beaucoup échangé avec André, il était aux débuts de la revue.
Jean Zin :
Gorz, dans son dernier texte, disait que la sortie du capitalisme avait déjà commencé. C’est un texte qui a beaucoup circulé. Je ne suis un disciple ni de Gorz ni de Robin. Ce texte, je pense que c’est intéressant d’en avoir un point de vue critique. Je vais essayer de dire ce qu’il me semble qu’il faut comprendre de ce texte. C’est le dernier texte de Gorz, donc on peut penser qu’il a voulu tout mettre dedans, mais c’est sans doute ce qui en fait la faiblesse : il y a peut-être confusion entre différentes temporalités. Il avait analysé le capitalisme financier qui fait de l’argent avec de l’argent, et il pensait que ça c’était quelque chose qui était juste illusoire et que ça allait s’écrouler. Il voyait un peu la crise actuelle comme pouvant être la fin du capitalisme. Mais c’était contradictoire avec les analyses qu’il avait faites précédemment, où la sortie du capitalisme avait déjà commencé pour d’autres raisons, qui étaient le passage au travail immatériel. Parce que ce dans qu’on appelle économie immatérielle, c’est surtout le travail qui devient immatériel. Il reste beaucoup de produits matériels bien sûr, mais c’est le travail qui devient de plus en plus intellectuel ou de service, qui n’est plus un travail de force. N’étant plus un travail de force, ça ne peut plus être un travail forcé et le capitalisme industriel était basé sur le fait qu’on réduisait le temps de travail et que c’était ça qui produisait de la plus-value. Gorz avait tendance à penser, comme beaucoup de marxistes mais pas comme moi, que tout travail qui ne produit pas de plus-value ne produit pas vraiment de la valeur. Moi je ne crois pas : il peut y avoir un travail qui ne produit pas de plus-value mais qui produit de la valeur. Un travail qui produit de la plus-value ça produit simplement de la valeur supplémentaire, mais on ne peut pas dire qu’un travail qui ne produit pas de plus-value ne produit aucune valeur. Un travail qui ne produit aucune valeur c’est un travail que personne ne veut. Ca existe un travail qui ne produit aucune valeur : si vous construisez un mur et qu’il s’écroule vous n’avez produit aucune valeur. Il y a des raisons qui sont liées au travail qui font que le capitalisme industriel est sur sa fin. Mais on ne change pas de système de production du jour au lendemain. Il ne suffit pas de prendre la direction d’une usine, il ne suffit pas de faire la révolution, et ça Gorz le disait de manière très précise. Il ne faut pas confondre les différentes temporalités qu’on a en ce moment. On a une crise du capitalisme qui est très semblable à celle de 1929, qui devrait déboucher sur un nouveau régime capitaliste moins sauvage que ce qu’on a connu ces dernières années. Je crois qu’il y a des cycles de Kondratiev où vous avez trente ans de croissance plutôt favorables au travail et trente ans de dépression plutôt favorables aux rentiers. Et c’est quelque chose qui s’est reproduit plusieurs fois. Kondratiev, quand il disait ça en 1929, était très mal vu de Staline, qui l’a envoyé dans les camps, parce que Staline croyait que c’était la fin du capitalisme. Or on a vu que le capitalisme c’est quelque chose qui a quand même une capacité de se régénérer très grande. Donc ce n’est pas du tout sûr qu’on en ait fini avec le capitalisme. Par contre ça sera un nouveau capitalisme, sans doute pas industriel, sans doute plus financier. Gorz pensait que la finance ne pouvait pas créer de la valeur juste avec la finance. Yann-Moulier Boutang, dans son livre L’abeille et l’économiste, soutient le contraire et je pense qu’il a un peu raison. Si vous avez un gros paquet d’argent vous pouvez faire des choses que vous ne pouviez pas faire sans. Et ce que vous pouvez faire, ça peut créer de la valeur. Et un des gros problèmes qu’on a actuellement (qui n’est pas qu’un problème virtuel mais réel) c’est que l’argent crée plus de valeur que le travail. Yann Moulier-Boutang donne l’exemple des grandes surfaces comme Leclerc, Carrefour : ils gagnent plus d’argent à manipuler le crédit (dans le fait de payer à 60, 90 jours leurs fournisseurs et à placer leur argent) que dans leur activité elle-même. C’est la même chose dans la vente en ligne comme Amazon. Amazon gagne plus d’argent sur la gestion financière que sur son activité. C’est quelque chose que l’on peut trouver scandaleux mais c’est un fait. Donc on peut très bien avoir un capitalisme financier qui dure un certain temps. Cette crise actuelle ce n’est pas la fin du capitalisme. Ca ne veut pas dire que le capitalisme n’a pas commencé une mort qui va être longue, comme a été longue la mort du féodalisme. Mais il faut du temps pour construire un nouveau mode de production. Je pense donc que ce n’est pas sur la même temporalité qu’on peut analyser la sortie du capitalisme et la crise actuelle, qui ont un certain rapport. Il y a une possibilité d’une sortie du capitalisme, mais qui serait plutôt une sortie du salariat au profit du travail autonome et au profit sans doute d’une relocalisation. Je voulais insister sur le fait que Gorz avait raison sur le fait que la sortie du capitalisme avait déjà commencé, mais pas complètement raison sur le fait qu’un capitalisme financier ne pouvait pas durer. Ca n’est peut-être pas dans l’immédiat, avec la crise actuelle, qu’on va avoir la fin du capitalisme, mais ça n’empêche pas de s’y préparer, de commencer cette sortie qui est surtout à analyser comme une sortie du salariat. Le revenu garanti fait partie de ce qui permet de sortir du salariat. Cette sortie du salariat, pour Gorz, est le travail autonome pour lequel il avait pensé qu’il fallait des structures, des coopératives de travailleurs autonomes qui leur permettraient de valoriser leurs compétences sans être dans une structure productiviste, en produisant moins de richesses. Quand on veut abandonner le capitalisme, il faut savoir qu’en général on va produire moins de richesses. Parce que le capitalisme est à la fois producteur de richesses, et destructeur de richesses. Et comme producteur on n’a pas trouvé mieux jusqu’à maintenant. Mais pour être prêt à produire moins de richesses, à moins consommer, il vaut mieux s’épanouir dans son travail, ne pas compenser la souffrance qu’on a au travail par la consommation, ou des loisirs qui doivent équilibrer. Donc si on arrive à avoir un travail autonome qui soit épanouissant (ça ne peut pas être que ça, un travail reste un travail), qui puisse occuper la vie des gens de manière positive, on peut penser qu’ils gagneront moins d’argent mais ils en dépenseront moins. Ca sera plus écologique, moins productiviste, et on ne sera pas obligé à ce moment-là d’être salarié d’une entreprise capitaliste. Parce que ce qui est débile c’est de se retrouver salarié d’une multinationale et de se plaindre que cette multinationale délocalise. Mais une multinationale est une entreprise capitaliste, donc on ne peut pas s’attendre à autre chose. Il pourrait y avoir des entreprises d’Etat mais cela pose d’autres problèmes.
Ce n’est pas parce qu’on ne sort pas immédiatement du capitalisme qu’on y est condamné pour toujours.
Un intervenant :
C’est une réflexion un peu naïve. Il y a toute une définition technique du travail, à la recherche de la valeur, en quoi il aliène, etc. (évidemment le travail à la Sarkozy : travailler plus pour gagner plus), et ce que je n’arrive pas à comprendre c’est pourquoi on n’a pas été fichu de dire que le travail, parfois, est une jubilation. Parce que être médecin, c’est avoir le plaisir de guérir et s’adonner à une réflexion. Le travail de l’enseignant c’est d’éduquer : on devrait être content. Ca peut paraître bizarre ici mais j’étais content de travailler, et j’imagine que le jardinier est content de voir pousser ce qu’il a planté, et l’agriculteur ou le boulanger de nourrir et de donner du pain. Il y a quelque chose qui me surprend beaucoup, parce que la réussite du slogan de Sarkozy c’est qu’il a manifestement placé le travail sur un seul plan. C’est quelque chose d’effroyable. Et qu’on n’ait pas réussi à mettre en face un travail, une façon de travailler à l’antipode de » tu travailleras à la sueur de ton front » mon fils, ou de travail égale tripalium, instrument de torture, comment on n’a pas été foutu de rééquilibrer le propos en disant qu’une partie du temps de travail qu’on accorde aux autres est d’une utilité sociale.
Jean Zin :
J’ai écrit un texte qui s’appelait Changer le travail, changer la vie. Effectivement c’est le point principal, ce n’est pas une question annexe : si on arrive à faire que le travail ne soit plus un travail forcé mais choisi, pour ça il faut qu’il soit autonome, que les gens puissent valoriser leurs compétences, avoir un certain épanouissement. Mais ça c’est un but. C’est travailler sur les conditions de travail. Plutôt que de se focaliser sur le quantitatif, les salaires, le temps de travail, il faut se focaliser sur les conditions de travail pour que le travail devienne épanouissant. Ca me semblait être un objectif qui pourrait être repris par toute la gauche mais qui n’a pas eu tellement de succès. Les exemples qu’on donne de travail épanouissant c’est plutôt dans l’immatériel. Effectivement quand on est médecin, professeur, intellectuel, on peut comprendre qu’on a un travail épanouissant. D’ailleurs c’est parce que le travail devient épanouissant que même les riches veulent travailler. Le travail a changé de nature, donc on doit pouvoir changer le travail, mais on ne peut pas non plus nier le fait que, en général, le travail est une souffrance terrible. Il y a quand même une majorité de travailleurs qui souffrent au travail. Donc il faudrait que ça soit un objectif très fort porté par tout la société, qu’on ne puisse plus admettre que les gens se suicident, qu’on ait des conditions de travail épanouissantes, parce que la vraie vie elle est là. La majorité du temps de la vie, on la passe au travail, donc si on arrivait à changer le travail on changerait la vie.
Un intervenant :
Un mot encore : j’ai dû vivre sur une planète bizarre. Je ne mets pas en doute la souffrance au travail, l’exploitation. C’est une sorte de perversité du travail. Je pense qu’il y a eu une espèce de période bizarroïde et j’aimerais que les sociologues m’indiquent ce qu’elle a pu vouloir dire, autour des années 1974-1975, à l’époque ou Dumazedier écrivait La société du loisir où il y a avait une sorte d’inquiétude du capitalisme, démontrant que la productivité était de plus en plus forte : un paysan qui trente ans auparavant nourrissait 4 ou 5 personnes en nourrissait trente dans ces années-là. On s’est dit : comment maintenir ces gens-là dans la souffrance au travail, alors qu’ils n’ont plus besoin que de travailler à moitié ? Ca a été la période du temps libre. C’était un symbole puisque pendant six mois on a eu un monsieur Henry ministre du temps libre. C’était pour donner une sucette à qui attendait le temps libre. Alors moi je n’ai pas compris ce qui se passait au niveau macro-économique et dans la représentation qu’on avait de l’univers économique de cette période. Je me souviens qu’il y a eu une période curieuse où pendant 4-5 ans le problème c’était : on va avoir de plus en plus de temps à soi parce qu’on produit de plus en plus. Ne serait-il pas utile de savoir ce qui s’est passé dans cette période-là ?
Francis Juchereau :
Une idée comme ça : il s’est peut-être passé Tatcher, Reagan et compagnie. Gorz en parle en disant que plus la productivité augmentait, plus il fallait faire travailler les gens parce qu’effectivement le profit par unité produite baissait. Tu parles d’une période un peu abstraite dans l’histoire. Le travail n’a pas tellement dû se désaliéner. Je me rappelle de l’époque de 1968, les ouvrières étaient menottées sur les machines ! Et on ne parle pas de ce qui se passait dans les pays du Tiers-monde. Donc ce que tu as pu percevoir c’est peut-être une impression qui correspond à quelque chose dans des conditions particulières, dans un endroit du monde particulier.
Marc Robert :
Il y a quand même eu toute une phase de perte de sens. Il y a un sentiment de désaffiliation, des solidarités collectives qui se sont largement effritées parce que la pression a été mise sur les individus qui ont été mis en demeure de réussir ; et si on ne réussit pas, on est seul face à soi-même et on est responsable de son propre échec. C’est une individualisation extrêmement forte qui a isolé les individus sur le plan mental, psychologique. Tout ça a abouti à une perte de sens au niveau du travail. On a non seulement cette individualisation qui a monté mais aussi une déconnexion entre ce qu’on produit et ce qu’on consomme. Et de nouvelles formes de divisions et d’aliénation qui sont apparues, notamment à travers les nouvelles formes de management. Et ça aussi, ça a contribué à ce sentiment de perte de fierté par rapport à ce qu’on fait.
Jean Zin :
Dès le moment où le travail est dans un cadre capitaliste, le but de l’entreprise capitaliste est de produire le maximum de plus-value : le travail ne peut pas être épanouissant. Ce n’est pas une question de choix mais de profit. Ce qu’il y a d’intéressant dans ce que vous dites, c’est qu’André Gorz lui-même valorisait le temps libre. Il avait été un peu déçu par l’autogestion et donc il pensait qu’on ne pouvait être autonome, libéré, que dans un temps libéré du travail et c’est à ce moment-là qu’il a défendu la réduction du temps de travail. D’un côté il y avait le temps de travail hétéronome qui était une souffrance, et d’un autre côté il pensait qu’on pouvait s’épanouir dans le temps libre qui serait un temps autonome. Il s’est rendu compte que le temps autonome ce n’est pas du temps de loisirs. Et le plus important c’était d’arriver au travail autonome, ça permettrait de changer le travail. Mais ce mouvement, du temps libre au travail autonome, a été le mouvement même de la réflexion de Gorz. Faut pas rêver, sans une lutte importante, sans un revenu garanti, on n’arrivera pas à faire que la majorité des travailleurs soient heureux dans leur travail.
Un intervenant :
Je voudrais revenir au sujet, parce que le travail je ne peux pas vous en parler : je ne sais pas ce que c’est, en tous cas je ne le pratique pas dans un cadre habituel. Comment sortir de la société productiviste ? Parce qu’on peut dire ce que l’on veut, mais elle fait rêver quand même, elle fait rêver le reste du monde qui n’y a pas encore droit. Tout le monde veut sa bagnole, sa télé, faire un voyage en avion. Et je trouve ça génial : avoir une bagnole, c’est génial, je trouve ça pratique, l’avion je trouve ça encore plus génial parce que j’en ai pas fait souvent. Et tout ce qui va avec, la société de consommation, c’est génial, on s’en fout plein la gueule mais elle a un problème, c’est qu’on ne peut pas la généraliser. La question que je veux poser c’est : n’est-t-on pas à un goulot d’étranglement avec la financiarisation ? Le monde est encore grand, alors ce petit jeu de faire du bénéfice sur l’immatériel, ça marche un certain temps mais à un moment la boîte va être pleine.
Vous connaissez le principe de celui qui envoie une lettre à dix personnes en disant : vous m’envoyez tous un euro, et ainsi de suite, et vous allez gagner de l’argent. Vous savez pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu’au dixième envoi vous avez dépassé la population mondiale, il y a plus de lettres que la population mondiale ; donc à un moment ça vous revient à la gueule. Ce système de financiarisation qui vit de l’immatériel, le principe des subprimes (on vend de la merde aux autres et on gagne de l’argent en vendant de la merde) à un moment donné ça se casse la gueule. J’ai entendu Carlos Ghosn dire : il n’y a aucune raison que les Chinois n’aient pas autant de voitures que les Français, 600 voitures pour mille habitants. Les Chinois n’en sont qu’à trente. Mais ils n’y arriveront pas. C’est matériellement impossible. Donc le goulot d’étranglement, il est là. On peut parler à l’infini de nos conditions de travail, pas de travail, il y a un moment on a joué le jeu : c’est nous qui la faisons tourner cette machine. Je me souviens très bien de Patrick Mignard qui expliquait comment la classe ouvrière y avait trouvé son compte dans ce système, même si elle est passée par des périodes difficiles, on est tous d’accord, et même si aujourd’hui on est dans la régression. Mais aujourd’hui ce n’est pas généralisable, c’est aussi bête que ça. Ce que je voudrais savoir, c’est : où vont être les premières ruptures ? Si on reste sur cette lignée on va arriver à des ruptures : l’élasticité a des limites. Et je pense qu’elle va être autour de l’agriculture. Notre agriculture est très dépendante de l’énergie fossile et on sait que son prix va augmenter. Et on veut que la bouffe soit pas chère parce que c’est un produit, donc une charge, une contrainte, comme le fait de se loger. Mais on mange mieux qu’il y a cinquante ans et on est mieux logé. On est dans la société de consommation dans toute sa splendeur. Et tant qu’on a à manger dans son assiette, on ne fait pas chier son voisin. Quand ça va manquer dans l’assiette, je ne garantis pas la paix. Des famines en Europe d’ici la fin du siècle, ce n’est pas inenvisageable.
Un intervenant :
J’aime bien ce que j’ai appris sur André Gorz, les deux alternatives qu’il envisageait. Il peut y en avoir d’autres aussi. C’est toujours la limite d’une prophétie. Je suis professeur d’histoire, j’ai un peu étudié et notre période elle me fait penser un peu à la fin du moyen âge. On étudie les sources et on voit que les gens savaient très bien comment sortir des difficultés : qu’il fallait un assolement, arrêter de morceler les parcelles, qu’il fallait mettre des choses en commun, avoir un peu plus de bétail pour permettre d’avoir plus d’engrais et d’intensifier, etc. Tout ça s’est fait après, mais les gens n’ont pas voulu parce qu’ils n’ont pas été capables de se remettre en cause, alors qu’ils savaient. Il a fallu des famines, qui ont affaibli les corps, donc il y a eu des épidémies, et là-dessus il a fallu des guerres pour que les gens se re-répartissent les choses ; et à ce moment-là on a trouvé assez de terrains pour permettre d’arrêter de fatiguer les sols et le système capitaliste est arrivé. J’ai l’impression qu’on est un peu dans le même contexte. C’est-à-dire qu’on voit très bien que ce système ne peut pas s’étendre au monde entier – sauf surprise. Comme disait Edgar Morin, tout ce qui était prévu n’est jamais arrivé et tout ce qui arrive n’était jamais prévu ; mais on sent quand même que du côté de l’être humain il y a quelque chose qui fait un peu répétition. En psychanalyse aussi : on parle comme si l’être humain voulait son bonheur. Je n’en suis pas persuadé. Je pense qu’il y a aussi bien des forces obscures qui agissent derrière les dirigeants du capitalisme que derrière les consommateurs. Qu’est-ce qui nous dit que l’être humain ne veut pas s’autodétruire ? On peut agir par rapport à ça. Je pense qu’il serait bon que dans le camp anticapitaliste (à défaut de pouvoir l’appeler autrement) on se pose la question de manière anthropologique. Marx dit : ce sont les hommes qui font l’histoire mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font. Freud va retisser ça. Quand je vois le succès de quelqu’un comme Chomsky, qui est très pauvre intellectuellement, cette séparation entre la linguistique et l’action politique, j’ai l’impression qu’on revient au positivisme, je trouve ça assez inquiétant. On a l’impression qu’il y a les méchants d’un côté et les gentils de l’autre. Comme disait Coluche : les riches sont méchants, les pauvres gentils. Le problème c’est que tout le monde veut devenir riche.
Un intervenant :
Je reviendrai sur le travail et la valeur. L’intervenant précédent parle d’agriculture : il faut sûrement en relocaliser, mais on est à combien de pourcentage de paysans dans la population active ? On ne va pas regagner des pourcentages comme ça, on ne va pas compenser en prenant sur les services, l’industrie il n’y en a plus. J’ai travaillé dans une usine : cela fait plus de vingt ans que j’en suis sorti, j’en ai encore rêvé cette nuit, voyez comme ça marque. Voici deux ans je suis repassé devant cette usine et je lui ai trouvé un air bizarre : il y a un musée maintenant, créé en 1993, bien avant la fermeture de l’usine où il avait 350 personnes. Quand j’y suis entré on était 450, dans les années cinquante il y en avait 900 ; bon, maintenant au moins on ne va pas polluer, ça c’est un gain, si on peut dire. Mais quand j’ai vu qu’elle était fermée, franchement ça m’a fait un choc aux tripes. Dans cette usine il y avait des souffrances, certainement, ce n’était pas facile le travail, mais je pense que malgré tout à l’époque, il y avait une certaine satisfaction des gens au travail, et maintenant on trouve ça où ? Le taylorisme, on a tiré dessus, on l’a enlevé, mais à mon avis il revient largement, notamment dans les centres d’appel. Avant les gens étaient fiers de leur travail. Par exemple si vous passez à Macon vous verrez une fresque, face à la Saône, fabriquée avec des petits carrelages faits à l’usine où j’étais, et qui représente Lamartine en 1847, parlant devant 6000 personnes. A l’époque de sa fabrication, une partie avait été étalée au sol, et une partie de l’usine a défilé devant avec fièrté.
Je reviens sur le travail : je suis d’accord. On n’a pas su remettre de la valeur en face du travail pour répondre à la droite, et les gens de gauche passent pour des feignants. Et la notion de valeur, on y met tout et n’importe quoi. Enfin c’est pas vraiment la valeur : le PNB, qui doit comprendre 50% de nuisances qu’il faut réparer (exemple du verglas avec les voitures au fossé à réparer, des journées d’hôpital). On ne sait pas mesurer la valeur comme il faudrait. Je n’ai pas bien compris tout à l’heure l’histoire du mur. Par exemple un joueur de musique dans le métro il produit de la valeur, mais elle n’est pas marchande, à part quelques pièces de monnaie, il produit du bonheur. Et ça on ne sait pas le mettre en avant.
Un intervenant :
Depuis le début je n’ai pas entendu les mots rapports sociaux de production, salariés, je n’ai pas entendu les salariés qui vendent leur force de travail pour survivre, dans ce système capitaliste qui est à bout de souffle. Après la seconde guerre mondiale le capitalisme a reconstruit tout ce qu’il avait détruit, ce qu’on a appelé les Trente glorieuses, 1945, 65, 75. Rappelez-vous 1975, premier choc pétrolier qui était une des expressions de cette crise mondiale du capitalisme. Nous sommes en 2010. Le capitalisme est toujours là. Un des intervenants expliquait la chute de l’URSS, en 1989, ce qui a donné un sursaut au capitalisme : 10, 20 ans peut-être. A nouveau des marchés s’ouvraient à eux, mais dans le cadre d’une crise capitaliste mondiale : surproduction de marchandises. La planète étant couverte par le système capitaliste, plus de territoires vierges à conquérir. Cette surproduction de marchandise, son effet se répercute sur quoi ? En terme d’économie, tout à l’heure j’ai entendu 1970. Les ouvriers produisent dans les usines des marchandises, les patrons en donnent une partie pour que les ouvriers puissent vivre. Le restant est la plus-value, le profit du capitalisme. Mais en 2010, l’informatique, le machinisme, a permis que le même individu de 1970 à 2010, multiplie sa productivité par 200. D’où moins d’ouvriers pour le capitalisme qui pour maintenir son taux de profit licencie des travailleurs, puisque dans cette partie de l’économie mondiale il n’arrive plus à sortir les marchandises qu’il produit. Donc on en arrive à une impasse dans ce système. Que faire ? On le réforme, on le dépasse ou on l’abat ? Pour ma part je préfère l’abattre. Que les travailleurs prennent le pouvoir économique et politique au niveau de la planète, instaurent un mot d’ordre transitoire qu’on appelle socialisme ; le communisme sera pour plus tard, plusieurs générations : s’approprier le pouvoir économique et politique afin de satisfaire les besoins de l’ensemble de la population. Sinon, réformer le capitalisme, le dépasser ? Mais la propriété privée des moyens de production, l’outil de travail, c’est le patron qui les possède. Tous ici nous sommes des salariés, ou nous l’avons tous été, on a vendu notre force de travail. En compensation on nous a donné un salaire. Mais la propriété privée de l’outil, les capitaux, c’est bien eux qui régissent le monde et qui envoient l’humanité dans le mur. On le voit actuellement : des millions de chômeurs et ce n’est que le début si on ne les stoppe pas.
Un intervenant :
Cher monsieur, le système soviétique était, dans son essence, un pays capitaliste ultra-centralisé. Un pays communiste actuel, la Chine, est un pays ultra-capitaliste, sans le libéralisme : on ne peut même plus être syndiqué en Chine populaire. Je crois que cette idéologie de la fin des temps, (Saint Augustin la fin des temps, Hegel la fin de l’histoire, Marx la fin du capital) est toujours l’idéologie de la finitude : au bout du tunnel, les fins heureuses. Moi je crois à la contingence, qu’il faut des volontés contingentes pour changer le monde, et qu’on ne change pas le monde si on ne se change pas soi-même. Il est bien évident que le camarade à côté parlait des parts obscures qui sont en nous-mêmes, nous en avons beaucoup. La preuve en est qu’un des régimes avec le collectif intellectuel le plus élevé d’Europe, en 1940, l’Allemagne nazie, pays de philosophes, de musiciens, de scientifiques… a été capable de programmer le génocide. L’Union soviétique a été capable de tuer une partie de ses intellectuels. Quand on arrive à mon âge on a fait toutes ces traversées : je suis un ancien ouvrier, j’ai pu voir aussi comment se comportaient certains délégués syndicaux, certains représentants politiques dans l’entreprise. Je demeure attaché à cette idée que la première révolution à faire c’est en soi-même et pour soi-même. Après on peut commencer à discuter avec les autres. Il faut être adulte.
Un intervenant :
On caractérise un Etat par sa nature. Actuellement nous sommes dans un Etat capitaliste avec des gens qui possèdent les moyens de production. En Union soviétique il y a eu une révolution en 1917, tout le monde le sait. Et puis il y a eu le stalinisme, la destruction des soviets et des têtes pensantes du parti bolchevique. Staline, sa théorie c’était : construisons le stalinisme dans un seul pays. A quel prix ! Au prix de décapiter le parti, l’armée ! Ensuite tu nous fais part de l’Allemagne hitlérienne avec des ouvriers ou des penseurs et qui a fait un génocide. Mais encore faudrait-il analyser comment Hitler est arrivé au pouvoir ! Repartons de la révolution russe : 1918-1919 la révolution allemande a échoué. Donc isolement du jeune Etat socialiste, avènement de Staline, bureaucrate représentant une tendance usurpatrice sur le dos des travailleurs ; ensuite 1933, je schématise comment Hitler est arrivé au pouvoir : par la politique de trahison imposée par Staline, refusant l’unité des travailleurs allemands entre le parti socialiste allemand et les communistes allemands. C’était paver la voie à Hitler. Tu me parles de la Chine. La Chine ce n’est pas un Etat communiste, ce n’est même plus un Etat socialiste. Il y a une révolution sociale par les masses sur lesquelles Mao s’est appuyé, certes, mais y a t-il eu des soviets en Chine ? Ce sont des faits.
Un intervenant :
Les révolutions tournent toujours mal et dévorent leurs enfants. 1789 : il faut lire les chroniques de Rétif de la Bretonne sur le petit peuple de Paris plus heureux sous l’Ancien régime. Je pense qu’il faut un changement profond en nous-mêmes pour informer de pratiques plus libérales et plus libertaires ; je pense que Rétif avait raison quand il disait que le peuple avait plus de liberté sous l’Ancien régime que sous la révolution de 1789. Quand on a cette espèce de chronolatrie (au bout de la route l’homme nouveau) je cite BHL qui n’a pas que des défauts : le gonfanon des libertés socialistes s’est planté sur un ossuaire.
Un intervenant :
Je pense que si on ne comprend pas l’histoire, comment analyser le passé, chez les prolétaires, comment comprendre le monde dans lequel nous vivons ? Alors on me donne comme contre-argument : » il faut que l’homme se dépasse « . Dans le cadre de cette société capitaliste où on est écrasé par le travail, la productivité, où il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim dans les écoles parce que leurs parents sont au chômage et qu’on leur coupe le droit à la cantine, des millions de chômeurs… je pense que ce n’est pas dans le cadre de cette société que l’homme peut changer. Donc il faut abattre cette société, le capitalisme en soi. Si on ne pose pas ce type de problème, qui est économique, politique, demain ou dans huit jours le système capitaliste sera le même. Par contre ce que je vois dans cette salle c’est qu’il y a beaucoup de cheveux blancs et que la jeunesse, elle, a été bien décervelée depuis des décennies par des partis qui se réclament de la classe ouvrière.
Une intervenante :
Si les jeunes ne sont pas là, c’est peut-être parce qu’ils en ont ras-le-bol d’entendre ce qui a réussi ou pas, l’Union soviétique ou la Chine, ce qu’a fait ou pas le communisme, le socialisme, avec les théories marxistes et ce qu’elles étaient à l’époque. Je crois qu’on est loin de ça dans le monde actuel. Le thème du jour c’était : sortir du capitalisme, et je rajoute » et l’écologie dans tout ça » ? parce qu’il y avait quand même le mot écologie dans votre thème. C’est pour ça que je suis venue et pas pour refaire l’histoire. Ce qui m’a intéressée, c’est ce qu’a dit M. Julliard par rapport à cette époque. Je vais faire un parallèle : à la fin des Trente glorieuses on a parlé de temps partagé, de temps libre. En l’analysant aujourd’hui au vu de ce qui s’est passé, il me semble que si on a cru au temps libre c’etait à cause de l’augmentation de la productivité et qu’on s’est dit : on a produit ce dont on a besoin, donc comme on n’a pas besoin de produire plus, on aura du temps libre. Là-dessus sont intervenues les multinationales qui produisaient, et pour elles il n’y a jamais assez de profit. La logique du profit a dépassé la logique des besoins matériels de la population occidentale. Je crois qu’on arrive à une période où pour d’autres raisons (les motifs écologiques et les crises dans lesquelles on arrive) on peut se reposer la question dans ces termes : la production pour quoi faire ? Sortir du capitalisme, pour nous écologistes (j’entre dans le social à travers l’écologie) je crois que c’est se dire qu’on a peut-être trop produit et qu’on peut vivre mieux avec moins de biens : notre leitmotiv c’est » moins de biens plus de liens « . Il faut savoir le mettre en pratique et le décliner sur une sortie du capitalisme qui soit une sortie du productivisme. On parle de société soutenable. Dans mon association, la société soutenable est une société qui prône la sobriété et l’équité. Ca m’aurait intéressé de parler de ça aujourd’hui.
Un intervenant :
Par rapport à l’écologie c’est intéressant de recentrer le débat, parce que le problème c’est pourquoi les gens veulent plus de biens (et je m’y inclus) que de liens. Il y aurait une espèce d’insatisfaction qu’on cherche à combler avec des objets. Le fait de proposer de consommer moins, de plus partager, c’est moins efficace que de proposer de consommer plus. Comment on va éviter la fin du moyen âge ? Au moyen âge on le savait tout ça, il a fallu aller jusqu’au bout de l’ancien système, jusqu’à ce qu’un tiers de la population de l’Europe disparaisse ; à ce moment-là il y a eu de la place, on s’est mis à se dire qu’il fallait faire quelque chose, et on est devenu plus raisonnable. De même qu’on a été un peu plus raisonnable en Europe de 1945 à nos jours (et encore c’est en train de se dégrader) parce qu’on a eu des millions de morts des deux guerres mondiales. C’est pour ça à mon avis qu’on a vécu cette espèce de parenthèse un peu moins médiocre. En France c’était rêvé : on n’était plus une grande puissance, on était pris entre les deux, courtisé par les Américains qui ont fait en sorte que la société de consommation s’implante ici mais en même temps en s’assurant que les travailleurs chez nous aient un peu plus que ceux de l’Est. Mais maintenant il y a un retour sur investissement : c’est fini l’époque de Casimir. On voit que de plus en plus de gens sont impuissants, dépossédés par rapport à ce qui se passe. Et moi c’est pareil, je ne vois pas. Je vois bien la sortie possible par la sublimation, la joie au travail, la recherche intellectuelle, mais ça, ça ne fonctionne qu’avec une minorité. Comment on fait pour qu’individuellement les gens changent ?
Jean Zin :
Je voulais juste dire que beaucoup de gens qui interviennent disent qu’en se changeant soi-même ça changera quelque chose. Franchement ça fait des millénaires que des gens changent, et en bien, et ça ne change rien du tout pour les autres. Par contre je voulais aller dans le sens catastrophiste. On le voit avec la crise actuelle. Dès que la crise va un peu mieux, les gouvernements ne peuvent plus rien faire. Il faut qu’ils soient devant la catastrophe pour qu’ils se décident à faire quelque chose. Il y aura malheureusement une crise écologique, on va sûrement vers une augmentation du prix du pétrole et des denrées alimentaires ; ça va créer des catastrophes et c’est ça qui va décider à changer. Ce n’est pas par un changement individuel qu’on y arrivera mais par un changement des structures, des rapports sociaux ; et ce n’est pas non plus en abattant le capitalisme comme ça, comme s’il y avait un mec en haut, hop on le supprime et il n’y a plus de capitalisme. Je ne vois pas comment on peut abattre le capitalisme au niveau mondial ! Ca me semble de l’ordre du fantasme. Des gens comme Gorz ont travaillé la question, je me la suis posée aussi : qu’est-ce que ça peut être sérieusement une vraie révolution, une vraie sortie du capitalisme ? Malheureusement ce n’est pas ce qu’on rêve. Ca ne peut être qu’à un niveau local, à un niveau qui prend du temps, où on change l’organisation du travail. Il n’y a pas de truc magique.
Un intervenant :
Fort de ces références historiques, cela signifierait quelque part qu’il y a une logique historique et qu’il faudra encore une fois passer par une catastrophe terrible. La fameuse sortie civilisée de Gorz, terminée. Sans exclure cette éventualité qui est toujours possible, je voudrais avoir ici une petite lueur d’espoir. D’abord pourquoi nos synapses sont elles pénétrées par la machinerie, disons médiatique, consumériste, etc. ? Le travail a été remarquablement fait depuis trente ans et c’est un miracle qu’il y ait encore des gens comme nous ici. Et il y en a un peu partout, un archipel de gens plus ou moins libres qu’il faudrait relier les uns aux autres. Ils sont très nombreux mais ne le savent pas. Il y a aussi toute une partie de la population qui est en dehors du système marchand, mais agit aussi. Et si les centaines de milliers de gens comme moi monnayaient leur activité ça créerait [de la valeur], et il y a tout le bénévolat. Le système marchand, l’orgie du capitalisme, dont parlait Zola, il fonctionne quand même sur une huile que nous mettons tous (là encore contradiction), et il faut le souligner. Parce qu’il ne faut pas oublier qu’un certain nombre de gens sont en dehors du système marchand et le font fonctionner. Je parle de nos sociétés. Tout le monde n’est pas formaté, tout n’est pas formaté et le travail, oui, mais au service de l’autre (guérir, soigner, nourrir), ce travail-là il faut le retrouver. Et je fais l’impasse sur tout un tas d’autre réseaux comme Ambiance bois, qui produisent dans un cadre plus ou moins proche de ce dont nous rêvons. Tout ça pour dire que j’ai décidé de voir, délibérément le même verre à moitié plein et non à moitié vide, pour aller de l’avant, même si il faut avoir cette lucidité-là. Comme dit Gramsci : » pessimisme de la raison, optimisme de la volonté « . De toute façon on va tous mourir, donc autant vivre debout et tenter des solutions.
Un intervenant :
Il s’est dit beaucoup de choses. Je relève ce que vous avez dit sur l’histoire. Je crois qu’on est dans une phase complètement nouvelle pour l’humanité mais il y a des choses qui restent : c’est le comportement humain. Il n’a pas beaucoup évolué : les philosophes de l’Antiquité intéressent toujours. Ce sont les conditions dans lesquelles on est qui ont changé. Effectivement il y a des civilisations, à travers l’histoire, qui se sont cassé la gueule, mais c’était local. Aujourd’hui on est à des échelles, des ordres de grandeur, qui font que c’est l’ensemble de l’humanité qui peut être contaminé. Nos sociétés sophistiquées sont des colosses aux pieds d’argile, elles, elles peuvent se déstructurer en quelques décennies. Le problème c’est qu’aujourd’hui beaucoup de monde le sait. Quand on voit ce qui se passe en haut dans les discussions sur le climat, ça pousse fort. L’Union européenne dit : » il faut qu’on s’engage à moins 30% de gaz à effet de serre d’ici 2030. » On le dit mais politiquement on ne fait rien. La prise de conscience est là, mais le courage politique pour mettre en action, non. La taxe carbone, on peut discuter de sa pertinence en France parce qu’elle était mal ficelée, mais on s’est dégonflé au dernier moment. Quand on parle de changer l’imaginaire, c’est gentil (j’en ai un tout neuf) mais ça va pas changer grand-chose. Il faut le forcer un peu et l’argent, je suis désolé mais c’est un peu le nerf de la guerre. Ca a une vertu pédagogique. Et la taxe carbone, si on arrivait à la met- tre en Europe ça serait une sacrée pédagogie. On sait que demain l’énergie telle qu’on l’a aujourd’hui sera plus chère et on va commencer à être intelligent. Je l’ai vu partout, dans des conférences : quand les gens ont compris, se sont approprié les idées, ils deviennent intelligents eux-mêmes. Sauf qu’on est dans une machinerie qui est monstrueuse et c’est pour ça qu’elle ne bouge pas, elle a une grosse inertie. Mais on voit plein de petites expériences où les gens sont intelligents, ils reconstruisent un autre monde. Alors en bas ça bouge, en haut on est conscient, mais c’est au milieu. J’ai la lourde charge de représenter l’environnement au Conseil économique et social et c’est des discours qu’on ne peut même pas avoir. J’ai essayé et j’ai l’air d’un con, et même avec mes copains qui sont dans les trucs associatifs, qui devraient être assez proches, ça ne passe pas du tout. On ne parle pas la même langue. C’est assez désespérant. Alors l’espoir c’est qu’ils finissent par se retrouver entre deux feux. J’espère que cela se passera mieux qu’en Union soviétique, mais quand elle s’est effondrée ça ne s’est pas fait dans une effusion de sang.
Jean Zin :
Ce qui se passait à l’époque des villes franches, c’est ça qu’on peut faire. On peut, au niveau local, avoir une production relocalisée, non productiviste, qui tienne plus compte des gens, qui fasse du développement humain, et ça, ça peut se répandre. Si ça marche bien dans un endroit (on est dans une société de communication) les choses peuvent se répandre. Donc c’est un peu le contraire de : abattre le capitalisme de toute la terre. C’est : au niveau local on construit quelque chose et quand ça marchera bien et que cela sera répandu de manière assez grande, à ce moment-là peut-être qu’on aura un rapport de forces plus intéressant et que ça ne sera pas la barbarie. Je ne crois pas malheureusement qu’on évitera des moments de barbarie.
Un intervenant :
Je n’arrive pas tellement à me retrouver dans toutes les opinions émises, chacune a une part de vérité. J’ai une question qui me préoccupe. Il me semble que les sociétés, diverses à travers le monde, s’organisent pour résoudre des problèmes immédiats et à très court terme. On voit que cette satisfaction des besoins qui sont exprimés ou que l’on fabrique, pour un profit immédiat, n’apporte pas des solutions durables à la vie des hommes dans le monde. Comment organiser la société, ou la réflexion, pour que les efforts soient portés sur des objectifs qui satisfassent, à long terme et de façon durable, les besoins humains ? Je pense par exemple à la recherche scientifique. Si on laisse les industriels faire de la recherche, ils vont par exemple améliorer les écrans de télévision, mais on voit que ce qui a le plus bénéficié à l’humanité ce sont des recherches qui ont été faites dans le but de développer notre connaissance du monde. Je pense à la pénicilline, aux recherches mathématiques qui conduisent à des solutions physiques dont on tire des bénéfices très importants. Comment faire pour que la réflexion, le travail, se portent vers des objectifs pensés, réfléchis et qui ne soient pas simplement guidés par un profit, ou une réponse immédiate à des besoins que l’on crée ?
Un intervenant :
Je ne voudrais pas me répéter. Comment réformer le capitalisme sans l’abattre ? J’entends ta réflexion sur les pôles économiques locaux, mais qui détient le pouvoir économique, que deviennent les patrons, le capitalisme, les banques ? C’est un vœu pieux. Comment faire ? Est-il possible de réformer le système ? Je ne pense pas. Je pense que ce système amène l’humanité entière à sa perte. Je vais donner un petit exemple par rapport au camarade qui est écologiste. Actuellement on vit un drame écologique majeur, sans précédent. Quel est le système économique qui engendre une telle catastrophe ? C’est l’homme en tant qu’individu, ou c’est le système capitaliste qui impose ou qui casse les normes de sécurité ? Juste avant l’accident, Obama allait signer un décret pour déréglementer les plateformes pétrolières. Moi je veux bien réformer tout ce que vous dites, mais ça n’aboutira pas. Le moteur du capitalisme c’est le profit. Il tire de moins en moins de profit de cette planète. Si on ne touche pas au système des moyens de productions privés on n’y arrivera pas.
Monsieur parlait de la recherche. Dans ce système capitaliste elle existe, mais où va-t-elle en premier lieu ? L’armement, force de destruction de l’humanité.
Un intervenant :
C’est peut-être le jour de se poser la question : quels sont nos besoins réels et nos envies ? Sinon on va à la catastrophe écologique. Et il y en a une deuxième : en ce moment le capitalisme s’empare de l’écologie. Pour quoi faire ? Des richesses sont en train de mourir, il va en chercher d’autres pour faire des profits, sur l’écologie, ce qui va engendrer encore plus de différence entre les riches et les pauvres. Eux, l’air pur, l’eau propre, ils l’auront, nous on n’aura rien. Donc là il va falloir qu’on réagisse réellement sur ce qu’on veut être, parce que la catastrophe on y va et les petites bêtes qui vont disparaître, c’est peut-être nous. Effectivement, là il y a une transformation de la société, de l’homme, de notre façon de penser. Est-ce qu’on veut se détruire ou dire : on arrête là de discuter et est-ce que j’ai besoin de ça ou pas ? Parce que le capitalisme a trouvé le filon : l’écologie. Le problème n’est même plus historique : on n’a jamais connu ça. On a connu des guerres, mais là c’est l’Homme.
Un intervenant :
Il me semble que les solutions sont relativement importantes. Les solutions locales, il peut y en avoir partout. J’ai assisté au film de Coline Serreau, Solutions locales pour un désordre global, et il y a des solutions qui existent, en Inde, en divers endroits. En Inde c’est pour produire des graines, des semences en dehors des multinationales. C’est vraiment pour contrer ces multinationales qu’ils ont mis en place ce système de production de semences. C’est bien une façon de lutter contre le capitalisme d’avoir ces solutions locales. Il y avait également un autre film, Le temps des grâces, sur l’agriculture. On a discuté lors de ce film de la propriété de la terre. Là c’est pareil, tu parlais de l’agriculture qui allait être un gros problème ; un des problèmes ça va être la propriété de la terre. Et là aussi je pense qu’il y a différentes solutions locales qui peuvent exister : elle peut appartenir à la région, ça peut être des communaux, des sociétés, des coopératives. Il ne me semble pas qu’il y ait une manière unique de lutter. Ce qui est important, c’est le nombre de personnes qui arriveront à être convaincues et ça, ça demande du travail de réflexion entre nous et vis-à-vis de la population. Et ça ne se fait pas en un jour.
Un intervenant :
Par rapport au film l’autre soir, je suis bien d’accord en ce qui concerne l’Inde, mais ici le problème ce serait d’étendre à beaucoup plus qu’à quelques pour cent. Quelque part est-ce que ce n’est pas plus facile en Inde qu’ici, à cause de la façon de travailler, de nos actes de consommation et de la distribution ? La commercialisation pour le consommateur au quotidien c’est dans la grande distribution. Comment avoir prise dessus ?
Je vis dans une commune périphérique où un supermarché s’est monté récemment et j’ai écrit, étant scandalisé par le fait que tous les parkings étaient éclairés la nuit, et l’autre nuit les deux tiers étaient éteints. Alors il y a peut-être des raisons d’espérer.
Un intervenant :
Je veux juste réagir à ce qui se passe en Louisiane, ce qui se passe à chaque marée noire. On montre du doigt le grand méchant pétrolier qui salope tout. C’est une façon de voir les choses. Mais après, qui profite de ce pétrole pas cher ? C’est nous. Comment on s’est défait ? Douloureusement parce qu’on s’est laissé piéger par le tout-voiture qui était très séduisant. Les lobbies n’existent que parce qu’on achète ce qu’ils produisent. Le lobby de l’eau de mer n’existe pas, il y en a partout et tout le monde s’en fout. On ne peut spéculer que sur des richesses rares et dont on a besoin. Aujourd’hui il y a des villes, en Suède, qui ont décidé de sortir du pétrole, en se donnant 20, 30 ans. C’est un longue route à faire, et si on n’est pas capable de faire cette route on sera toujours pieds et poings liés tant qu’il y aura du pétrole à vendre. C’est forcément un aller et retour entre l’individuel et le collectif.
Marc Robert :
Le local est important dans cette capacité à se déprendre à la fois individuellement et dans un aller et retour avec des organisations collectives. Une façon aussi de vivre ensemble, des modes d’organisation, d’urbanisme. Notre objectif à tous c’est quand même de faire tomber le capitalisme. Il faut faire pousser quelque chose dans le sol et ce sol, fondamentalement, il est local. Je crois que c’est une conviction partagée par énormément de gens de ma génération. En partant du local et en faisant vivre une démocratie entre nous, à la fois de face à face et plus globale, il est possible de renverser un certain nombre de choses. Il y a quand même des lueurs d’espoir, ici et ailleurs dans le monde. De ce point de vue-là l’histoire n’est pas finie.
Compte rendu réalisé
par Anne Vuaillat.