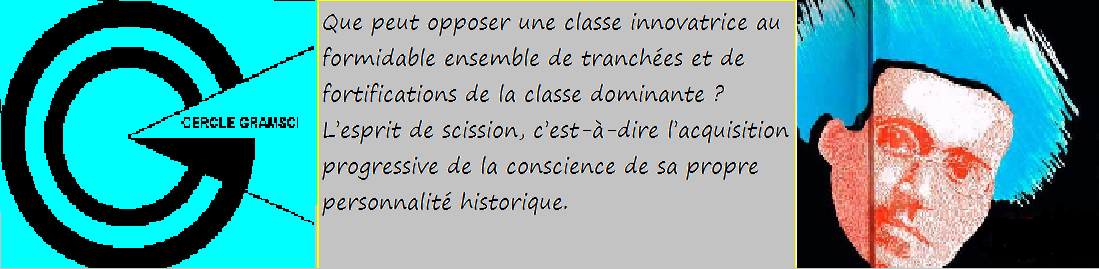Compagnie PAROLES
un spectacle théâtral autour des discriminations
Soirée du 20/12/2006
Lors de la soirée théâtre avec la Compagnie ParOles, l’enregistrement audio du débat n’a pas fonctionné. Nous ne pouvons donc pas retranscrire le contenu du débat qui eu lieu après la représentation. Ci-dessous vous trouverez l’introduction de Christophe Soulié ainsi qu’une contribution écrite d’un des participants.
Dans le texte de présentation de la soirée, l’atelier du Moulin à Paroles dit avoir été en phase avec ce qui touche de près ou de loin le monde du travail et ses manques.
Mais quels manques ?
Le monde de l’entreprise et ses trop :
– violences
– assistanat
– espoir d’ascension
– exclusion
– rentabilité
Le monde du travail et ses manques :
– sexisme
– harcèlement
– répartition des
richesses
Le travail tue, le travail paie, raconte une chanson écrite après 1968 par Raoul Vaneigem.
On a là deux aspects très forts de cette réalité qu’on appelle travail, d’où la question : faut-il perdre sa vie à la gagner ? Et gagner quoi ?
Quand on parle de travail, c’est toujours compliqué, tellement ce mot est chargé de sens et d’injonctions.
Il est d’abord piégé par une morale très ancienne qui dit qu’il faut gagner son pain à la sueur de son front. Il est souvent confondu avec l’activité, forme de travail non reconnue par le capital ou plutôt bien reconnue pour être capturée et être intégrée dans le processus de valorisation.
Le travail est un rapport social et un moment du capital. Dans cette acception, il est à la fois exploitation et aliénation. Sous cette appellation, le travail, c’est le salariat et c’est sans doute là-dessus qu’il est urgent de débattre.
Le salariat est né avec le capitalisme. Sera-t-il dépassable pour autant que le capitalisme puisse l’être ? La précarisation est un terme récurrent pour parler aujourd’hui du salariat. Ce concept est-il pensable en dehors de celui d’exploitation ? Ne renvoie-t-il pas à l’antagonisme entre une accumulation croissante de richesses du côté du capital et une accumulation de détresses du côté des salariés ? La précarité n’est-elle que la pauvreté matérielle ? N’est-ce pas cette accumulation sans fin qui est plus que jamais à l’œuvre ?
Et les évolutions actuelles ?
Réduction du temps de travail (qui dans sa version capitaliste se traduit par chômage et intensification du travail), flux tendus, flexibilité, management participatif ou autoexploitation.
Cela modifie-t-il les rapports sociaux traditionnels ?
Mais cela pose aussi la question de la protection sociale de tous quand celle ci s’appuie sur le travail (dans sa version plein emploi).
Alors que fait-on ? Que fait-on ici et maintenant ?
C’est peut-être là, modestement, une des pistes du débat de ce soir.
Christophe Soulié
Sur la précarisation du salariat
Cette courte introduction n’a pas l’ambition de soulever toutes les questions que le sujet mérite, et encore moins d’y répondre.
Seulement susciter quelques réflexions sur les ressorts fondamentaux du salariat, sa précarisation, et plus largement (car est-ce dissociable ?) sur l’exploitation de la force de travail.
Et proposer quelques pistes à débattre sur son éventuel dépassement.
Quelques repérages
fondamentaux à repenser
encore et toujours
Le salariat en tant que forme d’exploitation est né avec le capitalisme. Sera-t-il dépassable, pour autant que le capitalisme peut l’être ?
Mais, en attendant, un terme est récurrent aujourd’hui pour caractériser la situation du salariat, c’est celui de précarisation.
Recouvre-t-il, ce terme, exactement celui de paupérisation ou renvoie-t-il à une réalité différente de celle dont témoignait Karl Marx au XIXème siècle ? C’est-à-dire l’antagonisme entre une accumulation croissante de richesses du côté du capital et une accumulation de détresses du côté des salariés.
Est-il pensable en dehors du concept d’exploitation ? (Thèse bien connue de l’extorsion de plus-value : le salaire n’est pas malgré les apparences le prix du travail fourni, mais le prix de la force de travail, qui produit plus de valeur que n’en représente son coût).
Ou bien la précarisation n’est-elle que l’effet inéluctable mais nécessaire d’un certain degré d’inégalités sociales comme moteur du progrès ?
Question de dosage et de réajustement ?
Explication elle aussi bien connue d’une technologie et d’un marché qui ont besoin de trouver leur second souffle. Les lois de l’économie (et du progrès) si l’on en croit certains sont malheureusement bien implacables… Pour qui ?
Mais sont-elles si impénétrables ?
Et ce concept d’exploitation, si nous l’acceptons, est-il en soi suffisant pour rendre compte d’une réalité multi-dimensionnelle (la précarité n’est elle que la pauvreté matérielle ?) ?
Souvenons-nous qu’en d’autres lieux et d’autres temps pas si éloignés on a cru pouvoir s’en débarrasser (de l’exploitation de l’homme par l’homme) en rendant au peuple (collectivisation + plan) ce qui auparavant appartenait à César. Mais pour d’autres Césars et sans éliminer ni les injustices ni la misère (lire G.Orwell : La ferme des animaux ). Pourquoi ?
N’étaient-ce pas les mêmes logiques et les mêmes dogmes qui étaient à l’œuvre ?
En hyper-condensé : assurer la progression illimitée de la production sous une forme ou le travail mort écrase le vif. (Faut-il relire Marx sur la baisse tendancielle du taux de profit ?).
N’est-ce pas cette accumulation sans fin (aux deux sens du mot) qui est plus que jamais à l’œuvre sur toute la planète ? qui » promeut le moyen en fin et la fin en moyen « .
Mais alors ?… Prolétaires de tous les pays, unissons-nous !
Tiens ! Pourquoi pas de soulèvement général alors que tout pourrait y pousser ?
Serions-nous » aliénés » à ce point ? Qu’est-ce donc ? Et avons-nous besoin de ce concept en plus de celui » d’exploitation » ?
Peut-être. Car sinon, comment penser que l’exploitation perdure ?
Comment l’expliquer en effet sans comprendre les processus par lesquels les puissances sociales des Hommes, leurs capacités collectives (de produire, de réfléchir, d’échanger, d’organiser, de coopérer, de choisir,…) » se détachent d’eux pour devenir des forces » étrangères » qui les subjuguent et les écrasent » : les lois du marché, les logiques de pouvoir et de domination portées par les institutions, l’Argent fétiche, les machines et la techno-science, les religions et les idéologies cristallisées dans des églises et des partis,…
La misère n’est-elle donc pas la conséquence logique tout autant que la plus criante de ces processus de clivages sociaux et de dessaisissements qui aboutissent aujourd’hui à ce que des forces objectivées considérables ne sont plus maîtrisables dans l’archaïque cadre social existant ?
Sur quelques évolutions et
sur des permanences
L’ouvrier des temps modernes est-il toujours rivé à sa machine, transformé par elle, et soumis à un encadrement qui le prive de toute expression ?
Peut-on nier que des évolutions aient eu lieu avec le développement de la société industrielle, et donc dans le rapport au travail, notamment depuis les » trente glorieuses » ?
Faut-il en déduire que les inégalités s’amenuisent, ou au contraire que de fortes disparités maillent le tissu économique ?
Certes, il apparaît que certains salariés se disent (ou sont ?) plus qualifiés et plus autonomes dans leur travail.
Peut-on tirer des ces évolutions et de leur constat (indéniablement vécus et inscrits dans le mode de production capitaliste) des conclusions optimistes sur une disparition progressive de l’aliénation au travail et un net progrès social de la vie en entreprise ?
Ou cela se paye-t-il en contraintes plus fortes dans les rythmes de travail et par de nouvelles formes d’organisation (management participatif) ? Flux tendus, normes de qualité, flexibilité, individualisation/culpabilisation et stress par exemple.
Et l’individualisation des objectifs de travail ne consacre-t-elle pas l’affaiblissement des revendications collectives ?
Et surtout cette autonomie n’est-elle pas circonscrite aux processus de travail sans rien entamer sur les objectifs globaux et les buts ultimes de l’entreprise ?
Et cette tendance ne permet-t-elle pas de camoufler une permanence forte de rapports sociaux traditionnels entre patrons et ouvriers qui se maintiennent dans les secteurs industriels ? Mais seulement dans ces secteurs ?
Et interrogation théorique majeure : en quoi ces rapports traditionnels (taylorisme et/ou forte séparation commandement – exécution ) ont-ils rendus possibles par des gains en pouvoir d’achat qui ont pu compenser les insatisfactions au travail ?
Et en quoi les délocalisations et destructions diverses d’outils de production font-ils entrer peut-être une majorité de travailleurs dans des processus d’intensification de l’exploitation et de dégradations importantes de leurs conditions de travail et de rémunération ?
Etc…
Deuxième dimension de la précarité fortement induite par la » crise » : le rapport non plus au travail, mais à l’emploi.
Augmentation du chômage mais aussi des emplois à statut précaire (cdd, intérim) et du sous-emploi, sans oublier le chantage au licenciement.
Simples effets d’un décalage entre qualifications et poste de travail ? Réajustements structurels de l’économie et du marché ?
Conséquence des privilèges corporatistes de certains salariés ? (il paraît que les coûts salariaux sont trop élevés).
Est-ce la fin de l’emploi stable comme norme de référence ? Faut-il partager le travail ?
Ou au contraire la périphérie d’un marché de l’emploi instable est-elle nécessaire au fonctionnement de l’ensemble de l’économie pour en consolider le centre ? (avec comme objectif pour l’économie mondiale : 20% d’actifs de haut niveau de qualification).
La précarisation d’une partie des salariés serait-elle donc le prix à payer face à la concurrence internationale pour permettre aux autres de continuer à bénéficier de tous les avantages attachés au travail valorisant et/ou à la stabilité de l’emploi ?
Pour les chômeurs, sans lien par définition avec le monde du travail, le seul interlocuteur n’est-il plus que l’Etat-providence ?
Dans une société où l’essentiel des droits sociaux est presque entièrement dépendant des contributions issues du travail, se posent les questions des logiques protectrices de cet Etat-providence. Peut-on et doit-on choisir entre marchandisation libérale et modèle suédois de démarchandisation ?
Quelles conséquences pour le tissu social et les solidarités entre travailleurs ces « nouvelles » formes d’inégalités entre les salariés risquent-elles d’entraîner ?
Et, conséquences dans une troisième et pourquoi pas quatrième dimension de ces processus de précarisations, tout à la fois par rapport au travail et à l’emploi :
– disqualification des individus dans les sphères du privé ou au contraire repli dans ces sphères (famille, couple,…)… ou dans les tactiques communautaristes.
– réduction dans la sphère de la consommation des maigres satisfactions personnelles.
– discriminations sexistes et racistes. Rejet des handicapés.
– radicalisations politiques vers le populisme ou retraits de la vie sociale.
– sentiments d’indignité ou au contraire sur-valorisation de la réussite sociale au détriment des valeurs de solidarité et de coopération.
Et sans rien dire de l’exclusion/précarisation de continents entiers.
Sur quelques conclusions
possibles, provisoires,
très partielles
pour le mouvement social
Pour entrer dans une phase de révolution « , il faut deux sentiments contradictoires et qui sont solidaires : l’espoir et le désespoir. Il faut que les hommes se trouvent dans une situation inacceptable et il faut qu’ils conçoivent une autre réalité » (Raymond Aron).
La situation est-elle inacceptable ? Si nous pensons que » non « , il ne nous reste plus qu’à nous souhaiter » bonne nuit « .
Si nous pensons que » oui « , il nous reste à réfléchir à l’essentiel : concevoir une autre réalité.
Peut-on en rester aux formes traditionnelles de revendications des salariés ? La garantie d’un emploi mieux rémunéré et au final une meilleure répartition des fruits du travail et des richesses ? Un pouvoir d’Etat garant des droits et devoirs de chacun et des formes juridiques de justice sociale ?
Et lui assigner pour tâche de fixer des limites au capitalisme ? Par exemple de s’opposer aux licenciements des entreprises dont les profits sont importants ? Rétablir une logique de coût social et de service public ?
Mais ne resterions-nous pas alors et encore dans des logiques de négociations avec le capitalisme, et donc dans des stratégies défensives ? Et d’ailleurs qui pourra dire que défendre Pierre ce n’est pas laisser Paul démuni ? Que nos marges de manœuvre ne vont pas se rétrécir comme peau de chagrin ?
Sommes-nous alors condamnés à auto-prôner des situations précaires en nous inscrivant dans des productions marginales et locales ? Ou en acceptant le partage du travail ? Ou celui de la misère, avalisé par les théories de la décroissance ?
Peut-on faire dans ces conditions, tout de suite et ici, l’économie d’une remise en cause des logiques qui sous-tendent les mécanismes du marché et du profit ?
Ou bien doit-on commencer à penser un double mouvement : ré-appropriation par l’ensemble des individus de leur puissance sociale en dés-opacifiant les liens entre économie et politique et en introduisant un nouveau type de croissance et de productivité écologiste et humaniste, car basé sur l’économie en capital matériel et sur la valorisation du travail vivant.
Et peut-on croire à un véritable changement social et sociétal sans redonner le pouvoir aux gens qui travaillent, là où ils travaillent ?
Alors pourquoi la Démocratie s’arrêterait-elle là où elle ne serait plus que d’opérette : à la porte de l’entreprise ?
Et au bout ? Fin du salariat et libre association des travailleurs ? Et plus d’Etat ni de misère ? Rêvons un peu. Mais pas trop… Car n’attendons plus rien d’en haut.
Et conclusion de la conclusion : peut-on rêver à une société sans précarité sans en passer par le dépassement de l’exploitation capitaliste, et peut-on rêver ce dépassement sans se prendre par la main pour s’engager tout de suite dans des processus de dés-aliénation ?
Jean-Paul Lucas
Bibliographie :
Le Capital, de Karl Marx.
Commencer par les fins, de Lucien SEVE. Ed. La dispute.
Le salarié de la précarité, de Serge PAUGAM. Ed. PUF
Travaux de Paul BOCCARA