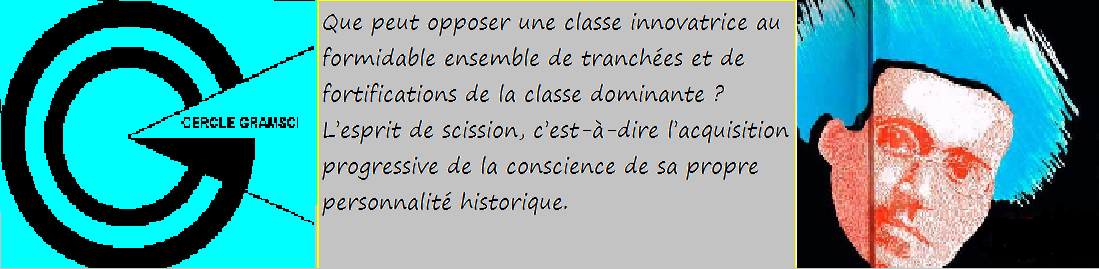« Se nourrir : une (re)mise en question
du lien au vivant dans nos sociétés
contemporaines ? »
Sociétés « agro-alimentaires », « assises de l’alimentation », mais que donc signifie s’alimenter aujourd’hui ? Il semble bien que nos sociétés contemporaines ne se nourrissent plus de ce lien nourricier et existentiel à la Terre mais s’alimentent hors-sol, ou avec un sol considéré comme un support, non comme un milieu de vie. En quoi les mots travaillent-ils les choses et les milieux ? En quoi le geste de se nourrir se fonde-t-il sur des choix éthiques, concrets et existentiels qui engagent notre responsabilité vis-à-vis des êtres vivants présents et à venir ?
Depuis que les êtres humains existent, ils travaillent leur milieu dans un sens éco-techno-symbolique comme le dit le géographe et philosophe Augustin Berque. « Eco », oikos en grec, signifie la maison, l’accueil. En tant qu’êtres vivants, les êtres humains agissent en conscience et leurs actes perceptifs sont ancrés dans un corps, une sensorialité en lien avec les autres êtres vivants et la biosphère à savoir cette couche de la planète qui accueille le vivant, la faune, la flore. « Techno », parce que l’être humain est inventeur d’outils, de techniques qui lui permettent de travailler son milieu et qui sont l’expression de savoirs, valeurs, savoir-faire, cultures. « Symboliques » parce que doué de langages, l’être humain peut se représenter l’absent, rêver, se rappeler, interpréter. C’est un être de sens, de signification en interrelation concrète avec un milieu donné, le sien, qu’il fait évoluer en sociétés.
L’agriculture industrielle : Une rupture avec le vivant
Dans une interrelation très forte entre des milieux et des communautés, les hommes, percevant leur milieu, l’ont rêvé, travaillé, ajusté et ce dernier, réciproquement, les a inspirés, amenés à le faire évoluer. C’est ainsi qu’ont par exemple émergé les cultures en terrasse, les cultures en forêt, et plus proche de nous, le bocage. Une diversité de façons de travailler la terre, de façonner les milieux ont vu le jour, avec des techniques créées ad hoc, par les artisans, paysans, jardiniers, selon leur ajustement à leur milieu. Des outils sur mesure exprimant et générant une manière de percevoir ce milieu spécifique, tissant étroitement cultures culturales et cultures culturelles.
Or, l’agriculture industrielle conventionnelle a coupé ce principe universel du lien éco-techno-symbolique entre les êtres humains et leur milieu, empêchant le paysan de cultiver, dessiner son païs, au sens culturel et cultural, l’amenant à appliquer des règles programmatiques. Ces dernières, dictées par les acteurs de la mondialisation tel Monsanto font abstraction du lien incarné, incorporé et en même temps symbolique, culturel que tout être vivant, tout paysan entretient avec son milieu. Ainsi, l’ « éco », notre maison, la terre/Terre devient un objet à régir, contraindre, exploiter par la sphère techno-symbolique de l’industrie agricole mondialisée. Une rupture avec le vivant qui puise sa source sans doute bien avant la mondialisation, les phases destructrices de l’agriculture mésopotamienne en sont un cas d’école. Cependant, cette dernière reste sans commune mesure avec l’étendue et l’intensité d’une vision unique qui tente de s’imposer partout dans le monde. Cette vision hiérarchique entre le sujet humain et le reste du vivant réduit ce dernier, la biosphère, à des données à exploiter, mesurer, contrôler, contraindre, à des espaces à conquérir.
Un pouvoir de désensibilisation face à des communautés porteuses d’innovations durables
L’agriculture conventionnelle industrielle exprime une pensée schématique de la mesure, un sujet moderne qui fait du vivant un objet. Amplifiée par les recyclages des inventions mécaniques et chimiques de la deuxième guerre mondiale, n’a-t-elle pas pris le parti de plier les paysans à ses règles, à son monde, ne respectant aucune autre manière d’être à la terre, aucune autre culture ? (…)
Une question : que peuvent les agriculteurs face à une agriculture de l’anesthésie ?
Ce modèle cultural n’exprime-t-il pas, ne génère-t-il pas une culture de l’anesthésie, de la désensibilisation ? Imposant ses règles aux agriculteurs à coups de subventions et de primes, de menaces et de jugements, permet-il encore à ceux qui cultivent la terre de se sentir vivants parmi les autres êtres vivants, de se sentir en accord avec leur milieu ? N’invite-t-il pas les agriculteurs à coups de force financières et politiques à servir une réalisation utopique, celle de la conquête machinique, numérique des territoires, dans l’exclusion de l’altérité humaine, vivante, sociale ?
L’agriculture industrielle conventionnelle exprime une manière d’être au monde incomparable avec les sensibilités culturelles et culturales, qui, dans leur multiplicité, entretiennent toutes une relation éco-techno-symbolique avec leur milieu. L’agriculture industrielle conventionnelle exprime et génère l’anesthésie. (…) Dans de nombreux endroits du monde, des individus, collectivités, communautés s’organisent pour innover, designer avec le vivant et pas contre, dans un lien éco-techno-symbolique entre paysans, habitants, païs, milieux, territoires. Tous tentent d’échapper à l’anesthésie (la COPAGEN en Afrique, coalition pour la sauvegarde du patrimoine génétique, les associations paysannes en France comme le réseau Semences paysannes, les collectivités comme la commune de St-Pierre de Frugie en Haute-Vienne, … ).
L’analyse des liens entre cultures culturales et cultures culturelles qui fondent leurs entreprises nous amènent dans Le Design et le Vivant. Cultures, agricultures et milieux paysagers à avancer quelques propositions parmi lesquelles :
La véritable innovation n’est pas là où l’on croit
Enfermés dans le mythe du progrès technoscientifique, nous pensons communément que l’innovation est liée à ce dernier. Par exemple, la mise en place d’un nouvel OGM. On oublie dans ce cheminement que l’innovation techno-centrée nie les manières de vivre, d’exister, des cultures paysannes à qui l’on impose ces plantes modifiées. On nie de fait la capacité des communautés paysannes, culturelles à innover en accord avec leur propre dynamique, animiste, sociale, économique comme au Burkina Faso où la culture d’une plante a un rôle symbolique, sociale, nourricier.
(…) Pour faire émerger des gestes et des techniques en accord avec les besoins du présent et avec l’advenue des générations futures, ces méthodes culturales se fondent sur des compétences paysannes réelles en termes de connaissances scientifiques sur le vivant, la biosphère mais aussi en termes de connaissances culturelles. L’innovation durable, selon moi, est celle qui tisse ensemble la culture, le social, le vivant, le passé et l’avenir dans un lien d’ajustement à un milieu spécifique. Les innovations durables permettent ainsi aux communautés de s’accorder à leur milieu et à la terre dans un lien de sens nourricier et existentiel, lien sémiotique que coupe l’agriculture conventionnelle. (…)
Une nature à redéfinir
Nombreux sont les scientifiques qui ont décrété que l’axe sémantique universel Nature/Culture n’est plus pertinent, tout étant devenu hybride (Bruno Latour, Philippe Descola pour ne citer que les plus célèbres). Mais ne s’agit- il pas là d’un coup de force qui nie ce qui pourtant est une matrice organisatrice de la perception, cette tension entre les gestes des activités humaines (culture) et la nature qui comprend le vivant, la biosphère et le cosmos ? En portant attention à la différence de définition que les occidentaux, les japonais et chinois ont donnée au concept de nature, je propose de sortir du cliché de la nature-objet que l’on a tendance à opposer ou/et hybrider avec la culture pour montrer en quoi la nature est à la fois ce de quoi nous émanons et puisons nos forces créatrices, à la fois une altérité non totalement modélisable, prédictible, technologisable.
Les effets concrets, politiques, éthiques et existentiels liés à la négation des pôles Nature/Culture sont entre autres la modélisation du vivant et la main mise sur le vivant car on disqualifie dès lors les questions de morale et d’éthique. On nie des cultures paysannes qui même en Occident, même en Limousin, ont, par le passé, su tisser un lien cosmique (les rituels de la semence, de la récolte, …), lien au vivant et au cosmos que l’on retrouve dans des formes plus contemporaines comme la biodynamie, la permaculture. Un lien qui justement exprime et fonde une complémentarité interactionnelle entre nature et culture, un respect du vivant en tant que ce qui nous dépasse. Un lien qui compose en même temps une sorte d’humilité des sujets humains que l’on retrouve dans l’expression « bon sens paysan ».
Sortir les signes et les gestes du « hors-sol » pour les ramener à la Terre/terre
L’être humain est un être éco-techno-symbolique, comme le dit Augustin Berque, c’est un être de langage et de symboles (symboliques), de techniques (techno) mais dans un lien charnel, ancré dans le vivant en tant que partie de la biosphère (éco). À ce titre, il tisse avec son milieu des langages, des signes, des discours, des techniques et interprète son milieu vivant, la terre qui le porte en les travaillant, en les façonnant (cf. les paysages de rizières, les bocages, …) de façon spécifique, embrayée et concrète dans la mesure où il prend en compte sa spécificité. Mais à partir du moment où il se coupe du milieu nourricier et existentiel de son milieu pour le travailler et le façonner selon des standards, il sépare l’éco (le vivant, la terre, l’eau) de ses activités techno-symboliques pour appliquer ces dernières sur les premières de façon arbitraire.
Il ne reconnaît plus alors le vivant que comme objet à manipuler, à exploiter, il s’en sépare ; il est « hors-sol ». La société de l’information, l’agriculture industrielle, agro-alimentaire, le design du vivant en biotechnologie font ainsi tourner les signes et les technologies dans des utopies, des mondes coupés existentiellement de la terre qui les porte. Les signes et les techniques ne servent plus alors qu’à justifier leurs propres systèmes, à faire en sorte qu’on y adhère. Et les opérations de greenwashing avec les ruches d’abeilles posées entre deux traitements dans des cultures conventionnelles industrielles pour la photo médiatique de vergers et cultures à l’allure « écolo » illustre ce principe. Les signes et discours n’ont plus alors de relation concrète et existentielle au milieu spécifique duquel on parle, duquel on émane et, ce faisant, on travaille les milieux en les coupant de leur histoire éco-techno-symbolique, de celle de leurs communautés. C’est ce que j’appelle l’anesthésie, effet des sociétés contemporaines techno-symboliques, coupées de l’éco.
Et c’est sans doute cette souffrance existentielle qui amène tant d’initiatives de « résistances » paysannes de par le monde.
Je dirais donc que dans les processus d’interprétation, de perception, il faut prendre en compte un autre sujet que le sujet humain ; la vie, la Terre, penser une interrelation par ajustement concret, de bon sens plutôt qu’une relation utopique.
Donc, interpréter, symboliser oui mais en interrelation, en ajustement avec le milieu pour que ce dernier évolue de façon favorable à la vie des humains et des autres …
Nicole Pignier
 Nicole Pignier
Nicole Pignier
compte-rendu : Cercle Gramsci – Nicole PIGNIER – le 16 décembre 2017
Le lien au vivant dans nos sociétés Agriculture, paysages, design, alimentation
Christophe Soulié :
La question de l’alimentation s’est posée de manière politique le 12 août 1999 quand, à Millau, des militants de la Confédération Paysanne ont démonté un restaurant rapide Mac Donald en construction. Cette action a eu un grand retentissement médiatique, tout en posant d’un point de vue politique la question de la nourriture, de l’alimentation. Je ne pense pas que par le passé cela ait été posé aussi fortement. Le démontage du Mac Donald à Millau était intéressant d’abord d’un point de vue symbolique, puisque les États-Unis avaient décidé de taxer le roquefort en représailles contre des mesures de l’Union Européenne visant à empêcher l’importation de viande de bœuf trafiquée. Cette action ciblait la mondialisation, parce que l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) avait légitimé la position des États-Unis. Le démontage du Mac Do correspondait donc aussi à l’émergence de la lutte contre l’OMC du mouvement altermondialiste. Derrière ces événements se profilait la question de la standardisation du vivant, de l’empoisonnement des sols et de la stérilisation du vivant avec les brevets appliqués à celui-ci. Tout ceci est vraiment apparu sur la scène à l’entrée des années 2000. La « malbouffe » a cependant masqué les enjeux qui se tenaient derrière, autour des agro-industries. Le débat a toutefois continué à évoluer et le cercle Gramsci y a participé, puisque dès 1998 des débats été tenus avec Alain Desjardin et Marc Dufumier notamment. Alain Desjardin, qui était paysan sur le plateau du Larzac et militant de la Confédération paysanne, avait donné pour titre à sa conférence « La politique dans notre assiette ». On abordait l’alimentation d’un point de vue politique. Marc Dufumier, agronome et enseignant-chercheur à Agro-Paris, est venu ici en 1999 discuter des agricultures paysannes à travers le monde. A la même époque Jean Pierre Berland, chercheur à l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), est venu traiter de la mainmise des multinationales sur le vivant et de la stérilisation du vivant à travers les droits de propriété sur les graines, ainsi que du pillage des agricultures paysannes fait en brevetant leurs semences. Berland avait utilisé le terme frappant de « nécro-technologies ». Il s’agit là du sens des mots et des concepts. Contrairement à l’usage consacré, ces technologies ne sont pas des « bio-technologies » mais des technologies mortifères consistant à stériliser le vivant pour le contrôler et le vendre. Avec le débat proposé par Nicole Pignier ce soir, on aura affaire à la définition des concepts, il sera également question du symbolique. On se situera aussi dans ces batailles vis à vis de l’agriculture des multinationales, l’agriculture de ceux, Nicole, que tu appelles les « agricultueurs ». Nicole Pignier est professeure à la faculté des Lettres de l’Université de Limoges. Elle est l’auteur du livre Le design et le vivant. Culture, agriculture et milieu paysager1. Depuis la rentrée universitaire, Nicole a mis en place une licence professionnelle à la faculté des Lettres qui s’appelle « Design des milieux anthropisés », en relation avec le lycée agricole des Vaseix, sous le patronage de Gilles Clément. Nicole Pignier interroge les perceptions qui sous-tendent et forment les gestes et les pratiques humaines. Pour elle, le monde agricole est aujourd’hui le théâtre des grands enjeux de société (la transition écologique, l’alimentation, la santé, le lien social…) qui posent des questions de sens, de perception et d’éthique. Elle interroge ainsi les liens entre les pratiques culturales (manières de travailler la terre) et les pratiques culturelles (manières de percevoir les liens entre nature et culture, entre individuel et collectif, local et global). Nicole Pignier Je remercie très chaleureusement toute l’équipe du cercle Gramsci pour m’avoir invitée à partager mes questionnements, mes réflexions. Je dis « mes », alors qu’on ne fait jamais des travaux de recherche seule dans son petit coin, derrière son bureau. On est toujours imprégnée d’un tissu social, scientifique, culturel. Évidemment, ce que l’on peut dire et écrire à un moment donné est toujours situé. Situé concrètement dans des questions qui se présentent au moment où l’on écrit, dans des questions qui évoluent en permanence. Et c’est toujours situé, je dirai, dans une interrelation avec des rencontres, avec des gens. Se nourrir et vivre, quel sens (sémiotique et agriculture) ? Je suis professeure des universités, chacun a son défaut. Le mien, c’est d’être sémioticienne. La sémiotique s’occupe de tout ce qui fonde les processus de perception, de signification : pourquoi tel geste, pourquoi telle manière de se nourrir feraient sens pour quelqu’un ? pour des individus ? pour des communautés ? Sens, au sens le plus basique du terme, c’est-à-dire un mouvement, une dynamique, une orientation, une force de vie, quelque chose qui attire ou retient notre attention. Le débat de ce soir sera surtout une invitation à réfléchir à ces impensés, à ces choses qu’on ne questionne pas forcément toujours, qui deviennent des automatismes. Oui, il faut bien bouffer, il faut bien manger pour vivre. Mais toute cette fondation du sens est à interroger. Et puis, je suis également imprégnée de culture paysanne, je me sens au fond de mes tripes tout à fait paysanne et je passe beaucoup de temps avec mes enfants à côtoyer des paysans, et quand je dis « paysan » c’est bien le terme choisi. Ce sont vraiment des gens qui œuvrent à façonner le païs, tant dans le lien social que le milieu paysager. Christophe disait que j’avais monté une formation « Design des milieux anthropisés »2. Là encore, on ne fait jamais les choses toute seule, c’est au fil d’heureuses rencontres avec à la fois des ingénieurs de la vie du sol, des paysagistes, des gens au CFPPA du Lycée agricole des Vaseix (Limoges) appartenant à la Formation paysagère, cette dernière étant très sensible à cette situation et à tous ses enjeux de société. C’est aussi des rencontres avec la Fédération compagnonnique, avec d’autres chercheurs et aussi avec tous ces apprenants qu’on accueille pour cette première promotion. L’un d’entre eux, ici présent, est un spécialiste de design permaculturel3. Merci à lui. Ce sont des rencontres avec des apprenants aux profils vraiment variés qui nous apprennent autant qu’on leur apprend. C’est une belle aventure. Le Jardin planétaire Christophe a parlé de Gilles Clément4 qui parraine cette formation et « L’école du jardin planétaire » 5 qu’on vient de mettre en place avec un pole formation, un pôle actions de sensibilisation du grand public et un pôle de recherche interdisciplinaire. En effet, ce ne sont pas seulement les scientifiques qui font de la recherche. De nombreux paysans, au quotidien, font de la recherche, expérimentent. Ce n’est peut être pas la même forme de recherche mais, justement, il y a la biodiversité et la culturo-diversité. Je vois également des paysans dans la salle, merci à eux d’être venus, d’avoir pris sur leur temps bien rempli pour partager les réflexions, parce que les réflexions ne sont pas écartelées entre des gens qui auraient le temps et les facultés de penser et d’autres qui auraient moins le temps et qui seraient toujours « la tête dans le guidon ». Qu’est-ce que « designer » (le design) ? Permaculture, keyline-design On a une vraie évolution de ces métiers de paysan qui sont des « paysans designers ». Designer, non pas au sens superficiel de « dessin d’objet à la mode qui va bien se vendre ». Designer au sens où Victor Papanek6 entendait cette interrelation entre avoir un projet, faire des esquisses, des croquis de permaculture ou un tracé du keyline design7 (inventé par l’agriculteur australien Percival Yeomans) et on a la chance d’avoir quelqu’un qui travaille sur un projet à Ségur-le-Château (Corrèze), Franck Chevalier qui enseigne le Keyline design. Ce design consiste à penser avant tout le façonnage de la terre par l’ajustement aux spécificités de cette terre, de ce paysage, de son histoire, de son lien social, etc. Ce « design » qui se définit en tant qu’articulation entre ce projet qu’on va esquisser, dessiner… et un dessein, c’est à dire une visée pratique (se nourrir, produire de la nourriture) ainsi qu’une visée éthique, à savoir une conception du mieux-être et du mieux-vivre individuel et collectif. Cette conception qu’il nous appartient à chacun, quel que soit son rôle, de questionner : est-ce qu’on ne fait pas parfois fausse route dans notre conception du mieux-vivre et du mieux-être individuel et collectif ? Ce sont toutes ces questions que l’on va aborder ce soir. C’est vrai que le titre de mon livre Le Design et le vivant n’est pas évident pour tout le monde. Pourtant en permaculture on parle de « design permaculturel » ; en innovation pour ce qui concerne les cultures culturales (manières de travailler la terre), on parle de « keyline design », etc. Je ne suis donc pas tout à fait à côté de la plaque. L’agriculture : un concentré des questions et des enjeux d’aujourd’hui Aujourd’hui, l’agriculture, plus que jamais, est une sorte de concentré de toutes les questions, de tous les enjeux sociétaux qui se posent. Cela s’exprime par des tensions assez vives : on le voit à travers les tensions qui se révèlent dans « Les Assises de l’alimentation », on le voit avec les débats autour du glyphosate, on le voit au quotidien entre le grand syndicat qui a le monopole et les autres syndicats qui tentent de défendre leurs manières de faire, de vivre, d’être au monde, d’être au paysage, de se nourrir. Des tensions qui portent tous ces enjeux de société qui sont les questions de pollution, se nourrir, le corps, la santé. Mais je dirai aussi une santé existentielle : se sentir vivre en tant qu’être vivant. Est-ce qu’on en a encore le droit quand on est paysan ? Sans doute que oui, mais comment faire ? Est-ce qu’on en a encore le droit quand on est citoyen ? Sans doute que oui, mais comment faire ? Déjà se sentir exister, à travers l’acte de se nourrir et l’acte de produire de la nourriture. C’est vrai que peut-être un des défauts de mon exposé de ce soir ou une des limites en tout cas sera de mettre l’accent sur le côté rural de l’acte de produire sa nourriture, mais toutes les questions que je vais aborder concernent également tous les urbains en tant que citoyens qui se nourrissent. On parle de plus en plus de ce « paysage nourricier » en ville, de l’agriculture urbaine. Parce qu’il faut bien reconcrétiser l’existence et reconcrétiser cette façon de se nourrir en la relocalisant aussi dans les communes, petites communes comme grandes villes. Et pour celles-ci, pas forcément sur les toits mais aussi en lien avec le sol. Un déséquilibre historique : industrie contre cultures paysannes Si j’ai voulu mettre l’accent sur cette question de l’agriculture, des cultures paysannes, de se nourrir et de produire l’alimentation c’est parce que, plus que jamais, on arrive à un déséquilibre entre des forces. Je ne serai pas manichéenne : c’est simplement qu’une manière de penser le rapport au vivant, le rapport à la terre et à la nourriture a pris le pas sur toutes les autres. Et donc, un déséquilibre des forces, parce que dans ce « un contre tous » c’est le « un » qui veut avaler le « tous », et ce n’est jamais bon. On le voit ici (diapositive n°1 – photo de terres ravagées par la déforestation) avec des illustrations qui touchent le poumon de la Terre, en Amazonie. Et ce déséquilibre aboutit à des tensions au sein de la biodiversité, on le sait, mais aussi à beaucoup des tensions sociales, beaucoup de malheureux : à la fois des agriculteurs qui sont pris au piège, à la fois des paysans qui veulent en sortir mais comment ? Il y a aussi de nombreux malheureux parmi les citoyens qui ne se reconnaissent plus dans leur paysage, qui ont le sentiment d’être arrachés à leur païs. Diapositive n°2 : il s’agit d’un déséquilibre des forces à travers deux images. D’une part des gens qui aujourd’hui tentent de designer avec le vivant (image d’agriculture en terrasses), de faire avec le vivant (situation minoritaire). Et puis des gens pris au piège de cette monopensée, cette monoculturalié qui font contre le vivant (grande culture en open-field). Et cela continue aujourd’hui : chaque hiver des haies sont arrachées, le glyphosate est pulvérisé, le drainage est perpétué… De la « nourriture » à l' »alimentation » : généalogie et sens d’un mot Ces enjeux de société se retrouvent dans nos assiettes, ils se retrouvent dans les rayons des supermarché, dans les marchés locaux, partout. Mais ils se retrouvent peut-être déjà dans les mots que l’on utilise. Je suis sémioticienne, mais je suis un peu en porte à faux avec beaucoup de linguistes qui pensent que la réalité n’a de sens que le sens qu’on lui donne avec les mots. Je fais partie de ceux qui pensent que les mots surgissent aussi du rapport que l’on a à la réalité et de ce que l’on entend d’elle, de ce qu’on écoute d’elle, et de ce qu’elle nous dit. Ainsi j’accorde une importance assez forte aux liens que nous entretenons entre notre manière de forger notre païs, de nous nourrir, de vivre, et les mots que nous utilisons. Ainsi, il se trouve qu’on ne va pas parler d’ « Assises de la nourriture », mais d’ « Assises de l’alimentation ». Dans les hypermarchés, dans les supermarchés, on ne parle pas de rayons pour « se nourrir » mais de rayons « alimentaires ». En ce qui concerne l’histoire des mots, je vais faire très vite. Au 12ème siècle, les mots nutrire et alere signifiaient la même chose : à la fois, très concrètement, allaiter l’enfant, nourrir l’enfant et aussi éduquer. Il y avait donc dans cette nourriture une dimension très concrète, liée au corps, et aussi une affaire de perception, d’éducation, de lien à la société. Et puis au 16ème siècle, l’évolution de « nourrir » a donné « prendre soin » à la fois de son corps (se nourrir), mais aussi les nourritures de l’esprit (intellectuelles et spirituelles). Peu à peu ce sont les termes « alimentation » et « alimenter » qui ont pris le dessus, mais avec un changement de sens. Au 19ème siècle, on en a fait un terme intégré au mouvement de l’industrialisation, et qui voulait dire « fournir, alimenter », « fournir en énergie une machine, une arme, un corps ». Puis au 20ème siècle, le mot s’applique au commerce, à l’industrie agro-alimentaire : on s’alimente, on ne se nourrit plus, en tout cas dans les sociétés dites évoluées. Il ne faut pas caricaturer parce que je connais beaucoup de paysans, plutôt anciens et même des plus jeunes, qui disent encore qu’ils produisent d’abord pour se nourrir, pour nourrir leur famille et puis après pour les gens qui vont acheter au plan local. Ceux-ci ont résisté à cette monopolisation, à cette récupération du terme « alimenter », à cette déviation de ce terme parce que, évidemment, quand on parle de s’alimenter comme nourrir une machine, il y a une dynamique de réduction. Ce mouvement réductionniste fait de notre corps, du corps de la Terre, du corps collectif, un outil de production, un outil de consommation et donc quelque chose de fonctionnel et non plus d’existentiel. Donc, ces fameuses « Assises de l’alimentation » laissent beaucoup de gens sur le côté. Les paysans en premier lieu, puis les associations qui essaient de ramener la question du vivant au sein de l’alimentation. D’une manière générale, tout est orienté vers les solutions technologiques qui seraient seules capables d’alimenter la planète entière. Rapport existentiel à la terre : les cultures paysannes dans le monde (Burkina Faso) Finalement, quand on fait ça, on nie tout le rapport existentiel à la terre et au vivant qu’il y a dans l’acte de produire de la nourriture et de se nourrir. Je vais passer un extrait d’une interview réalisée au printemps dernier (2017) avec Richard Minoungou, habitant du Burkina Faso qui s’occupe d’une association, la Copagen, dont l’objet est de sauver le patrimoine génétique en Afrique. Richard est animateur-responsable pour le Burkina. Dans ce petit extrait on va justement écouter ce rapport au vivant et ce sens qu’il trouve dans l’acte de se nourrir. Mais je ne voudrais pas laisser croire que, seules, des communautés loin de chez nous ont ce rapport-là puisqu’en Limousin, il y a peu de temps, on avait encore un tout autre rapport à la nourriture. Et je ne voudrais pas être non plus nostalgique parce que beaucoup, notamment des jeunes qui s’installent et innovent en termes de cultures culturales (manières de travailler la terre), ont un tout autre rapport que ce rapport réducteur, « fonctionnaliste » à la nourriture et à la terre.
Richard Minoungo :
« …On n’a pas besoin de surproduction ni de gaspillages, on n’a pas forcément besoin de grands espaces, mais on a besoin d’utiliser son environnement de façon efficiente, tout en lui donnant ce qu’on lui demande. Parce c’est bien connu : il faut nourrir la terre et que la terre nous nourrisse. Selon les milieux, les pratiques peuvent être variées. Même quand on récolte, on ne commence pas à récolter comme ça et puis à se nourrir. Il y a des cérémonies pour remercier la Terre, pour remercier le Ciel d’avoir accepté de nous donner ce dont on a besoin pour continuer de vivre sur la Terre. Faire les choses de travers comme la déforestation veut dire « affecter des esprits » : on rompt le lien entre l’homme et ses ancêtres. En empoisonnant la terre, on tue des micro-organismes par les pesticides, etc. Cela ne peut pas permettre de vivre et générer, alors que tout ce qui est dans le sol se trouve là pour maintenir la vie sur la Terre. Donc nous sommes un peu choqués quand nous entendons parler d’agriculture industrielle parce que ce n’est pas destiné à nourrir l’homme. Ce n’est pas destiné à maintenir la vie sur la Terre. C’est destiné à répondre à des besoins économiques, des besoins financiers égoïstes qui perturbent l’ensemble du système. Cela perturbe les écosystèmes, ça perturbe les réalités et les pratiques culturelles de nos paysans, cela perturbe aussi le système que les paysans ont créé pour conserver, pour multiplier leurs semences, les échanger entre eux. Parce que lorsqu’on parle d’agro-industrie, ça veut dire le brevetage du vivant dans l’alimentation, dans beaucoup de pratiques. Dès lors qu’on met des brevets sur une semence, on est en train de rompre, non seulement le cycle normal de cette semence mais, de plus, on perturbe la souveraineté des paysans vis à vis de cette semence parce que c’est devenu un enjeu commercial alors que c’est un bien collectif. Ensuite, cette pratique-là débouche sur la monoculture. Quand on veut faire 700 hectares de sésame, c’est du sésame pour le marché. Ce n’est pas pour se nourrir. Et généralement ce sont des produits empoisonnés. On empoisonne comme cela la ressource-terre. Maintenant nous ne nous retrouvons pas tellement dans ces systèmes. Il est évident que ça détruit vraiment l’organisation, le système même de nos villages. Quand vous voyez leurs petits champs, il y a des pistes, il y a tout. Les gens savent par où il faut passer pour aller dans les pâturages, par Richard Minoungo : « …On n’a pas besoin de surproduction ni de gaspillages, on n’a pas forcément besoin de grands espaces, mais on a besoin d’utiliser son environnement de façon efficiente, tout en lui donnant ce qu’on lui demande. Parce c’est bien connu : il faut nourrir la terre et que la terre nous nourrisse. Selon les milieux, les pratiques peuvent être variées. Même quand on récolte, on ne commence pas à récolter comme ça et puis à se nourrir. Il y a des cérémonies pour remercier la Terre, pour remercier le Ciel d’avoir accepté de nous donner ce dont on a besoin pour continuer de vivre sur la Terre. Faire les choses de travers comme la déforestation veut dire « affecter des esprits » : on rompt le lien entre l’homme et ses ancêtres. En empoisonnant la terre, on tue des micro-organismes par les pesticides, etc. Cela ne peut pas permettre de vivre et générer, alors que tout ce qui est dans le sol se trouve là pour maintenir la vie sur la Terre. Donc nous sommes un peu choqués quand nous entendons parler d’agriculture industrielle parce que ce n’est pas destiné à nourrir l’homme. Ce n’est pas destiné à maintenir la vie sur la Terre. C’est destiné à répondre à des besoins économiques, des besoins financiers égoïstes qui perturbent l’ensemble du système. Cela perturbe les écosystèmes, ça perturbe les réalités et les pratiques culturelles de nos paysans, cela perturbe aussi le système que les paysans ont créé pour conserver, pour multiplier leurs semences, les échanger entre eux. Parce que lorsqu’on parle d’agro-industrie, ça veut dire le brevetage du vivant dans l’alimentation, dans beaucoup de pratiques. Dès lors qu’on met des brevets sur une semence, on est en train de rompre, non seulement le cycle normal de cette semence mais, de plus, on perturbe la souveraineté des paysans vis à vis de cette semence parce que c’est devenu un enjeu commercial alors que c’est un bien collectif. Ensuite, cette pratique-là débouche sur la monoculture. Quand on veut faire 700 hectares de sésame, c’est du sésame pour le marché. Ce n’est pas pour se nourrir. Et généralement ce sont des produits empoisonnés. On empoisonne comme cela la ressource-terre. Maintenant nous ne nous retrouvons pas tellement dans ces systèmes. Il est évident que ça détruit vraiment l’organisation, le système même de nos villages. Quand vous voyez leurs petits champs, il y a des pistes, il y a tout. Les gens savent par où il faut passer pour aller dans les pâturages, par où il faut aller chercher du bois, pour aller aux forêts où on dit qu’il y a des génies, des esprits que là-bas il ne faut pas détruire. C’est une manière de conserver l’environnement à travers des pratiques culturelles, alors que quand on vient pour chercher de l’argent, on bafoue tout ça « .
J’ai choisi cette interview parce que, pour moi, il est commun à cette orientation, à cette dynamique que recherchent de nombreux paysans aujourd’hui dans les sociétés dites évoluées où on tente de mettre la main sur le vivant, sur les agriculteurs, sur les citoyens pour plus ou moins les endormir. En fait, ce dénominateur commun est de trouver la manière de se nourrir et de produire la nourriture, en faisant avec le vivant, et non pas contre lui. Retrouver le bon sens paysan, celui du lien « éco-techno-symbolique » et de la créativité Dire cela, c’est finalement retrouver du bon sens paysan. C’est retrouver l’essence même de l’être humain sur cette Terre. Augustin Berque, géographe philosophe, résume très bien tout cela par cette belle expression : « Chaque être humain entretient un lien éco-techno-symbolique avec le monde qui l’entoure : son milieu ». – « Eco », c’est l’oïkos, c’est la maison, c’est la planète. C’est la terre en tant que sol qui nous porte, et la Terre avec un T majuscule, c’est à dire la planète. – « Techno », parce que depuis qu’il y a des humains sur la Terre, il y a cette relation d’invention technique pour, disons, optimiser, prolonger leurs compétences corporelles. – » Symbolique », parce que nous sommes des êtres de sens, nous sommes en quête de sens, et nos facultés à manier le langage, à pouvoir faire usage d’un ensemble de signes qui font sens, entre autre par les langues. C’est une manière de nous abstraire de l’ici-maintenant, de pouvoir nous représenter l’absent. Mais ce mouvement mono-cultural, cette manière de penser le rapport à la nourriture comme rapport uniquement économique et fonctionnel, qui a donné cette industrie agroalimentaire, a cassé ce lien de continuité entre l’éco-techno-symbolique pour établir un rapport de hiérarchie entre d’un coté le « techno-symbolique » (oui, je suis, donc je pense, ou je pense donc je suis) et, de l’autre côté, l’éco-, le vivant. Le techno-symbolique se détache et domine, il surplombe alors le vivant. Cette industrie agro-alimentaire a considéré que tout ce qui relevait de cet oïkos, de cette planète (la biodiversité, la terre comme sol-support), n’était finalement que fonctionnel. Donc il fallait l’exploiter. Il fallait conquérir cette Terre. C’est cet imaginaire de la quête, de la conquête, qui prévaut. En revanche, aujourd’hui ce que l’on trouve dans ces dynamiques paysannes, partout dans le monde, c’est cette envie de retrouver un lien de continuité. Mais quand je dis retrouver, il ne s’agit pas de revenir à un état paradisiaque, d’imaginer qu’avant c’était idéal. Parce que, bien avant l’industrie agro-alimentaire, on a eu des cultures destructrices. On caricature donc un peu trop les choses en disant qu’en Occident on est les vilains petits canards, qu’on a tous été dans ce mouvement de l’industrialisation. Non, c’est simplement que, je dirais, les différentes institutions ont porté bras levé cette manière de faire agro-industrielle, cette agriculture beaucoup plus destructrice, celle qui détruit en premier ses propres acteurs, ses agriculteurs à qui on enlève le droit d’être des « créatifs », pour en faire des outils « fonctionnels », qui font fonctionner le système. C’est un mouvement, un déséquilibre des forces, qui fait que cette agriculture agro-industrielle a essayé d’étouffer, d’asphyxier, d’aspirer, de vampiriser toute la diversité créative que nous pouvions avoir dans un rapport « éco-techno-symbolique » à notre milieu. Diversité créative qui s’illustre de multiples façons, selon les communautés paysannes : ces communautés paysannes qui ont su designer avec le vivant, non pas contre lui, et qui ont eu un rapport très créatif avec lui. Verdissage Diapositive n°4 (sur le greenwashing8) : on est ici dans cet air du temps avec cette agriculture agro-industrielle qui tente de laisser croire qu’on entretient un quelconque lien éco-techno-symbolique, proche avec notre milieu. Il s’agit de ces emballages « terroir » qui ont comme slogan, « Nos régions ont du talent ». Mais le terroir n’est pas considéré ici comme quelque chose de vivant à l’instar du milieu et de la terre. Il s’agit seulement de lister ou de construire une image des aptitudes d’un sol. Mais quand on écoute de gens spécialistes de la vie des sols comme Gérard Ducerf9, on se rend compte qu’un sol n’est pas figé dans une identité, qu’il évolue avec la manière dont on se met en interrelation avec lui, dont on le détruit, dont on s’ajuste à lui pour qu’il vive, pour qu’il prospère et nous fasse prospérer aussi. Mais l’étiquette « terroir » fait vendre, semble-t-il. Et puis, ce marketing fait aussi semblant d’entretenir ce lien assez proche avec le « local » : le savoir d’où on vient. Mais quand on voit les manières de faire de certains agriculteurs endettés avec leurs vaches, leurs manières de les élever et de produire le lait, j’ai envie de dire : Ce lait, on sait d’où il vient, on n’en veut pas. Donc, il y a dans nos manières de faire croire à cette « localisation » une réification du vivant. Si ça fait vendre, « on » le fait, tout en continuant de toute façon à détruire, à passer au glyphosate. On fait même maintenant des bâches de couleur verte ! Ethique et éthos Je reviendrai à la définition du design proposée par Victor Papanek qui nous dit : « Chaque être humain est un designer ». Cela n’est pas réservé à des gens qui ont pour métier de créer. Nous tous, dans à peu près toutes nos actions quotidiennes (se nourrir, s’habiller, se vêtir, se loger, se déplacer), sommes des designers parce que cela repose sur des choix. Choix qui sont toujours liés à différentes contraintes, mais aussi à des conceptions du mieux-être et du mieux-vivre individuel et collectif (choix éthiques). Et là, c’est la société civile qui est en première ligne, c’est elle qui doit aussi faire évoluer nos manières de designer, de consommer, de nous nourrir ainsi que de développer les aspirations à d’autres manières de produire de la nourriture. Pour ça, il faudrait que cette société civile arrive à faire la part des choses entre l’éthique, c’est-à dire se questionner, dialoguer sur les différentes manières de concevoir le mieux-vivre, le mieux-être individuel et collectif, et l’éthos, cette image, cette représentation, cet imaginaire social. Malheureusement, comme on est dans une société où tout va très vite, où la surinformation est partout, on ne prend pas forcément le temps de se poser pour faire la part des choses. Entre des m.o.t.s qui cachent des m.a.u.x et des m.o.t.s qui sont en phase avec des manières de procéder, se glisse le « greenwashing ». L’industrie agroalimentaire en fait grand usage pour son plus grand profit. Ainsi, on va mettre un petit nichoir à mésanges dans une pommeraie à Allassac (Corrèze) ; on va mettre une ruche entre deux traitements pour montrer que la petite abeille est bien là, donc qu’on est green, etc. Mais c’est nous les premiers fautifs quand nous nous laissons prendre à cette confusion entre l’éthique, c’est à dire se projeter pour un mieux dans l’avenir et l’ethos, la représentation, le cliché. L’innovation, la vraie : renouer avec la terre et le vivant Les Assises de l’alimentation parlent beaucoup d’innovation. J’entendais à la radio la responsable de la FNSEA expliquer que les innovations technologiques avec la « smart-agriculture »10 permettaient de vraiment cibler les traitements et ainsi ne pas détruire la biodiversité.
Elle ajoutait que les innovations biotechnologiques permettant de façonner le vivant donnaient les moyens de nourrir la planète. Mais est-ce bien cela, la véritable innovation ? Il me semble que la véritable innovation vient tout d’abord de ceux qui façonnent le paysage, le païs, et ne doit pas être imposée par un petit nombre d’acteurs qui vont vendre en grand la nourriture de façon uniformisée un peu partout dans le monde, niant les spécificités culturelles, les interrelations entre cultures culturales (manières de travailler la terre), et cultures-culturelles (manières d’être au monde, manière de penser son lien au vivant). Il me semble que les véritables innovations sont celles qui, justement, sont portées par ces paysans qui vont devenir des designers en ajustant très souvent leurs propres outils, en les inventant. Et là je regarde Mickaël parce qu’on travaille ensemble un projet commun, « Paysage comestible – paysage nourricier », à Ségur-le-Château ; et Franck Chevalier qui enseigne le keyline design. Franck est aussi quelqu’un qui veut avoir son propre atelier pour façonner des outils pour lui ou à destination de paysans voulant créer des outils aratoires à partir des spécificités de leurs propres milieux. Et non pas faire l’inverse. C’est-à-dire, ne pas bouleverser tous leurs milieux pour que les « bons »(gros, uniformes et grands) outils qui sont vendus par l’industrie agricole puissent passer et être utilisés. Nous préférons « l’atelier paysan ». Là en fonction de son milieu, de ce que l’on produit, de sa manière de cultiver, on va « designer » les outils. Donc, le sens du geste, comment je procède, le sens du choix de l’outil et des machines avec quoi je vais travailler. C’est à dire, quelque chose de vraiment fondé sur une volonté de retrouver ce lien éco-techno-symbolique. Non plus hiérarchiser, non plus travailler et reconfigurer la terre jusqu’à ce qu’elle « supporte » des machines et des graines qu’on veut y mettre, mais le mouvement inverse. Un mouvement qui n’est donc plus transitif, celui où l’on va du sujet dominant (le sujet humain) vers la conquête du sol (du vivant, de la terre), mais un mouvement de réciprocité où il y a une sorte d’ajustement : l’un ne va pas sans l’autre et l’autre ne va pas sans l’un. Un mouvement, aussi, qui est créatif et non pas déterministe. Un mouvement créatif, d’où cette multiplicité des cultures paysannes. Mais le problème là encore c’est une certaine confusion entre progrès technologique et progrès tout court. Je ne dis pas que c’est l’inverse qu’il faut (le refus de la technique). Nous sommes des êtres de technique et de technologie mais quand le lien est rompu, quand on n’est plus être capable de considérer son milieu et les effets sociaux qu’ont des innovations technologiques, on en arrive à cette « progression » de l’humain qui n’est plus « humaine », qui n’est plus celle d’un être conscient du vivant : une machine à fonctionner (homme robotisé). Donc, la véritable innovation, pour moi, c’est une innovation qui prend à bras le corps cette continuité entre progrès social, lien social et façonnage du paysage nourricier. Ce sont des paysans très soucieux, très attentifs au lien social qu’ils mettent en place. Je pense à ces paysans présents ce soir qui font en sorte de récréer du dialogue, des moments où on va se réunir, pour réfléchir à ce que c’est que de vivre à la campagne, que de se nourrir. Des choses très simples mais qui, en même temps, amènent des gens de différents horizons, inter-générationnels aussi, à réfléchir ensemble et à avoir envie de faire des choses en commun. C’est un lien social qui est exclu par l’agriculture industrielle, car là on est plutôt hors-sol. Ainsi, avec les engins de cette agriculture on n’a plus de lien direct à la terre. Parce qu’on est trop pressé, on a perdu cette expérience, cette histoire consistant à vivre, à sentir, à toucher la terre ainsi que ce lien avec les habitants. La véritable innovation est celle qui ne crée plus de hiérarchie mais qui pense d’un seul tenant l’innovation technique-technologique et l’innovation dans le lien au vivant, dans cette conscience du vivant que l’on peut avoir. Ici, sur cette dernière diapositive on a quelques exemples d’innovations paysannes. J’en prendrai un : celui du bocage au Sahel. L’innovation, c’est forcément ce qui part de préoccupations locales : comment concrètement je peux redonner du lien social et vivant avec ma terre, avec mon milieu ? Et qui dit local dit ne pas être enfermé dans une culture figée, qui n’évoluerait jamais. Le local, c’est également une capacité à dialoguer entre cultures et entre individus. Et, justement, le bocage au Sahel est un exemple typique. Nous connaissons le bocage en Limousin. Il en reste encore. Le nord du Burkina Faso est une zone où le désert avance pour de multiples raisons. Là, il y a des expérimentations menées notam-ment avec la Copagen, pour faire reculer ce désert. Et ce sont des expérimentations qui marchent. Donc, on va recréer des haies avec des espèces locales qui permettent de se nourrir parce que dans ces haies on trouve des arbustes fruitiers ainsi que des plantes qui permettent de faire de l’huile, etc. Ainsi, on recrée des haies qui permettent de faire pousser la nourriture ou de préserver les plants en période de sécheresse. Ces innovations locales ne sont donc pas « fatalement » venues d’en haut. Elles sont faites avec les habitants, en design participatif. Ce sont les habitants, ce sont les paysans qui sont maîtres d’œuvre, forces de proposition, en concertation avec les connaissances actuelles sur la vie du sol et sur l’apport de la biodiversité. Une véritable innovation est donc celle qui sait relier la sphère générationnelle des connaissances passées (qu’on a tendance à reléguer comme dépassées) avec des connaissances tout à fait contemporaines à la pointe des innovations scientifiques, sur ce que l’on peut apprendre et connaître de mieux par rapport à avant. La nature comme « sujet » et altérité Si on veut des innovations durables dans la manière de produire sa nourriture, de se nourrir et de faire société, il faut très certainement balayer d’un revers de mains cette confusion entre mondialisation et universel. Ce qui est universel, c’est justement ce lien techno-symbolique au local, à l’oïkos. Augustin Berque dit qu’il faut « reconcrétiser l’existence ». C’est à dire avoir des outils, avoir des espèces adaptées à cette relation au milieu local. La véritable innovation, c’est celle qui requestionne aussi notre rapport entre nature et culture; c’est celle qui fait qu’on n’oppose pas les deux et qu’on ne prend pas non plus la nature comme cet objet à dominer, à exploiter, mais comme une altérité de laquelle on émane, qui nous dépasse et qui, à ce titre, ne peut pas être programmée. Somme toute, que l’on ne peut pas diriger. Ainsi, je dirais que les biotechnologies en général ne sont pas de véritables innovations puisqu’elles consistent à « designer » le vivant, à créer du lien transitif, donc un sujet qui domine : le sujet scientifique. L’être humain alors domine et souhaite façonner à l’envie le vivant. Mais le problème est que le vivant se rebelle, parce que ce n’est pas quelque chose que l’on peut façonner à sa guise. On peut faire avec, s’ajuster, mais pas le dominer. Ainsi les biotechnologies sont de fausses innovations parce qu’elles coupent ce lien concret et existentiel au vivant ainsi qu’au milieu local. Une véritable innovation nécessite de prendre soin de la nature, non pas comme objet mais comme un autre sujet, une altérité à respecter qui nous dépasse et à écouter. Donc recréer ce lien, non pas déterministe mais créatif entre l’être humain et les communautés humaines ainsi que leurs milieux de vie, leur paysage. Ce sera ma conclusion : sortir de cette sorte de déni, de cette idéalisation que la mondialisation a pu en son temps porter. Mais la mondialisation date de 190411. Voilà, un processus capitalistique par lequel le marché s’est étendu à toute la planète. Où voyons-nous de l’universel là-dedans ? C’est tout à fait le contraire. C’est le début de l’anesthésie au lieu de l’esthésie12 en tant qu’être vivant parmi la communauté du vivant. Le débat Un intervenant : En ce qui concerne la relation entre le producteur et le consommateur (pour simplifier), je dirai que cette relation a été coupée, en ce sens que les intermédiaires se sont installés entre le producteur et le consommateur, et le consommateur s’est retrouvé à consommer des choses que l’industrie a normalisées. Même encore aujourd’hui, il ne se pose pas assez la question de ce qu’on lui fait avaler. Quant à revenir en arrière, ce n’est pas évident. Je ne sais pas comment rétablir ce lien. Est-ce que le design naturel n’est pas le meilleur, quand on voit les scientifiques faire du bio-mimétisme en copiant la nature pour construire, par exemple, des ailes d’avion ? Ce design-là, celui de la nature, est meilleur que tout ce que l’on pourra faire. Nicole Pignier : Je vais répondre en deux temps. Rétablir un lien entre producteur et consommateur. Première remarque : ces termes se sont spécialisés au XVIIIème siècle pour considérer uniquement cet aspect économique, chacun à un bout de la chaîne. Donc, très certainement, il ne s’agit pas de revenir en arrière mais de dépasser ce clivage. Avant d’être des consommateurs ou des producteurs nous sommes des êtres vivants, des citoyens qui ont pour mission de tisser leur « païs », le milieu dans lequel ils vivent. C’est vrai que c’est plus facile pour ceux qui vivent à la campagne et qui côtoient des agriculteurs, des paysans, de prendre conscience de ce qui se passe, s’ils ne sont pas eux-mêmes hors sol, s’ils sortent de chez eux. Pour des gens qui sont en ville, qui sont pris par le rythme du travail, c’est plus compliqué. Mais un des enjeux aujourd’hui, c’est de mettre la production de notre nourriture au cœur des cités. Et, forcément : loin des yeux, loin du cœur ! Plus on regarde autour de chez soi et plus on est en prise avec des gens qui produisent de la nourriture, plus on constate ce que ces gens-là font comme entreprise. J’ai entendu récemment un économiste qui remettait en question cette notion d’entreprise. Il expliquait qu’au XIXème et au début du XXème siècles, l’entreprise n’avait pas uniquement pour mission de faire des bénéfices financiers, mais des bénéfices dans plusieurs sens du terme : « bénéfice », c’est faire du bien, quelque chose qui va profiter à tous, et le faire avec les autres. Aujourd’hui de nombreuses entreprises agricoles subissent des pressions très fortes de réduction financière à court terme et au lieu de faire des bénéfices elles font des « maléfices » sans le vouloir forcément, mais des dommages importants. On s’en rend compte quand on vit à la campagne, si on est sensible au vivant, au patrimoine, etc. L’intérêt, c’est de rapprocher du cœur cette production de nourriture et d’impliquer les gens : design participatif, faire avec ; par exemple les jardins partagés, qui sont une petite goutte d’eau, car il faut aller beaucoup plus loin. Les Amap sont aussi une manière de sensibiliser, parce que tous ces paysans qui se retrouvent à plusieurs pour accueillir les gens dans un coin de la grange, c’est aussi une manière de dire : « Regardez, là il y a mes animaux, les paysages » ; et c’est une manière de faire partager les bénéfices (absolument pas financiers) qu’ils produisent. Quand aurons-nous une société civile, puis peut-être des politiques (il ne faut pas trop rêver !) qui seront capables de prendre en compte ces bénéfices qui ne sont pas monnayables, qui sont bien plus importants que cela ? La nature comme designer : je suis passionnée par les travaux de François Julien, qui est spécialiste de la Chine. Il explique que, dans la philosophie traditionnelle chinoise, l’être humain a un rapport d’ajustement à la nature, et cette nature il la considère comme une artiste. L’artiste, son rôle, c’est d’être une sorte de passeur : s’ouvrir par la respiration dans son geste de peindre ou d’écrire, pour laisser passer ce flux que la nature, le vivant lui apportent ; mais la beauté est déjà là dans la réalité, dans la nature, et lui n’a plus qu’à s’ajuster à elle, lui redonner un élan pour la faire partager aux autres. Quand on va designer le paysage en ce sens, on ne va pas mettre des sculptures partout, mais prendre des éléments naturels (lotus, pierre, eau…) et jouer de l’ajustement de la beauté qu’elles ont déjà. La vision dominante de l’être humain dans l’esprit moderne, c’est : « Nous sommes au-dessus du lot, le reste du vivant n’a aucun sens, et seuls, nous, nous pouvons lui donner un sens. » Un linguiste, Benveniste, écrivait dans les années 1960 que nous sommes les seuls êtres doués de capacité symbolique, celle de représenter l’absent ; or on sait bien aujourd’hui que les animaux sont vraiment doués de conscience, de capacité symbolique. Ce sont des êtres vivants aussi. C’est tout cela qu’il faut remettre en cause. Pas opposer l’homme et la nature, c’est-à-dire que nous sommes bien capables de faire avec le vivant sans le détruire. Il faut en prendre conscience. Quand on regarde un certain nombre de paysans, c’est bien ce qu’ils font : au lieu de détruire, les bénéfices, en terme de biodiversité, sont très importants, beaucoup plus que si on laissait tout en friche. Quand on regarde les cultures en terrasses ou l’agriculture en forêt en Indonésie, on se rend bien compte que ces cultures paysannes n’opposaient pas l’homme et la nature mais que l’un allait avec l’autre. Là c’est important de redéfinir la notion de nature, cette sorte d’altérité, et de créer des liens d’ajustement, de réciprocité et pas de domination avec elle. Un intervenant : Le problème, c’est que tu fais des kilomètres pour faire le tour d’une ville : tu as des lotissements qui s’étendent partout. NP : Là encore se loger, se nourrir, habiter, sont des questions très liées. On peut constater (notamment dans les petites communes et les petites villes) ces lotissements qui s’étirent, et très souvent les gens qui habitent ces endroits voient ces habitations comme fonctionnelles : ils viennent là pour avoir la paix, parce que le terrain est un peu moins cher, mais ils sortent très peu. Ils vont peu se promener dans la campagne et ont très peu ce soin de ce qui se passe dans leur milieu. Cette sorte de conquête de l’espace n’en finit pas et tant qu’on avancera comme cela on pensera que la terre, le sol qui nous porte, c’est juste un espace à occuper. Il n’y a plus ce lien existentiel. Il y a des designs d’habitats participatifs qui se mettent en place, il y a d’autres manières de procéder qui se mettent en place, mais qui sont une goutte d’eau par rapport à cette incitation à construire à la conquête de l’espace. Ça, c’est un vrai problème. Un intervenant : Je voudrais revenir sur la nature et le vivant. Il me semble qu’il y a une confusion entre nature, naturalité, et ce qui est vivant. Par exemple dans le bocage il y a beaucoup de vivant, et c’est pourtant quelque chose qui n’est pas du tout naturel. Dans nos pays, si l’homme n’intervenait pas, la nature serait partout la forêt, avec quelques clairières. Dès lors que l’homme intervient pour se nourrir, il s’oppose à la nature et ce n’est plus la naturalité. NP : Il ne peut pas y avoir de confusion entre les deux parce que comme le dit Gilles Clément l’être humain est partout. Connaissez-vous un endroit où il ne soit pas intervenu ? Non. Cette nature ce n’est pas une nature de degré zéro. C’est bien une nature qui a été façonnée, « designée » dans une relation avec des êtres humains. Des êtres humains et des êtres vivants (des animaux). La nature de degré zéro n’existe pas ou ne nous est pas accessible parce que, en tant qu’êtres humains, nous n’avons des rapports qu’ethno-techno-symboliques avec elle. La manière dont nous la percevons nous incite à la travailler, à la façonner. Vous avez bien fait de faire la remarque, parce que selon moi on est sur une planète anthropisée. Un intervenant : Deux remarques : la relation de l’homme à son milieu, c’est la toute-puissance de l’homme (véhiculée surtout par les religions monothéistes) sur la nature. Tout ça c’est gentil, mais c’est pour les bobos. Il y a 7 milliards d’individus à nourrir, bientôt 10, et on nous dit qu’il n’y a que l’agriculture industrielle qui pourra les nourrir. On sait bien que c’est faux. NP : Effectivement, beaucoup de chercheurs s’accordent à dire que les religions monothéistes ont fortement contribué à casser ce lien de continuité entre l’oikos* et le techno-symbolique de l’être humain, et c’est vrai que dans les religions polythéistes on a beaucoup plus ce respect de la nature au sens de l’interrelation entre le vivant et le cosmos ; une relation d’altérité avec cette nature dont on émane mais qui nous dépasse, donc on doit la respecter et il y a des limites à ne pas dépasser. Il y a notamment un biologiste, Pierre Henri Gouyon qui pose beaucoup de questions sur les biotechnologies, les OGM, et qui le dit lui-même : il y a des limites dans le façonnage du vivant à ne pas dépasser, or on les a dépassées, et les religions polythéistes ne les auraient pas dépassées. C’est vraiment le credo de l’être humain parce qu’il est doué de raison, de symboles, de langage et parce qu’il est capable d’inventer des outils beaucoup plus évolués que la pie, la corneille ; eh bien, il s’octroie tous les droits, finalement. C’est un vrai problème. Le deuxième problème est très grand parce qu’on a le sentiment que de nombreux politiques sont hors-sol, c’est-à-dire qu’ils ne font plus le lien entre les mots et les choses. Ils considèrent que seuls les discours qu’ils tiennent vont avoir du sens et une efficacité ; donc on est dans le déni de réalité et on considère que si on enrobe bien le truc, ça suffit à faire passer la pilule. On le voit au quotidien, ça. Derrière les beaux discours on va laisser la réalité s’aggraver. C’est vrai que je n’ai pas de baguette magique et je me dis qu’il n’y a que la société civile qui peut agir là, pousser les politiques. Un exemple tout local : cet été, pour la formation, je discutais avec la chargée de mission pour la « ceinture maraîchère » de l’agglo. Elle me disait : « Ça se bataille, il y a beaucoup de politiques qui ne veulent pas se mettre à dos la Chambre d’agriculture, donc c’est fort probable que cela ne soit pas en bio » et je lui demandais : « Est-ce que vous avez consulté les habitants, ceux qui vont profiter de la nourriture qui sera produite là ? » Non, pas du tout. Je lui ai dit qu’encore une fois les décisions allaient se prendre sans consulter les habitants. Du coup, nos apprenants on fait un super travail pour mener à terme une consultation auprès de quelques habitants. On a eu quelques soucis pour les contacter, mais on a réussi à consulter quand même. On est tellement arrivé à saturation dans la surinformation, sur-communication, qu’on a dépassé le rythme de l’anthropos, du vivant. Dans cette sursaturation de la communication et de l’information, on passe des trucs en boucle mais quand est-ce que, en tant que citoyen, on prend le temps de traiter une information et d’en faire quelque chose, d’agir ? Ça passe, et nous, on passe à autre chose. Cette sursaturation profite aux politiques, qui vont dire sans faire ou faire le contraire de ce qu’ils ont dit, et ils se succèdent et ils font tous ça. Donc c’est à nous citoyens de nous poser, de réfléchir et de construire ensemble parce qu’on n’a que ça. Je ne vois pas d’autres solutions.
[A suivre…] Compte-rendu réalisé par Francis Juchereau et Anne Vuaillat.
Voici la seconde partie du débat de la soirée du 16 décembre 2017 avec Nicole Pignier : « Le lien au vivant dans nos sociétés Agriculture, paysages, design, alimentation ».
Un intervenant : Je voudrais revenir sur l’aspect nature et vivant. Le vivant fonctionne par l’équilibre de ses composants ; quand il y a développement, c’est un développement équilibré. Le vivant que méprise l’homme qui le fait évoluer par palier en sélectionnant un aspect et puis dix ans plus tard un autre aspect. Par exemple : on a sélectionné des blés pour les rendements ; résultat : on se retrouve avec des glutens pas digestes. Et l’homme ne veut pas faire marche arrière.
Nicole Pignier : Je dirai d’abord qu’il y a deux manières de faire, de penser cette évolution : sélectionner et améliorer. Il y a celle qui se fait dans un rapport très étroit d’ajustement avec le milieu, local dans lequel travaille le paysan. Et là je ne peux m’empêcher de penser à Guy et Carole qui sont en Charente limousine, qui font partie de ce réseau Semences paysannes, et qui, depuis des années, patiemment, laissent leur blé, leur avoine, différentes variétés anciennes, évoluer. Là ils vont sélectionner, conserver, échanger avec d’autres paysans dans un respect total du temps qu’il faut à la plante et à la graine pour résister, évoluer. Et puis il y a cette évolution, cette sélection qui se fait en laboratoire et qui, elle, est très intrusive parce qu’elle va traficoter à l’intérieur même du vivant pour le contraindre, le rendre plus fonctionnel sur un point. Elle ne respecte ni le rythme du vivant ni le lien à un milieu donné (à la fois de biodiversité et culturel) à des communautés. Je vais citer Christophe Noisette, parce que suite à mon ouvrage j’ai fait un web documentaire avec beaucoup d’interviews de personnes différentes, des paysans. Christophe Noisette est journaliste spécialiste des OGM, il travaille pour Infogm. Il explique que l’évolution, la sélection dans les semences paysannes, est très respectueuse du lien au milieu local et à une communauté. Toujours en lien avec une communauté culturelle, alors que les sélections et les évolutions liées aux biotechnologies, elles, coupent ce lien pour standardiser, pour uniformiser et elles façonnent le vivant à l’envers du vivant. C’est une violation du vivant. Alors, revenir en arrière ? Dans le premier cas ça ne cause pas de problème parce qu’on est en ajustement avec ce vivant. Dans le deuxième cas ça cause problème et on est dans cette illusion que seul le progrès technologique va nous sauver, mais c’est un problème récursif parce qu’il pose plus de problèmes qu’il n’en résout. Alors évidemment, c’est bon pour la consommation, puisqu’il va falloir mettre sur le marché d’autres espèces dites améliorées qui vont résoudre le problème mais en créer dix nouveaux. Si c’est bon pour la consommation, c’est moins intéressant pour l’agriculteur qui est très dépendant et aliéné par ce système-là et qui n’a plus aucune marge de manœuvre, qui n’est plus du tout designer. Notre rôle à tous en tant que citoyens c’est de penser l’intégration du paysan dans le paysage. Le paysan, celui qui fait avec le vivant. Notre rôle à tous c’est d’arriver à mettre les politiques devant les faits accomplis et que devant nos attentes ils ne puissent exterminer totalement ces volontés paysannes et soient obligés de faire quelque chose.
Une intervenante : Je suis paysanne, militante à la Confédération paysanne. Je pense qu’un des gros freins à tout ce qu’on dit ce soir, c’est peut-être le monde paysan lui-même. En tant que militante de la Confédération paysanne je défends l’agriculture paysanne avant tout, depuis des années, mais je crois que les personnes les moins à même de le comprendre, de l’entendre, ce sont les paysans eux-mêmes. Et je crois que pour les consommateurs, les citoyens que nous sommes, il y a un gros travail travail à faire au niveau des jeunes générations, au niveau des lycées agricoles, parce qu’on est complètement inaudible auprès de ces populations-là. Et après trente ans de combat, je trouve que cela n’évolue pas bien vite, même si j’ai de l’espoir par rapport à la nouvelle génération qui monte. On assiste à un renouvellement de génération avec des jeunes qui ne sont pas issus du milieu paysan et ça c’est plutôt une bonne chose.
NP : Merci à vous parce que ça me fait chaud au cœur qu’il y ait des paysans dans la salle qui aient pris le temps de s’extraire de leurs multiples occupations pour pouvoir venir partager leurs idées et leurs témoignages. Je constate (on ne peut pas caricaturer) qu’il y a une multiplicité de cas. Il y a beaucoup de paysans qu’on a réussi à inférioriser, c’est-à-dire des gens qui ont de multiples savoirs, des savoir-faire, une vraie connaissance de leurs milieux, qui n’est pas une connaissance scientifique, académique. Mais ils ne croient plus du tout en leurs capacités, ils sont déprimés. J’ai un voisin très déprimé. C’est quelqu’un qui est malade, issu de culture paysanne et qui aime beaucoup son milieu, mais qui n’a pas confiance en lui et donc il suit les préconisations des chambres d’agriculture. Il a semé son blé d’hiver comme les autres au mois d’octobre. Il a passé un désherbant dont je ne connais pas le nom mais pendant un mois on ne pouvait pas respirer quand on passait à côté. Je lui ai dit : « Qu’est-ce que vous avez passé ? C’est pas comme d’habitude, on peut à peine respirer. » Il s’est senti honteux et m’a dit : « De toutes façons pour moi c’est bientôt fini. » Il est à la retraite, mais sa femme travaille encore. « Ce n’est pas une agriculture qui me convient, mais on ne peut pas faire autrement. » On s’est mis à parler et je lui ai dit : « Et votre fils, il va reprendre ? – Non, c’est suicidaire de reprendre aujourd’hui. Il n’y a plus que les gros qui résistent, ceux qui polluent tout, qui dévastent tout. » Et il y en a beaucoup des comme ça, des gens écartelés, et c’est tragique, donc je ne les accable pas. Des gens qui ne veulent pas suivre complètement le système et qui sont doublement punis, parce que les voisins ne sont pas très heureux de voir leur manière de procéder ; et ils sont punis aussi parce que ce sont des gens qui aiment leur milieu et qui aimeraient pouvoir le designer avec plus de créativité mais qui, pour de multiples raisons, n’osent pas franchir le pas et suivent les consignes des chambres d’agriculture. Il y a le glyphosate, il y a ceci, cela, mais ça ne leur correspond pas du tout. Ils ne sont pas là pour détruire, mais ils le font, et ils en ont conscience et ne savent pas comment faire. Donc il y a ce cas de figure-là et puis il y a ceux qui, c’est vrai, sont contents d’aller à la conquête de l’espace et de détruire un peu plus. C’est très multiple. Ce que vous dites est vrai : on a fait un grand travail de manipulation pour leur faire perdre leur confiance en eux, alors qu’ils savent faire plein de choses, mais on les standardise et ils vivent cela parfois très très mal, parfois moyennement ; parfois ils en jouissent un peu, d’être les plus gros sur la commune. Il faut faire un travail très important, et moi ce qui m’attriste, c’est de voir des jeunes qui sortent de lycées agricoles et dont le seul rêve est d’arriver avec le bull et de faire sauter les dernières haies de papa. C’est vrai aujourd’hui et ce sera vrai demain. Dans ces lycées agricoles, il y a des enseignants franchement très archaïques qui sont dans cette illusion du progrès technologique ; et puis il y en a d’autres qui sont très malheureux parce que s’ils veulent continuer à enseigner il faut qu’ils enseignent des choses qui ne sont comprises ni par leur public ni par leurs collègues, ni sans doute par leur hiérarchie. C’est une tragédie qu’on vit aujourd’hui, à tous les niveaux. Dans les chambres d’agriculture il y a des gens qui voudraient retrouver un peu de bon sens et qui se trouvent soumis à des pressions. C’est la même chose que dans les formations agricoles et chez les paysans.
Un intervenant : Tout à l’heure vous commenciez par l’alimentation, la nourriture : où est la différence ? Moi j’y vois une différence de quantité et de qualité. Est-ce que la première question ne serait pas celle-là : est-ce que notre société n’est pas dans la quantité plutôt que dans la qualité ?
Un autre intervenant : Je connais quelqu’un qui ne veut pas acheter de poulet fermier. Il préfère acheter un poulet Leclerc : il n’y a pas besoin de mâcher. Il ne veut plus perdre son temps à faire son jardin pour ne rien récolter, et il préfère aller au supermarché et se promener avec sa femme.
NP : Je crois que pour cette question entre quantité et qualité, ce serait chouette que nos paysans qui sont là disent comment ils abordent les choses et comment ils font au quotidien. Julien, Pedro ? C’est quand même eux les héros de la soirée. C’est dommage que dans nos communautés rurales, on ait exterminé l’espèce paysanne.
Julien : Je peux vous raconter ce qui vient de se passer l’année précédente. Je suis paysan-boulanger. J’ai voulu revenir en France d’une manière telle que je me retrouve autonome, dans un rythme proche de la nature. J’ai vite rencontré des gens qui m’ont encadré avec Mille et une semence limousines, avec des variétés anciennes. J’ai fait ma première récolte au mois d’août (14 quintaux à l’hectare) et ça me suffit pour faire du pain et le vendre le mercredi soir aux gens qui viennent à la ferme. Il y a des choses plus difficiles : on est trois couples sur une ferme, ce qui fait qu’on apprend aussi à vivre à plusieurs, c’est pas facile. Ca se passe bien, j’ai réussi à semer deux hectares. On a loué 5 hectares sur 9 ans avec mon collègue qui a cinq vaches et un taureau (il fait la traite à la main) et grâce à une dame qui n’ a pas voulu louer à celui qui avait beaucoup d’hectares. On a essayé de remuer les pouvoirs publics. Je n’ai pas une animosité contre les politiques, je crois qu’on est dans une situation politique qui est à bout de souffle et il faut recréer une constitution et une sixième république. J’espère qu’on va communiquer à la fin pour voir comment s’entraider entre citadins et paysans, parce qu’il va falloir. Cette soirée me fait beaucoup penser à ce documentaire qui est passé sur Arte, Ni dieu ni maître : à un moment donné ils parlent de la CNT (Confédération nationale du travail) où les gens avaient repris en coopérative les entreprises, les terres. C’est ça, il faut reprendre le pouvoir et donc s’entraider. Pourquoi pas faire confiance dans un mouvement politique ?… même si on n’est pas dupe, tentons l’aventure. Nous, on ne veut pas faire du profit avec les graines, avec la nourriture. On veut partager, communiquer, vivre ensemble. On a monté une Amap, on a essayé d’avoir un prêt bancaire, finalement on a eu 30000 euros chacun, même si on n’avait pas de revenu ! On s’est dit : on va construire un four dans la grange, comme ça quand les gens viennent pour les légumes, les fromages, il y a aussi le pain tout chaud, au levain sans additif, avec des variétés anciennes. La nature est bien faite, le patrimoine génétique s’est construit sur des millénaires et grâce à l’Inra et à Semences paysannes, on arrive à faire pousser des variétés anciennes avec un patrimoine génétique qui fait que ça ne tombe jamais malade, donc on ne fait pas de traitement ; on peut désherber avec du sarrazin. Aujourd’hui il y a plein de solutions. Je découvre le métier d’agriculteur. Mon voisin qui a 200 vaches, 300 hectares, me dit : « Ce que vous faites c’est génial ! Nous ce qu’on fait, c’est … » Mais il est à la FNSEA, il est de droite. Il me dit : « Moi je suis de droite, toi de gauche, tu auras tort ! » Au moins c’est clair. On garde le contact, il me prête des outils, il m’appelle « l’artiste ». Il m’a vu labourer. Il dit : « Tu ne laboures pas assez profond et puis il va falloir que tu passes du glyphosate. » Je lui dis : « Non, puisque je laboure… Alors on fait quoi ? – Les deux. – Ah bon, mais tu me disais qu’avec le glyphosate on ne passait plus la charrue, et qu’on allait consommer moins de fioul. » Le sujet est complexe : il s’agit de moins labourer, et de passer du glyphosate pour moins consommer de gasoil ! On va moins consommer de gasoil, mais pourquoi labourer si vous passez du glyphosate ? C’est un peu un dialogue de sourds. Je lui ai dit que la prochaine fois que je vais labourer, c’est dans dix ans. « Ah bon, comment tu vas faire ? – Ben je vais semer après récolte, couvrir le sol. » C’est en ce moment, ils en parlent, ça va bien marcher et sans passer de glyphosate. Je pense que c’est possible. Et j’aimerais qu’on communique entre nous parce que je ne pense pas que l’on soit des glyphosateurs, ce soir. Comment on peut s’entraider ? Parce que produire de la qualité sans produits cela demande de la main d’œuvre. Comment nous, les paysans, on fait pour aider en ville ? A la campagne, le carnet, ou plutôt le barème d’entraide, ça existe à la chambre d’agriculture. Les agriculteurs ont le droit de s’entraider gratuitement, sans se déclarer ; alors allons-y. Tous les lundis, avec six petits exploitants autour de la Bécarie, on s’entraide. Toutes les six semaines il y a six à douze personnes qui viennent m’aider à faire les fagots pour cuire mon pain ou qui m’aident à construire, ou pour Mathieu ou pour Yann, pour les serres. Donc ça marche. Les adhérents de l’Amap nous aident aussi à leur niveau. L’hiver dernier les serres se sont envolées, on a fait appel à des dons.
NP : Et je vais travailler la qualité au lieu de travailler la quantité. Pedro et Raymond pourront aussi aborder cette notion de qualité.
Pedro : Je suis là avec Sophie, ma femme. C’est important parce que je pense que je n’aurais pas pensé ma vie agricole sans Sophie. Je suis né en Normandie dans une terre ultra fertile. Mon père avait une ferme de 100 hectares avec à peu près 45 charolaises. Et sur ces 100 hectares il faisait du blé, colza, lin, maïs. De la polyculture intensive classique. On avait aussi un bâtiment avec 5000 volailles. J’ai travaillé là-dedans, j’ai fait un bac en production animale, un BTS en gestion agricole. Dès que je me suis intéressé à la gestion, je me suis rendu compte qu’il y avait une aberration entre les chiffres qu’on nous annonçait et les résultats qu’on faisait sur la ferme et le temps de travail, parce qu’on nous annonçait que c’était un temps plein à 2500 heures, mais si moi et mon grand-père on ne venait pas donner un coup de main ça ne marchait pas. Donc je commençais à me poser des questions. Je suis parti un an à Angers où j’ai fait une licence professionnelle en production végétale. J’ai travaillé à la chambre d’agriculture de Seine-Maritime, et là j’ai rencontré une technicienne qui m’encadrait et on s’est dit : on pourrait faire du blé et au lieu d’avoir sept traitements, on ne va en faire que deux mais il faut semer différemment. Je me suis retrouvé avec des groupes d’agriculteurs qui commençaient à mettre ça en place et là les chiffres commençaient à être plus cohérents : c’est-à-dire que le temps de travail par rapport à ce que gagnait le type devenait plus cohérent. Et là j’ai commencé à poser des questions à mon père. Et je n’ai pas pu m’installer sur la ferme, parce que l’équilibre économique, technique, et au niveau de la nature n’était pas bon. Donc je suis parti et j’ai eu la chance de rencontrer Sophie. On est partis deux mois en voyage en Inde, en Chine. Au retour on a décidé de quitter la Seine-Maritime et le rôle que la famille m’avait donné : reprendre la ferme. Je me suis dit que j’allais m’installer, mais sûrement pas sur la ferme de mon père. Je voulais m’installer dans mon projet, ma réflexion, mes envies. En 2009 on arrive en Charente et je dois trouver du boulot. Sophie est vétérinaire. Je vais taper aux portes des agriculteurs pour trouver du boulot. Chez un, je lui dit : « Je ne sais pas quand je vais m’en aller mais je vais reprendre des études d’ingénieur et me reformer. » Pourquoi ? parce qu’à un moment il faut rebattre les cartes. Quand vous partez de votre terre, de votre réseau, de tout ce qui vous construit, vous êtes à nu : vous arrivez dans un endroit où vous ne connaissez personne, vous ne connaissez pas le milieu et vous êtes incapable de réfléchir. Clairement, au lycée agricole, on ne m’a pas appris à réfléchir dans un contexte différent. On m’a juste appris à mettre des animaux, des cultures dans des contextes que je maîtrise pour les faire pousser. Là, j’étais complètement perdu. Donc j’ai repris pendant trois ans des études d’ingénieur à Bordeaux et à Clermont-Ferrand et en même temps je travaillais au contrôle laitier de la Charente où j’encadrais des techniciens et j’essayais de mener ma barque comme ça. Il fallait bien que je finance ma formation, c’était la seule solution. Au contrôle laitier pour la chambre d’agriculture, j’avais pour mission de développer le conseil technique chez les éleveurs allaitants (vaches à lait). Comme tout bon commercial, je prends le listing des éleveurs et je les appelle les uns après les autres. Le premier gars que j’appelle, c’est celui à qui j’ai acheté la ferme. C’est un grand monsieur, gentil, qui me reçoit sympathiquement, mais j’ai bien senti qu’il n’avait pas besoin de conseil. Il avait 150 hectares d’un seul tenant, en bio depuis 1998, tout étant autour de la ferme. Il me fait visiter, on discute. Il voulait améliorer ses génisses. Je lui dis : « Non, ne changez rien, votre système est cohérent, il tient la route. » Si, j’aurais pu lui dire de faire des céréales, de l’engraissement sur la ferme, mais son système était équilibré. J’enlève ma casquette de technicien : il avait une habitation à louer. « Le jour où vous voulez vendre la ferme, je l’achète. » Six mois plus tard, il m’annonce qu’il vend : 1 million d’euros. C’était normal (bâtiments, terres, bêtes…). Je lui dis : « Non, ça ne va pas. Sinon je fais du maïs jusqu’au pied de ta maison ou alors on fait de la forêt partout et on loue en chasse privée pour des Parisiens. Je pense que tu n’es pas prêt à la vendre, on verra plus tard ». En 2012, il nous dit : « Je vais vous louer la maison. Si ça se passe bien en tant que locataires, on verra pour la ferme ». En attendant j’ai changé de boulot, je suis devenu responsable de l’agneau baronnet du Limousin. J’avais la responsabilité marketing et communication pour toute la France. J’avais pour mission de faire valoir l’image des mille éleveurs (et de leurs produits) de la région et des cantons limitrophes, dans les grandes surfaces et les boucheries. Pendant trois ans j’ai fait ça. Il fallait que j’aille dans les grandes surfaces négocier de la place pour mettre un gigeot ; les chefs de rayons n’en pouvaient plus parce qu’ils en voient des dizaines comme moi tous les jours. On ne pouvait plus se parler. Chez les bouchers, ben j’ai rencontré des gens qui ne savent pas ce qu’il se passe derrière leur frigo : l’animal, c’est une carcasse qui arrive, la viande ils ne savent pas d’où elle vient, ce qu’elle est. J’ai fait se relier bouchers et agriculteurs pour qu’ils sachent de quoi ils parlent et vendent. Les agriculteurs, je voyais bien qu’ils allaient dans le mur. Il fallait qu’ils évoluent. Vers une alimentation 100 % à l’herbe, vers le bio, mais ils n’étaient pas prêts. En mai 2015, avant de reprendre la ferme, on est partis un an en voyage, en France, en Nouvelle-Zélande, en Bolivie. 7000 kilomètres à pied, ça nous a donné le temps de réfléchir et d’ancrer les valeurs de notre projet en nous. Et c’est là où je vous rejoins : ça a donné du sens à ce qu’on faisait. Dans la marche, on en a besoin. On a un bail de 18 ans sur la ferme, reconductible. Il nous a vendu ses vaches, son matériel. Nous, tout doucement, on est en train de changer le système. Aujourd’hui la ferme c’était 75 limousines en bio, ça vivait bien. Il y avait les subventions qui permettaient de bien vivre. 70 veaux par an, des broutards qui partaient se faire engraisser en Italie, en Israël alors qu’on avait des subventions bio ! Je ne suis pas d’accord si c’est pour vendre un produit qui sort du cycle bio. Donc avec cette conscience citoyenne-là, avec la relation avec l’animal, si c’est pour que les animaux partent se faire engraisser ailleurs, ça n’a pas de sens. Donc avec Sophie on a monté un projet en trois axes pour cette ferme-là. D’abord de la production de viande parce que c’est le sens même, premier, qui permet de nourrir les autres, c’est-à-dire réduire le nombre de vaches, engraisser sur place tous les animaux et qu’avec de l’herbe parce que, aujourd’hui, si on a une remise en cause de nos filières viande c’est aussi parce qu’on a une alimentation pas logique : une vache ou un mouton, ce n’est pas fait pour manger des céréales. Cet engraissement, on ne peut pas le faire avec de la race limousine, parce qu’elle a changé, parce que dans ses gènes aujourd’hui quand le schéma de sélection produit des taureaux pour les diffuser auprès des agriculteurs, qu’est-ce qu’ils font ? Ils récupèrent des taureaux chez des éleveurs dits sélectionneurs qui utilisent déjà beaucoup de céréales dans l’alimentation de leurs vaches. Ces taureaux-là sont mis dans des bâtiments et on les compare sur leur croissance, mais avec une alimentation où il y a 30 % de céréales. Celui qui va faire la meilleure croissance sur les trois mois sera vendu le plus cher. Cela veut dire qu’on oriente tout doucement la race vers une race qui aura besoin de 30 % de céréales. Donc aujourd’hui, la race on ne peut plus l’élever seulement à l’herbe. C’est une aberration parce que notre territoire limousin ne produit pas de céréales et que vous prenez des terres agricoles pour nourrir ces animaux, alors que normalement ces animaux peuvent se nourrir d’eux-mêmes avec de l’herbe. Donc sur ma ferme si je devais acheter 100 tonnes d’aliments à l’extérieur il faudrait intégrer ces 100 tonnes comme surface dédiée à mon exploitation. C’est une aberration totale. Ce qu’on veut aussi, c’est produire de la nature, et pour ça on travaille avec Charente Nature et ProméTerre qui sont sur le Poitou-Charentes et qui vont nous aider à réimplanter des haies (et là j’aimerais rencontrer le monsieur qui s’occupe du keyline parce que si il veut, il y a 150 hectares pour s’amuser). La troisième chose c’est de produire de l’information, de la compétence : je suis en train de refaire des mares, et avec Charente Nature on filme ce travail qui sera montré aux collégiens de 6ème du collège de Confolens. Tout à l’heure, Julien, tu disais qu’il y avait de l’entraide ; nous, 150 hectares, on pense que ce n’est pas normal qu’on soit tout seuls dessus. Ca m’a permis de m’installer, mais la porte est ouverte et si demain on pouvait être dix avec des gens qui vont faire du maraîchage, du petit ruminant pour faire de la production laitière, de l’arboriculture, il y a de la place.
NP : Deux remarques : cette dynamique paysanne, y compris dans notre région, elle est vraiment liée à cette question du lien social. Que ce soit Julien, Pedro, ou d’autres, ils le disent tous : c’est un besoin de partager, de coopérer. C’est vraiment très important, parce que quand on se pose la question de la revitalisation des campagnes, si on n’a qu’internet à nous proposer, c’est un peu léger. Donc ça passe par là, réintégrer les paysans dans le paysage. Par rapport aux enfants, c’est tout à fait vrai qu’on ne changera rien si on ne s’occupe pas d’abord de la sensibilisation des enfants, à quelque niveau que ce soit : parents, grands-parents, voisins, enseignants, etc. Sensibiliser les enfants parce que ce sens qu’on va trouver dans l’acte de se nourrir et de produire, il ne peut que se faire en re-concrétisant l’existence, c’est-à-dire au lieu de regarder une vidéo sur youtube pour voir comment faire de la permaculture, je vais peut-être déjà aller voir des gens qui font leur jardin, aller sentir, toucher la terre. Ca passe par le corps dans toute sa globalité, le corps en lien avec le vivant. Ce qui me semble très important, c’est de ramener un rythme vivant. On s’en rend compte, les agriculteurs en premier, on les enferme dans des rythmes qui sont complètement coupés du vivant, hors-sol, qui en font des esclaves.
Raymond : Je ne suis pas une élite, je me suis installé à 52 ans sur une reconversion professionnelle et là je viens d’entendre des parcours où vous êtes allés plus vite que moi. Je suis admiratif de voir la dynamique des jeunes aujourd’hui. C’est pour mettre un trait positif sur ces choses lourdes qu’on a entendues : elles existent, elles vont de pire en pire. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui s’installent et pas beaucoup issus de familles agricoles. J’ai eu la chance de faire un bref passage dans une école agricole, le temps de me prendre la tête avec les gars de l’entretien qui venaient désherber sous les fenêtres des salles de cours. Ca m’a valu une convocation chez le directeur du lycée des Vaseix. Il n’était pas content. Je n’ai pas fait de reprise d’activité familiale, mais je me suis installé sur une partie (deux, trois hectares) qui appartenait à mon arrière grand-père. Par rapport à la CNT à Limoges, Julien, c’est moi qui ai fourni les paniers au groupe de Limoges qui est venu me voir un soir de débat au Lido. Ca fait quatre-cinq ans et ça marche bien. C’est pas toujours évident, on a des problèmes de timing. J’ai réussi à intégrer un producteur de fromage de chèvre, tout le monde n’en veut pas. Sur Pageas, il y a deux producteurs bio qui se sont installés, des jeunes, des ingénieurs, des gens qui n’ont rien à voir avec le monde agricole. L’année de mon installation j’ai eu quelques soucis : je suis voisin d’un type qui a des châtaigniers greffés et qui n’est pas agriculteur, il est marchand d’instruments de musique, il a hérité de ça. C’est une coopérative qui s’occupe de tout. Il a suivi les conseils des techniciens. On lui a proposé un certain prix pour ses châtaignes si elles étaient traitées, et un autre moins cher si elles ne l’étaient pas ! Il n’avait pas compris qu’il pouvait les vendre en bio. Donc traitements héliportés (c’est pourtant interdit en France). Ils m’ont pollué une parcelle. J’ai essayé la conciliation (le lien social!). Je me suis rapproché d’une équipe à Alassac qui lutte contre les pesticides (Alassac ONGF). J’ai réussi avec toute une dynamique, avec le PNR qui s’en est mêlé, à aboutir au fait qu’il n’y ait plus de dérogation pour pulvériser les châtaigniers. Je fais des légumes, un peu de jus de pomme, je fournis deux biocoop en jus de pommes. L’essentiel de la production de légumes, c’est pour moi et l’Amap. Et puis quand il n’y a pas assez, on se débrouille avec les collègues. Il y a moyen de faire des choses. Accessoirement je fabrique des outils, je développe des astuces. En fait je suis un opportuniste.
NP : Mickaël est spécialiste de la permaculture et suit la formation « design des milieux anthropisés ». Il est en stage dans une ferme où le paysage nourricier est au cœur de son stage.
Mickaël : « Spécialiste », c’est un grand mot. J’essaie d’apprendre. Le keyline design est né un peu avant les années 1970. C’est une méthode pour irriguer les parcelles de façon homogène, sans système d’irrigation. C’est le travail du sol qui va permettre d’envoyer l’eau des creux vers les crêtes, et donc ça passe par une connaissance du terrain assez approfondie qui permet d’engager des travaux agricoles pour favoriser cette irrigation des sols. Franck Chevalier, qui vient de s’installer à Ségur-le-Château, nous dit que si le paysage est façonné – designé- pour permettre des productions agricoles. C’est plus facile d’obtenir des récoltes, si on aménage correctement. Notre milieu agricole sera d’autant plus productif.
NP : J’ajouterais (et tu me dis si je me trompe) que c’est designer ce paysage en le respectant totalement dans ses potentialités et en faisant tout pour accueillir le vivant, et non pas pour en avoir la maîtrise. C’est pour lui donner la possibilité de grandir, en fait, de nous surprendre.
Mickaël : Effectivement, l’eau est à la base de la vie. Quand on a des parcelles agricoles qui se désèchent, encourager les dynamiques du vivant c’est plus compliqué. C’est en ce sens-là que dans l’aménagement, si on veut aller vers un milieu qui soit de plus en plus vivant, on va favoriser la circulation de l’eau vers ces endroits pas très vivants. Par ce travail on va aller vers plus de vie. C’est l’objet du keyline.
NP : Le projet à Ségur, c’est vraiment de la polyculture, alors que c’était de la monoculture de maïs. C’est le projet de réintroduire des châtaigniers de variétés anciennes. Tu peux dire un mot là-dessus, puisque tu as assisté à ces journées de design où une association avec Hervé Covès, ingénieur agronome, a planché sur ce terrain : comment l’imaginer, imaginer la vie demain en créant du lien social, le droit de se promener, de l’écouter, de le regarder et de produire pour se nourrir.
Mickaël : A Ségur on travaille en groupe, on fait du design participatif, parce qu’on croit que c’est comme ça que les choses peuvent aller vers plus d’abondance. Le travail qu’on essaie de mettre en place se base sur le principe des successions écologiques. On s’interroge sur la manière de passer de l’espace prairial à des modèles agricoles adaptés à nos conditions : la forêt. Plutôt que de se battre contre cette dynamique naturelle du vivant, on conçoit notre design à partir de ce constat, puisqu’ici la nature tend vers la forêt. Donc comment passer de l’espace prairial à des systèmes arboricoles en sylviculture, des cultures multi-étagées ? On met en place des stratégies, il n’y a pas de solutions miracles, on s’appuie sur les caractères variables des situations. Sur 13 hectares, les situations ne sont pas les mêmes partout. Ce design nous amène à créer une trame agroforestière, avec des cultures multi-étagées et dans laquelle diverses cultures s’insèrent. Le temps que les châtaigniers soient matures, d’autres choses vont pouvoir venir à leur pied. Les quinze premières années il peut y avoir des pommiers, des petits fruits, du maraîchage. C’est une agriculture en mouvement. En comprenant comment la nature évolue, on peut insérer des activités agricoles dans une trame en mouvement.
NP : Cette question du sens, elle est là. C’est avant tout être à l’écoute du mouvement du vivant. Cette dynamique à partir de laquelle on va fonder son processus créatif au lieu de faire l’inverse.
Un intervenant : Peut-on dire que ce lien social entre le designer-producteur et le consommateur-citoyen, c’est la transmission de la connaissance et de la qualité ? Parce qu’en fait on consomme, ou on s’alimente, mais cette qualité on ne la connaît pas, on ne sait pas la définir. Qui peut nous l’apprendre ? Ce sont les producteurs designers.
NP : Oui, je crois beaucoup à cette importance du geste. La qualité on peut y croire à partir des notations sur les emballages, mais c’est surtout quand on voit les personnes œuvrer, créer, leur geste corporel avec le sens qu’il a, son ancrage dans le vivant, en lien avec l’oikos, avec la terre. Tant qu’on coupera ce lien entre les citoyens-consommateurs et le paysan-designer on passera à côté d’une réelle qualité. Un intervenant : Juste une petite expérience. Certaines personnes disent : « Le bio ce n’est pas sûr que ce soit meilleur marché ». J’ai fait l’expérience en achetant un poulet de supermarché et un poulet fermier. Je me suis amusé à faire le rapport coût ramené au kilo de viande consommé. Même si le poulet fermier, je l’ai payé plus cher, au kilo de viande consommé, il me revient nettement moins cher. C’est pareil pour d’autres aliments bio par rapport à l’industriel.
Un intervenant : Merci pour cette soirée assez exceptionnelle. C’est ce caractère que je voudrais mettre en relief. Au cercle Gramsci on est habitué, depuis plus de trente ans, a parler politique mais d’une manière plus classique, plus académique, pas au sens de l’université, mais de la politique qui se fait. Ce soir j’ai l’impression qu’on a fait de la politique autrement, à savoir qu’il y a quelque chose qui est en train de naître et peut-être qu’il y aura une grande vague, un tsunami. C’est ce mouvement dont on parle ce soir, très concret, qui part d’en bas et d’endroits très distincts, ceux qui reprennent des exploitations agricoles. On a un professeur d’université, des associations, avec des citadins, des ruraux, la question alimentaire, on parle de l’international, on a entendu des paroles africaines, on a l’impression qu’il y a quelque chose en mouvement. Je ne voudrais pas partager cette impression de désespoir reflétée par les statistiques des suicides de paysans, mais au contraire dire qu’il y a de la vie et qu’une nouvelle génération, une nouvelle manière de prendre sa vie est là ; et puis on parle beaucoup de citoyen. Moi je dirais c’est une manière de dire parce qu’on n’a peut-être pas d’autres mots, aujourd’hui, on fait des choses collectivement, mais en même temps en tant qu’individu. Je pense que cette soirée, en tous les cas pour moi, annonce quelque chose, déjà amené par des gens comme Dujardin. Je crois qu’en Limousin on est les derniers, mais on est les premiers.
* Un oikos — du mot grec ancien signifiant « maison », « patrimoine » — est l’ensemble de biens et d’hommes rattachés à un même lieu d’habitation et de production, une « maisonnée ».
Notes :
1/ Editions Connaissances et savoirs, 2017.
2/ « anthropisé » : qui est modifié par la présence humaine (Wikipedia, 2017).
3/Permaculture (« agriculture permanente ») : modèle d’agriculture naturelle théorisé dans les années 1970. C’est au sens large une « culture de la permanence », les aspects sociaux faisant partie d’un système durable. Ainsi, la permaculture forme des individus à une éthique et à un ensemble de principes et d’objectifs permettant de concevoir et de créer (design permaculturel) une société plus autonome, durable et résiliente, donc moins dépendante des systèmes industriels de production et de distribution.
4/Gilles Clément a animé un débat au cercle Gramsci le 23 juin 2012 sur le thème de « L’alternative ambiante ».
5/ Il existe deux Ecoles du jardin planétaire qui fonctionnent comme des universités populaires, une à Viry Chatillon (Essonne) créée en 2010, l’autre à la Réunion (2014). La troisième, à Limoges (2017), est la seule offrant également un cursus de formation universitaire. Le Jardin Planétaire est un concept destiné à envisager de façon conjointe et enchevêtrée : la diversité des êtres sur la planète ; le rôle gestionnaire de l’homme face à cette diversité. Le concept de Jardin Planétaire est forgé à partir d’un triple constat : la finitude écologique ; le brassage ; la couverture anthropique planétaire (site de Gilles Clément).
6/Victor Papanek est un designer austro-américain (1923-1998). Défenseur d’un design responsable d’un point de vue écologique et social, il désapprouve les produits industriels qu’il juge peu sûrs, ostentatoires, mal adaptés et souvent inutiles (Wikipedia).
7/La conception de Keyline est une technique pour maximiser l’utilisation bénéfique des ressources en eau d’un terrain. Le Keyline se réfère à une caractéristique topographique spécifique liée à l’écoulement de l’eau. Au-delà de cela, Keyline peut être considérée comme une collection de principes, de techniques et de systèmes de conception pour le développement des paysages ruraux et urbains (Wikipedia).
8/L’écoblanchiment (ou verdissage) aussi nommé greenwashing, est une expression désignant un procédé de marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation (entreprise, administration publique nationale ou territoriale, etc.) dans le but de se donner une image écologique responsable (Wikipedia 2017).
9/Gérard Ducerf : ancien paysan, botaniste, auteur de L’Encyclopédie des plantes bio-indicatrices, et co-auteur de Récolter les jeunes pousses des plantes sauvages comestibles.
10/ Smart : connecté et techno-« intelligent ».
11/Le blog Histoire globale fait remonter l’une des premières utilisation du mot « mondialisation » à l’année 1904. Pierre de Coubertin utilisa ce terme dans une tribune du Figaro du 13 décembre, afin d’alerter sur le déclin de la puissance française dans le domaine des armes et dans celui de la fortune, et d’appeler à un sursaut national dans le domaine des idées. 12/ Esthésie : du mot grec signifiant « sensation » : percevoir par les sens, sensibilité.