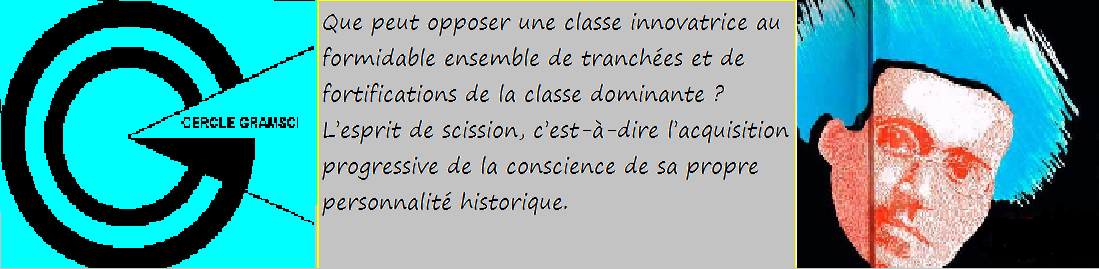le mardi 15 septembre 2009 « Inculture 1 » à Limoges à 19h
et le samedi 19 septembre 2009 « Incultures 2« à Cussac :
« Et si on empêchait les riches de s’instruire plus vite que les pauvres… » ou une autre histoire de l’éducation»
de Franck Lepage
Document de présentation
Compte rendu réalisé à partir de l’enregistrement audio de la soirée, et de larges extraits du livre de Franck Lepage. *
Le personnage entre en scène. Il est vêtu en jardinier du dimanche : chemise hawaïenne à manches courtes, short-bermuda, bottes en caoutchouc, chapeau de paille. Il tient un poireau dans une main et un arrosoir dans l’autre.
Sur la culture
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ceci est un poireau. Alors, se pose tout de suite une question : est-ce un objet de culture ? (montrant le poireau) Vous allez me répondre : » Oui – oui : de culture des poireaux ! » Ce n’est pas la question que je vous pose. Si vous demandez à quelqu’un si ceci est un objet de Culture, il vous répond : » Ah non – non, pas du tout, cela n’a rien à voir ! » Parce que nous avons quelque chose qui s’appelle La Culture aujourd’hui.
J’habite en Bretagne et je suis dans la culture des poireaux. Avant, j’habitais Paris et j’étais dans la Culture tout court. La Culture avec un grand Cul. J’habitais Paris, et pour être précis j’étais dans la culture des pauvres, maintenant dans celle des poireaux, et je connais beaucoup plus de succès dans la culture des poireaux que dans celle des pauvres. J’ai considéré qu’il y avait assez de pauvres comme cela et que ça n’était plus la peine de les cultiver. J’ai compris que la culture, ça sert à reproduire les pauvres, pas à les supprimer.
On dit aussi que la culture sert à reproduire les rapports sociaux. Moi j’en eu ai marre de les reproduire. Il m’est arrivé cette chose terrible : j’ai arrêté de croire à la Culture. Je ne souhaite ça à personne. Vraiment, c’est une expérience terrible ! Et c’est l’histoire que je vais vous raconter.
Je faisais ça dans les banlieues (c’est là qu’ils sont souvent, les pauvres) et donc, je leur balançais des charrettes d’engrais culturel, essentiellement sous forme d’art contemporain et de » création « . Il y a beaucoup de fumier dans l’art contemporain. L’idée, c’est que les pauvres allaient pousser et rattraper les riches : l’idée de » l’ascension sociale » par la culture.
Détendez-vous, cela n’a pas commencé. Quand le spectacle commencera je vous le dirai. En fait il y une très longue introduction d’environ une heure et demie et un tout petit spectacle de rien du tout au bout. Si vous ne voulez voir que le spectacle, vous pouvez aller fumer au bar et revenir dans une heure et demie.
Sur la durée
Ca va durer environ deux heures, ce qui est la durée d’un spectacle de théâtre. Quand vous êtes dans un spectacle de deux heures, c’est que vous êtes au théâtre. Si vous êtes dans un spectacle de cinq heures, huit heures ou plus, alors ce n’est plus du théâtre : c’est de la Culture. Ce n’est pas la même chose. C’est même le contraire. Le théâtre, ça consiste à faire semblant, à faire » comme si « . La culture consiste à faire » pour de vrai « .
Je vais vous donner un ou deux exemples. Il y a un endroit qui s’appelle Avignon, où tous les cultivateurs se réunissent une fois par an. Il y a deux ans de ça, il y a eu un petit scandale qui a agité tout Avignon. Un Belge (un Belge de droite) qui s’appelle Yann Fabre, avait monté un spectacle qui n’était pas du théâtre. C’était un spectacle culturel et à un moment dans le spectacle, ses acteurs faisaient pipi pour de vrai, au milieu de la cour d’honneur du Palais des Papes. Alors, ça, c’est de la Culture. C’est-à-dire que ça mérite une subvention colossale du Ministère de la Culture parce que c’est une » vraie prise de risque artistique « . Il y a un » ourage de l’artiste » que n’ont pas les gens de théâtre. Les gens de théâtre font semblant. Théâtralement, d’ailleurs, ça n’aurait aucun intérêt ! Si je voulais vous faire comprendre, théâtralement, que je fais pipi, je me tournerais comme ça, je ferais semblant. Je ne la sortirais pas ! Puis je ferais le geste de me secouer, et vous auriez tous compris. Mais je ne ferais pas vraiment pipi, là, par terre. Alors que si j’urinais vraiment, ça serait de la Culture. Et là, je pourrais demander de grosses subventions au Ministère de la Culture.
Vous allez me dire : » Ca ne sert à rien ! « . Si, bien sûr : la culture est une formidable démonstration politique de quelque chose. Cela manifeste de la liberté d’expression. Mais une liberté d’expression facile, pas dangereuse, à bon compte. Ca manifeste, en fait, de la démocratie. Ca fait croire qu’on est en démocratie. Comprenez bien que si un type peut faire pipi par terre et que c’est subventionné par un ministère, c’est qu’on est en démocratie. Un pays totalitaire n’encouragerait pas cela !
En fait le capitalisme a compris l’intérêt qu’il y avait à récupérer les méthodes totalitaires, et notamment créer une culture officielle, contrôlée, qui consiste à nous faire croire à la démocratie, sans avoir besoin de la pratiquer. Cela s’appelle la Culture.
Si, par exemple, au milieu de la cour d’honneur du Palais des Papes, vous voulez déclamer que l’office public des HLM du Vaucluse a une politique d’attribution des logements qui fabrique de véritables ghettos, alors, vous n’auriez pas de subvention du Ministère de la Culture : ça ne serait pas considéré comme de la liberté d’expression. Alors que faire pipi, oui.
Quand et comment tout cela a-t-il a commencé ? C’est de cela dont on va parler quand ce spectacle aura décidé de commencer.
Jean Vilar, pour ceux qui connaissent – et on ne connaît que lui – s’appelait un » animateur » de théâtre, pas un « créateur « . Le pouvoir a compris à un moment, dans le tournant des années 1960, qu’il y avait un formidable intérêt à souffler à l’oreille de ces gens-là qu’ils étaient beaucoup plus que des animateurs de théâtre : qu’ils étaient des » cré-a-teurs « .
C’est formidable, parce que la création, c’est un mot du lexique religieux. Il n’y a pas de création en biologie. Vous ne pouvez pas critiquer une création. Vous pouvez critiquer du théâtre, parce que c’est fait pour ça. Vous pouvez critiquer un acte esthétique. Vous pouvez dire : » C’est moche « , » C’est beau « , » C’est bien joué « , » C’est mal joué « . Si c’est une » création « , vous ne pouvez plus rien dire, sinon, vous êtes un fasciste. On ne critique pas une création. Alors, c’est extraordinaire : le pouvoir a réussi à mettre quelque chose hors-critique ! C’est du sacré. L’art, la culture, sont devenus un objet sacré. Mais si c’est hors-critique, ce n’est plus de la démocratie, vous comprenez, c’est du totalitarisme capitaliste.
Pour vous donner encore un exemple de la différence entre la création et le théâtre, vous avez un » créateur « , dans les années 1980, qui, dans son acte créateur, a exigé pour sa création d’avoir un plateau entièrement recouvert de marbre. Mais pas du marbre de chez Bricorama : du marbre qu’on faisait venir d’Italie, un marbre rare, avec une couleur très particulière. Il voulait du vrai marbre, évidemment : c’était un créateur. Et les techniciens du spectacle, les décorateurs (ce sont des gens qui croient encore que c’est du théâtre, ils ont complètement raté les années 1980 ! Ils sont bêtes, ils sont syndiqués, vous voyez le truc ! Ils s’imaginent encore avoir un métier ! A notre époque, on a une » com-pé-ten-ce « , on s’en fiche d’avoir un métier) donc, les décorateurs sont allés voir ce créateur en lui disant : » N’achetez pas de marbre, ça coûte trop cher. Nous, c’est notre métier, on va vous peindre au sol un effet marbre plus vrai que du vrai ! Les gens vont jurer que c’est du marbre. » Alors le type a piqué une colère. Il a appelé le ministre, dont je ne vous dis pas le nom, mais il est facile à deviner (Jablablack Lanblanblang) en lui disant : » On veut me faire faire du faux ! » N’importe quel ministre du théâtre normalement constitué aurait dit : » Ben oui, mon vieux, c’est du théâtre, calmez-vous. Où est le problème ? » Mais pas du tout : le ministre a piqué une colère épouvantable, a appelé le syndicat des décorateurs, et le gars a eu son marbre. Ils sont allés le chercher en Italie, l’ont ramené. Ce sont des grandes plaques de marbre, alors il a fallu péter les portes d’un monument historique, mais ça tombe bien : c’est le même ministère qui autorise et qui interdit. Donc ils ont fait entrer les plaques de marbre, on a installé le marbre, et le gars a allumé les éclairages. Et il a piqué une deuxième colère : » Mais ? Ca brille ! » – » Euh… Oui : c’est du marbre « .
Vous avez deviné comment ça s’est fini : les décorateurs ont peint du faux marbre sur le vrai marbre. Ca a coûté dans les deux millions, mais quand on crée, on ne compte pas. C’est pas comme Vilar, qui économisait l’électricité : encore une preuve que ça n’était pas un créateur !
Sur la nature du spectacle
Tout ce que je vais dire, à partir de maintenant, est un tissu de contrevérités. Ceci doit être absolument clair entre nous. Vous prenez vos responsabilités : je ne dirai que des mensonges à partir du moment où cela commencera.
Qu’est-ce que vous allez voir ce soir ? Ce n’est pas de la Culture, on est d’accord. Ce n’est pas du théâtre public. Si c’était du théâtre public (on dit aussi : théâtre subventionné) ça serait beaucoup plus grand, d’abord. Moi, j’aurais cent, deux cents projecteurs pour moi tout seul, et on me ferait apparaître dans une lumière bleue. Une lumière très, très dramatique, telle que même si je récitais du Raffarin, vous iriez croire que c’est du Sophocle.
Spectacle
Tout cela a commencé par un coup de téléphone à une vieille demoiselle, Mademoiselle Christiane Faure, 94 ans. J’avais trouvé son nom parce que le Ministère de la Jeunesse et des Sports m’avait demandé de faire un travail sur une notion en train de disparaître : » l’éducation populaire « . Je m’étais mis en tête de retrouver quelques grands anciens, notamment Mademoiselle Faure, parce qu’elle avait joué un rôle important en 1944.
J’y suis allé. J’ai sonné. La porte s’est ouverte. Et là, Mesdames, Messieurs, j’ai vu une vieille dame. Mais vieille ! Une espèce de mélange de Carmen Cru et de Pauline Carton, qui m’a regardé par en dessous. Elle a accepté qu’on se parle, dans le cadre d’une conversation face-à-face, une seule fois. Elle m’a prévenu qu’il n’y aurait pas de deuxième jour. Et donc, ce que je vous raconte là, Mesdames, Messieurs, c’est ce qu’il me reste de cette journée incroyable. C’est ce que ma mémoire a enregistré. En fait, ça a duré deux jours parce que, le premier jour, je n’ai pas pu lui poser une seule question. C’est elle qui m’a cuisiné. Mais cuisiné, comme jamais on ne m’avait cuisiné ! Elle a tout – voulu – savoir – sur moi !
Il faut que je vous dise qu’à cette époque, j’étais prophète. Prophète salarié, prophète officiel. Ca ne s’appelait pas comme ça sur ma fiche de paye, ils ne sont pas idiots non plus ! Ca s’appelait » Directeur, chargé du développement culturel « . Moi, j’avais fait rajouter sur ma carte » Directeur, chargé du développement culturel, de la communication, des actions de prospective et de formation « . Donc, prophète ! Je travaillais à la Fédération nationale laïque pluraliste co-gestionnaire et démocratique de la jeunesse sociale solidaire civique culturelle et citoyenne de France qu’on appelle, en raccourci, la FNLPCDJSSCCFF. Mon travail de prophète consistait à dire la vérité. C’est-à-dire à aller chercher la vérité, la vérité officielle, dans les cercles du pouvoir, et puis à venir la » délivrer » (je ne sais pas comment dire) à ce qu’on appelle » la base » (on dit aussi » le terrain « ). Mon bureau était dans une grande tour en ivoire. Et eux, ils étaient à » la base « , sur » le terrain « . Eux, ce sont des types qui me disaient toute l’année : » Tu comprends, Frank, nous, on est les pieds dans la boue ! Nous, on est les mains dans le cambouis ! » Je vous rassure : ils sont dans de petits centres sociaux très propres avec des moquettes. Ce n’est pas la question. Mais voilà : ils parlent comme ça d’eux-mêmes.
Et le pouvoir m’expliquait les mots qu’il souhaitait que ces gens-là utilisent dorénavant pour désigner la réalité sociale, s’ils voulaient avoir en échange l’argent du pouvoir : la subvention. Je venais donc donner les mots-clefs de la subvention. Quand les agents sociaux (c’est-à-dire vous) acceptez d’utiliser ces mots-là, vous avez l’argent. Vous avez le droit de ne pas accepter, mais bon, vous faites comme vous voulez, hein ! Vous n’aurez pas d’argent.
Vous avez peut-être remarqué que le pouvoir fait un travail considérable sur les mots. Je ne sais pas si cela vous a frappés ? Il y a des mots qui disparaissent et il y a des mots qui apparaissent. Vous avez peut-être lu George Orwell, 1984. Le ministère qui fait la guerre, s’appelle » ministère de la paix « , celui qui gère la pénurie s’appelle » ministère de l’abondance » etc. Chez nous il y avait un Ministère du travail qui défendait le droit du travail ; puis, c’est devenu un ministère » du travail et de l’emploi « , avec deux directions dont une défendait le droit du travail et l’autre l’attaquait (au nom de l’emploi : n’importe quel emploi) ; aujourd’hui, vous n’avez plus qu’un ministère » de l’emploi et de la solidarité » dont le but est de démolir le droit du travail. Les linguistes expliquent cela très bien. Ils expliquent que les mots, c’est ce qui permet de penser. Non pas : » Je pense la réalité sociale, puis je fabrique des mots « , ça ne marche pas comme ça ; c’est plutôt : » Il y a des mots, et avec ces mots, je peux penser la réalité sociale « . Donc, si on m’enlève des mots et si on m’en met d’autres à la place, je ne vais pas la penser de la même manière, la réalité sociale.
Je vais prendre un exemple, parce que je vous sens perplexes. Ceux d’entre vous qui ont connu la guerre de 1968 savent qu’à cette époque-là, les pauvres, on les appelait des » exploités « . Je jure aux plus jeunes dans la salle que c’est vrai ! Ca ne nous posait pas de problème ! On parlait d’eux comme ça couramment ! Quand on était éducateur social dans les quartiers, on parlait des » exploités « . Vous comprenez bien que c’est un mot très embêtant pour le pouvoir. Parce que c’est un mot qui vous permet de penser la situation de la personne, non pas comme un état, mais comme le résultat d’un processus qui s’appelle » l’exploitation « . Si ce type-là est exploité, c’est qu’il y a un exploiteur quelque part.
Le pouvoir nous a fait comprendre que ça serait bien dorénavant d’appeler ces gens-là des » défavorisés « . Et regardez bien, c’est très amusant : c’est le même type, dans la même situation, mais dans un cas il a été exploité par quelqu’un, dans l’autre il n’a pas eu de chance. Qu’est-ce que vous voulez qu’on y fasse ? On ne va pas aller faire chier le patronat parce que ce con n’a pas de pot, quoi ! » Défavorisé « , c’est un état. Il n’y a pas de défavoriseur. C’est comme » exclus » : il n’y a pas d’exclueur. Exclus, c’est un état : le type, il est né comme ça ! Je m’en fous, moi : je suis inclus. Je m’en tape, de lui. Lui, il est né exclus : qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse ?
Evidemment, vous comprenez bien que, si en tant que travailleur social, vous pensez le gars comme un type qui a été exploité ou comme un type qui n’a pas eu de bol, vous ne travaillez pas de la même manière votre intervention sociale. Et si vous acceptez de penser la réalité sociale avec ces yeux-là, alors le pouvoir vous donne de l’argent. Voilà, c’est très simple.
Maintenant, libre à vous de continuer à faire des demandes de subvention : » Bonjour, je voudrais des sous pour m’occuper des aliénés de mon quartier. » Vous pouvez essayer, hein ! » Il y a une bande d’exploités là-bas, je voudrais des sous. » Vous me direz combien vous avez gagné.
Donc, moi, je faisais ça. Je faisais un métier utile. Et puis, surtout, j’y croyais. Et c’est très agréable, d’y croire ! Nager dans le sens des idées dominantes, c’est délicieux ! Je prenais des bains de médiation culturelle, je me shootais au diagnostic partagé, je me défonçais à la préservation du lien social, à tous ces » concepts opérationnels » qui empêchent de penser comme disait Marcuse. Toujours pour ceux qui ont connu la guerre de 1968, il y avait un philosophe à l’époque, Herbert Marcuse, qui nous avait prévenus. Il avait compris le truc, il avait dit : » Attention, Mesdames et Messieurs, nous sommes en train de vivre dans le monde – ça touchait le monde entier en 1968 : le Mexique, les Etats-Unis… – nous sommes en train de vivre la toute dernière critique efficace du capitalisme ! » Après, Il y aura encore des critiques, mais elles seront inefficaces parce qu’il est en train de s’opérer une révolution dans l’ordre des langages, qui fait qu’on nous enlève tous les mots qui nous servent à nommer négativement le capitalisme, comme » exploitation » et on nous met à la place des mots qui le nomment positivement, comme » libéralisme « , » développement » (il y en a même qui voudraient qu’il soit durable ! ) Marcuse appelait ça des concepts » opérationnels « , par rapport à concepts tout court. Un concept, c’est un truc qui sert à penser une réalité. Un concept opérationnel, ça sert à agir. Dans le sens dans lequel le pouvoir souhaite que vous agissiez.
» L’insertion » : voilà un concept opérationnel très chouette ! Vous savez comment on fait partie d’une société ? Quand on a la capacité de la contester. Il n’y a pas d’autre moyen. Ca s’appelle l’intégration. Le mot a été dévoyé, mais peu importe. Pour faire partie d’une société, c’est 1968. Regardez, je vais m’intégrer :
(Il fait mine d’écarter un groupe avec les bras pour prendre bruyamment sa place)
» Poussez-vous, je ne suis pas d’accord ! » Lààà, voilà ! Vous faites partie de cette société ! L’insertion, c’est le contraire. L’insertion :
(Il fait mine de se faufiler le plus discrètement possible dans une ronde)
Il y a un nom pour ça. Ce sont les énoncés performatifs. C’est pire que le concept opérationnel. Ca veut dire que c’est le mot qui fait exister la chose. Ca veut dire que si vous acceptez d’utiliser ce mot-là, » l’insertion « , c’est vous qui faites exister l’insertion. L’insertion, cela veut dire que vous acceptez qu’il n’y ait pas de place pour tout le monde. Bachelard disait : » Un mot, c’est une théorie « . Si vous acceptez de penser en termes d’insertion, vous affirmez qu’il n’y a pas de place pour tout le monde et donc c’est vous qui fabriquez l’insertion ! C’est génial ! extraordinaire !
Donc, j’étais là-dedans à fond, et puis un jour, l’accident, le dérapage. J’étais dans un colloque, coincé entre un maire et un représentant de la région. Est-ce que j’avais abusé du kir royal ? – il y a toujours du blanc-cassis, dans les colloques. C’était un colloque sur la décentralisation. On a trouvé un truc super : on a mis toutes les collectivités locales en concurrence les unes contre les autres ; ça s’appelle la décentralisation. C’est bien de dé-cen-tra-li-ser, ça sonne bien ! J’étais donc dans un colloque sur la décentralisation et le développement local. Et j’ai dû balancer un truc, avec mon kir, du genre :
» Monsieur le maire, Monsieur le conseiller général, Mesdames, Messieurs, au fond il serait temps de se demander si la décentralisation est vraiment un progrès pour la démocratie. »
(Il a l’air effrayé de ce qu’il vient de dire)
Et bien, Mesdames, Messieurs, il y a eu un blanc, le temps qu’ils comprennent, et puis ils ont ri et ils ont applaudi. Et le maire est venu me voir à la fin, avec son kir, il m’a dit : » J’ai beaucoup apprécié votre intervention ! Au fond, il serait temps de se demander si la décentralisation est vraiment un progrès pour la démocratie ! » (Il avale son kir) Sluurp !
Ca m’a scié, ce truc-là. Alors, j’ai recommencé. J’ai voulu vérifier, à quelques jours de là dans un colloque sur » Développement culturel et développement local « . Cette fois-ci, je n’ai pas bu de kir, j’ai bien regardé le maire, j’ai bien regardé le monsieur du Conseil régional. Et j’ai dit :
» Monsieur le maire, Monsieur le conseiller, Mesdames, Messieurs, au fond il serait temps de se demander si le développement culturel, ça développe quoi que ce soit ! »
(Il regarde attentivement les réactions autour de lui)
Et bien, Mesdames, Messieurs, il y a eu un blanc, ils ont ri et ils ont applaudi. Et le maire est venu me voir à la fin, avec son kir royal et il m’a dit : » J’ai beaucoup apprécié votre intervention ! Au fond, il serait temps de se demander si le développement culturel, ça développe quoi que ce soit ! » Sluurp !
Je m’en suis fait une spécialité. Je suis devenu menteur professionnel. Avec quelques autres, on s’est mis à organiser des colloques de menteurs : des colloques où l’on ne disait plus que des contrevérités. J’avais un succès fou ! On me faisait venir de très loin, on me disait : » Monsieur Lepage, on veut absolument votre participation à la tribune. Nous avons un colloque sur » Les acteurs de l’éducation partagée » Moi, je leur disais : » Stop. Attendez. Vous savez que je ne dis que des contrevérités ? » » Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui ! C’est exac-te-ment ce qu’on veut ! Ca met de l’animation dans le colloque ! »
Mademoiselle FAURE
Elle m’a dit : » En 1940, Monsieur, j’étais jeune professeur de français au lycée de jeunes filles à Oran, lorsque l’Etat français a promulgué les lois portant statut des Juifs. Nous avons reçu un jour une circulaire nous demandant de dresser les listes des élèves juives de notre établissement, afin qu’elles soient expulsées puisque l’Etat français avait décidé que les Juifs n’auraient plus le droit de bénéficier de l’instruction publique. D’un seul coup, des Français découvraient qu’ils n’étaient pas français. »
Elle m’a dit : » Monsieur, j’étais horrifiée ! Mais j’étais plus encore horrifiée quand je me suis rendue compte que j’étais la seule à être choquée. Toutes mes collègues m’ont dit : Christiane, on ne peut rien faire à ça, c’est une loi ! Et puis, est-ce que tu seras plus utile une fois que tu seras renvoyée ? Tais-toi, tu vas avoir des ennuis ! »
Et Christiane Faure me raconte : » Monsieur, nous avons fait les listes. Et moi, j’ai regardé mes jeunes élèves descendre la colline d’Oran avec leurs petites blouses roses sous le bras. Et j’ai pleuré, Monsieur. Et je me suis dit que plus jamais je ne pourrais être enseignante. J’enseignais Diderot, Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Monsieur, sachant les enseigner, nous aurions dû savoir les défendre. »
Alors, elle me raconte qu’elle résiste. Oh, pas grand chose : elle donne des cours en cachette aux jeunes élèves juives chez elle. Ca se sait, on la menace. On lui dit qu’elle va être déportée. Mais l’Algérie est libérée très tôt.
En 1942, le Gouvernement provisoire de la République Française s’installe à Alger et un nouveau ministre – non plus de l’Instruction publique, mais de l’Education nationale – décide de constituer un cabinet. Il va chercher un philosophe, Jean Guéhenno, qu’on a un peu oublié aujourd’hui, proche du parti communiste : un type important à l’époque. Il va chercher d’autres personnes : Messieurs Bayen, Badvent et Mademoiselle Christiane Faure.
Mademoiselle Christiane Faure entre donc dans le premier cabinet qui va constituer un Ministère de » l’éducation nationale « . Parce que ce n’est plus un problème d’instruction. Avec Auschwitz, avec le nazisme, on sait désormais que ce n’est pas parce qu’on est instruit, qu’on préfère nécessairement la démocratie au fascisme ! Et qu’on peut être parfaitement instruit et être un nazi. Il y a dans l’intelligentsia française, il y a parmi les plus hauts dignitaires allemands, des gens qui ont un très haut niveau d’instruction.
Et ça, Mesdames et Messieurs, c’est un traumatisme pour ce ministère ! parce qu’il est désormais obligé d’accepter une idée toute simple, que Monsieur le Marquis de Condorcet avait déjà exprimée en 1792, quand il avait présenté son plan d’éducation à l’Assemblée. Condorcet avait dit : » Attention, si vous vous contentez de faire l’instruction des enfants, vous allez simplement reproduire une société dont les inégalités seront désormais basées sur les savoirs ! » Si vous voulez fabriquer une république et une démocratie, il vous faut un deuxième volet. Il vous faut faire de l’éducation politique des adultes, parce que la démocratie, ça ne tombe pas du ciel. Ca ne marche pas tout seul : il faut y réfléchir pour la préférer. Il faut faire un travail critique permanent.
Et donc, en 1944, Mesdames et Messieurs, en France, on crée dans le Ministère de l’éducation nationale une chose incroyable, pour laquelle il aura fallu une Shoah de vingt millions de morts pour qu’on accepte cette idée. Cette idée toute bête, c’est qu’il est de la responsabilité de l’État de prendre en charge l’éducation politique des adultes.
Et comme on ne peut pas faire de l’éducation politique avec des enfants, on va en faire avec les » jeunes « . Attention, ne faites pas d’anachronisme, Mesdames et Messieurs. Aujourd’hui, quand on parle d’un jeune, c’est un adolescent d’origine immigrée dans une tour de quinze étages avec les lacets défaits et la casquette en arrière ! Mais à l’époque, ils ne sont pas là : on n’a pas fait venir leurs parents pour les employer dans nos usines, on n’a pas construit les cages à poules de quinze étages. Ca va venir après, cette définition du jeune ! Quand un homme politique aujourd’hui parle d’un jeune, il parle rarement d’un type qui a 21 ans, une cravate et qui est père de famille ! Or c’est ça, un jeune, en 1944.
Et Mademoiselle Faure est chargée de ça, chargée de recruter des instructeurs nationaux d’éducation populaire. Elle va aller chercher dans ce que l’on appelle à l’époque » la culture populaire « . C’est un truc qui a disparu depuis que maintenant il y a la Culture. La culture a cessé très rapidement d’être populaire. On va donc chercher des gens du cinéma, des professionnels : Monsieur Chris Marker en fera partie un jour ; de la radio : Monsieur Pierre Schaeffer, qui va créer Radio France. On va chercher des gens du théâtre : Monsieur Hubert Gignoux ; on va chercher des gens du livre, des écrivains. On va chercher des économistes, on va chercher des ethnologues, on va chercher des professionnels du champ culturel.
A l’époque, la culture, c’est une grande chose : Malraux n’a pas encore ratatiné cela aux beaux-arts ! On va donc voir ces gens, et Mademoiselle Faure leur demande à tous : » Est-ce que vous accepteriez de sacrifier votre carrière pour venir créer, inventer de toutes pièces, les conditions d’une éducation politique des jeunes adultes en France ? »
Et mademoiselle Faure me raconte qu’en 1948, les communistes, voyant qu’ils ne pourront pas mettre l’un des leurs dans la direction, préfèrent – plutôt que ce soit un gaulliste – préfèrent tout saboter et empêcher ça !
C’est un choix politique. Ils ont peut-être eu raison, peut-être eu tort, on ne sait pas.
Elle me raconte que Monsieur Roger Garaudy, en 1948, déclare, à la stupeur générale, en pleine chambre, que le groupe communiste propose pour mesure d’économie publique de fusionner la toute jeune » Direction de l’Education Populaire des Mouvements de Jeunesse » avec la gigantesque » Direction de l’Education Physique et des Activités Sportives « . Pour créer une très bizarre, très curieuse, très improbable » Direction Générale de la Jeunesse et des Sports « , matrice du ministère qui existe encore actuellement et dont les fonctionnaires, soixante ans après, se demandent encore ce que peut bien vouloir dire » jeunesse et sports « . Est-ce que ce sont des jeunes qui font du sport ? Bon, le sport, on voit ce que c’est ; mais alors la jeunesse ?
Comprenez bien, Mesdames, Messieurs, que » jeunesse et sports « , c’est un anti-concept. Jeunesse et sports, c’est un truc inventé pour tuer du politique et pour dire : il n’y aura pas d’éducation politique des jeunes Français.
Ce n’est pas grave, ils font du kayak, c’est déjà ça ! C’est le premier avortement de ce projet indispensable. Mais il va y avoir un deuxième avortement : Jean Guéhenno, quand il voit ça, donne sa démission. Christiane Faure, elle, quand elle voit ça, dit : » OK. Je pars en Algérie « . Parce qu’en Algérie, elle va diriger une Direction d’éducation populaire qui n’est pas rattachée aux Sports ! Elle me raconte qu’elle va faire un travail avec les soldats du contingent. Ils vont écrire sur ce qu’ils vivent. On va la traiter de communiste, c’est une fonctionnaire d’État. Elle va faire du théâtre en arabe avec les Arabes en pleine guerre d’Algérie : l’OAS veut la tuer, elle et son équipe ! Elle me raconte ça. Elle raconte, raconte, et moi je m’accroche pour en garder le plus possible.
Et pendant ce temps-là, en France, les instructeurs de l’éducation populaire n’ont plus qu’une seule idée : c’est se sauver du sport ! On leur construit, en 1948-49, des » centres régionaux d’éducation populaire et sportive « . Ils arrivent, ils regardent et disent : » Bonjour, où est le théâtre ? » – » Euh, ben, il y a le gymnase. Vous n’avez qu’à mettre des rideaux ! » – » Où est la salle de cinéma ? » – » Eh bien, il y a le gymnase. » – » Oui, mais où est l’atelier d’arts plastiques ? » – » Il y a le gymnase. »
Ils ont compris qu’il faut qu’ils s’en aillent. Alors, ils écrivent un livre en 1954, dans lequel ils réclament d’avoir leur propre direction, leur propre administration et ils appellent ça » Pour un ministère de la Culture « .
Mesdames et Messieurs, un » ministère de la Culture » en 1954, c’est très, très culotté ! Parce qu’il n’y a eu, à ce moment de l’Histoire, que trois ministères de la culture dans le monde. Un chez Hitler, un chez Mussolini, et un chez Staline. Pour une raison assez simple à comprendre : c’est que la notion même de ministère de la culture est totalement incompatible avec l’idée de démocratie.
Je ne vous parle pas d’un secrétariat d’Etat aux Beaux arts, qui pensionne des artistes officiels comme c’est le cas aujourd’hui. Je vous parle d’un vrai » Ministère de la culture « . Parce qu’un Ministère de la culture, cela veut dire que l’État dit le sens de la société, et ça, c’est la définition du fascisme.
Mais eux se disent qu’il doit y avoir moyen d’avoir un Ministère de la culture démocratique. Ce sera forcément un ministère qui va travailler la question démocratique en permanence. Ce serait un ministère de l’éducation populaire.
Vous voyez bien comment aujourd’hui ce ministère prétend travailler la question démocratique : il est là pour nous faire croire à la démocratie en faisant pipi par terre ! Mais eux, à l’époque, ils utilisent le théâtre, ils utilisent le cinéma, ils utilisent tout ce qu’aujourd’hui déteste le Ministère de la culture ! » On ne doit pas utiliser le théâtre pour parler de la vie des ouvriers ! Ca, c’est tuer l’art ! L’art n’a pas à servir une cause sociale ! » Tout le discours d’aujourd’hui.
Et je demande à Mademoiselle Faure : » Mais est-ce que vous aviez des contacts avec Mademoiselle Jeanne Laurent ? » Mademoiselle Laurent dirige la direction des Arts et Lettres. Son problème à elle, Jeanne Laurent, ce sont les Beaux Arts. C’est elle qui va donner sa première subvention à Jean Vilar pour faire le festival d’Avignon. A côté de Jean Vilar, il y a un type dont vous n’avez jamais entendu parler, c’est Jean Rouvet. Lui, c’est un instructeur d’éducation populaire. Il va construire le festival d’Avignon, les CEMEA à Avignon, tout ça. Vous croyiez que c’était Jean Vilar qui avait tout fait ? Evidemment, on vous a toujours dit la vérité, à vous !
Ils veulent donc un Ministère de la culture. Ils pensent à Albert Camus pour être leur ministre. Camus à l’époque a dirigé une maison de la culture en Algérie, et a créé un théâtre, » le Théâtre du travail « . Vous imaginez ? Un gars qui milite pour la création collective, contre la création individuelle, bref, un anti-Malraux. Camus se tue en voiture.
Et là-dessus : un putsch. En 1958, un général prend le pouvoir en France. Vous connaissez son discours célèbre : » Pourquoi voulez-vous, qu’à 77 ans, je devienne un dictateur ? » Et ce général a dans ses valises, un admirateur forcené, un chantre : André Malraux.
Le Général voudrait lui confier un ministère. On lui demande : » qu’est-ce que vous souhaitez être, comme ministre? « . Et Malraux répond (voix caricaturale) : » Je veux être ministre de la jeunesse « .
Mesdames, Messieurs, faites très attention ! En 1958, il y a eu trois ministères de la jeunesse dans le monde. Un chez Hitler, un chez Mussolini, et un chez Staline.
On lui répond : » Non, non, non ! On ne va pas faire un Ministère de la jeunesse en France. » Alors, Malraux fait un deuxième choix. Il dit (même voix) : » Je veux être ministre de la recherche « . Avec la bombe atomique ! Avec les scientifiques, les trucs, les machins ! On lui dit qu’il n’a pas les compétences. Alors, il fait un troisième choix. Il dit (même voix) : » Je veux être ministre de la télévision « . Il y a environ quatorze postes de télé en France en 1958, vous voyez le genre – ça fait rigoler absolument tout le monde la télévision ! Tout le monde parie cinq ans maximum sur cet objet-là : une boîte en bois avec une nana qui parle dedans et une horloge pour donner l’heure ! Debré ne comprend absolument pas ce que peut être un ministre de la télévision. Il ne voit pas du tout ! Malraux, lui, a compris. Malraux est génial (dangereux, mais génial). Et on lui dit non, parce qu’on ne sait pas à quoi sert un ministère de la télévision. Donc il boude. Debré retourne voir De Gaulle, De Gaulle enguirlande Debré, pique une colère et exige un ministère pour Malraux.
Vous remarquerez que Malraux n’a pas demandé à être ministre de la culture. Evidemment, vous, vous croyez que c’est Malraux qui a inventé le Ministère de la culture. C’est normal : on vous a toujours dit la vérité. La vérité officielle. Vous n’avez jamais entendu la plus petite contrevérité sur la question. Malraux, il n’y avait même pas pensé, à être ministre de la culture. Ce n’est pas Malraux qui a fabriqué ce ministère : c’est un personnage beaucoup plus discret et beaucoup plus puissant, Emile-Jean Biasini. On va y venir, patience.
Et donc, on lui construit son ministère : on va chercher le cinéma au Ministère de l’industrie, on va chercher les Arts et Lettres à l’Éducation nationale – normal : on lui donne les Beaux-Arts ! – et puis, on lui donne l’éducation populaire, on lui donne les CEMEA, les maisons de jeunes qui sont déjà au point, la Ligue de l’enseignement, les Francs et franches camarades, Peuple et culture, tout ça ! On lui donne les instructeurs nationaux d’éducation populaire, et Mlle Faure revient d’Algérie et intègre le cabinet de Malraux pour construire enfin un vrai ministère de l’éducation populaire.
Eh bien, non. Ils n’ont pas gagné. Parce que, comme on ne trouve pas de fonctionnaires pour les donner à Malraux, on va lui donner des fonctionnaires dont personne ne veut : les rapatriés de la France d’Outre-mer, c’est-à-dire tous les fonctionnaires qui sont virés par la décolonisation : des gars qui reviennent du Tchad, etc, des types pas très à gauche – je ne sais pas comment dire ça… plutôt le volet » aspect positif de la colonisation « , vous voyez. Des gars formés à une école qui s’appelait l’École Nationale de la France d’Outre-Mer. Donc des types qui sont habitués à travailler vite, beaucoup plus vite qu’un fonctionnaire français, à construire des ponts, des routes, des ponts, des routes, des ponts, des routes, à défendre la culture française, la grandeur de la France, la puissance de la France, etc. Et c’est eux, Mesdames et Messieurs, c’est eux – parce qu’ils sont terriblement efficaces – qui vont construire le ministère de Malraux.
Car Malraux est incapable de construire un ministère. Incapable.
Malraux, le jour où il essaye de défendre son budget à l’Assemblée nationale – son budget, ses propres sous ! – il lit trois lignes et il dit : » Et euh… et j’en passe et ça lasse… » ! Et il jette les feuilles en l’air et fait : » Antigone est entrée… » Comme ça ! Et tous les députés reviennent, pour écouter Malraux !
Donc, ce n’est pas Malraux qui a fait le Ministère de la culture : ce sont ces fonctionnaires-là. Emile-Jean Biasini, au moins vous aurez entendu son nom ! Un type très, très important, très puissant, qu’on va retrouver sous Mitterrand comme directeur des grands travaux. C’est le type qui va surveiller Jack Lang. Et donc, ce gars-là va tout de suite comprendre l’intérêt du programme des maisons de la culture : l’intérêt pour l’État, pour la puissance de l’État.
Et il va complètement détourner le projet que Christiane Faure et les autres ont commencé à écrire. Une maison de la culture, avec Christiane Faure et les instructeurs, c’est une maison où tout le peuple, toutes les associations, ont le droit de venir, c’est leur maison.
Avec le projet que va rédiger Biasini, le peuple n’a pas le droit de mettre les pieds dans une maison de la culture. Ce n’est pas pour le peuple, ça n’est pas pour les pouilleux ! Ce ne sera pas le hangar des galas de fin d’année en tutus roses des associations de parents d’élèves ! Une maison de la culture version Biasini, ça va être l’endroit où l’on va montrer l’élite, la puissance de la France, » la France d’en haut » (vous avez remarqué que le peuple est en bas, en général ?) Et la première décision de Biasini, c’est de virer l’éducation populaire : il comprend tout de suite ce que c’est ! Tout de suite. Il dit à Debré : » Vous me reprenez ça, vous me le renvoyez à Jeunesse et Sports. » Debré râle, mais accepte.
» L’éducation populaire, Monsieur, ils n’en n’ont pas voulu. Ca n’intéresse plus personne aujourd’hui. Au revoir. »
Ce ministère va faire des dégâts considérables, mais va devenir un ministère idéologiquement très important. Quand Malraux va partir, à un moment on aura un centriste, Duhamel. Un centriste en France, quand il arrive, dit : » Bon, moi je n’ai pas d’idée. Qu’est-ce que vous proposez ? » Duhamel se laisse influencer par des gens très bien, des gens de Peuple et culture – Joffre Dumazier – et tous ces gens-là vont lui dire : » Il faut arrêter les folies à la Malraux ! arrêter cet élitisme grotesque, c’est une horreur ! Vous allez construire un ministère de la distinction totalement anti-populaire, c’est un crime ! C’est ratatiner la culture aux Beaux Arts, à l’expression artistique la plus bourgeoise ! »
Quand Biasini va chercher de l’argent auprès du Commissariat au plan, les fonctionnaires du Plan, en 1960, regardent son projet et lui disent : » Mais enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, Monsieur Biasini, dans votre projet de Ministère de la culture : il n’y a que les Beaux Arts ! Vous avez oublié l’information économique des populations. »
A cette époque-là, Mesdames et Messieurs, l’information économique faisait encore partie de la culture. Aujourd’hui, c’est fini. Dommage. Le Ministère de la culture subventionnerait ATTAC, qui se porterait un peu mieux, mais bon ! Duhamel meurt tout de suite après, d’un cancer. Ensuite, il y a deux ou trois ministères jusqu’à la super-catastrophe. En 1981, on récupère Super Malraux ! Jack Lang ! L’homme des phrases historiques : » La fête de la musique ne sera pas une fête de la merguez ! » ; » L’économie et la culture, c’est la même chose ! » Il en a sorti deux ou trois bonnes, Jack Lang.
Jack Lang va comprendre comment on empêche les gens de faire de la politique (une activité très démodée pour les socialistes) et va propulser l’idée de la culture contre l’idée du politique. Ca s’appelle » moderniser la politique « . Jack Lang comprend que le Ministère de la culture va être une façon de rendre extraordinairement ludique le capitalisme. Je ne sais pas si vous avez vu la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, mise en scène par un Français qui s’appelle Decouflé ? Normalement, la cérémonie des Jeux Olympiques, c’est la cérémonie la plus fasciste du monde : les nations qui défilent au pas de l’oie. Alors, traité par Jack Lang… ils défilent avec des plumes dans le cul ! C’est super rigolo ! Alors, du coup, on ne voit pas que c’est fasciste.
Oh c’est cool, quoi, le capitalisme ! Avec Jack Lang, le Ministère de la culture, ça va être un ministère du capitalisme rigolo, quoi !
Ce ministère va faire un travail terrifiant dans l’ordre des langages et des représentations mentales.
Notamment, il va changer le héros de la gauche. Avant, dans les années 1970, le héros de gauche, c’était l’ouvrier qui s’organise collectivement pour résister. Après Jack Lang, pour les socialistes, le héros, c’est l’artiste qui reste tout seul pour créer en regardant son nombril : c’est cela être de gauche… Etre de gauche, c’est défendre la création artistique. Ce n’est pas défendre les ouvriers. De toutes façons, il n’y en a plus.
On a posé la question à des étudiants de 5ème année : » Combien y a-t-il d’ouvriers en France ? » Ils ont répondu qu’il y en avait environ 5%. Des étudiants de 5ème année !
Or, il y a 30% d’ouvriers en France ! Eh bien, grâce à la culture, vous en avez 25% qui ont disparu. Ils ne sont plus dans nos imaginaires, ils ne sont plus à la télévision, ils ne sont plus dans le théâtre, ils ne sont plus au cinéma. La condition ouvrière, Mesdames et Messieurs, a disparu ! C’est une bonne nouvelle. Le Ministère de la culture va faire un travail terrifiant – mais terrifiant ! – qui va consister à remplacer du politique par du culturel.
J’explique vite fait, avec un petit schéma idiot.
(Il met les deux mains l’une au-dessus de l’autre)
Le politique, c’est un jugement de valeurs qui consiste à dire : » Ceci est mieux que cela « . Bon voilà, ça, c’est politique ! Par exemple, vous dites : » une société qui décrète l’égalité de l’homme et de la femme est une société meilleure qu’une société qui ne la décrète pas « . Maintenant, je vous le fais en culturel, regardez bien.
(Il bascule les deux mains en parallèle à la même hauteur)
Hop ! » Une société qui décrète l’égalité de l’homme et de la femme, c’est un choix d’organisation culturelle, c’est une expression culturelle.
Une société qui décrète que l’homme et la femme ne sont pas égaux, et même que les femmes sont moins que des chèvres, c’est une autre expression culturelle. Et une expression culturelle n’a rien à dire à une autre expression culturelle. Elle est respectable en tant qu’expression culturelle. C’est ça l’égalité ! Elle est pas belle la vie, pour un socialiste ?
Donc, d’un côté, là, vous interdisez l’excision ; de l’autre, vous dites : » Je ne vois pas pourquoi on irait embêter ces gens-là s’ils ont choisi d’exciser » ! Voilà.
Vous voyez un peu le discours. Je ne veux faire de peine à personne. Comme disait une candidate à la présidence de la République : » Bon, si c’est comme ça qu’ils veulent, pourquoi pas ? »
Et donc, ça, c’est culturel, et ça détruit constamment du politique. Pour ceux qui ont vu ça peut-être à l’époque – vous savez, en 1989, quand la France a célébré le bicentenaire de la Révolution française ? – un truc terrible ! Alors, c’est terrifiant, parce que juste avant cet événement, toutes les nations, tous les intellectuels du monde pensaient que ça allait être un moment terrible, le bicentenaire de la Révolution française ! Un moment où la France allait dénoncer toutes les dictatures dans le monde : en Afrique du Sud, en Amérique du Sud… Et tout le monde attendait, tous les intellectuels du monde entier attendaient le bicentenaire de la Révolution française !
Ca n’a pas été ça du tout. Monsieur Jean-Noël Jeanneney, qui était responsable de cette commémoration, a déclaré officiellement : » La France n’a plus de leçons à donner au reste de l’humanité « .
C’est une commémoration bizarre, parce qu’au moment de la Révolution française, du politique il y en avait, houlala ! du jugement de valeurs il y en avait, terrible ! La France avait même déclaré (c’était à mourir de rire) qu’elle allait » délivrer les peuples opprimés qui en feraient la demande » ! Et maintenant, on dit : » Non – non – non : les peuples opprimés, c’est un choix d’organisation culturelle. »
Ca donne ce défilé extraordinaire, peut-être l’avez-vous vu ? Moi, j’étais invité, j’étais aux premières loges. Ca s’appelait : » Les Tribus Planétaires « . Vous comprenez : ça veut dire qu’il n’y a plus d’ordre de grandeur ! Il n’y a plus que des tribus planétaires posées les unes à côté des autres ! Et chaque pays était représenté, caricaturé, par son signe culturel le plus rigolo, le plus évident. Les Noirs, l’Afrique, ils étaient tout nus, ils tapaient sur des tam-tam ! On n’a jamais vu de Noir faire des études, ça se saurait. Les Anglais étaient sous des trombes d’eau ! Parce qu’il pleut toujours en Angleterre. Je n’ai pas vu le char belge, mais je n’ai pas de mal à l’imaginer : ça devait être une grande frite, ou je ne sais quoi.
Voilà, c’était ça la célébration du bicentenaire de la Révolution. Façon culturelle. Terrifiant.
Et ce ministère va mettre en avant la notion d’art contemporain : la droite est moderne, la gauche est contemporaine. Contemporain, c’est beaucoup plus moderne que moderne ! Contemporain, c’est » tout de suite, maintenant ! » et dès que c’est dépassé de dix minutes, c’est complètement cuit : ça n’a plus aucun intérêt, c’est ringard-grave, quoi !
Ca, ça valorise un des critères du capitalisme qui est l’innovation permanente, la rotation de la marchandise.
Le colloque
(Il bat 16 cartons marqués chacun d’un mot de la langue de bois, comme un jeu de cartes, coupe, recoupe, rebat et les pose devant lui. Puis il tire les cartes une par une pour prendre connaissance du mot, et construit un discours de la façon suivante : )
» Monsieur le maire, Monsieur le représentant du conseil régional, Mesdames, Messieurs, je voudrais revenir, dans le temps qui m’est imparti sur une question qui me paraît essentielle.
– Et cette question, c’est la question… du lien social,
– que je voudrais mettre en rapport avec la question, … du partenariat.
– Si, comme on peut le penser, à l’heure où nous estimons qu’il faut mettre en oeuvre… des médiations
– Qui prennent en compte… les acteurs,
– c’est-à-dire à l’heure où l’espace du… local
– est devenu l’espace d’une authentique… participation
– Alors, alors la question de… l’évaluation
– dans l’espace, désormais définitif de la… proximité,
– nous impose, lorsque nous passons des… contrats
– à l’heure de la… mondialisation,
– de mettre en place un véritable… diagnostic partagé !
– Sans quoi, ce que nous appelons… » développement »
– et dont nous voulons qu’il prenne en compte les… habitants
– n’entraînerait en définitive aucune… démocratie
– aucune… citoyenneté
– Et c’est pourquoi, nous devons prendre en compte tout cela
lorsque nous demandons aux gens de monter des… projets.
(Quel que soit l’ordre des mots, la phrase semble faire sens. Il bat, rebat et recoupe le tas de cartes-mots, les pose devant lui et recommence une seconde fois 
Mais je voudrais dire tout de suite une deuxième chose. Cette deuxième chose, c’est que, comme l’a fait remarquer l’intervenant précédent, à juste titre, si la question du partenariat dans un processus de développement doit prendre en compte nécessairement la question de l’évaluation au plan local, dans un souci de lien social, alors c’est une authentique médiation que nous devons trouver dans nos projets.
C’est-à-dire que la question de la citoyenneté est désormais la question centrale de la démocratie, à l’heure de la mondialisation. Et lorsque nous passons une logique de contrats dans l’espace de la proximité – cette logique de contrats que nous passons avec les acteurs, c’est-à-dire en définitive : les habitants – eh bien, elle doit se fonder sur un vrai diagnostic partagé qui n’est rien d’autre en définitive que la question de la participation ! »
A ce stade, Mesdames et Messieurs, dans un colloque, on passe la parole à la salle pour les questions.
(Il descend vers le public et fait tirer deux cartes à un volontaire qui accepte de poser une question avec)
Le spectateur : je voudrais savoir comment vous articulez lien social et mondialisation ?
C’est une excellente question, monsieur, et je vous remercie de l’avoir posée. Je dirais même que c’est la question centrale. Mais plutôt que de vous répondre moi-même, j’aimerais bien savoir ce qu’en pense la salle ?
(Il fait tirer la réponse en deux cartes à un autre spectateur)
L’autre spectateur : Moi je pense que c’est la question de la participation des habitants qui est la clé du problème.
Absolument monsieur, je n’aurais pas pu le dire mieux, c’est exactement cela le problème.
(Il remonte sur scène)
Deux sociologues de mes amis, dans un livre dont le titre devrait vous séduire, Le nouvel esprit du capitalisme, se sont mis en tête de traquer les raisons culturelles qui font que nous acceptons le capitalisme, alors que nous en comprenons les dégâts. Ils se sont mis dans la tête une idée très curieuse, qui est que la théorie du capitalisme se trouve dans les ouvrages de management.
C’est à dire qu’en fait, leur idée, c’est que le management c’est la théorie de l’exploitation ! C’est à dire : apprendre à nos futurs directeurs à nous exploiter : c’est ça, le management ! Ils se sont mis en tête d’entrer dans un ordinateur quatre-vingt-dix ouvrages de management de l’année 1960, puis quatre-vingt-dix ouvrages de management de l’année 2000. Et ils ont lancé leur logiciel d’analyse du langage pour voir quels étaient les mots qui arrivaient, dans quel ordre de fréquence.
Mesdames et Messieurs, en 1960, le mot le plus souvent cité dans quatre-vingt-dix ouvrages de management est » hiérarchie « . A cela, rien que de bien normal : on voit bien pourquoi il faut apprendre à nos futurs dirigeants à raisonner en termes de hiérarchie.
Alors je vous pose la question : selon vous, combien de fois le mot » hiérarchie » apparaît-il dans quatre-vingt-dix ouvrages de management de l’année 2000 ?
ZERO fois !
Mesdames et Messieurs, le mot » hiérarchie » a disparu de la théorie du capitalisme ! Alors je vous pose cette question complémentaire : Selon vous, la hiérarchie a-t-elle disparu des entreprises ? Parce que si comme moi, vous pensez qu’elle n’a pas disparu et qu’à bien des égards elle s’est renforcée – mais qu’on ne peut plus la nommer comme hiérarchie ! – alors, on ne peut plus la penser comme hiérarchie ! Et le syndicalisme a un problème, parce qu’autant on peut mobiliser un collectif de travailleurs contre une hiérarchie, autant il est extrêmement improbable de lancer des individus à l’assaut de ce qui tient lieu aujourd’hui de hiérarchie.
Et selon vous, quel est le mot qui arrive en tête dans quatre-vingt-dix ouvrages de management de l’année 2000 ? Participation, solidarité, réussite ?
Mesdames et Messieurs, je vous présente notre ennemi : le » projet » !
(Il retourne la carte marquée PROJET)
Si nous ne parvenons pas à combattre ça, nous sommes foutus ! Nous sommes foutus, parce que ce satané mot – qui est tellement positif par ailleurs ! – ce satané mot a tellement colonisé nos façons de penser en vingt ans – c’est un mot récent – que nous ne parvenons plus à penser en dehors de lui !
Nous estimons que les jeunes doivent avoir des projets. Nous disons de certains jeunes qu’ils n’ont pas de projets. Nous estimons que les pauvres doivent faire des projets. Les gens le plus en difficulté, pour se projeter dans l’avenir, on leur demande des projets. Les seuls à qui on ne demande pas de projets, ce sont les riches !
Nous estimons qu’il faut avoir un » projet de vie « . Manifestement » vivre » ne suffit plus ! Nous devons transformer notre propre vie en un processus productif ! Parce que ce mot, Mesdames et Messieurs, est un mot qui transforme tout ce qui bouge en un produit. C’est-à-dire en une marchandise. Des choses qui, jusqu’à maintenant, échappaient à la logique de la marchandise – du social, de l’éducatif, du culturel – à partir du moment où on les fait sous cette forme-là, cela signifie qu’au lieu de travailler dans un quartier sur huit ans, dix ans, douze ans (ce qu’on faisait dans les années 1960, quand on était éducateur) aujourd’hui, on réunit un groupe de jeunes, avec eux, on monte un » projet « . Ce projet dure un an. On défend ce projet en échange d’une subvention, en concurrence avec d’autres porteurs de projets. Ce projet n’est pas fini, qu’on est déjà en train de préparer le projet suivant pour obtenir la subvention suivante. A partir du moment où l’on fait ça, Mesdames et Messieurs, on entre dans la définition marxiste de la marchandise.
La marchandise, c’est un bien ou un service réalisé dans des conditions professionnelles, qui teste sa pertinence sur un marché en concurrence avec d’autres biens ou services équivalents.
Eh bien, Mesdames et Messieurs, le mot » projet » est un mot qui, insidieusement, transforme notre vie en un processus de marchandise.
Mesdames messieurs je voudrais avant de vous laisser, vous dire la chose suivante : le capitalisme est une saloperie !
Mais ça, vous le savez déjà. C’est une saloperie à cause du trou dans la couche d’ozone, à cause des milliards de pauvres dans le monde, des millions de chômeurs dans la France qui est le 4ème pays le plus riche du monde, de la violence partout et du pillage de l’Afrique… tout cela, vous le savez.
Mais c’est une saloperie pour une autre raison : ce foutu système parvient à se faire aimer et désirer par nous alors même que nous croyons nous en défendre, et il utilise pour cela des astuces de langage qui enrôlent notre générosité à son service.
Mesdames et Messieurs, lorsque nous croyons nous battre pour la liberté du créateur, pour la défense de la création, pour le développement culturel, pour la restauration du lien social, nous enrôlons notre générosité au service du capitalisme. Mesdames et Messieurs, on nous a volé des mots, et on nous a fourgué à la place de la camelote, de la verroterie, de la pacotille.
Je voudrais bien que quelqu’un ici m’explique ce que c’est que le lien social ? je voudrais que quelqu’un me dise qui détruit du lien social, entre le patron de Michelin qui licencie 7000 pères de famille la même année où il a établi des bénéfices records, ou bien le fils de l’un de ces pères de famille qui raye la peinture d’une voiture avec sa clé ? Qui dans ce quartier, détruit du lien social ? Et qu’est-ce que c’est que ce lien social qu’il nous faudrait restaurer, sinon celui de l’ordre au service du capitalisme ?
(Il lève les yeux vers le plafond)
Tout cela, c’est un peu à cause de vous, Mlle Faure. Avant de vous rencontrer, je croyais à ces mots. Ils ne me posaient pas de problème.
J’étais bien. Et puis vous m’avez raconté votre histoire, vous m’avez expliqué ce que vous aviez tenté de faire après Auschwitz, et ce que l’on avait fait avec ce que vous aviez tenté de faire. Vous m’avez raconté l’histoire du Ministère de la culture.
Je ne suis pas d’accord avec vous quand vous m’avez dit : » l’éducation populaire, Monsieur, cela intéresse plus personne aujourd’hui. Ils n’en ont pas voulu. » Je crois que vous vous êtes trompée Mademoiselle : regardez, ils sont plus d’une centaine, ils sont restés jusqu’au bout. Je peux vous assurer que pas un seul n’osera, en tout cas pas devant moi, prononcer le mot » projet « .
Le débat
Un intervenant : On pourrait te renvoyer, d’une certaine manière, ce que tu nous assènes. Dans l’éducation populaire il y a aussi quelque chose, que tu portes encore. Nous ici, à Limoges, avons eu des universités populaires : c’était par exemple le « bon professeur » qui allait dans les quartiers et qui apprenait l’hygiène aux prolos. C’était aussi la SFIO avec tous ses réseaux, etc. Or vous refaites ça, avec une certaine modernité dans le discours, mais je pense qu’il y a beaucoup de choses qui font qu’on a encore l’impression d’avoir à faire à un magister. Ce n’est pas ce que je conçois comme autoformation. Tous ici nous pouvons avoir une expérience très forte, aussi forte que la tienne. On a sûrement tous des choses à dire qu’il serait bon que tu entendes aussi, mais là on a eu trois heures. Et je suis le seul à réagir.
FL : On se bat depuis des années pour surfer sur la vague des universités populaires et pour renverser la tendance que tu dénonces. Les universités populaires façon Onfray sont des trucs descendants (le savoir va de haut en bas. NDLR) mais des universités populaires montantes, on n’en trouve pas des masses.
Le même intervenant : Si, il suffit de regarder le site du cercle Gramsci : l’université populaire montante, ça fait 25 ans bientôt qu’on fait ça. On ne s’appuie pas sur une revue ni sur un mouvement d’éducation populaire comme celui que tu as utilisé à ton compte, qui commence par un A et finit par un C. Les camarades d’ATTAC voulaient t’inviter, et c’est dommage qu’on ne se soit pas rencontrés pour faire ça ensemble. Une soirée réussie d’éducation populaire, et là je suis d’accord avec toi, c’est un machin qui ne se bâtit pas du jour au lendemain. Par exemple l’année dernière, nous avons fait un travail pendant des mois avec les gens de l’Institut d’études occitanes et de la Librairie occitane qui sont venus nous solliciter. On a discuté, on s’est engueulés, la soirée a été très forte et il y a eu dans la salle un mec qui voulait la place de celui qui était l’animateur, mais en même temps il y a eu tout un tas d’autres choses. Au final je suis content de la soirée qu’on passe ensemble aujourd’hui, mais c’est tout.
FL : Je n’ai peut-être pas décodé tout ton message. A l’intérieur de la Scop on a des débats très violents sur la forme de la conférence gesticulée, parce que ça tire vers la logique spectaculaire, et on se demande si c’est juste de faire comme ça. Pour l’instant on s’aperçoit que cela permet d’aller dans des tas d’endroits, et que quand on propose des choses sous une forme plus sérieuse, ça ne répond pas. Donc pour le moment on garde ça. Mais il y a un effet de séduction voire de sidération auquel il faut faire gaffe.
Un intervenant : Moi je n’ai pas du tout pris ça comme ça. Ca m’a rappelé 1984, de Orwell. C’est du ressenti, chacun y trouve ce qu’il veut. J’ai beaucoup pensé à Norman Baillargeon, Le petit guide de défense intellectuel. Je ne me suis pas senti agressé.
FL : Nous sommes persuadés que la question du militantisme doit aujourd’hui se poser de façon plus vivante, participative – je ne sais pas comment dire pour ne pas utiliser des mots langue de bois. Et plus personne n’ose le faire par ce que ce sont des méthodes qui avaient été développées dans les années 70 : ça fait ringard. Je suis allé à l’université d’été du NPA il y a 15 jours. C’est terrifiant. Ce sont des conférences super-balaises, et ceux qui prennent la parole doivent lever la main. Nous, quand on travaille au nom de l’éducation populaire, on fait des groupes d’interviews mutuelles, on fait des enquêtes sociales dans la rue à deux ou trois, on fait les porteurs de parole dans l’espace public. On essaie d’inventer tout un tas de machins qui cassent le rapport du type grand groupe, avec seulement les grandes gueules qui la ramènent, ou conférence. On n’en fait jamais. On a juste cette forme-là qui est une forme sur laquelle on se pose plein de questions, y compris dans mon couple parce que j’ai une nana qui est une commissaire politique et qui pose plein de questions sur la pertinence de ça.
Premier intervenant : Il n’y a que nous deux qui parlons. On regarde Secret story et on n’en pense pas moins, c’est ça que tu viens de dire, et je sais que ça peut être différent parce qu’on a vu ici tout un tas de discussions passionnantes avec un tas de gens qui parlaient, et qui n’en ont pas l’habitude mais qui en ont ressenti le besoin. Mais là on n’a pas besoin de parler.
Un intervenant : Sur le fond, cela ne me gène pas du tout : ça aide à décrypter un certain nombre de choses que parfois on perd de vue. Sur la forme, ça m’a rappelé les mises en scène faites par les groupes de communication en entreprise, au moment de la privatisation et de la séparation de La Poste et de France Télécom. J’étais du côté syndicaliste. Je fais partie de ceux qui se sont battus contre cette réforme. Nous avons été battus sur l’idéologie. La façon de faire adhérer les gens, ce sont des mécanismes que j’ai entendus ce soir. J’ai encore mieux compris comment ça fonctionnait ce soir. Sur le langage : on parle de modernité, c’est un mot que j’ai en horreur. Quand on supprime les postes des gens, on leur dit : « Mais avez-vous un projet de reconversion ? » C’est des trucs comme ça, sur la façon de fonctionner, des modes d’organisation… Et j’ai vu dernièrement qu’à EDF, ils n’ont rien inventé : ils font ce qu’on a fait à France Télécom. Ils copient.
Un intervenant : J’ai été très satisfait de la soirée. On entend nos politiques utiliser tous ces mots positifs, il y a des prophètes qui nous les resservent. Quand on est à la recherche d’une ascension sociale ça coule comme du miel, on ne se sent pas agressé par tous ces mots. Et peut-être ce que disait le camarade c’est que aussi ce soir, tout ce qui a été dit, ça coulait comme du miel. Est-ce qu’on va réussir vraiment à conscientiser comme ça le peuple ? Moi je suis animateur. Ce soir je me suis pris une grande claque, parce qu’on nous parle toujours de projets. Il faut faire des projets avec les jeunes. Et je me demandais si ce soir en rentrant je n’allais pas faire une affiche demandant pardon aux jeunes de toujours les saouler avec ce mot de » projet « , parce que finalement moi qui veux revendiquer certaines valeurs, inconsciemment je les entraîne pile-poil dans le capitalisme. Ca provoque forcément un interrogation sur soi-même et ça demande du temps de réflexion. Car quand on entend beaucoup, beaucoup de choses, quand on entend Sarkozy qui va nous citer Jean Jaurès… ça demande vraiment une éducation populaire qui nous donne des valeurs politiques.
Une membre de la Scop : C’est dommage qu’on ne puisse pas vous inviter ce soir à un de nos ateliers de désintoxication de la langue de bois, qui ont toujours lieu après la conférence gesticulée. On essaie d’intervenir à deux pour animer, pour donner la parole, pour construire. C’est évident que cette forme-là interpelle, elle a cette vocation ; et c’est évident qu’il faut transformer ça après la conférence.
Une intervenante : Je n’ai pas eu l’impression que ce qu’on vient d’entendre était autre chose que ce qu’on peut entendre ou lire habituellement si on a un peu l’habitude de ce genre de recherche. On n’a pas à le gober plus qu’autre chose. Ca questionne, ça donne envie de rechercher par soi-même. Oui, d’accord, Malraux je n’en avais jamais entendu parler comme ça, et peut-être que je vais aller voir autre chose. C’est une invitation à se bouger, à se mettre en marche. J’ai l’impression que ce n’est pas à prendre tout cru et que la forme est un choix, avec ses qualités et ses défauts. En tous cas j’ai bien apprécié et ça m’a stimulée.
L’intervenant précédent : Je te rejoins sur l’idée qu’il ne faut pas prendre ça tout cru et qu’il faut poursuivre les recherches. Ce qu’il y a, c’est qu’on est habitué à entendre les choses. Les jeunes remettent peu en question ce qu’ils entendent. La religion non plus ne nous a jamais demandé de la remettre en question.
FL : Pour moi, cette conférence est une tentative de vulgarisation. J’ai travaillé une quinzaine d’années à la fédération des MJC avec des directeurs de MJC qui ne pouvaient pas lire un livre parce qu’ils étaient rincés, et que le soir ils avaient envie de lire un roman policier. Moi, j’étais à un poste très curieux où j’ai eu un luxe démentiel : payé pour être un intellectuel organique. J’étais payé pour lire et pour rencontrer des intellectuels. Dans les années 1990 je me suis mis à rencontrer des mecs comme Simon Vul, Bernard Heme, qui dénonçaient les dispositifs d’insertion. Et j’ai travaillé avec des gens par centaines qui mettaient en oeuvre des dispositifs d’insertion. Donc, j’ai d’un côté des intellectuels qui écrivent des livres qui démontent le scandale, l’obscénité des dispositifs d’insertion, et de l’autre côté des mecs qui mettent ça en oeuvre du matin au soir. Pendant des années j’ai essayé de les faire se rencontrer. Et ça ne marche pas. On fait comment, pour que ces putains de travailleurs sociaux lisent ces putains de bouquins ? Dans le film de Pierre Carles où Bourdieu se fait attaquer par un jeune beur qui lui dit « ho intello machin », Bourdieu lui répond : « Tu es un con, parce qu’un bouquin c’est une arme ». A Avignon, je joue le truc, et puis à un moment j’ai un gros doute sur ce que je raconte sur Boltansky, à savoir que le mot hiérarchie a disparu. Je ne peux quand même pas raconter n’importe quoi, il faut que j’aille vérifier. Je vais à la FNAC, je ne trouve pas ce livre. Je vais voir la vendeuse : « Excusez moi ; vous avez Le nouvel esprit du capitalisme ? » Elle me répond : « Mais qu’est-ce que vous avez tous avec ce bouquin en ce moment ? » Donc je réalise que des gens qui sortaient du spectacle avaient envie de voir ce que Boltansky racontait sur le projet. Et ce sont des gens qui bouffent du projet du matin au soir. Alors je me dis que cette forme-là a une espèce d’efficacité, mais pour moi elle n’a pas d’autre vertu que d’être une sorte de vulgarisation rigolote dans laquelle je raconte que j’ai tout raté, que je ne sais pas faire pousser des légumes, où j’essaie d’inverser la figure de l’expert. En même temps j’ai conscience que c’est très tordu parce qu’il y a des gens qui peuvent dire que je suis en train de créer une nouvelle religion qui est celle de Christiane Faure. J’ai une amie, Françoise Tétard, qui est historienne des mouvements de jeunesse et qui trouve que j’y vais un peu fort avec Faure. Elle me dit : « C’était pas aussi important que ça, cette histoire de rattachement raté. Tu es en train d’en faire un truc… » Sauf que ce qu’elle me raconte, Christiane Faure, c’est un truc énorme. Un jour, il y a une femme qui vient me voir et qui me dit : « Je voudrais vous dire merci » – « Pourquoi? » – « Le mot de projet, ça me rendait folle, mais je n’osais le dire à personne. Découvrir qu’un mec (Boltansky) a écrit 900 pages là-dessus, vous ne pouvez pas savoir le bien que ça me fait : ça veut dire que je ne suis pas folle ». Sauf que cette femme-là n’a pas accès à ces travaux. Elle bouffe de la méthodologie de projet depuis qu’elle a fait son BAFA et qu’on lui a expliqué qu’il y avait une différence entre les buts et les objectifs. Et qui ici, qui à gauche dénonce ça ? Qui dénonce la méthodologie de projet, la pédagogie par objectifs à l’école ? Qui ? J’en connais un : Le Goff. Il a écrit un bouquin que personne ne lit.
Une intervenante : Je me dis surtout qu’il y a des gens qui proposent quelque chose, qui y ont travaillé, et ça m’intéresse d’entendre ce qu’ils ont à dire. J’ai eu l’impression qu’il y avait aujourd’hui des gens qui avaient des choses à proposer, et qu’ensuite il y avait une discussion autour de ça. Du coup, je ne comprends pas où est le problème (évoqué par le premier intervenant. NDLR). Heureusement qu’il y a encore des gens qui préparent des choses. Les discussions spontanées, c’est bien, mais on ne peut pas fournir le même effort que quand il y a des gens qui ont bossé un truc. Là où je vis, on essaie de s’organiser pour que l’un ou l’autre prépare des choses. La question peut être posée en ces termes : » Tiens, cette forme-là nous surprend, est-ce que c’est la bonne ou pas ? etc. » (à F. L. :)Moi ça m’intéresse ce que tu racontes là. On a commencé la discussion par l’idée que la forme de cette conférence était choquante. (Au premier intervenant  Tu interpelles tes camarades : « Qu’est-ce que vous foutez à ne pas réagir ? » Mais comment veux-tu qu’on réagisse après une telle entrée dans le débat ? Juste ce constat : ça m’intéresse ce que vous présentez là, ça ne veut pas dire que je le prends tel quel, mais faisons-nous confiance les uns aux autres. Il ne faut pas se tromper d’ennemi.
Tu interpelles tes camarades : « Qu’est-ce que vous foutez à ne pas réagir ? » Mais comment veux-tu qu’on réagisse après une telle entrée dans le débat ? Juste ce constat : ça m’intéresse ce que vous présentez là, ça ne veut pas dire que je le prends tel quel, mais faisons-nous confiance les uns aux autres. Il ne faut pas se tromper d’ennemi.
FL : Par exemple, on va travailler avec les élus d’une communauté de communes et les animateurs jeunesse sur la question « Qu’est-ce qu’une politique jeunesse? » On va intervenir deux jours. Moi, je ne sais pas faire passer en deux jours ce que j’ai mis treize ans à comprendre, à savoir qu’une politique jeunesse ça n’existe pas. Ce n’est pas ça la question. Comment vais-je dire ça à l’animateur jeunesse ? C’est ce que je raconte dans le colloque. On va essayer de partir du désir politique des gens en essayant de reconstruire en deux jours. Quand on organisait des universités d’été on faisait ça sur six jours, et les gens nous disaient : « Vous êtes malades, il n’y aura personne ». Et en fait, on avait 300 personnes à chaque fois, et on faisait un travail d’émancipation qui était sidérant. Je suis d’accord avec toi. L’erreur, c’est de porter un discours descendant : je vais vous expliquer ce qu’est une politique jeunesse, ce que ça devrait être ou ne pas être. Je l’ai déjà fait, je sais que ça ne produit rien. Ce qu’il faut, c’est essayer de travailler avec les gens.
Premier intervenant : Au cercle Gramsci, on invite toujours quelqu’un qui a bossé le truc. Quand on parle d’effet de sidération de trois heures de tchatche et d’effet spectacle, c’est autre chose.
Un autre intervenant : Cela, on le savait très bien. Ce qu’on propose ce soir se déroule comme on l’avait prévu. On savait bien que c’était trois heures, avec une coupure. Chaque fois qu’on a fait un spectacle au sein des soirées du cercle Gramsci, il y a toujours un petit moment après les où c’est un peu lourd parce qu’il faut digérer la chose. Là il y a un débat qui s’instaure.
Un intervenant : Pour revenir à la première question, il me semble qu’il y a un effet séduction, par la forme. Mais chaque fois qu’il y a une conférence, même si elle n’est pas mise en scène, il y a des effets de rhétorique. C’est la même chose.
Deuxième question : est-ce qu’on peut se passer à tout prix de quelqu’un qui intervienne ? Appelons ça un maître avec beaucoup de guillemets, au sens où Rancière parle du » maître ignorant « . Je ne le pense pas. Ce qui est important, c’est de quel maître il s’agit. Il y a le maître de savoirs, ce que tu appelles la descente, celui qui dit : « Voilà ce que je sais et vous êtes des cons si vous ne savez pas ». Ce n’est pas dans cette position que tu étais, comme le sont beaucoup d’intervenants dans les réunions du cercle Gramsci, avec une séduction verbale et non pas gestuelle, mais qui revient au même à mon avis. Tu es dans la position d’un maître éveilleur, c’est-à-dire quelqu’un qui bouscule pour penser. Il ne faut pas confondre les deux. Si on attend que spontanément des gens se disent des choses, ça peut faire des débats très pauvres. Ce n’est pas anormal du tout qu’à un moment donné il y ait quelqu’un qui vienne avec ses moyens, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui viennent habituellement ici parce que ces moyens ne sont pas uniquement verbaux. Mais ils viennent là pour une discussion, comme ça s’est amorcé avec la question du langage, du projet. Il y a des choses qui nous secouent, qui nous font parler. C’est plus long que d’habitude et c’est plus difficile de redémarrer mais je ne pense pas que la conférence d’aujourd’hui, sous prétexte qu’elle était gesticulée, était plus séductrice que beaucoup de conférences dont la rhétorique est tout aussi séductrice.
FL : Les deux questions à partir de cette provocation/spectacle restent posées : premièrement, comment reprend-on la question culturelle à gauche ? Quand je regarde l’ensemble des programmes, je constate qu’ils sont tous sur la défense de la liberté du créateur. C’est ça, l’horizon de la gauche. Et l’autre question, c’est comment on se bat contre la démarche qualité et tous ces mots-là. Pour ça, il faut du temps.
La forme que je trouve juste, c’est celle que j’appelle l’université populaire ou la recherche-action. Je souhaite que des gens, des lieux, vous par exemple cercle Gramsci, vous organisiez, dans le temps, du récit, du collectage et que vous trouviez des façons de transformer ce collectage en témoignages, en analyses politiques, puis en actions collectives. Chaque fois que je demande à des animateurs jeunesse de faire ça avec des enseignants, ils me disent que ce n’est pas leur boulot. Quand on organisait des universités d’été, au lieu de faire venir des intellos pour qu’ils expliquent je ne sais pas quoi, on demandait à des gens de faire des recherches-actions comme ça, de passer un an avec des agents d’une mission locale pour qu’ils racontent leur métier. On s’apercevait que de mois en mois ils avaient une analyse de plus en plus politique et critique de ce qu’ils faisaient. Mais pas la première fois. La première fois, ils disaient : « Ce que je fais c’est bien, c’est utile ». Au bout de la cinquième ou sixième séance ils disaient : « Soit j’avoue ce que je pense, soit je me jette par la fenêtre ou je démissionne, soit on fait quelque chose ». C’est le temps qui permet ça. Une soirée-débat, c’est la forme la pire qui puisse exister : « Vous êtes pour ou contre le voile ? » Voilà, on se balance quatre clichés et on se casse. Samedi je vais faire une conférence gesticulée sur l’école, et j’espérerais qu’après elle des enseignants constituassent un groupe…
Un intervenant : Bonne idée ! Je suis enseignant, et je proposerai cela (ton projet) pour qu’il soit inscrit dans le » Projet d’établissement » officiel et obligatoire de mon lycée.