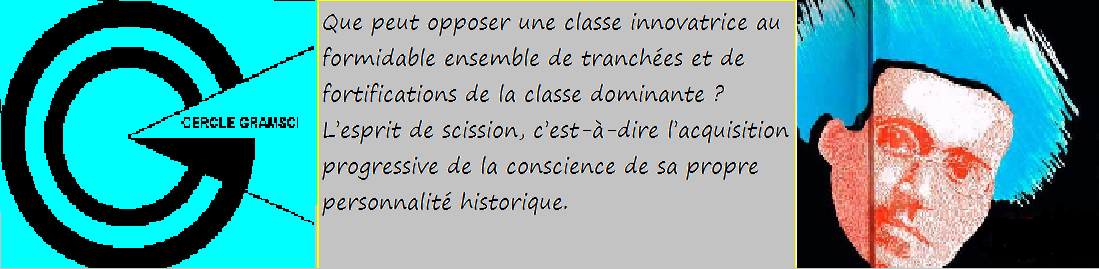Avec Philippe Pignarre
le 26 mai 2005
Philippe Pignarre :
Dans ce livre nous employons des mots comme « sorcellerie », « envoûtement ». On peut croire que ces termes sont utilisés d’une manière symbolique, pour dire des choses qui ne peuvent qu’être » sérieusement » décrites avec d’autres mots. En fait, pas du tout. Nous pensons que ces mots là sont sérieux, et les prenons dans leur sens réel.
La campagne du référendum sur la constitution européenne
Au moment où ce livre a été remis à l’éditeur (novembre 2004), il n’y avait pas de débat sur la constitution européenne. L’expérience de ce référendum a été pour nous (Isabelle Stengers et moi) une bonne surprise. Parce que personne ne s’attendait à ce que les partisans du non soient les premiers à instaurer le débat politique sur la question de l’Europe. Nous devons les remercier de cette inauguration, de cette sortie d’envoûtement.
Avec les partisans du oui, nous sommes en présence d’une espèce d' »union sucrée » (Hollande qui pose à côté de Sarkozy à la Une de Paris Match) proclamant, avec un anti-libéralisme de circonstance, que voter pour la constitution donnerait plus de poids à la France. Ainsi toute la France serait contre le libéralisme. C’est tout de même une situation nouvelle ! Quand l' » union sucrée » parle de divergences, c’est simplement sur les moyens de s’y opposer (au libéralisme).
Alors une théorie apparaît, celle « des gens qui se tirent une balle dans le pied « .
Cette théorie n’est pas nouvelle, rappelons-nous les batailles contre l’OMC à Seattle et Doha. On y entendait le même argument dans la bouche de ceux qui disaient : « Bien sûr, l’OMC c’est pas terrible, mais sans elle ce serait pire ! »
Désormais, chaque fois qu’on n’est pas d’accord avec quelque chose, qu’on veut faire de la politique, on nous signifie de ne plus rien faire, sinon gare aux conséquences. Vous serez punis : » vous aurez les accords bilatéraux ! le traité de Nice ! les délocalisations! « ). Le comble c’est que cette même alliance, entre droite et gauche, a rédigé successivement le traité de Nice et la constitution!
L’industrie pharmaceutique fait la même chose en brandissant le chantage au respect des brevets (par exemple, contre la fabrication des trithérapies à bas prix contre le sida en Afrique), sinon plus de moyens pour la recherche sur » vos » cancers ou maladies cardiovasculaires dans » nos » pays riches !
Cette théorie vise à empêcher que les questions politiques soient déployées, examinées, discutées, prises en charge collectivement. Il y a là un véritable mode d’envoûtement (paralysie, tétanisation) et une organisation de destruction de la politique.
Avec cette campagne tout se décline d’une manière particulièrement obscène. Car on nous dit que l’internationalisme passe en définitive par le capitalisme. Ce serait lui seul qui définirait quel serait le monde commun dans lequel nous devons vivre et réduirait tout opposant en vulgaire nationaliste chauvin.
Dire NON, c’est dire : » Nous ne voulons plus de ces envoûtement là ».
L’envoûtement brisé ou le retour de la politique
Le problème que nous avons essayé de saisir dans ce livre est que le capitalisme est un mode d’organisation qui saisit toutes les forces de créativité pour les retourner contre elles-mêmes. Chacun, dans ses diverses expériences, vit aujourd’hui comme cela le capitalisme. On s’en rend compte jusque dans nos collectifs de lutte où l’on est parfois tétanisé par les alternatives infernales dans lesquelles on est placé.
Nous sommes amenés de plus en plus souvent à employer l’expression, et il ne s’agit plus d’une métaphore : ce monde nous rend malade.
Depuis 20-30 ans, un horizon totalement nouveau de destruction de l’humanité elle même nous est apparu. Autrefois, pour le mouvement socialiste ouvrier, l’enjeu était au pire la barbarie. Cet enjeu de destruction peut se dessiner dans des catastrophes écologiques entraînées par la façon dont les sociétés capitalistes fonctionnent.
Ce monde nous rend malade par des biais très concrets (catastrophes écologiques, mais aussi pollutions insidieuses). Prendre au sérieux » ce monde qui nous rend malade « , nous oblige à réfléchir, d’une part, sur les manières de se protéger contre lui. Et, d’autre part, aux manières d’agir collectivement.
Le rapport maladie/capitalisme a été seulement posé deux fois en 30 ans. D’abord dans le livre en deux volumes de Deleuze et Guattari (vol.1L’Anti-Œdipe – attaque contre la psychanalyse- et vol.2 Mille plateaux – examen du capitalisme-) dont le sous-titre général est Capitalisme et schizophrénie. Quand à Isabelle et moi, nous parlons plutôt de » capitalisme et dépression « , au sens où, aujourd’hui, tous les mécanismes de fonctionnement du capitalisme fabriquent, pour l’individu comme au niveau collectif, de la tristesse, de l’incapacité à agir. C’est une perte d’énergie vitale : celle de faire des choix, de faire de la politique, celle d’être joyeux dans la façon dont nous vivons ou exprimons de la créativité.
Faire de la politique est horriblement difficile dans la situation actuelle. Nous sommes entourés de forces qui font de la politique pour détruire la politique. Ceci a été illustré à Seattle par la formule ironique et pleine de condescendance de Pascal Lamy disant aux pionniers de l’alter mondialisme : » On n’arrête pas les horloges ».
Cela veut dire : le monde va dans un certain sens et il est impossible de s’y opposer. Il n’y a rien à discuter. Cette formule là remplace la politique par la pédagogie. Ainsi de nombreux hommes politiques ne voient dans leur rôle que celui de pédagogue. Ils considèrent, lorsque le peuple n’est pas d’accord, qu’ils se sont mal expliqués sur les contraintes auxquelles notre action est soumise. Cela revient à infantiliser les gens. Mais trop infantiliser le public peut le retourner. Et celui-ci, devenant trop turbulent, peut finir par voter Le Pen.
L’événement de Seattle
Là-bas, aux Etats-Unis même, face à cette infantilisation, quelque chose a été inventé. Cela s’est traduit par le slogan « un autre monde est possible » qui a fait florès et marqué toute une génération.
Ce slogan n’est pas un programme, une vision de la société qu’il faudrait construire, c’est un cri. Il signifie : » Non ! Il n’y a pas de chose dont on ne peut pas discuter ; quelque chose qui avance d’une manière inexorable et contre lequel il n’y aurait rien à faire « . La revendication posée est celle du droit à réinventer de l’espace politique, là où on essaye de supprimer la discussion des problèmes. D’un coup, avec le cri de Seattle, tous ces abandons qu’on nous demandait de faire sont entrés en crise.
Cela correspondait à une période où on a assisté à un retournement très important. Peut-être pour la première fois depuis toujours, un sentiment majoritaire s’est répandu, celui que nos enfants vivront moins bien que nous. Une « torsion » de notre représentation commune est survenue, celle qui consistait à croire au Progrès global.
Depuis les années 80, quand on demande aux gens de faire des sacrifices, sur leur pouvoir d’achat, leur retraite, leur sécurité sociale…, ce n’est jamais au nom d’un progrès à venir dont plus personne ne croit. C’est au nom d’une guerre économique dont la singularité est, dit-on, qu’elle n’aura jamais de fin. Elle sera en permanence alimentée par les différences, par les décalages entre les différentes sociétés, entre les différents niveaux de vie.
On ne pourra pas comprendre le non au référendum en France, son importance, si on ne prend pas en compte tous ces mécanismes qui travaillent notre société depuis un certain temps.
Marx et la fin des prophètes : le temps des jeteurs de sonde
Dans ce parcours avec Isabelle Stengers nous avons beaucoup discuté de capitalisme, donc inévitablement nous avons dû nous situer par rapport à l’héritage du marxisme.
La première chose a été de dire : » Qui sommes-nous pour raconter ça ? ».
Isabelle Stengers est philosophe. Elle a beaucoup travaillé avec les scientifiques (Prigogine), et sur la psychanalyse, l’hypnose, avec Léon Chertok. Elle s’est toujours intéressée aux questions politiques, à travers le rapport science et politique.
Pour ce qui me concerne, j’ai connu une expérience politique en tant que militant à la LCR et fait un parcours au sein de l’industrie pharmaceutique.
Mais tous deux, nous nous trouvions, psychologiquement, émotionnellement, embarqués sur ce bateau de l’alter mondialisme, tel qu’il avait été lancé à Seattle. Bateau qui nous disait de rouvrir le champ des possibles, le terrain de la discussion politique.
Dans cette situation, ce qui nous paraissait intéressant était que personne ne possédait la carte du territoire permettant de dire : » Ce bateau doit aller selon telle route « , comme Marx avait pu le croire.
Le monde tel qu’il se construit, nous rend malade, nous détruit de plus en plus : écologiquement, physiquement, mentalement. Ne sachant pas où il va, nous nous sommes dits, » nous ne serons pas des prophètes « . Le monde commun, autre, ne découlera d’aucune théorie préexistante. Il ne dépendra que des manières dont nous le fabriquerons, manières qui restent aussi en partie à inventer. Il faut donc regarder toutes les expériences où se fabriquent des choses qui donnent envie, tous les groupes qui dessinent des parcours même très limités, souvent locaux, et qui disent : » Tiens ! C’est par là que pourrait passer un monde commun différent « .
Nous nous sommes simplement, modestement, définis comme des » jeteurs de sonde « . Des sondeurs disant : » Attention ! Là il y a des bancs de sable, ici il y a de mauvais courants, le bateau pourrait se fracasser ». Et cela rejoignait une idée qui est une critique, de notre part, de Marx. L’idée que faire de la politique c’est entrer dans un monde où il n’y a plus de garantie, où la seule garantie qui existe est la discussion collective. C’est-à-dire, penser qu’à la différence des religions, on ne peut jamais faire appel à des textes sacrés, à une transcendance qui nous dicte ce qu’il convient de faire.
Pour employer un langage philosophique: tout est immanent. On ne peut pas faire appel à quelque chose venant d’au-dessus (transcendance) qui viendrait régler le problème.
Autrefois, on pouvait confier toute une série de questions aux scientifiques, aux experts. Le monde était finalement divisé en deux (Bruno Latour appelle ceci le » grand partage « ). Il y avait les questions qui relèvent de la nature, dont les scientifiques discutaient entre eux et dont ils étaient les porte-parole. De l’autre côté il y avait le monde politique, celui des questions humaines.
Mais ces dernières années, nous avons appris que cette division-là avait disparu et que faire de la politique aujourd’hui était s’intéresser à toutes les questions.
On ne peut rien confier aux scientifiques. D’abord, chaque fois que se pose une question scientifique intéressante, les experts sont en désaccord entre eux (sur le nucléaire, les OGM, l’avenir des bancs de poissons, le prion et la vache folle .. ).
Toutes ces questions » chaudes » doivent être intégrées dans le débat politique et être discutées comme telles, parce que nous n’avons pas de théorie pour les garantir. Les scientifiques font des expériences différentes et s’en font chacun les porte-parole. Expériences qu’il faut écouter, mais qui doivent être tranchées politiquement, au risque de se tromper et de se corriger. Ce que d’ailleurs permet la politique.
La politique, c’est juger des choses que l’on fait, aux conséquences que cela a. Et la question permanente reste : est-ce que ce que l’on fait permet de déployer un bon ou un mauvais monde commun ?
Au contraire de Marx, qui avait pensé faire une théorie scientifique du capitalisme, nous proposons simplement d’essayer de voir quelle expérience nous faisons du capitalisme. Il nous semble en effet que la manière la plus intelligente d’en parler c’est de se confronter à l’expérience de ce système qui nous met en permanence devant des » alternatives infernales « .
Pourquoi Marx a-t-il construit son œuvre sur le capitalisme en tant que théorie ? Très probablement parce qu’il avait conscience de la capacité de ce système à nous saisir et à nous détruire. Ainsi, en se mettant dans une position de scientifique, cela lui permettait de se mettre à distance, de se protéger de cette réalité redoutable. Et ainsi de pouvoir l’étudier.
L’idée de Marx avec laquelle nous ne sommes pas d’accord est celle de progrès. Marx pensait que le capitalisme fait avancer l’Humanité par le mouvement même de destruction qu’il opère. Par là, il décille les yeux des personnes concernées, tout en nous menant au bord du socialisme.
Mais l’expérience nous montre que les destructions opérées par le capitalisme, des cultures populaires aux conditions du réchauffement de la planète, ne sont pas positives et peuvent même rendre de plus en plus improbable l’arrivée d’un monde meilleur.
Qu’est-ce qu’être de gauche aujourd’hui ?
Gilles Deleuze considérait que ce qui distingue la gauche de la droite, c’est que » la gauche a besoin que les gens pensent « .
Cela signifie qu’il n’existe pas de solution toute faite, que la politique est un monde sans garantie. Tout est fabrication collective, tout est invention. Exemple : comment inventer quelque chose permettant de s’opposer à une situation comme le chômage.
C’est seulement dans l’effort tendu vers la création de solutions qui pourront répondre à une amélioration de ce monde, solutions qui souvent sont locales mais donneront envie à d’autres (effet imitatif), que les alternatives infernales qui se posent à nous seront déserrées.
Capitalisme, marché, biens communs : desserrer les alternatives infernales
Le libéralisme est une construction idéologique mensongère (la concurrence loyale et non faussée). En effet, c’est quand il n’y a pas de marché que le capitalisme fait le plus de profits. L’importance aujourd’hui des brevets, du droit des marques et des copyrights est là pour le montrer.
L’Inde, qui ne respectait pas les brevets, avait fait baisser de 100 fois le prix des trithérapies contre le sida, en utilisant les mécanismes du marché. Mais les firmes pharmaceutiques ont fait appel à l’OMC et imposé leur loi par le chantage : pas de brevet, pas de recherche !
Une association a pourtant relevé le défi et desserré une telle alternative infernale. C’est l’Association Française contre la Myopathie. Sa décision fut de collecter des fonds (Téléthon) et financer ses propres équipes de recherche. Cet exemple a donné envie à Médecins sans Frontière qui a lancé des équipes de chercheurs contre les principaux fléaux sanitaires dans les pays pauvres qui sont le paludisme et les tuberculoses résistantes. Ce qui n’intéresse ni la recherche privée, ni la recherche publique.
Ces associations ont créé une sorte de bien commun d’une nouvelle catégorie, les anciennes étant les terres communales, puis les mutuelles au 19ème siècle. Le système des mutuelles, chacun cotise en fonction des ses ressources et bénéficie en fonction de ses besoins, fut d’ailleurs aussitôt contré par les assurances capitalistes (on achète une garantie). En France le système mutualiste s’est généralisé avec la Sécurité sociale.
Il y a en permanence une lutte entre ceux qui veulent fabriquer des biens communs nouveaux, créant ainsi un autre monde, et ceux qui veulent les détruire.
Ce livre, La Sorcellerie capitaliste veut donner du courage à tous ceux qui, pris dans les alternatives infernales du capitalisme, montrent qu’on peut s’en protéger et être source d’invention.
Le Débat
Un intervenant
Le capitalisme ne rend pas seulement les gens malades. Lui aussi traverse des périodes de maladie, de crise. Dans ces périodes il ne peut plus satisfaire le plus grand nombre et les injustices de ce système ressortent avec vigueur. Cependant vous n’avez pas abordé cet aspect du » mal capitaliste « .
Un intervenant
Je crois, pour ma part, que la crise économique de nos pays est de trop produire, au risque de faire » crever » la planète. Cette richesse, par ailleurs mal répartie et basée sur des besoins sans cesse créés et renouvelés, rend malheureux par frustration.
Aujourd’hui le niveau de vie moyen d’un européen n’est pas » soutenable « . Nous mangeons le capital de la planète.
Cet autre monde possible à inventer consiste à inventer les manières de se décoloniser l’esprit de cette économie, afin de vivre autrement : réinventer des valeurs simples, humaines.
Philippe Pignarre
Je partage vos propos sur l’injustice.
Par contre, nous ne parlons pas de crise du capitalisme.
Contrairement à aujourd’hui, en 1929, le capitalisme traversait bien une crise. Nous ne sommes plus dans cette situation qui fait encore trop référence à l’idée de progrès (après le crise, la reprise ou la révolution).
Aujourd’hui le capitalisme est entré pour une longue période dans une restructuration permanente. Il se déterritorialise de plus en plus rapidement, et en même temps se territorialise (se concentre) dans des situations lui permettant d’échapper au marché (brevets, droit des marques, copyrights, droits d’auteur). Par contre, les salariés sont mis en concurrence mondialement. La crise existe, mais pour les pauvres ou pour le salariat qui devient une condition de moins en moins enviable.
Un intervenant
Je considère que les partis écologistes ne se déterminent pas clairement sur le mouvement de mondialisation conduit par le capitalisme.
Je pense que la Chine, pays non capitaliste, est paradoxalement le meilleur soutien du système monétaire US en lui garantissant son déficit budgétaire abyssal.
J’observe enfin une double et grave dégradation, celle de l’idéologie socialiste qui a perdu tout contenu moral et celle du langage qui connaît aujourd’hui une véritable falsification du sens des mots.
Un intervenant
Je suis intéressé par la volonté des deux auteurs de dénombrer, d’identifier, de décrire l’archipel des tentatives qui, aujourd’hui, permettent l’ouverture de brèches dans les interstices du dispositif social et économique dominant. Je suis cependant préoccupé par l’émiettement de ces alternatives, car le temps nous semble compté.
Un intervenant
Je considère qu’il ne faudrait pas laisser penser que le capitalisme est seul à attenter à la vie sur la planète. Il y a eu le nucléaire soviétique ; il y a aussi l’utilisation massive du charbon en Chine.
Philippe Pignarre
Pour moi, l’écologie n’est absolument pas synonyme de protection de la nature. L’événement que constitue l’écologie politique consiste justement à considérer qu’il ne faut pas laisser isolées la nature et ses questions, ou les confier aux bons soins des experts (des scientifiques), mais au contraire les réintégrer dans le débat politique. La politique ne relève donc pas simplement des questions de la vie des hommes entre eux.
Parler du rapport Chine/USA me suggère une double question : Qu’est-ce que l’Etat laisse faire au capitalisme et qu’est-ce que le capitalisme fait faire à l’Etat. Contrairement à ce que prétendent faussement les théoriciens libéraux du « tout marché », le capitalisme demande toujours plus d’Etat. Pour imposer, par exemple, une législation mondiale sur les brevets, le capitalisme réclame beaucoup d’interventions étatiques, sans cela il serait dans une situation de chaos intolérable.
L’expérience que nous faisons du capitalisme montre que celui-ci est formé d’une multitude de marchés différents, côte à côte, lesquels nécessitent une multitude de lois et de règlements pour fonctionner.
Ce n’est donc pas le marché qui crée sa loi. C’est l’inverse. La loi fait exister le marché. Par exemple pour le marché du médicament, il faut une loi sur les brevets, sur le monopole de la prescription (par les médecins), de la distribution (par les pharmaciens) ; une loi sur les essais cliniques, pour l’autorisation de mise sur le marché, etc.
Il est donc possible de modifier en permanence ces règles. Du coup, cela redonne des marges de manœuvre. Nous en disposons de plus que l’on voudrait nous laisser croire.
Nous devons discuter de la structure de chaque marché, de ses lois et règlements et comment agir sur ces marchés. Cela suppose déployer ces questions et en devenir experts. C’est-à-dire fabriquer de l’expertise collective.
Par exemple, aujourd’hui, l’angle d’attaque contre l’industrie pharmaceutique n’est pas la nationalisation (les capitalistes laisseraient bien à l’Etat ces usines qui les embarrassent), mais la question de brevets. Cette question pollue maintenant jusqu’à la recherche publique, laquelle renonce à sa vocation de publier (et d’enseigner), au profit de la dissimulation de ses recherches, afin de pouvoir, elle aussi, déposer des brevets.
Ainsi la politique ne consiste pas simplement à dénoncer, mais à déployez des expertises et des expérimentations nouvelles.
Un intervenant
Le système capitaliste se situe dans une phase ultime qui ne consiste pas seulement à surproduire et à détruire les biens naturels (la biosphère), mais aussi à détruire, à force de surconsommation et de croissance obsessionnelles, les forces du travail elles-mêmes.
Un intervenant
Je souhaite que vous reveniez sur le couple capitalisme/psychiatrie-psychanalyse.
Un intervenant
Je pense que le capitalisme est effectivement un colosse aux pieds d’argile qui a pu faire croire qu’il offrait une chance de réussite à chacun, et plus généralement à la classe ouvrière. Mais dorénavant Produit Intérieur Brut (PIB) et bien-être vont en se séparant. Quand l’un monte, l’autre commence à décroître.
Aujourd’hui, nous devons arrêter, individuellement et collectivement, de suivre les règles du système, de jouer son jeu, y compris en cherchant à l’affronter. Arrêtons de passer notre vie et notre énergie à le combattre : créons autre chose !
Philippe Pignarre
Le capitalisme produit de l’incapacité à agir, de la tristesse, de la destruction. Nous sommes habitués à séparer d’un côté ce qui dépend du psychologique, de l’individuel et de l’autre côté ce qui relève de la société, de la sociologie, des grands mécanismes. Il y a un chantier à mettre en œuvre sur l’idée de cette séparation.
Nous relatons à la fin de notre livre une expérience de militantes américaines qui nous a beaucoup intéressé. Ces collectifs féministes ont vu venir et ont su affronter sans être écrasés cette énorme contre-offensive néo-conservatrice et religieuse à l’œuvre depuis Reagan. Mieux ! elles ont été capable de faire l’événement à Seattle, et plus récemment d’animer d’immenses manifestation anti-guerre ou quasiment de paralyser la dernière convention républicaine à New York.
Pour pouvoir tenir, leur idée a été de redonner une dimension spirituelle aux batailles qu’elles menaient. Elles ont défini une identité assez forte autour d’un certain nombre de valeurs et de pratiques relevant d’une spiritualité.
Se définissant comme sorcières néo païennes, elles ont enseigné des techniques de la non violence aux manifestants de Seattle. Elles ont fait un lien entre thérapeutique et politique, comme Deleuze et Guattari avaient essayé de le faire entre capitalisme et schizophrénie. Elles ont constitué des groupes où la préoccupation permanente était : quelles techniques met-on en œuvre pour que nos groupes militants soient vivables, non mortifères ; pour qu’on y trouve plaisir et joie à créer ?
Nous avons à apprendre de ces groupes. Nous devons réfléchir aux poisons que le capitalisme diffuse et que nous transposons nous-mêmes dans nos façons de militer, nous faisant perdre en permanence du terrain.
Compte-rendu réalisé par
Francis Juchereau.
Dossier :
POSSIBLE MAIS SORCIER !
Après les « douleurs » du 20ème siècle, l’accouchement néolibéral
La restructuration néo libérale du capital a fini par s’imposer à travers le monde. Cette gigantesque transformation – « la mondialisation » – a réussi à neutraliser, sinon à détruire les modèles de société issus des bouleversements du 20ème siècle : états socialistes, états providence des « acquis sociaux », états en développement du tiers-monde…
La croyance au progrès et l’établissement de la justice sociale firent donc fiasco, sapant les fondements mêmes des organisations qui s’en faisaient les hérauts.
Alors, fallait-il, comme beaucoup, renoncer ? Ou bien attendre des jours meilleurs sans réinterroger en profondeur des conceptions, des pratiques progressistes et anticapitalistes ayant montré leurs limites ou leurs dangers ?
Que font les anticapitalistes ?
Mais les impasses, les dégâts, les catastrophes, les excès permis et commis par la nouvelle donne capitaliste revinrent très rapidement à la surface, ainsi que des luttes y correspondant.
En décembre 1999, à peine dix ans après la chute du mur de Berlin, une nouvelle génération d’activistes nord américains contribuait, dans la rue, à mettre en échec les négociations de l’Organisation Mondiale du Commerce à Seattle au cri de « un autre monde est possible ».
Ces dernières années, les expressions multiples de « mouvements sociaux » très variés (écologistes, humanitaires, pacifistes, alternondialistes, indigènes..) accompagnés d’une renaissance de la contestation anticapitaliste, apparaissent comme les hirondelles d’un printemps dont on n’ose pas trop croire l’arrivée. Et avec juste raison, le capitalisme ayant tellement montré sa formidable puissance d’adaptation, d’insinuation, de neutralisation…
Et puis, quoi mettre « à la place » de « son » marché, de « sa » démocratie … ? Certainement pas « notre » administration, « notre » bureaucratie, « notre » socialisme à la mode de… !
La question de bâtir cet « autre monde possible », sur des bases assurées, vraies, vivantes, « pragmatiques » (*), tenant compte des leçons parfois terribles du passé, reste donc plus que jamais en suspens.
Là est la question (comme dirait William) politique, l’exigence d’invention posée par notre
temps, qu’abordent avec profondeur et précaution Isabelle STENGERS et Philippe PIGNARRE dans leur livre : La SORCELLERIE CAPITALISTE.
(*) Au sens de John Dewey. Voir J. Dewey Le Public et ses problèmes, Farango, 2003
Qui sont ces deux auteurs
Directeur des éditions Les Empêcheurs de penser en rond, ex militant trotskiste, Philippe Pignarre est un ancien cadre de l’industrie pharmaceutique, dont il est devenu un redoutable contempteur, signant des livres comme Le grand secret de l’industrie pharmaceutique, Comment la dépression est devenue une épidémie ou encore Comment sauver (vraiment) la Sécurité sociale (tous aux éditions La Découverte). Ajoutons que P. Pignarre est chargé de cours sur les psychotropes à l’université de Paris VIII.
Chimiste ayant bifurqué vers la philosophie des sciences, auteur de La Nouvelle alliance, en 1979, avec le Prix Nobel de chimie Iljya Prigogine, ou encore de L’invention des sciences modernes ou de Cosmopolitiques, la Belge Isabelle Stengers s’est toujours intéressée aux savoirs minoritaires et dominés : elle a travaillé sur l’hypnose, sur l’usage des drogues, sur la sorcellerie… Elle a aussi une activité militante (Collectif sans ticket de Bruxelles, groupes anti-OGM).
Tous deux partagent une même recherche de pratiques et de savoirs qui n’aboutissent pas à « écraser » ou à disqualifier les autres – que ce soit dans les relations interculturelles ou au sein d’un même mouvement politique.
Un livre original, annonciateur de ce que pourrait être l’intelligence collective
L’originalité de cette « recherche » réside en ce que les deux auteurs ne se sentent aucun droit de propriété intellectuelle sur les idées du texte. Ainsi, I ; Stengers et P. Pignarre avaient décidé de soumettre des versions préliminaires de ce texte à une mise à l’épreuve en les mettant en ligne sur le web (site www.anticapitalisme.net). Ainsi de nombreux internautes intéressés, prenant la balle au bond, ont mis « sous tension » l’écriture de ce texte, annonçant ce que pourrait être à l’avenir une production de l’intelligence collective propre au web.
Pourquoi la sorcellerie ?
Puisant dans leur connaissance de l’ethnopsychiatrie, P. Pigarre et I. Stengers décrivent le capitalisme comme un « système sorcier sans sorcier » : un système qui nous frappe de paralysie et d’impuissance en nous confrontant sans cesse à ce qu’ils appellent des « alternatives infernales » – par exemple : si vous voulez maintenir ou renforcer la protection sociale des salariés, vous accélérez les délocalisations et provoquez la hausse du chômage. Ainsi le capitalisme est « un dispositif que ses victimes activent malgré elles » ; cette définition dit Philippe Pignarre étant bien celle d’un système sorcier.
Ces alternatives infernales qui se présentent à tout moment et partout dans nos vies forment impasse. Il nous faut donc trouver les moyens de sortir de ces trajets désespérants (captures) et avoir prise sur l’Histoire en essayant d’envisager et d’habiter d’une autre manière les situations que tous, comme chacun, traversent.
Mais, pour nos deux auteurs, cette référence à la sorcellerie ne sert pas uniquement d’outil permettant de mieux pénétrer les mystères de la toute puissance capitaliste. Une partie du livre traite également des méthodes de protection idéologiques et militantes réinventées par les sorcières altermondialistes néo païennes, américaines et bien incarnées, elles. Notamment ce que propose une de leurs principales représentantes, Starhawk, dont Isabelle Stengers a traduit un texte de 1982 toujours d’actualité : Femmes, magie et politique (Les Empêcheurs de penser en rond).
La Sorcellerie capitaliste (pratiques de désenvoûtement) n’est pas le nième essai politique sur le monde d’aujourd’hui. Il propose une démarche, des postures susceptibles de délivrer des carcans et des réflexes empoisonnés qui pourraient étouffer la fragile contre-offensive politique apparue au cours de ces dernières années. Là réside son intérêt tout particulier.
AUTOUR DE « LA SORCELLERIE CAPITALISTE » ET DE SES AUTEURS :
APHORISMES et CITATIONS
– A propos de militantisme, de l’engagement, des usagers, des citoyens…
Nous avons à « créer un espace où faire exister le monde qu’on appelle de nos vœux »
« Qui milite limite ». Il s’agit au contraire de créer les conditions d’un engagement en rupture avec la militance sacrificielle : « on y participe non par devoir, mais parce qu’on a du plaisir à se retrouver ; on y veille à ce qu’aucune personnalité ou opinion ne soit écrasée par les autres » (note du rédacteur : c’est exactement la philosophie qui s’applique à l’activité du Cercle depuis qu’il existe)
On lutte à partir de ce qui nous « attache », à partir de notre « milieu » (malade et sa famille dans les associations de malades, par exemple). Les usages fabriquent les attaches. L’usager vaut mieux que le « citoyen » qui est construit à partir d’une fiction (étatique)
« Je crois que les attaches sont ce qui fait devenir. Pas de déterritorialisation sans territoire ».
Il faut opposer au mouvement de masse une multitude de trajets d’apprentissage auxquels on applique une intelligence locale, mais suscitant une dynamique de propagation. Nous croyons à la transmission, à la connexion plutôt qu’à la mobilisation qui est de nature belliciste.
Il s’agit de refuser « la séparation » (au sens de Miguel Benasayag, c’est à dire entre l’homme et la nature, le bien et le mal en nous et à l’extérieur de nous, etc.)
– Capitalisme, politique et besoin que les gens pensent
« Le capitalisme peut-être défini comme ce qui tue la politique, ce qui confisque un choix après l’autre. La politique a été remplacée par une pédagogie mensongère, celle d’« expliquer les contraintes inexorables auxquelles notre action est soumise. Il s’agit d’arracher aux experts les questions qui nous concernent, les remettre en circulation pour en refaire des questions politiques : s’obliger à penser, pas à dénoncer, en prenant garde aux conséquences de ses actes (pragmatisme) ; réussir un double processus de création d’expertise et de mise en politique ».
– Isabelle Stengers : son intérêt pour les « hérétiques » contre les autorités du savoir.
« J’ai été convaincue qu’on ne pouvait penser le rôle des savoirs scientifiques dans la société sans poser la question de l’événement démocratique par excellence que constitue la production active de savoirs par des groupes politiquement engagés. Ces groupes sont seuls capables aujourd’hui d’obliger les scientifiques (experts) à admettre qu’ils ont à prendre part à un problème au lieu de prétendre le définir »
« Je travaille à déconstruire des réflexes conditionnés liés à la notion générale de progrès et le type d’arrogance qui en résulte »
(Il faut) « refuser les destruction ‘bénéfiques’ qui simplifient la vie. Quand on pense, on doit se sentir héritier de toutes ces destructions, cela doit peser. Mais peser c’est obliger à penser, et obliger à penser contre la petite ritournelle du progrès »
Ces pages ont été réalisées par FJ en s’aidant d’extraits d’un article de Mona Cholet et d’une interview d’Isabelle Stengers sur les sites des revues Périphéries et Vacarme :
www.peripheries.net/g-pingsteng.html http://vacarme.eu.org/article 263.html